Entretien avec Jocelyn Benoist (1) : Autour des Eléments de philosophie réaliste
AP : Tu insistes sur la dimension toujours déjà concrète du sens. Par exemple, en interrogeant la question de l’instanciation de la signification chez Husserl. La signification caractérise plutôt une classe d’actes (par exemple la classe des actes qui visent le nombre 4, ou la classe des actes qui visent le rouge). La seule chose qui autorise, à ce titre, à parler de signification, est l’évidence que des actes multiples peuvent bel et bien viser une même chose. Ici, la signification est d’abord opératoire dans la mesure où l’on ne peut la saisir indépendamment de l’acte lui-même (la dimension du sens n’est pas, autrement dit, séparable de la dimension d’acte, mais n’émerge comme telle que réflexivement). L’acte lui-même n’est pas une abstraction ponctuelle : Husserl souligne dans une annexe des Leçons de 1908 sur la signification qu’il y a déjà une temporalité spécifique de la visée signitive – quelque chose du sens se faisant dans la visée signitive. Dans la suite de ta réflexion, on retrouve j’ai l’impression, cette double dimension d’acte et de concrétude : d’acte, dans le côté « manipulatoire » que j’ai évoqué plus haut, de concrétude, parce que tu insistes de plus en plus sur ce qu’il y a de concret, d’affectif, de singulier dans chaque pensée.
JB : Il est certain qu’en un premier temps la notion d’« acte » du signifier a pu représenter pour moi la possibilité d’une lecture pragmatique de la phénoménologie, en correctif du platonisme apparent de la doctrine husserlienne de la signification-objet. On trouve dans cet aspect de mes premières recherches la source de tout ce qui va dans le sens d’une pragmatique dans mon travail. Ce que j’avais en vue, derrière ce motif, c’est l’idée que la signification se construit, qu’elle n’est pas « donnée » une fois pour toutes, et qu’elle dépend de ce qu’on fait en signifiant, de la façon effective de la mettre en œuvre.
Cependant, je dois dire que la notion d’un « acte du signifier » sur lequel la signification se prélèverait par idéalisation me paraît aujourd’hui bien impropre, là où il s’agit de cerner le caractère dynamique de la signification. L’idée d’un tel acte, du reste, à la suite de conversations déjà anciennes avec Jacques Bouveresse, puis Charles Travis, m’est apparue de plus en plus inconsistante. Il me semble qu’il y a une erreur de grammaire à déléguer la signification, qui est une norme, à quelque acte que ce soit. Cela ne veut pas dire que ce qu’on fait – la façon qu’on a d’appliquer la norme – n’ait pas d’incidence sur la signification. Cependant, la vérité est que, s’il n’y a de signification que là où nous faisons quelque chose, et une certaine signification que là où nous faisons certaines choses, il n’y a pas de correspondance biunivoque des significations aux actes que nous accomplissons en signifiant. En réalité, nous pouvons faire toute sorte de choses pour mettre en œuvre une seule et même signification et l’identité d’une signification ne se reflète dans celle d’aucun acte signifiant qui serait supposé lui correspondre absolument. A vrai dire, c’est même un point fondateur du contextualisme radical qu’on ne peut jamais clore a priori la liste des actes possibles correspondant à une signification déterminée : il y a toujours d’autres façons de la mettre en œuvre, de la faire vivre, auxquelles on n’avait pas pensé parce qu’on ne pouvait pas y penser, cela n’avait pas de sens d’y penser.
Réel
AP : Le formalisme frégéen semble jouer un rôle important dans la sortie de l’idéalisme – de ce qu’il reste d’idéalisme latent dans toute position phénoménologique et intentionnaliste. Frege permet, écris-tu, de « briser la flèche intentionnelle » : la question de la vérité relève de normes qui ne sont pas celles de la réalité, mais celles du discours en tant qu’il dit la réalité. Or, la racine même de la distinction n’est pas atteinte lorsqu’on retourne simplement l’idéalisme en définissant des « vérifacteurs » pour ancrer la vérité dans le réel.
JB : J’appelle « idéalisme » toute position qui privilégie le sens sur la réalité et fait comme si celle-ci n’était que sous condition d’être signifiée, au lieu de la traiter pour ce qu’elle est, c’est-à-dire tout à la fois 1) la condition de tout sens et 2) ce qui est, à chaque fois, concerné par le sens.
Un aspect de l’idéalisme est de privilégier le concept de « vérité » sur celui de « réalité » ou de prétendre les identifier. La « vérité » est la propriété d’un certain sens, ou d’un certain type de sens ; elle n’a jamais été une propriété de la réalité, en revanche, qui n’est ni vraie ni fausse, mais est simplement ce qu’elle est. Typiquement, la perception, qui est épreuve du sensible, donc d’une certaine forme d’être dans son ipséité, a la puissance de la réalité, et non de la vérité. Il est important de faire ce genre de distinction. Une part majoritaire de la philosophie moderne, qui la manque, est enlisée dans l’idéalisme et cela au moment même où, défendant les couleurs de « la vérité », elle croit assurer les droits du réalisme.
En fait, ce qu’il faut mesurer, comme Austin a commencé à le faire dans son texte fondateur de 1950 « Truth », c’est le point auquel la contrainte de la réalité pèse sur la vérité : il n’y a pas de vérité qui ne soit ancrée dans le réel, inscrite qu’elle est dans une certaine prise que, en son propre sein, on a construit sur lui et qu’on lui applique localement, toujours de façon située.
D’un autre côté, libérer la réalité de son identification avec la vérité, qui constitue une erreur de catégorie, c’est aussi se donner la possibilité de mieux voir ce en quoi toute vérité, loin d’être la simple collection d’une réalité, suppose la construction d’une prise sur elle. Il est certain que dans l’approche du concept de réalité, quelles que soient les différences importantes qu’il faudrait introduire, la notion frégéenne d’objet : ce qui est juste ce que c’est, l’entité « saturée », a constitué pour moi un modèle. Et inversement, l’idée frégéenne du concept comme fonction, entité insaturée, qui, appliquée à ce qui est purement et simplement, donne une valeur, a été décisive pour ce qui est de définir le lieu de la vérité. Il n’y a de vérité que là où une qualification, ou au minimum une identification sont opérées. Par opposition, les choses, figures de la réalité, sont tout juste « elles-mêmes ». Mais être soi-même n’a jamais constitué une identité – même si est très exactement ce qui est cerné par les identifications que nous mettons en œuvre, là où elles réussissent. Frege m’a ainsi aidé à ménager l’écart entre la vérité et la réalité, tout en pensant l’efficacité de l’une par rapport à l’autre.
Ce que j’ai trouvé dans Frege, c’est ce pas de côté, cette espèce de prise de distance qui est la marque de la mise en œuvre de concepts et qui laisse la chose être ce qu’elle est – qui est donc l’envers du réalisme de cet auteur. Il y avait là la ressource nécessaire pour sortir d’une certaine spécularité, celle qui résulte de la linéarité supposée de la référence intentionnelle, qui file directement à l’objet et fait comme s’il portait lui-même, dans son ipséité, les déterminations qui ne sont en réalité faites que pour saisir cette ipséité. Le péché originel en matière d’épistémologie, c’est de prendre l’efficacité – normative – de la vérité pour une forme d’adéquation métaphysique, comme si c’était la chose même qui se montrait et non nous qui la disions, et d’une certaine façon. Etre réaliste, c’est laisser à ces « façons de dire » leur marge, et les interroger dans les ajustements constitutifs qu’elles opèrent par rapport au réel. Ce n’est pas essayer désespérément de retrouver le « dit » dans le « donné », là où le dit ne définit pour les choses qu’une certaine norme et n’est en rien, dans sa constitutive insaturation, comparable à elles.
Encore une fois, ce qu’il y a apprendre de Frege, qui est une condition fondamentale du réalisme, c’est l’épaisseur du discours, au-delà du mythe de la transparence phénoménologique. Les choses ne parlent pas, décidément. Nous parlons d’elles, ou par rapport à elles, et ce n’est pas du tout la même chose.
D’où mon scepticisme par rapport à toutes les théories des vérifacteurs et autres entités intentionnelles : ces métaphysiques me paraissent en fait avoir acheté l’idéalisme avec la monnaie du réalisme.
AP : Mais – juste en passant – comment te situes-tu par rapport à un projet réaliste plus métaphysique, voire ontologique, comme celui de Claudine Tiercelin qui entend élaborer une métaphysique réaliste à partir des sciences, en montrant que les sciences sont aux prises avec des questions qui ne peuvent être appréhendées et élaborées comme telles que philosophiquement ? Autrement dit, élaborer une métaphysique qui ne relève pas de catégories englobantes, mais qui reprenne et reconceptualise ce que les sciences naturelles rencontrent, dans leur rapport au réel, sans pouvoir le traiter – par exemple des questions comme celle de la causalité descendante en ce qui concerne le problème corps-esprit, ou bien celle des propriétés dispositionnelles ?
JB : Je n’ai pas lu l’ouvrage de Claudine Tiercelin, donc je ne vais pas spéculer sur ce que je ne connais que par ouï-dire.
Je ne peux donc réagir qu’aux termes que tu emploies, pour expliciter ma posture. D’abord, « mon » réalisme – qui est plutôt une analyse de notre concept de réalité qu’une thèse – n’est pas ontologique. L’ontologie, pour moi, c’est la vue de dessus, décontextualisante et qui fait « objet » de tout. Je ne crois pas à l’utilité des catalogues de ce qu’il y a. Où, c’est-à-dire à quelle distance du réel sont-ils faits ? Toujours trop grande, sans nul doute. Ce genre de distance me laisse sceptique, et je ne crois donc pas à la possibilité de l’ontologie.
Je ne souhaite pas non plus élaborer une métaphysique. J’entends une métaphysique comme science. Je pense qu’il y a du métaphysique dans chacune des prises intellectuelles que nous exerçons sur le monde, au sens où on y rencontre toujours plus qu’il n’y est représenté. Il n’y a pas de pensée, en ce sens, qui ne se trouve en situation d’extériorité. Mais qu’il y ait du métaphysique dans chaque pensée ne veut pas dire qu’il y ait forcément un lieu pour quoi que ce soit comme « la métaphysique », en tant que supposée théorie générale d’une telle extériorité.
L’idée d’un travail philosophique – qui pour moi se situe plutôt dans le registre de l’élucidation que de la construction – attentif aux sciences, dans leur développement, m’est éminemment sympathique. Les principaux progrès conceptuels que j’aie pu faire, ces dernières années, ont résulté de l’interaction avec les mathématiciens et les logiciens. Ils m’ont fait comprendre énormément de choses. Cela ne m’empêche pas de penser que seule la philosophie peut apporter un certain type d’élucidation par rapport aux concepts, y compris scientifiques – une élucidation d’un type dont les sciences n’ont en fait pas toujours besoin, et qui a trait à la position de ces concepts spécialisés dans notre champ conceptuel en général.
Après, si je crois bien que la question du réalisme se pose dans les sciences comme par rapport à d’autres discours que nous tenons, je ne suis pas convaincu que l’épistémologie détiendrait à elle seule, ni même nécessairement prioritairement, la clé du réalisme. Je crois qu’il s’agit d’un problème beaucoup plus global, qui commence avec les discours ordinaires, qui constituent autant de façons de s’orienter dans le monde même et de s’y rapporter. De ce point de vue, les sciences représentent certainement une façon de raffiner notre prise sur le monde et de mieux cerner certains aspects de ce que nous appelons « réalité ». Néanmoins, je ne crois pas qu’elles aient le monopole de la réalité. Le sens de la réalité commence avec les discours les plus ordinaires sur les choses. En revanche, l’épistémologie présente un très grand intérêt : celui de nous faire prendre conscience de la complexité de nos prises sur le réel et du point auquel appréhender celui-ci dans les problèmes qu’il nous pose suppose des changements d’échelles et de formats. Il n’y a pas une adresse du réel. Armé de ce savoir, on est amené à jeter un œil différent sur les discours ordinaires.
AP : Si j’ai bien compris, c’est aussi dans la structure d’acte concret, dans la grammaire de cette structure d’acte – pour parler un langage bâtard, que tu vas tenter de déterminer la place du réel. Tout l’intérêt par exemple de la question des indexicaux, est, qu’en elle, se touchent la dimension signitive et la dimension réelle – il y a quelque chose d’irréductiblement réel dans l’indexicalité, qu’il est très difficile de faire entrer dans la structure selon laquelle Husserl pense l’intentionnalité. En un sens sans doute, l’indexical ou l’ostensif n’ont pas à être compris selon leur sens, mais selon un « faire » au sein duquel je suis tout de suite. On peut traiter la question des objets non-existants selon le même schéma. Au lieu de se demander quel est leur statut, on demandera par exemple dans quel contexte et pourquoi je vais être amené à dire que l’actuel roi de France est chauve, et ce que je fais quand je dis ça… C’est bien plus généralement dans cette thématique des actes de langage – à travers les analyses d’Austin, donc – que paraît s’esquisser le réalisme « contextualiste ».
JB : Disons qu’initialement l’idée d’acte – idée par rapport à laquelle je me montrerais aujourd’hui extrêmement réservé : que veut dire d’appeler l’intentionalité, qui renvoie à des formats de prise sur les choses, un acte ? – m’a paru synonyme d’une certaine effectivité. C’est en tout cas mon désir de replacer l’analyse sur ce terrain « effectif » qui m’a conduit à m’intéresser à cet aspect de la construction husserlienne. Dans l’idée d’acte, j’ai cherché une figure de la « performance » et de l’inscription effective du sens. Mais là encore, ce n’est pas parce que le sens n’est pas dissociable de la façon dont on parle effectivement, renvoie au rapport normatif au réel qui est interne au fait même que l’on prononce tels ou tels mots à tel ou tel moment dans tel ou tel contexte, que pour autant cela aurait un sens de dire que le sens « arriverait ». Je ne crois plus aujourd’hui qu’il y ait des actes du sens. Une telle représentation est fondée sur une confusion conceptuelle. Le sens est plutôt toujours ce qu’on attribue aux mots tels qu’ils sont utilisés dans certains actes linguistiques.
En revanche, il y a des actes de langage, bien réels, et la considération de ceux-ci nous reconduit assurément sur le terrain de réalité. Ainsi, ce que j’ai trouvé dans la tradition austinienne, c’est en effet le réalisme, comme thèse de la réalité en amont du sens, à son principe et non seulement en face de lui comme son objet. C’est à ce titre que le modèle des actes de langage est si déterminant pour moi, y compris en vue de réattaquer les concepts fondamentaux de la philosophie de l’esprit.
Il est tout à fait exact que, pendant quelques années, la question des indexicaux m’a servi, comme à d’autres, à réarrimer le sens à la réalité, en mettant en avant ce qu’un certain type d’analyse répertorierait comme un cas particulier où le sens dépendrait directement de la réalité à laquelle il construit une référence ou, ce n’est pas tout à fait la même chose, d’un contact avec celle-ci. Puis, de plus en plus, je me suis dit que le problème auquel le cas des indexicaux était censé constituer une réponse : celui de l’apparent décrochage de principe du sens par rapport à la réalité, était un faux problème. En fait, il n’y a pas de sens qui ne définisse un certain rapport avec la réalité mais aussi qui ne soit fondé sur un tel rapport. Pas de sens effectif qui ne « cible », en quelque sorte, la réalité qu’il norme – et contre un certain modèle phénoménologique de la visée, il faut rappeler que viser est une forme de relation réelle, qui suppose qu’on soit déjà en relation avec la chose par rapport à laquelle on va définir une certaine attitude, ayant ses propres conditions de succès et d’échec. Un temps, j’ai eu l’idée que ce fait devait nous incliner à adopter une interprétation uniformément indexicale des expressions et de leur relation à cette portion de réalité qu’à chaque fois leur usage concret constitue en leur objet. Je pense maintenant que c’est inutile : le rapport à la réalité à laquelle il y a référence – ou toute autre forme de renvoi normé – est de toute façon inscrit dans la notion d’usage. Il n’y a pas besoin de traiter toute expression utilisée comme un indexical pour l’assurer. Il n’y a là, de toute façon, rien à assurer. Quelque chose à organiser, en revanche. L’indexicalité en est une modalité parmi d’autres.
AP : Le sens que je peux viser dépend dans une certaine mesure des objets auxquels j’ai affaire – dans une certaine mesure, sachant que le terme est mal choisi ici. L’exemple de la distinction de l’écureuil européen et de l’écureuil américain évoqué dans Les limites de l’intentionalité est parlant : il montre bien comment la contextualisation relire la part « métaphysique » qu’il peut y avoir dans l’externalisme sémantique. C’est à partir d’un contexte et au sein de ce contexte que s’exerce l’intentionnalité. Un phénoménologue dirait : le contexte est le sol primitif d’où comprendre l’intentionnalité, mais le contexte est plutôt une norme descriptive qui prend acte de ce dire, ou « viser », ou « percevoir », c’est toujours plus que dire, viser, percevoir : c’est le faire au sein du réel, ce qu’il ne veut pas dire qu’il y ait plus dans ce qui est dit, visé, perçu, mais que le plus souvent l’acte de dire, de viser, de percevoir impliquent autre chose que leur contenu…
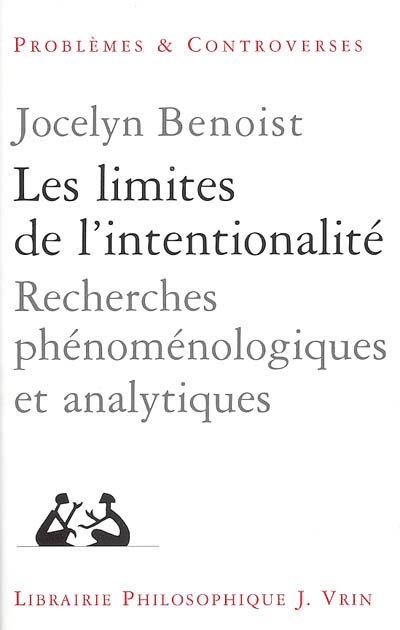
JB : Dans ma révolte contre l’internalisme intentionaliste, j’ai pu, au départ, être tenté par l’externalisme sémantique pur et dur, métaphysique. En partie sous l’influence de McDowell – avec lequel je continue pourtant d’être en désaccord profond, car à mes yeux il manque complètement le sens de la notion de « réalité » et nous propose au fond une sorte de phénoménologie à l’envers, « conceptualiste » – j’ai mis de l’eau dans mon vin, et suis revenu à une forme d’intentionalisme externaliste, ou d’externalisme modéré. Ce à quoi renvoie ou non mon énoncé est bien, en un sens, mesuré par son « sens » : que pourrait être le sens, sinon ce qui mesure cela ? Mais 1) ce sens n’est pas un « contenu » qui serait indépendant du contexte et qui serait comme tel représentable, il faut renoncer à toute théorie du contenu et considérer plutôt la façon dont on applique effectivement les mots dans certaines situations et comment on juge ces performances 2) on ne peut jamais préjuger de la solidité de ce sens confronté à une situation nouvelle : il peut s’avérer soit beaucoup plus robuste soit beaucoup plus friable qu’on ne l’aurait pensé ; c’est-à-dire : cela dépendra essentiellement de ce que l’on fera pour le maintenir ou non. S’il y a une internalité du sens, c’est bien une internalité à ce qu’on fait, aux discours effectifs que nous tenons. Mais ceux-ci, comme tout faire, mettent constamment en jeu des conditions qui ne sont pas représentées en eux, et qui, pourtant, les constituent comme tels, sont une part essentielle d’eux-mêmes. Et, d’autre part, comme tout faire, ils ont une dimension constitutive d’ouverture : là où on procède d’une certaine manière, on peut toujours faire autre chose qui modifie la signification et la valeur de ce qu’on faisait jusque-là. Ce sens inhérent à nos façons de parler telles qu’elles s’appliquent concrètement à des cas, en fonction duquel il faut évaluer si le cas présent est bien tel que tel mot ou expression puisse y référer ou non, est par bien des côtés en construction, ou en tout cas ses limites demeurent très souvent ouvertes. Cela ne veut pas dire qu’il n’en ait pas. Mais ce n’est que dans l’usage effectif qu’elles se décident, loin qu’elles puissent peser comme une contrainte a priori sur cet usage.
AP : D’où l’importance de prendre en considération le champ de forces au sein duquel se détermine cette normativité – la prise en compte en particulier de la réalité sociale. Pierre Bourdieu est peu évoqué, mais Concepts semble un livre très « Bourdieu Compatible » (d’ailleurs, quand on pense que la première thèse entamée par Bourdieu portait sur les structures immanentes de la temporalité chez Husserl, il y a dans tout ce parcours un certain écho).

JB : Oui, la fin de Concepts (2010) fait signe en direction de Bourdieu. Son immanentisme m’a toujours séduit, même si, quand j’étais plus jeune, et plus marxiste que je ne le suis, je ne pouvais m’empêcher de le soupçonner d’idéalisme – il faisait le corps trop symbolique à mon goût – sans doute du fait même de ce reliquat d’imprégnation phénoménologique qui subsiste chez lui et dont le statut n’est pas toujours clair. Maintenant, je serais beaucoup plus sensible à ce qui constitue le cœur de la théorie : la critique de la domination et le maintien de la notion de force, que cette critique suppose et sans laquelle elle est inintelligible. Ce qui est fascinant, c’est la capacité de Bourdieu à penser l’espace social – la réalité sociale – comme un champ de forces qui ne s’exercent pas de l’extérieur sur les pensées, mais qui les structurent de l’intérieur – ce qui suppose essentiellement que celles-ci ne soient pas pures « représentations ». Bourdieu n’a pas reculé devant la violence du social, il ne l’a pas conçue comme quelque chose qui arriverait de l’extérieur à la pensée, comme une catastrophe, mais comme quelque chose qu’elle porte avec elle, comme sa réalité. C’est grand.
AP : Tu as pu écrire que tu te situais au plus près de Merleau-Ponty en décrivant cette forme d’être-dans (dans Sens et signification) mais en se situant sur l’autre bord – celui de l’y-être, justement. . Pas la chair, mais « ce que ça fait d’être « au réel » – d’avoir le réel, d’y être. En langage phénoménologique, on pourrait dire qu’il s’agit de prendre au sérieux l’idée d’attitude naturelle – d’interpréter de façon réaliste l’attitude naturelle – d’admettre son caractère irréductible et premier. Mais peu à peu, cet horizon phénoménologique semble là encore s’estomper : l’attitude naturelle, la chair sont un peu des façons de recoudre une béance qui a d’abord été ouverte alors qu’il s’agit pour toi de ne plus admettre à la base de distance par rapport au réel.
JB : Merleau-Ponty est probablement le phénoménologue qui est allé le plus loin dans l’exploration des limites de l’intentionalité. A son crédit il faut mettre au premier chef l’idée que la perception n’est pas une connaissance, et qu’elle a plus à voir avec la réalité qu’avec la vérité (voir Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques). Toutefois, Merleau-Ponty reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre. Il interprète, tout de même, en dernier ressort, la perception comme une forme d’intentionalité : passive, primordiale, non véritative, mais tout de même intentionnelle. C’est comme s’il y avait une double norme, celle de la perception et celle du concept. Ce qui met mal à l’aise dans une telle position, c’est le fonctionnement, à l’étage inférieur, de quelque chose comme une norme qui n’en serait pas vraiment une. Il faut savoir quel langage on parle. La perception n’a pas de normes, elle a des structures, et ce n’est pas la même chose. Après, ces structures peuvent, sous certaines conditions, servir de normes, mais cela suppose qu’on en ait fait des concepts, la construction de quelque chose comme des concepts perceptuels. Il n’y a pas d’intentionalité non conceptuelle. Non pas parce qu’il y aurait là une impossibilité objective, comme si quelque chose d’envisageable était exclu, mais parce que nous n’en avons pas besoin. Raisonner dans ces termes, c’est en fait, tout en s’en défendant, encore mesurer la perception à ce qu’elle n’est pas et manquer le point auquel elle détermine les termes mêmes du problème qu’on lui pose et que cela n’a donc pas de sens de lui poser.
Quant à ton diagnostic final : « l’attitude naturelle, la chair sont un peu des façons de recoudre une béance qui a d’abord été ouverte alors qu’il s’agit pour toi de ne plus admettre à la base de distance par rapport au réel », oui, il est tout à fait exact et caractérise parfaitement ma position. Toutes ces notions ont l’inconvénient de mettre à distance un réel qu’elles supposent, pour dire qu’il n’est pas à distance, ce dont il est tout de même très étrange que nous ayons à le dire. Dans quelle situation devons-nous nous mettre, pour avoir besoin de dire ce genre de choses ? Il me paraît plus utile d’examiner, comme a pu le faire Lévi-Strauss, ce que nous faisons de ce réel. Plutôt que « comment le sensible nous est-il donné ? » (comme si le dire « donné » en était une caractérisation intrinsèquement adéquate), « que faisons-nous du sensible ? ».
AP : Mais on pourrait peut-être dire aussi, en faveur de Merleau-Ponty, et de façon un peu hégéliennne ici, qu’on a besoin de séparer une première fois des dimensions, même si c’est un effet du langage, pour prendre toute la mesure de ce qu’il y a dans ce «cela va de soi». D’une certaine façon, dès qu’on parle, dès que notre rapport à l’expérience est structuré par l’autre qu’est le langage, ce qui est simplement là paraît problématique. Cela va de soi d’un certain point de vue – il ne pourrait pas en être autrement, mais d’un autre point de vue, c’est «extraordinaire». Le «je» est d’un côté non problématique, de l’autre vertigineux – en tant qu’il est forcément celui-là : il y a quelque chose de fou à être « celui qu’on est », à voir « ce qu’on voit », même si c’est une folie qui vient d’une distorsion engendrée par le langage. Il y a peut-être chez Merleau-Ponty, dans la façon même – en particulier dans Le visible et l’invisible – dont il déploie le langage – aussi la prise en compte de cette double perspective.
JB : Bien sûr, c’est là que nous divergeons. Il est intéressant que tu adoptes spontanément une référence hégélienne pour caractériser le procédé. Je me suis toujours méfié de cet auteur, et précisément pour cette raison. Dépasser le point de vue de la conscience subjective ? Fort bien, mais pourquoi faudrait-il donc en partir et y aurait-il donc lieu de le « dépasser » ? Je suis toujours plus frappé par ce qu’il y a d’intra-kantien ou disons, de façon plus consensuelle, d’intrinsèquement post-kantien chez Hegel. Il s’agit de surmonter le point de vue kantien. Mais c’est le point de départ qui ne va pas !
On peut toujours dire qu’il s’agit d’une reconstruction. Toute « phénoménologie » serait de cet ordre : la mise en scène de la phénoménalisation comme un artifice pour dire son contraire, le fait que les choses sont simplement là. Cependant, je ne comprends pas la nécessité d’un tel scénario. Il n’y a aucun miracle à ce que les choses soient ce qu’elles soient. Il n’y a pas d’« énigme du monde ». Les miracles commencent là où on essaie de faire quelque chose des choses et/ou d’adopter une attitude par rapport à elles, et où il se met donc à y avoir un sens pour la surprise. Quant aux « énigmes », elles résident toujours dans nos doutes par rapport à nos façons de faire et dans une certaine forme d’indécision, là où nous adoptons un certain procédé mais sans y être vraiment, tout en souhaitant qu’il soit autre – ce qui, certainement, est une possibilité de notre liberté. Alors, les choses paraissent énigmatiques.
Quant au « cela va de soi » de la réalité, est-il vrai qu’il y ait tant que cela en lui ? Je veux dire : cela a-t-il un sens de dire qu’il y a là beaucoup ou peu ? Il y a ce qu’il y a, aurais-je tendance à dire. Le « beaucoup » ou le « peu », encore une fois, dépendent essentiellement de ce qu’on fait : suivant ce qu’on en fait, une même réalité paraîtra beaucoup ou peu. Mais beaucoup et peu ne sont pas des catégories de la réalité.
AP : Si l’avoir est la modalité descriptive appropriée alors il épuise ce qu’on peut dire de ce qu’il y a. Parler de contact, c’est déjà obscurcir l’avoir – lester la grammaire de l’il y a » d’autre chose. Mais cette idée de contact me paraît révéler quelque chose de fondamental dans la grammaire de l’ « il y a » : que celle-ci implique un sujet. Non un sujet conscient, un sujet percevant, pas un sujet qui « a ce qu’il y a », ou « a ce qu’il a », mais une dimension subjective – un sujet de l’action, un sujet qui manipule, qui choisit…A la fois un sujet formel – comme chez Lacan – et un sujet concret, pourrait-on dire.
JB : Je laisserai de côté la référence à Lacan, sur laquelle je ne peux pas me prononcer ici.
Ce qu’il m’arrive d’appeler « avoir » – toujours en contraste avec « représenter » ou « viser », ou « recevoir » comme « donné » – implique-t-il un sujet ? Je n’en suis pas sûr. Son corrélat est de l’ordre du « on » et non un sujet personnel. Il est l’avoir qu’on entend dans des expressions du type « Voyons donc ce qu’on a là ! », cet avoir qui renvoie au simple être des choses dans leur indifférence. Notre expérience elle-même, en tant qu’expérience, a cette qualité du réel, de n’être jamais que ce qu’elle est. C’est dire qu’elle n’est pas spécialement « subjective ». Tout simplement, elle est.
En revanche, il me semble – et c’est sans doute là le principal glissement par rapport à ma position initiale – que la question de la subjectivité commence là où on n’est pas seulement, mais où on fait quelque chose. Cela ne signifie pas que la subjectivité se réduise à une dimension d’activité. Bien au contraire, la passivité qui constitue l’envers de toute action demeure un élément essentiel de définition de toute subjectivité. Mais la notion de sujet n’est pas séparable du fait de se placer sous une règle, et/ou du rapport problématique entretenu par l’agent, en aval, avec elle. Il n’y a pas de sujet que là où je fais quelque chose et où cela me fait quelque chose. C’est dire que le problème de la subjectivité n’est pas dissociable de celui des dispositifs normatifs que nous mettons en œuvre, c’est-à-dire aussi toujours sous lesquels nous nous plaçons, dans nos façons d’exercer une prise sur les choses. Je ne crois toujours pas que le sujet soit sujet du sens – en un certain sens, celui-ci le précède, ce qu’on appelle langage est toujours déjà là, et le sujet ne peut exister que d’entrer dans un jeu de sens ou un autre, qu’il n’a pas fait. Mais je continue de penser que la subjectivité constitue comme un reste du sens : comme la facticité de l’opérateur de ces opérations en vertu desquelles il y a sens. Cela n’a pas de sens de dire en général que les choses nous « apparaissent », mais ce qui « apparaît » en revanche, ce qui a une existence purement phénoménale, c’est l’usager, tel que les fonctionnements et disfonctionnements des systèmes normatifs en définissent la place. C’est la question sur laquelle s’achèvent les Eléments de Philosophie Réaliste. Je n’ai donc pas renoncé à mes premières interrogations sur la subjectivité. Elles se sont simplement déplacées, du projet d’une phénoménologie de la subjectivité – selon une forme de redondance que je ne pouvais apercevoir tant que j’étais dans la phénoménologie – au simple constat de la subjectivité de la phénoménologie. Ce n’est que sur un arrière-plan réaliste qui n’a rien de phénoménologique que cette subjectivité devient visible.
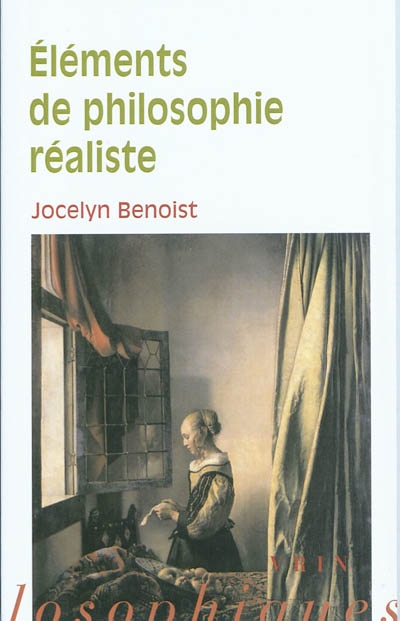
AP : Juste une dernière remarque sous forme de proposition. Tu dis toi-même à plusieurs reprises que s’il est difficile de fonder la phénoménologie comme discipline, il y a indiscutablement des problèmes phénoménologiques – preuves s’il est besoin, la fécondité de toutes les descriptions de Husserl, tout ce qui a été effectivement rencontré et mis à jour – par exemple, en ce qui concerne la genèse de la spatialité – quel que soit son statut. La pensée étant concrète et chargée d’affection, elle est sensible pour elle-même – elle rencontre concrètement ses questions.
On pourrait interpréter la phénoménologie comme une phénoménologie fiction – qui aurait un peu le statut d’un ensemble d’exercices par lesquels la pensée se met en état de « rencontrer » l’expérience avec le plus de variété et de subtilité possible. Alors, on ne dirait pas que « tout est phénomène » mais que tout peut être considéré comme phénomène – constitué comme phénomène et envisagé comme s’il était phénomène.
Il y a quelque chose de ça, il me semble, dans la phénoménologie de Richir. Ce qu’on peut remarquer d’abord, c’est que Richir: contrairement à Marion, ne propose pas de phénoménologie de l’extériorité : pour lui, il n’y a pas de sens à parler d’une expérience de l’extériorité : l’extériorité est une condition de possibilité de l’expérience, elle est une contrainte structurelle que doit intégrer la thématisation du phénomène – en l’occurrence, en interdisant que quoi que ce soit puisse être considéré comme « donné » – tirant son contenu de soi-même.
La phénoménologie en cette acception produit des concepts permettant de s’orienter dans la masse de l’expérience, d’y déceler des configurations, des niveaux – un peu comme les mathématiques vont thématiser l’espace à différents niveaux (topologique, différentielle, métrique, etc.) Richir parle explicitement – dans l’entretien que j’ai mené avec lui ici et ici – d’un élargissement de la conception husserlienne des tout phénoménologiques et de leurs constituants, et de la phénoménologie comme décomposition des phénomènes en paramètres, en facteurs, en dimensions, qui sont ensuite à leur tour considérés comme des phénomènes et « désintriqués » de la même façon. Il s’agit ainsi en quelque sorte de « donner la parole » au plus possible de formes, d’armer la philosophie pour qu’elle puisse avoir accès à la plus grande diversité de ce qui se fait dans l’expérience – et à ce que l’expérience fait avec le réel à ses différents niveaux.
Cette façon de faire procède sur deux axes : l’axe d’une réduction hyperbolique, cartésienne, à l’issue de laquelle on fait sauter rigoureusement toute certitude sinon celle qu’il y a des phénomènes, et l’axe d’une archéologie, qui part des configurations qui paraissent les plus évidentes.
JB : Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question-proposition.
A un certain niveau, je suis assez séduit par ton idée de phénoménologie-fiction qui permet de « voir quelque chose ». Ce qu’il faut retenir de la phénoménologie, à mon sens, c’est sa capacité de saisir la pensée dans son incarnation, sa promotion, quand elle est à son meilleur, de l’exemplification comme méthode fondamentale en philosophie. Plutôt que la notion de « fiction », ce serait celle de « dramatisation » au sens littéral de « mise en drame » qui me viendrait en premier lieu à l’esprit, sans doute du fait de Levinas qui, avec son concept d’« intrigue », a inventé une façon de maintenir l’impératif fondamental de la phénoménologie (de « retour aux choses mêmes »), tout en le déplaçant et en le faisant en un sens échapper à la phénoménologie, reconduisant l’interrogation sur le terrain réel, qui est celui du discours et de sa capacité à répondre entre nous du monde. Cependant beaucoup de choses de ce que tu dis de ta possible ‘phenomenology revisited’ me paraissent très justes. Ma perplexité va seulement à la nécessité d’une opération aussi indirecte. Comme si l’immédiateté était toujours à construire. Aussi, certainement, l’est-elle. Comment ne le serait-elle pas ? C’est le raisonnement en termes d’immédiateté (sous un nom de remplacement ou un autre) qui ne va pas, car il revient à toujours se placer du point de vue d’une pensée de la médiation, de l’accès aux choses : comme si nous avions à acquérir celles-ci, alors que la vérité est qu’au fond le genre de situation qui nous projette initialement dans la philosophie est plutôt celle où elles sont là et nous ne savons littéralement pas quoi en faire. C’est ce qui nous invite, originellement, à la réflexion sur les différentes formes de faire, et sur ce que veut dire « faire », en général.
Pour Marc Richir, sur lequel je sais que tu as travaillé et dont tu présentes la pensée avec une grande clarté, je ne me prononcerai pas car je connais très mal son œuvre. Il y a une vingtaine d’années, j’ai lu certains textes brefs, que, dans le contexte phénoménologique de l’époque, j’ai trouvés extrêmement éclairants et qui, philosophiquement, m’avaient intéressé. J’ai eu plus de mal avec les livres, qui déploient un univers assez interne, avec un langage qui leur est propre. Je suis sans doute maintenant trop éloigné de ce style philosophique pour comprendre ce dont il s’agit. Il est cependant possible que, par d’autres voies, il ait en vue les mêmes problèmes que moi. A priori, encore une fois, c’est le point de départ – l’idée de phénoménalité – qui, là encore, me gênerait. Mais il y a évidemment bien des façons de la mettre en jeu. Ce que je ne saurais accorder, quoi qu’il en soit, c’est la « réduction hyperbolique, cartésienne ».








