Renaud Barbaras a récemment publié un ouvrage intitulé Métaphysique du sentiment qui fut recensé ici-même sur Actu-Philosophia. Livre important en-soi en même temps que jalon décisif de l’œuvre de son auteur, il appelait un certain nombre de développements qu’offre à méditer Le désir et le monde1 qui analyse en détail bien des éléments contenus dans Métaphysique du sentiment. Nous avons donc souhaité interroger Renaud Barbaras autour d’un certain nombre de questions que soulèvent ses écrits, et le remercions grandement de son amabilité autant que de sa disponibilité.
Propos recueillis par Thibaut Gress
A : Genèse d’une réflexion sur le désir : le rôle de Merleau-Ponty
Actu-Philosophia : Une fois n’est pas coutume, j’aimerais partir, si vous me le permettez, d’un autre ouvrage que celui que vous venez de publier afin de lancer l’entretien. Dans la préface de Signes, Merleau-Ponty – que vous connaissez mieux que quiconque – propose une réflexion sur la vision du corps affranchie du joug de la conscience ; décrivant deux corps en train de se regarder, il oppose l’analyse de la conscience qui y verrait deux ego essayant de se dominer l’un l’autre à la description authentiquement phénoménologique mettant en scène deux corps se faisant face et générant une sorte de champ commun neutralisant le rôle de la conscience. Or, au détour de cette analyse, Merleau-Ponty dit de la vision qu’elle
« esquisse ce que le désir accomplit quand il expulse deux « pensées » vers cette ligne de feu entre elles, cette brûlante surface, où elles cherchent un accomplissement qui soit le même identiquement pour elles deux, comme le monde sensible est à tous. »2
Bien que le désir n’y soit pas thématisé comme tel, il apparaît comme étant doté d’un sens tout à fait anti-hégélien : loin d’être désir de reconnaissance par la médiation d’une lutte et d’une domination, il est ce par quoi deux corps construisent une sorte de terrain commun ou de communauté où s’accordent justement les désirs, tout comme par la vision se révèle la communauté indécelable de deux corps voyants.
Nous voyons dans cette comparaison que le désir est ce par quoi le sujet se rapporte à son propre corps en sa profondeur, et ce à partir de la profondeur de l’autre corps ou, pour le dire avec Merleau-Ponty, à partir de l’autre chair. De là ma première question : est-ce chez Merleau-Ponty que vous avez trouvé matière à réflexion sur le désir pour thématiser ce qui n’était qu’embryonnaire chez lui ?
Renaud Barbaras : En réalité, il est très peu question du désir chez Merleau-Ponty, sinon de manière incidente. Cependant, on peut distinguer deux types d’occurrences : il y a les textes, très rares, où Merleau-Ponty esquisse l’idée d’une identité de la perception et du désir, ou plutôt d’une détermination de l’intentionnalité perceptive comme désir. Il y a, d’autre part, les textes, tout aussi rares, concernant le rapport érotique à l’autre. Si on laisse de côté le chapitre sur « Le corps comme être sexué » dans la Phénoménologie de la perception, qui en passe par l’intentionnalité affective pour mettre en évidence le caractère non-objectivant de l’intentionnalité perceptive, on trouve deux textes : celui que vous citez et un autre, plus explicite à mon sens, dans Le visible et l’invisible :
« Pour la première fois, le corps ne s’accouple plus au monde, il enlace un autre corps, [s’y] appliquant soigneusement de toute son étendue, dessinant inlassablement de ses mains l’étrange statue qui donne à son tour tout ce qu’elle reçoit, perdu hors du monde et des buts, fasciné par l’unique occupation de flotter dans l’Être avec une autre vie, de se faire le dehors de son dedans et le dedans de son dehors. Et dès lors, mouvement, toucher, vision, s’appliquant l’un à l’autre et à eux-mêmes, remontent vers leur source et, dans le travail patient et silencieux du désir, commence le paradoxe de l’expression » (p. 189).
En effet, comme vous le soulignez, la perspective développée ici est aux antipodes de celle de Hegel. On trouve l’idée selon laquelle le désir est la première modalité d’un dépassement de l’insularité subjective et donc, au moins négativement puisque je suis comme décentré de moi-même en une quasi-coïncidence avec l’autre, le premier accès au sens en son universalité. Autrement dit, en permettant une sorte de décrochement vis-à-vis du rapport perceptif au monde, le désir est bien la première modalité de l’expression, comme le premier pas vers l’idéalité. La relation érotique est donc déjà une sorte de relation interrogative en laquelle, par la médiation de l’autre, s’amorce une forme de quête de l’origine et du sens. En cela, Merleau-Ponty s’inscrit dans la ligne du Husserl de Universale Teleologie, qu’il cite d’ailleurs, texte dans lequel Husserl comprend la pulsion (Trieb) comme une poussée vers l’universel par la médiation de l’autre : elle est préfiguration plutôt que négation de la vie rationnelle.
Il ne fait pas de doute que je m’inscris résolument dans cette perspective, pour laquelle le sens du désir sexuel n’est pas sexuel, pour laquelle c’est tout autre chose qui s’y joue et qui concerne mon rapport oiginaire au monde. J’ai toujours vu dans le désir une quête qui transcendait l’autre comme autre empirique, comme une sorte d’accentuation de ma présence au monde par la médiation de celui-ci. Au fond, comme le soutient Merleau-Ponty contre Husserl, le premier autre c’est le monde et non autrui, autre qui contient tous les autres et rend possible mon rapport à eux. Il s’ensuit que tout rapport aux autres engage nécessairement mon rapport au monde, que m’approcher d’autrui dans le désir c’est aussi m’approcher du monde que nous avons en commun. Peut-être même faudrait-il dire que le monde n’est pas le premier autre mais le seul, au sens où les autres (autrui) sont de mon côté, comme des extensions de moi-même et où ce qu’ils possèdent d’altérité plonge donc dans celle du monde. Dès lors, il y va toujours nécessairement du monde dans mon rapport aux autres, en tout cas dans ce rapport privilégié par lequel je cherche à le rejoindre là où il est et que l’on nomme désir. J’ai été très tôt frappé par ces textes de Merleau-Ponty mais c’est seulement à la faveur du développement récent de ma propre perspective sur le désir comme tel que je me suis aperçu que je m’inscrivais en effet dans la même ligne.
AP : Une remarque m’a semblé très intéressante dans vos écrits consacrés à Merleau-Ponty. A travers une analyse serrée de la notion de réduction phénoménologique chez celui-ci, et de la possibilité husserlienne de saisir les étants en leur totalité afin de les néantiser pour révéler l’apparaître, vous montrez très bien le refus merleau-pontien de ramener celui-ci à la synthèse de la conscience. Mais alors qu’est-ce qu’un sujet s’il n’est pas le fondement de l’apparaître ? C’est, écrivez-vous à partir de Merleau-Ponty, « la négativité comme mode d’être »3 Et comme pour expliciter ce résultat, vous émettez l’hypothèse suivante : peut-être faut-il passer par le désir pour ouvrir l’horizon à titre de présence non-objectivable du monde, ce qui revient à dire qu’il n’y aurait de monde que pour un être capable de désir. N’a-t-on pas, dans cette hypothèse destinée à rendre compte d’une difficulté merleau-pontienne, déjà présents les éléments fondamentaux qui détermineront votre analyse du désir ?
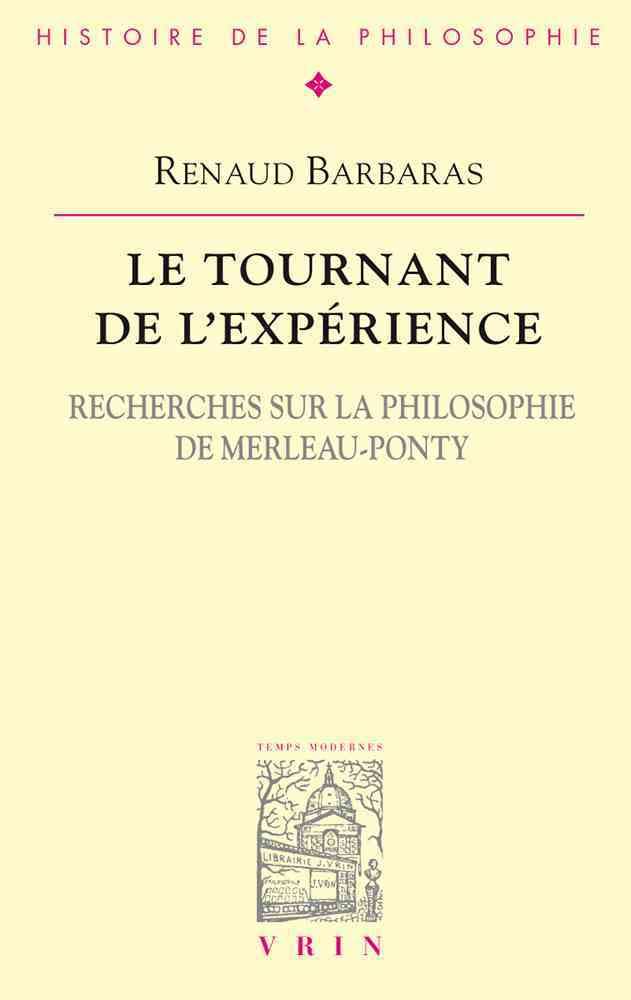
RB : Vous avez tout à fait raison. Après avoir achevé ma thèse sur Merleau-Ponty, il y a maintenant bien longtemps, et en prenant un peu de champ par rapport à elle, j’ai eu très vite la conviction que, par delà les circonstances empiriques, sa pensée souffrait d’un défaut d’aboutissement. La difficulté tenait (et tient toujours) à mes yeux dans le décalage entre sa description du perçu comme tel, notamment en sa dimension d’horizontalité et d’invisibilité constitutive et, d’autre part, celle du mode d’être du sujet percevant. Je me suis expliqué à plusieurs reprises sur ce point : la question est de savoir en effet si le vocabulaire de la conscience, puis ensuite du sentir, convient pour décrire une ouverture à cela qui est plus profond que tout objet et déjoue donc toute forme d’appropriation, à commencer par l’intuition. Or, on découvre chez Merleau-Ponty lui-même, dans ses tout derniers textes, une prise de conscience de la difficulté à travers l’importance qu’il en vient à accorder au mouvement – ce qui est une manière de dépasser le vocabulaire de la conscience, même incarnée, au profit d’une dimension vitale plus originaire. C’est de cela que je suis parti après mes premiers travaux sur Merleau-Ponty.
Je me suis vite aperçu alors que, si on voulait rendre compte de la perception telle que Merleau-Ponty la décrivait, il fallait non seulement rapporter la conscience à la motricité mais penser l’intentionnalité perceptive elle-même comme mouvement, c’est-à-dire en effet comme négativité concrète. Bien entendu, ceci exigeait de repenser le mouvement en profondeur, ce qui signifiait de le distinguer d’un simple déplacement. Le mouvement intentionnel, formule qui n’est plus métaphorique, désigne alors un déplacement qui éclaire son terme, une avancée qui est expérience. C’est ce mouvement que j’ai défini très tôt comme désir, pour autant que le propre du désir est que, loin de reposer sur une représentation préalable de l’objet, comme le pensait Husserl, il fait paraître son objet en se portant vers lui. En outre, contrairement au besoin, le désiré exacerbe le désir au lieu de l’apaiser, de sorte que ce qui le satisfait le relance tout autant. Or, à bien y penser, ce mode d’être singulier répond exactement à celui du monde, pour autant que celui-ci s’absente de tout ce qui le présente, c’est-à-dire transcende tout objet. Ce qui déjoue l’intuition ne se donne que dans une avancée ; on ne peut accéder à la profondeur pure du monde qu’en y pénétrant. Ainsi, au cœur de l’intentionnalité perceptive il y a ce désir que je nomme transcendantal puisqu’il effectue l’ouverture du monde lui-même.
AP : Chez Merleau-Ponty, peut-on considérer qu’il y aurait un lien de continuité entre la question générale de la perception et celle du désir ?
RB : Je crois avoir explicité ce lien de continuité mais il n’est pas présent chez Merleau-Ponty. Et il ne peut pas l’être car le corps apparaît toujours chez lui comme une solution, en vue de lester en quelque sorte la conscience afin de rendre compte de sa dimension originellement perceptive, alors que c’est en vérité un problème. C’est pourquoi, dans le meilleur des cas, Merleau-Ponty invoque le désir comme une dimension essentielle de ce corps et tente de l’articuler à la perception en décrivant le mode d’être du corps de telle façon qu’il intègre à la fois la perception et le désir. Ainsi, par exemple, dans un Résumé de cours au Collège de France :
« Le corps qui a des sens est aussi un corps qui désire, et l’esthésiologie se prolonge en une théorie du corps libidinal. Les concepts théoriques du freudisme sont rectifiés et affermis quand on les comprend, comme le suggère l’œuvre de Mélanie Klein, à partir de la corporéité devenue elle-même recherche du dehors dans le dedans et du dedans dans le dehors, pouvoir global et universel d’incorporation » (p. 179).
Comme on le voit, il s’agit ici de ressaisir le corps de telle façon que la perception intègre le désir, c’est-à-dire encore de décrire l’activité perceptive de telle manière (« pouvoir universel d’incorporation ») que le désir puisse en être une modalité. Mais, dans ma perspective, ce n’est pas le désir qui renvoie à la perception mais plutôt la perception qui renvoie au désir au titre de son mode d’être constitutif Autrement dit, il me semble que le corps est un problème plutôt qu’une solution et que la question, que ne pose pas Merleau-Ponty, est celle du sens d’être de ce corps. C’est en affrontant cette question que j’ai été conduit du côté du mouvement puis du désir, autrement dit de la vie. Ainsi, le désir en particulier et la vie en général ne sont pas des modalités du corps ; c’est plutôt celui-ci qui procède de la vie et est en quelque sorte déposé par elle. Ce n’est pas le mouvement qui est une propriété du corps mais le corps qui est originairement un corps moteur, qui est mouvement.
B : Approche phénoménologique du désir
AP : Ces questions liminaires à visée génétique étant posées, nous pouvons à présent approfondir le sens que vous conférez au désir dans votre œuvre. La définition la plus claire que j’ai trouvée se trouve peut-être dans Métaphysique du sentiment où vous montrez que le désir n’est rien d’autre que le mouvement faisant paraître le monde. « Entendons-nous, précisez-vous. Il ne s’agit pas du désir au sens psychologique d’un certain rapport à l’autre mais de la dimension ou du mode d’être qui se découvre dans ce rapport et que nous retrouvons au cœur de la subjectivité. »4 Et vous ajoutez quelques lignes plus bas :
« Le désir n’est donc pas manque, faute de quelque chose de déterminé qui serait susceptible de l’apaiser ; le désir ne manque de rien non pas parce que rien ne lui fait défaut mais plutôt parce que ce qui lui fait défaut est de l’ordre du rien, n’est rien d’étant. En effet, tout se passe comme si l’objet du désir se donnait comme en défaut vis-à-vis de quelque chose qui l’excède, de ce qui serait alors l’objet véritable du désir au sens où il le comblerait – mais il ne s’agit justement pas d’un objet. »5
Ma première remarque porte sur une certaine évolution. Il me semble que dans Le désir et la distance le désir renvoyait systématiquement à un manque originaire qui faisait de lui quelque chose d’insatiable. Or ce manque paraît avoir disparu ; de quelle évolution au sein de votre œuvre cette disparition de l’originarité du manque est-elle le signe ?
RB : Le désir et la distance est un ouvrage que j’ai écrit il y a près de vingt et, même s’il constitue incontestablement une première tentative personnelle, j’en suis maintenant assez loin : il est donc probable que mon vocabulaire se soit affiné et précisé. Je veux dire que, sur le fond, je crois avoir toujours soutenu la même chose, à savoir l’irréductibilité du désir au manque ; si j’emploie donc ce terme dans Le désir et la distance c’est sans doute par inadvertance ou faute de mieux. En effet, le manque renvoie à un objet défini susceptible de le combler et est donc en cela constitutif du besoin. Si le désir ne manque de rien c’est bien au sens où cela qu’il désire n’est pas de l’ordre de l’objet, transcende tout objet. Si le désir est désir du monde, la négativité qui le caractérise comme désir – au sens où, en effet il n’y a pas de désir sans une forme d’incomplétude ou de défaut ontologique – ne renvoie pas à une lacune circonscrite. La négativité qui est au cœur du désir est plus profonde que le manque puisque le désir ne peut être comblé : elle est de l’ordre de l’être plutôt que de l’avoir, de sorte que si l’on veut maintenir le vocabulaire du manque ce sera au sens très singulier d’un manque d’être ou d’un manque à être.
C’est pourquoi, dans Le désir et le monde, je substitue au vocabulaire du manque celui de la séparation. Le désir est le fait d’un être qui est séparé de lui-même, en défaut sur lui-même : sa condition est celle de l’hétéronomie ontologique. Il est donc à la fois plus et moins que manque : moins puisque le désirant n’a aucune lacune circonscrite et plus parce que ce qui fait défaut c’est lui-même. Le désir est donc le fait d’un être qui est défaut sur et de lui-même, qui est séparé de lui-même. Dès lors, s’il est désir du monde, c’est dans la mesure où c’est dans le monde que repose son être : le désir est la condition d’un être qui est séparé de sa source ou de son sol, d’un être qui est exilé, mais pas au point d’avoir oublié son origine et c’est pourquoi il tend vers le monde, aspire à une réconciliation ontologique, même si celle-ci est impossible, non pas logiquement mais ontologiquement. Vous le voyez, ce qui est finalement au cœur du désir, c’est une séparation première, l’événement d’une scission originaire, qui n’est pas l’œuvre du sujet puisqu’il en procède au contraire, ni du monde lui-même, dont la nature est telle qu’il ne peut se nier lui-même, qui relève par conséquent de ce que je nomme un archi-événement. Au cœur du désir il y a la séparation plutôt que le manque.
AP : Je note peut-être une évolution lexicale entre votre première réflexion thématisée autour du désir, exposée dans Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception6 et celle portée dans Le désir et le monde. Dans Le désir et la distance, et plus précisément au cœur de la cinquième partie, vous faisiez du désir « l’essence de la subjectivité » et le désir nommait la capacité du sujet à se rapporter à des objets. Mieux encore, en vous appuyant sur l’intentionnalité husserlienne, vous rapprochiez celle-ci du désir en tant que structure a priori de tension vers le monde, permettant de se rapporter dans un second temps si je puis dire à des objets, ce que vous synthétisiez en ces termes :
« Ce qui importe ici, écriviez-vous, est que la mise en évidence de l’autonomie de l’intentionnalité pulsionnelle ouvre la voie d’une dépendance génétique de l’intentionnalité objectivante vis-à-vis du désir. »7
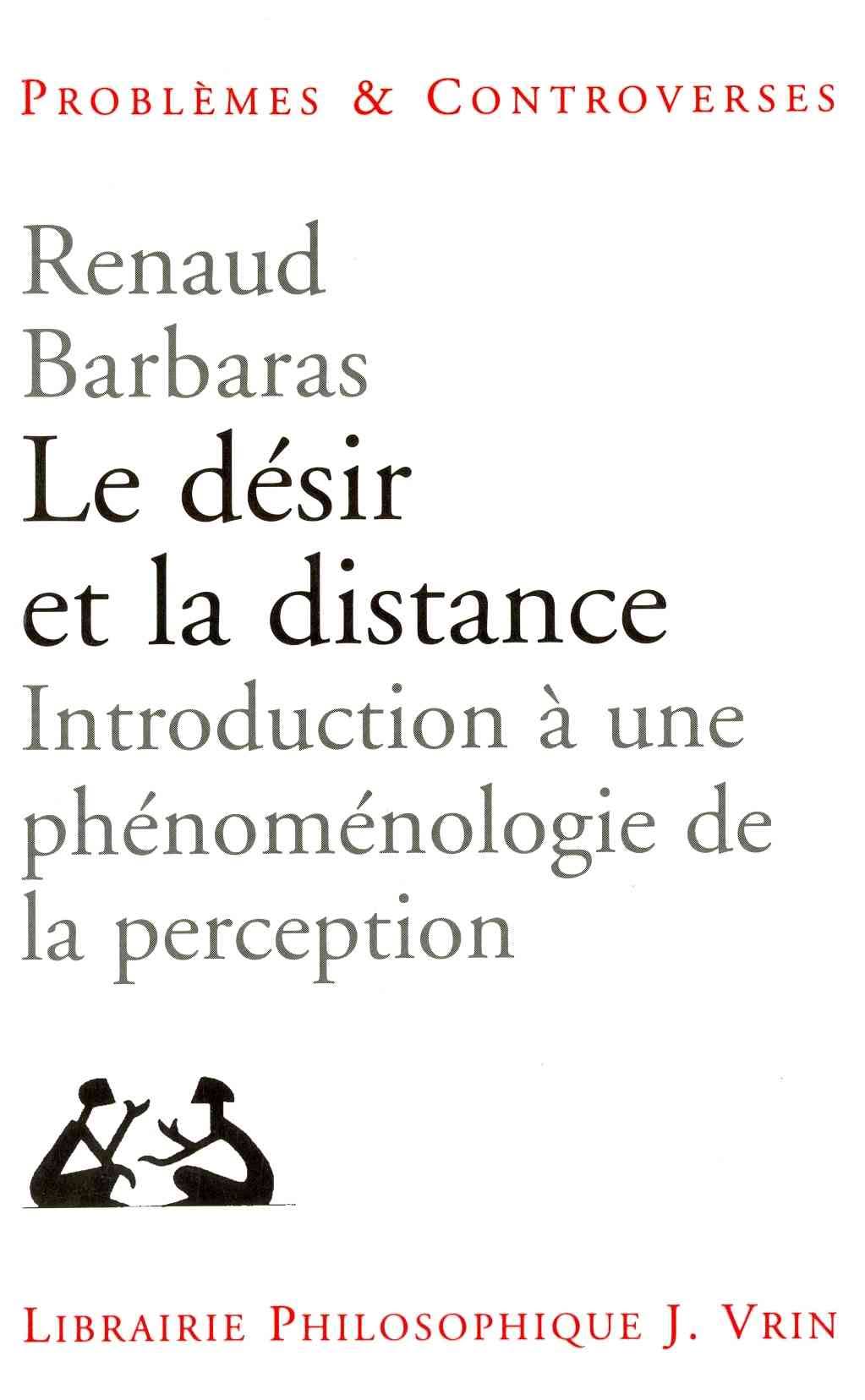
Cette proposition me paraît très riche car elle relie l’intentionnalité et le désir, introduit la question de la pulsionnalité et met en avant une « dépendance génétique ». Diriez-vous toujours aujourd’hui que l’intentionnalité objectivante dépend, génétiquement parlant, du désir ?
RB : Là encore, mes formulations dans Le désir et la distance n’avaient sans doute pas l’exactitude souhaitée. Ce qui est certain c’est que le désir nomme, à mes yeux, l’essence de la subjectivité et, par conséquent, l’essence de l’intentionnalité. Il est donc l’ouverture première au monde comme « il y a » originaire, scène ou sol pour toute apparition d’objet. Le désir concerne un plan infra-objectif qui est celui de la transcendance « sans masque ontique » ou encore de la profondeur pure, bref, du monde. Celui-ci est l’être-donné de la continuabilité de l’expérience, ou encore l’horizon de tous les horizons et c’est pourquoi il ne peut être atteint que par un sujet qui existe sur le mode de son propre défaut et donc de son propre excès. Autant dire que le désir, en tant qu’ouverture du monde, est le préalable à la donation de tout objet, que l’intentionnalité dont il est le cœur précède et fonde l’intentionnalité objectivante. Sans doute les choses n’étaient-elles pas aussi claires dans Le désir et la distance, ni l’usage du concept d’objet aussi précis, parce que je me situais sans doute encore dans le cadre plus étroit d’une phénoménologie de la perception qui est, en quelque sorte par définition, tournée vers l’objet. Quoi qu’il en soit, l’intentionnalité objectivante dépend génétiquement du désir dans la mesure exacte où celui-ci délivre le « là » premier, la scène primordiale sans laquelle aucun objet ne peut être visé. J’inverse donc le scénario de Husserl, qui affirmait le primat de actes objectivants sur les actes non-objectivants : à mes yeux, c’est cet acte non-objectivant par excellence qu’est le désir qui sous-tend tous les actes objectivants, dans la mesure où il commande la dimension de présence sans laquelle il n’y a pas d’objet, même si, bien entendu, l’objectité y ajoute quelque chose.
AP : Vous évoquez également la question de la pulsionnalité qui fait l’objet d’une analyse serrée en son sens freudien et pour lequel vous montrez que la pulsion semble dénuée de toute intentionnalité en tant que l’objet vers lequel se porte la pulsion n’est pas tant visé pour lui-même que pour la satisfaction qu’il est censé procurer. « En ce sens, écrivez-vous, même si elle [la pulsion] ouvre sur une extériorité, la pulsion ne vise rien : elle est force plutôt qu’intentionnalité, aspiration plutôt que vision, recherche du plaisir plutôt que dévoilement. »8 Est-ce une manière de rompre avec la notion d’ « intentionnalité pulsionnelle » développée dans Le désir et la distance ? N’y a-t-il pas un déplacement du rôle de la pulsion entre Le désir et la distance et Le désir et le monde ?
RB : J’avais oublié les développements sur l’intentionnalité pulsionnelle dans mon ouvrage de 1999 mais, en effet, sur cette question, les choses ont nettement évolué. Je pense que, dans Le désir et la distance, j’avais tendance à assimiler purement et simplement désir et pulsion. Les choses ont évolué, d’une part parce que, dans Le désir et le monde, en raison de la démarche qui y est la mienne et qui aboutit au concept de désublimation, j’ai été conduit à travailler de plus près le concept freudien et à mettre en évidence le fait que, en effet, la pulsion comme telle est dépourvue de toute intentionnalité, est poussée plutôt que visée et par conséquent, contrairement au désir, n’a pas de puissance phénoménalisante.
D’autre part, dans la mesure où je montre que ce mouvement qu’est le désir s’inscrit dans un mouvement ontogénétique dont il procède – mouvement qui n’est autre que celui du monde lui-même, mouvement de mondification qui est synonyme d’une archi-vie – je peux faire une place à la pulsion en sa différence avec le désir. Le pulsion signe en quelque sorte l’appartenance du désir à cette physis, elle marque la présence du monde dans le désir, elle est le résidu de son archi-puissance au sein de notre mouvement fini. Autrement dit, même si le désir est un mouvement impuissant puisqu’il aspire à.. faute de pouvoir produire, la puissance qui lui appartient en tant que mouvement (et mouvement incessant), puissance sans laquelle il ne serait même pas mouvement, ne peut lui venir que de celle du monde, de la surpuissance qui caractérise l’archi-vie. La pulsion désigne exactement cette puissance, elle est la présence de l’origine au sein du désir, elle est à la suture de l’ontologique et de l’existential.
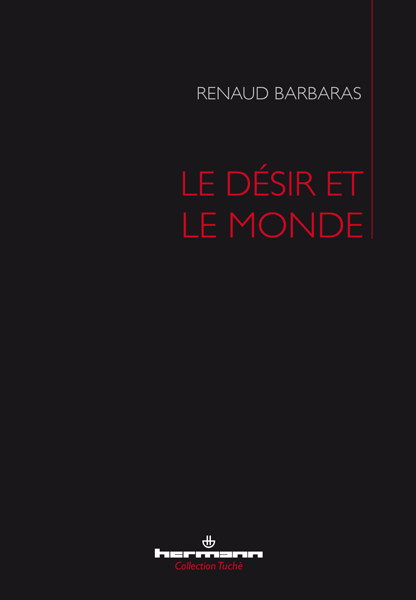
AP : Un autre élément me paraît signifiant. S’il y a une certaine forme de négativité dans le désir tel que vous le pensez, au moins par son incapacité à saisir ce qui lui échappe parce qu’il n’est pas un objet – le monde –, il n’y a pas de traces d’une quelconque forme de destruction. L’étymologie du mot désir porte pourtant en elle cette charge destructrice – la nostalgie d’une étoile disparue ou détruite – et toutes les grandes pensées du désir me semblent mettre en scène ce que l’acte même de désirer comporte de destructeur. La dialectique du maître et du serviteur n’est rien d’autre par exemple qu’une tentative pour chaque conscience de soi de coloniser la conscience de l’autre, et donc d’en détruire le désir initial afin d’y implanter le sien propre. Pourtant, il n’y a pas de place dans votre réflexion pour la destruction ni même pour la disparition si bien que je me pose les deux questions suivantes :
1) faute d’une destruction à l’œuvre dans le désir que vous décrivez, s’agit-il vraiment d’un désir et ne menez-vous pas plutôt une phénoménologie de l’attraction voire de la sympathie au sens stoïcien du terme ?
2) Ne faudrait-il pas d’emblée adopter l’analyse ontologique et aborder ce que vous appelez l’exil, en tant qu’il assumerait le rôle de la destruction ici pensée comme séparation radicale et qui justifierait le terme de « désir » ? Mais si tel était le cas, pourquoi commencer par la description phénoménologique et non par l’analyse ontologique ?
RB : Je ne suis pas certain que l’on puisse s’appuyer à ce point sur l’étymologie et que la dimension de destruction soit inhérente au désir. D’ailleurs, de la nostalgie d’une étoile détruite au désir de destruction, il y a un pas à franchir qui ne va pas de soi. Ce qu’il faut retenir de l’étymologie, c’est que, dans le désir, il y va d’une perte sans doute irrémédiable. Dès lors, je ne crois pas que ce que j’ai décrit soit de l’ordre de l’attraction ou de la sympathie. Bien au contraire, toute la première partie du livre s’attache à une description du désir tel que nous l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire de la sexualité et de cette sorte de spirale de la satisfaction et de l’insatisfaction qui la caractérise. D’autre part, en effet, le cœur du désir renvoie à l’archi-événement d’une scission qui affecte le monde sans qu’il en soit la source, scission dont procède le sujet du désir et dont la tension du désir est l’envers.
Cela signifie que le désir relève en dernière analyse d’une ontologie ou, en tout cas, que la phénoménologie du désir conduit à l’ontologie. Cependant, je ne peux pas commencer par celle-ci, d’une part parce que j’ai besoin de l’analyse phénoménologique pour montrer que le monde, ce monde dont le désirant est séparé, est le désiré du désir et, d’autre part, parce que c’est seulement à la faveur d’une démarche régressive, qui prend appui sur la détermination du sujet comme mouvement et sur l’appartenance constitutive du sujet, que je peux en venir à saisir le mode d’être du sujet comme témoin ontologique de celui du monde et à caractériser alors le monde de manière dynamique comme archi-vie. Il est donc absolument nécessaire de commencer par l’analyse phénoménologique qui, seule, permet de donner sens et poids à l’analyse ontologique. Il s’agit au fond de comprendre que cette tension du désir, cette insatiabilité ne peuvent provenir que d’un défaut d’être, ce qui signifie que le désir est toujours et d’abord désir de soi, aspiration à la réconciliation ontologique.
La suite est consultable à cette adresse.
- Renaud Barbaras, Le désir et le monde, Paris, Hermann, 2016
- Maurice Merleau-Ponty, Signes, Préface, Paris, Gallimard, coll. Folio-essais, 2001, p. 32
- Renaud Barbaras, Le tournant de l’expérience. Recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris, Vrin, 1998, p. 260
- Renaud Barbaras, Métaphysique du sentiment, Paris, Cerf, 2016, p. 21
- Ibid., p. 22
- Renaud Barbaras, Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception, Paris, Vrin, 2009
- Ibid., p. 138
- Le désir et le monde, op. cit., p. 29








