L’essai que Françoise Bonardel a livré en mars 2010, Des héritiers sans passé. Essai sur la crise de l’identité culturelle européenne, offre une réflexion philosophique profonde sur les conditions de possibilité d’une reviviscence de la « culture » dans le contexte d’une époque définie essentiellement comme celle de la postmodernité. La postmodernité, justement, est l’objet de ce livre, ou plus exactement sa cible. Il s’agit en effet de circonscrire la nature de cette époque et de cette pensée satisfaites d’avoir liquidé les « grands récits » explicatifs du monde, éprises d’interconnexion généralisée, de réseaux planétaires, et rêvant d’une disponibilité immédiate, instantanée, et donc non problématisée, de toutes les connaissances.
C’est dès l’introduction que la postmodernité culturelle est caractérisée : elle apparaît comme un écartèlement, évidemment des plus inconfortables, entre le rêve d’un cosmopolitisme généralisé, et un besoin d’enracinement, identitaire et culturel, souvent jugé négativement : « pourquoi l’individu postmoderne est-il continûment confronté à cette fausse alternative – cosmopolitisme ou enracinement ? » 1 demande ainsi Françoise Bonardel, posant le fil rouge que suivra le livre. Elucider l’origine d’une hésitation entre deux fausses solutions ou positions, et trouver les ressources intellectuelles propres à résoudre une telle aporie, telle est la double gageure que le livre parvient de manière convaincante à affronter.
A : La culture à l’épreuve de la postmodernité
En caractérisant l’époque et le climat culturel (l’essai se concentre sur une problématique culturelle, et sur les enjeux éthiques de celle-ci, laissant de côté l’approche plus proprement politique de la postmodernité qui pourrait être adoptée par ailleurs) comme « postmodernes », Françoise Bonardel pointe un ensemble de travers : une atmosphère de relativisme culturel moyen, un nivellement des œuvres de l’esprit, une culture du reniement de soi et de la culpabilité permanente 2, le fantasme d’un métissage généralisé (donc organisé), fantasme du « village planétaire », fantasme aveugle au fait que dans le contexte de la mondialisation des échanges économiques, il ne rend possible qu’une américanisation de la vie , tout juste « rehaussée d’un zeste d’exotisme indifféremment asiatique ou africain 3. Le postmoderne se flatte d’avoir liquidé les « grands récits » qui donnaient sens au devenir historique, promet à tous une culture sans effort, sans solitude, sans difficulté : il remplace donc la culture par un succédané trompeur. Ce faisant, se croyant à la pointe d’un humanisme satisfait de soi, il ne se rend pas compte que sa position ne fait que dissimuler, à son insu sans doute, « de nouvelles ressources d’inhumanité 4 ».
Le lecteur un tant soit peu tenu au fait des principales discussions médiatico-intellectuelles se demande alors s’il ne se trouve pas en présence d’un n-ième essai nostalgique, passéiste, sinon typique de la rhétorique « réactionnaire » qu’on a hâtivement et sottement voulu lire chez des auteurs de la trempe de Muray, de Finkielkraut, de Houellebecq, de R. Camus, etc. Nous voudrions ici montrer qu’une telle lecture serait superficielle, et irait à contresens du projet réel de l’essai, tant celui-ci, ne plaidant en rien pour un quelconque retour à un passé idéalisé, ni pour une affirmation purement identitaire d’une culture refusant tout lien à son autre, nous semble au contraire animé par un souci très profond de repenser les conditions de possibilité d’une véritable culture pour notre présent. Le livre de Françoise Bonardel est traversé par un sens de l’universalité et un esprit humaniste qui rendent parfaitement impossible sa réduction à un « camp » idéologique, ou à une simple posture médiatique parmi d’autres.
Si, par conséquent, la postmodernité mérite bien d’être décrite et jugée comme elle l’est ici, c’est le destin de la culture qu’il faut examiner, en repartant notamment d’éléments de définition les plus précis possibles. Ce travail de définition, sur le concept de culture comme sur d’autres, est en fait mené de façon suivie, par ajouts successifs, tout au long du livre. Certes, on y retrouve très vite les dimensions de formation, d’individuation, d’humanisation, qui en sont les traits les plus évidents, mais ces traits sont systématiquement enrichis, réexaminés, à la lumière de la problématique annoncée : que deviennent ces dimensions de la culture quand elles se trouvent tiraillées entre cosmopolitisme et enracinement, quand simultanément on s’imagine que la culture n’est plus qu’un gigantesque réseau, qu’un pur « accès » (et peu importe alors à quoi on a réellement accès, ni ce qu’on en fera, l’important est d’y avoir accès), et que par ailleurs la culture « ne peut plus » (nous verrons plus loin l’origine de cette rhétorique des interdits posés en matière de culture) se définir comme affirmation d’une identité, d’une vie sans toute sa particularité sans mélange ?
Les deux pôles de l’alternative aporétique de la postmodernité trouve alors à se redéfinir tout au long du livre : Françoise Bonardel pointe avec justesse la dissociation qui s’est opérée entre rationalité technoscientifique vidée de tout sens autre que sa propre efficacité d’une part, et spiritualité éprise de fusion organique et régressive avec des « origines » pourtant introuvables. Tout se passe comme si l’on n’avait plus désormais le choix, en termes de réalisations culturelles, qu’entre une rationalité asséchée, celle d’une technique tendant à s’autonomiser toujours plus par rapport aux fins proprement humaines qu’elle est pourtant censée servir, et une spiritualité de pacotille, rêvant d’une mystique et d’une grande désindividuation à peu de frais 5.
La culture retrouvera(it) alors les conditions de son effectuation en retrouvant sa vraie nature : contre un acquiescement irrationnel au mythe de la nouveauté (exécuté, comme il se doit, p. 34 par exemple 6, ou à l’événement comme valeur en soi (cela a lieu/cela existe, donc c’est forcément bien), la culture doit être définie et donc pratiquée comme un « art de tirer parti », comme un « sens de la mesure » sachant ne pas se confondre avec la « mesure de la science », et trouver, dans les réalisations les plus singulières, les plus positivement identitaires, le sens d’une véritable universalité. Ainsi éviterait-elle l’écueil de l’ « alexandrinisme », d’un métissage jugé bon en soi, l’écueil aussi d’un « déracinement », conséquence d’un cosmopolitisme identifié comme source de vulnérabilité aux idéologie.
La culture n’existera donc que dans un « nouvel équilibre » 7, retrouvant sa juste « place » : « Ce que l’Europe a durablement nommé « culture » n’a pu en effet se déployer que dans un espace intermédiaire entre un déracinement radical d’inspiration gnostique et un enracinement grégaire et sectaire tel celui prôné au XX° siècle par les nazis.8 », et retrouvant le mouvement d’appropriation qui la caractérise : non pas une réception passive de données de tous ordres, un emmagasinement d’informations, mais une transformation personnelle de réalisations humaines dont on hérite, artistiques et intellectuelles, en vue de se transformer soi-même.
B : La dimension « performative » de l’essai
La réflexion sur la culture qui est ici proposée, sur son universalité, sur la crise qu’elle traverse, nous semble être validée par le style, l’écriture mêmes de l’essai. Parlant de culture, l’essai se fait ainsi œuvre de culture, est un acte qui va dans le sens de cette haute culture humaniste qui savait embrasser ensemble éthique et esthétique, humanisme et sens de la transcendance, rationalité et spiritualité, identité et altérité, rigueur de la démonstration et saveur de la langue. Plusieurs traits du livre de Françoise Bonardel peuvent être retenus qui témoignent de sa nature « performative », à commencer par le nombre des références invoquées au fil de la réflexion, et l’écriture même du livre. La page 63, par exemple, réussit le tour de force de citer et de commenter, sans céder au travers de l’allusion vague, Marguerite Yourcenar, Hofmannsthal, Hesse, et la correspondance entre Goethe et Schiller. Cela nous semble typique de la manière et du projet même de l’essai : puiser dans les sources européennes de la culture de quoi revivifier la pensée, faire de la pensée un cheminement éclairé au sein d’une multiplicité de voix, un dialogue soutenu, informé, précis, et parfois critique, avec le passé. Le livre met ainsi en œuvre ce qu’il défend : une réappropriation constante des grands auteurs.
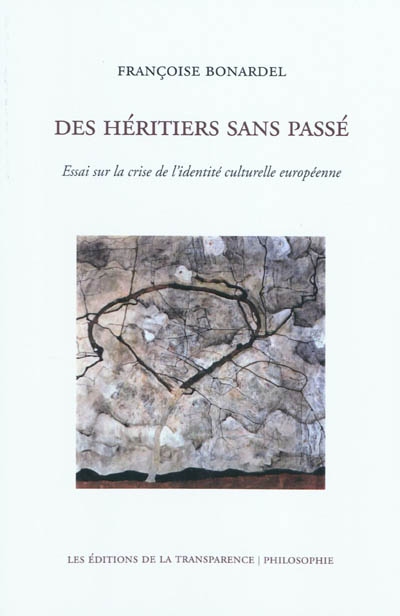
Un autre trait de cette dimension « performative » réside dans l’écriture elle-même : précise, élégante, ne faisant aucune concession au jargon inutile, animée par un goût des images et du concret qui révèle dans la chair du texte cette volonté de retrouver le « principe d’incarnation » que, selon Sloterdijk, l’intellectuel moderne serait incapable de communiquer. La pensée parvient à peindre, à raconter, à manifester ce qu’elle tente d’approcher. Qu’on en juge, par exemple, sur le « sentiment d’incarcération » que suscite une postmodernité arrachée à tout sens de la temporalité :
« Quand demeure béante la faille entre passé et présent, c’est l’ombre du passé qui resurgit, paralysant tout élan vers un quelconque futur ; et quand le futur n’est plus l’horizon où déjà se dissipent les incertitudes propres à tout avenir, sa prémonition demeurée fantomatique s’en vient hanter continûment le présent devenu la geôle où ont eu le sentiment de croupir tant de poètes et penseurs contemporains, retrouvant à l’occasion des accents « gnostiques » pour évoquer leur incarcération en un tel monde, au sein d’une telle société, en l’absence d’une réelle communauté d’amis9. »
Un dernier trait achèvera de rendre compte de nos impressions de lecture : malgré l’ampleur de la tâche, la gravité du sujet, l’acuité du diagnostic, la précision conceptuelle qui caractérisent l’essai, nous y avons également bien ri. Le chapitre 9, émaillé de citations de Bernard-Henri Lévy et de Sartre à propos du statut de l’intellectuel, est ainsi souvent drôle, d’autant qu’il se contente parfois de citer simplement les errements « intellectuels » de BHL, voyant dans le travail de journalisme auquel il s’astreint l’apogée de la vie intellective, ou de Sartre, définissant, de façon involontairement comique, l’intellectuel comme « celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas »… Ce que Françoise Bonardel ne se prive pas de reformuler : « Lui, l’ennemi de tous les mystères, fait merveille dès que s’engage à son initiative le débat et que son « souci de l’autre » le porte à se faire le porte-parole de tous ces autres qu’il ne connaît pas 10. » Quelques autres formules, toniques, incisives à souhait, sur le « crétinisme » planétaire engendré par la crise postmoderne de la culture, sur « l’engouement pour le multiple, le bi-, le pluri- » caractérisant les tics et gimmicks d’une pensée et d’une politique culturelle caricaturales dans leur « ivresse du mélange » ou dans leur « frénésie de mixage 11 », semblent ainsi tout droit sorties d’un livre de Philippe Muray.
C : Une pensée en dialogue
Performatif, l’essai l’est aussi, justement, en ce qu’il mène une série de discussions serrées non pas avec le postmoderne lui-même, avec des auteurs dont le discours aurait tenté de légitimer la logique de la tabula rasa, le mixage des cultures avant même que chaque culture se soit pleinement épanouie, l’accessibilité intégrale du savoir sans effort, ou encore la glorification du nouveau et du multiple pour eux-mêmes, mais avec des auteurs qui ont tenté d’approcher, justement, cette crise de la culture européenne. C’est l’un des gains majeurs de l’essai. S’il n’est pas une simple prise de position médiatique de plus, s’il ne se réduit à aucune idéologie, c’est justement parce que, prenant de la hauteur, il peut contribuer à clarifier et à rationaliser le débat, en dissipant des malentendus, en rectifiant des approximations dans le diagnostic qui peut être émis sur la culture contemporaine. Ces séries de clarifications, menées le plus souvent en trois ou quatre pages, sur un thème précis de la pensée d’un écrivain, font mouche. Ainsi, lorsque Hannah Arendt prétend lire dans la brèche du présent entre passé et futur l’occasion pour le penseur moderne de prendre conscience de lui-même et de son activité, F. Bonardel répond qu’il n’y a là aucune spécificité propre au penseur moderne, et que c’est la tradition précédant la modernité qui a toujours fonctionné par la prise de conscience de ruptures profondes, de changements présents. Ainsi ne faut-il pas trop vite attribuer à la modernité une radicalité qui a de toute manière toujours été le moteur, ou le mouvement même, de la culture, ni enfermer la tradition dans la caricature d’une transmission de contenus positifs qui n’aurait jamais connu la créativité, l’innovation, les bouleversements. Ainsi, l’examen d’un moment de La crise de la culture, prolonge le fil d’une réflexion plus globale sur le fonctionnement de la culture comme héritage, les impasses qu’engendre le refus d’un tel héritage (apologie de la culture de masse, renoncement à se cultiver par anti-élitisme et anti-capitalisme simpliste), et le paradoxe qui survient dès qu’on tente d’opposer trop fortement tradition et modernité : « comment se fait-il que la tradition ait réussi à édifier et à transmettre en s’émasculant elle-même de toute créativité, tandis que la modernité tiendrait sa créativité perpétuellement novatrice de son refus de la continuité ou de son impuissance à se perpétuer ?12»
Le même type d’examen à la fois bref et précis est pratiqué sur l’opposition trop rapidement dressée entre Goethe et Herder par Alain Finkielkraut dans un article de 1985 intitulé « La défaite de Goethe ». Il s’agit ici de montrer l’anachronisme de l’article d’A. Finkielkraut, dont les formulations semblent opposer les deux penseurs comme des sortes de préfiguration des systèmes totalitaires d’une part, et d’autre part comme les représentants d’un rationalisme sans limite et de son opposé le plus strict. Reprenant de près les textes, F. Bonardel montre que cette double projection, ou cette double rigidification de la pensée de Goethe et de Herder, est illégitime. On est, dans un premier temps, presque surpris de voir une telle explication avec un écrivain dont bien des thèses sur la culture et le monde contemporains pourraient, a priori, être compatibles avec le projet de l’essai. Et pourtant, cela se justifie clairement, du fait que produire un diagnostic globalement juste, ou à tout le moins intéressant, n’autorise pas à proposer une étiologie approximative, ni, donc, à philosopher à coups de noms propres sans remplacer ceux-ci par les concepts et les thèses précis qu’il faut leur associer.
On pourrait multiplier les occurrences où se trouve appliquée une telle méthode (avec Samuel Huntington et son « choc » des civilisations, par exemple) ; qu’il suffise simplement de dire que cette méthode, justement, qui propose au lecteur de petits « coups de sonde » précis dans les œuvres de quelques autres penseurs de la modernité et de la postmodernité, se révèle à la fois féconde et passionnante à lire. Elle contribue par là-même à épurer le débat de toute emphase (arrêtons de voir en tout auteur complexe, difficile, nuancé, la matrice d’un système politique mortifère gigantesque…), et de tout pathos. Le débat perdra alors en dimension spectaculaire ce qu’il gagnera en rationalité.
S’il y avait alors une frustration à exprimer, face à la vivacité et à la rigueur d’une telle pensée en dialogue, c’est qu’elle n’ouvre pas davantage l’examen critique à propos d’une notion de style heideggerien, qui est finalement peu abordée : la « Technique ». L’auteur lui conserve la majuscule, en fait le grand repoussoir auquel l’ « atelier » parviendra à remédier, mais elle n’est pas assez creusée ni définie. Pourquoi cette majuscule ? Faut-il lire en cette notion tout ce que Heidegger en a dit ? Faut-il accepter avec elle l’idée de l’accomplissement d’une métaphysique centrée sur la subjectivité ? Que faut-il y inclure : l’automatisation de la fabrication, les usines, Internet, certaines pratiques médicales… ? Si, sans a priori, nous reconnaissons à Internet, par exemple, une dimension d’ambivalence (comment juger de la valeur de Wikipédia, par exemple, de son utilité ou de sa nocivité au regard de l’idéal de grande culture humaniste qu’il faut défendre et faire vivre ?), peut-on le décrire en termes d’arraisonnement, de mise à disponibilité, et surtout en faire le pôle où se concentrent quasiment toutes les impasses de la postmodernité ? Toute mise en réseau grâce à des performances techniques mettent-elles en péril l’individuation et la formation de chacun par la culture ? Si oui, comment l’expliquer ? Ce sera là notre seule réelle réserve à l’égard de l’essai : si l’on voit bien ce qui est recherché, voulu, cette haute culture tissée de rationalité et de spiritualité, on voit en revanche insuffisamment en quoi « la Technique », à elle seule, incarne ou représente tout ce à quoi cette haute culture tente de s’arracher.
D : en finir avec le nazisme comme argument définitif
Revenons sur le type de pathos que l’essai permet d’abandonner sans regret : s’il en est un qui, tout particulièrement, alourdit, voire hypothèque, le débat actuel sur la culture et la politique, c’est l’omniprésente ou l’inéluctable référence au nazisme. Sur internet, justement, on connaît le fameux point Godwin, ou moment lors duquel, inévitablement, dans une discussion de forum qui aura trop duré, on en viendra, pour faire taire le contradicteur, à asséner une référence à Hitler et au nazisme censée trancher définitivement. Plus généralement, et selon une position hâtive et grossière du problème, il flotte dans le débat médiatique et intellectuel l’idée quelque peu sournoise que la culture serait fondamentalement impuissante à nous humaniser, et à faire rempart à la barbarie : la preuve en serait que la haute culture européenne n’a pas pu empêcher l’avènement du nazisme. On en viendrait alors à suspecter en retour cette culture qui, n’ayant pu s’opposer au nazisme, l’aurait peut-être au contraire « permis » ou favorisé ; on en vient aussi, selon une attitude que Françoise Bonardel nomme fort justement « asthénie culturelle », à désespérer des possibilités de la culture désormais : « (…) c’est l’époque entière qui subit le contrecoup d’un traumatisme autrement tragique, discréditant la culture de la vieille Europe demeurée impuissante face à la barbarie nazie : « Pourquoi s’évertuer à élaborer et transmettre une culture qui a fait si peu pour endiguer l’inhumain, qui abritait des ambiguïtés profondes, celles-ci n’étant pas toujours hostiles à la barbarie ? » interroge George Steiner, comme l’ont fait Thomas Mann, Hans Jonas, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, Alain Finkielkraut et tant d’autres se faisant, qu’ils soient juifs ou pas, les porte-parole d’une sorte d’asthénie culturelle post-traumatique13. » L’enjeu qui gravite autour de cette asthénie culturelle est de taille : il pourrait y avoir là un argument de plus à avancer pour justifier l’abandon de tout idéal de culture, et l’adoption d’un mode de vie pouvant, sinon devant, se passer de la culture. L’auteur, en divers moments de l’essai, série les conséquences culturelles du nazisme : il a engendré une véritable « phobie du lieu » (la peur d’en revenir au Blut und Boden dès que l’on affirmerait l’idée même de « racines », d’enracinement…), une confusion entre différents « espaces » perçus comme régressifs : « la matrice dont on refuse de sortir, le cocon où l’on préfère continuer à ne pas grandir, la crypte où l’on se livre entre initiés à des pratiques occultes (…) 14 ». Dès lors, la seule issue possible revient à se couper de tout lieu, de toute géographie, d’abandonner tout vocabulaire « organique » de l’enracinement, de la maturation, et même de la « culture ». Une nouvelle fois, l’essai va montrer que cette façon de poser les questions dans le débat actuel sur la culture est erronée : l’erreur a consisté à poser que la culture avait laissé faire, alors que précisément, c’est une déculturation antérieure qui a permis l’avènement du nazisme. On a redécouvert non pas la filiation entre culture et barbarie, mais tout simplement le fait que la raison, même très cultivée, ne peut pas constituer un obstacle suffisant à la barbarie. Qu’elle ne soit pas un tel obstacle ne suffit pas à lui attribuer toute la responsabilité de ce que personne ne l’a jamais cru capable d’empêcher. Françoise Bonardel ajoute, à ce propos : « Il y a même à cet égard quelque chose de désarmant dans le raisonnement de l’humaniste, de l’homme de culture prêtant à des hommes fanatisés par la propagande une attention aussi vive que la sienne à ce qui aurait pu dans le passé se dire ou s’écrire qui les ait motivés et confortés dans leur folie. Comme si le barbare d’hier ou celui d’aujourd’hui lisait attentivement, annotait consciencieusement les livres qu’ensuite il cloue au pilori !15 »
C’est ainsi en rappelant que la raison ne saurait être toute puissante face à son autre, face au déchaînement barbare des passions, que paradoxalement on en consolide l’exercice.
E : De la géographie de la pensée à l’ « amitié stellaire »
L’essai ne consiste toutefois pas principalement en une série de mises au point sur les faux problèmes et les faux débats portant sur le thème de la culture. Le ton n’en est absolument pas plaintif, et le caractère polémique ne l’emporte jamais sur la volonté d’approcher les conditions de possibilité d’une culture et d’une spiritualité retrouvées, ou réactivées. S’il fallait qualifier le mode de pensée auquel le lecteur est ici invité, peut-être parlerait-on d’une sorte de localisation, d’identification des lieux, où la pensée pourrait se développer. Pour contrecarrer l’écueil du « village planétaire », l’illusion de se croire partout chez soi, et la posture d’un « nomadisme intellectuel » qui se rêve déraciné et perpétuellement mobile (en ignorant que les véritables nomades vivent dans des sociétés profondément traditionnelles…), il faut retrouver un sens du lieu, l’exact localisation où l’esprit – thème que Françoise Bonardel privilégie – pourrait trouver ses sources les plus vives. Si la culture est formation de soi, transformation, maturation, alors le vertige d’un perpétuel voyage, et d’un déracinement de chaque instant, ne fera que retrouver l’impasse de la tabula rasa. Il retrouvera également une autre impasse, désignée dans l’essai, à la suite de Thomas Stearns Eliot, comme un « nouveau provincialisme » : sous couvert de « cosmopolitisme », de dialogue perpétuel des cultures, il consiste à déprécier l’histoire passée au point de n’y plus voir des sources de vitalité et de sens qu’il faut sans cesse réactiver, pour demeurer rivé au présent, seul vivant. Se croyant le plus ouvert à l’altérité, le nouveau provincial la perdrait pourtant totalement, son provincialisme n’étant plus spatial mais temporel. Dès lors, il est impérieux de retrouver les lieux en lesquels, justement, s’ouvrir à une universalité réelle, quoique non cosmopolite.
Ces lieux sont ceux que tout homme de culture fréquente, à commencer par la bibliothèque, qui tient à la fois de la cellule monacale et de l’amphithéâtre (voir pp. 142-143), d’une temporalité solitaire productive et d’une ouverture maximale au théâtre du monde. L’essai envisage également le « Musée imaginaire » vu par Malraux, tentant par la culture de remédier à l’effacement du religieux, rêvant ce musée comme l’antichambre d’un temple qu’il reviendrait à chacun de franchir ou non. A chaque évocation de ces lieux, le lecteur voit moins une invitation quasi politique à se rendre effectivement dans de tels lieux concrets, qu’à retrouver le sens associé à ces lieux, à en retrouver toutes les implications spirituelles et intellectuelles. Dans chacun de ces lieux, en tout cas, se trouve en quelque sorte résolue la tension qui innerve l’essai, entre cosmopolitisme et enracinement. Il semble qu’en ces lieux, jusqu’à l’atelier, le dernier d’entre eux cité dans l’essai, se trouve pleinement assumée la double contrainte d’ouverture et de clôture sur soi, d’expansion et d’intensification, d’extase et de retrait par rapport au monde. C’est donc là une philosophie assez déroutante qui se déploie, pensant par lieux plus que par concepts, par images et situations concrètes plus que par raisonnements abstraits. Elle invite à des relectures, à un jeu de va-et-vient dans le corps de l’essai, sa vérité n’émergeant que peu à peu de la géographie, ou de la topologie générale qui est proposée.
C’est finalement dans un « atelier » que F. Bonardel invite à descendre afin de désamorcer la tension entre cosmopolitisme et enracinement. C’est là que, le plus nettement, on voit la pensée se laisser informer par le lieu où elle se trouve : faisant confiance à la main de l’artiste ou du créateur, elle s’essaie, crée sans obéir à une chaîne d’intentions linéaire, et assume alors définitivement son « incarnation », dont le déficit a été pointé comme l’un des problèmes majeurs de la postmodernité en voie de déculturation. A nouveau, l’écriture se fait presque narrative, il semble presque que l’on aille effectivement dans l’atelier de Giacometti, que l’on aille se laisser habiter par la « forme » qui convoque l’artiste pour parvenir à l’être et à l’apparaître : « L’atelier est ce lieu où une forme puissamment vous requiert et entend mener sa vie propre par votre ferme mais amical intermédiaire 16. » Ainsi en somme échappe-t-on aussi à tous les « lieux » qui ne savent pas faire place à l’homme cultivé : places publiques, bureaux, usines et officines diverses 17. L’atelier est ce qui résiste, alors, le mieux à toute intrusion de l’univers de la Technique et de l’univers consumériste. C’est là qu’une explication plus étoffée sur la nature de la Technique, mais aussi sur la collusion entre économie mondialisée et culture massifiée, « démocratisée » et « consumérisée », aurait été bienvenue. Il n’en demeure pas moins que cette proposition d’un « retour à l’atelier », dans le dernier chapitre du livre, s’avère séduisante, principalement par sa puissance d’évocation, et les possibilités de spiritualisation qu’elle promet.
Car c’est bien de spiritualisation qu’il s’agit ; en quelques moments clés, Françoise Bonardel parle également de « transmutation », procédé hérité de l’alchimie qu’il conviendrait de savoir réactiver pour parvenir à un « corps spirituel » qui, bien compris, dépasse la fausse alternative entre enracinement et déracinement 18. Redescendu dans l’atelier, se souvenant de l’expérience tout à la fois monacale et théâtrale de la bibliothèque, de celle, universelle, du Musée imaginaire, l’homme de culture trouvera les moyens de sa spiritualisation, de sa quête d’esprit et de sens dans l’ouverture d’un dernier espace : celui de l’ « amitié stellaire ». Rappelant les notations sur l’amitié de Blanchot, d’Aristote, de Hölderlin, de Rilke, l’essai trouve enfin dans l’amitié, définie comme affectivité et distance conjointes, l’une dans l’autre, l’aboutissement de ce « repérage des lieux » d’une culture possible. N’étant ni un enracinement familial et sanguin, voire fœtal, ni pur accueil ouvert à tous les vents, l’amitié devient le lieu réel où, comme en un atelier, la pensée peut librement s’essayer, portée par la confiance et le rapport non fusionnel à l’autre : « C’est aussi affirmer, à contre-courant d’un temps porté aux solidarités grégaires, que l’ami n’est pas forcément celui qui vous ressemble, ayant les mêmes qualités, défauts et idées que vous ; ni votre parfait opposé avec qui espérer une « coïncidence » telle qu’elle reconstitue certaine androgynie mythique supposée perdue. Il est celui qui, ayant procédé pour son propre compte à ce retrait, placera d’entrée l’amitié sur le plan « stellaire » qui la soustrait aux attractions et répulsions primaires : « On ne voit plus maintenant deux êtres face à face s’efforcer par l’amour de réunir leurs individualités singulières, mais deux êtres tenter l’un par-dessus l’autre d’atteindre à une idée de l’humanité », disait Antonin Artaud, lui aussi en quête d’une nouvelle symbiose entre amitié et « formation » de soi. 19» Le tour de force ici réalisé n’est pas mince. Françoise Bonardel parvient tout simplement à proposer un éloge de l’amitié – et de la bonté, décrite comme inentamable, irréductible à l’horreur, exemple de Jünger à l’appui – qui ringardise totalement les pratiques de méfiance, de dénonciation perpétuelle qui tiennent lieu de pensée et de démarche intellectuelle pour nombre de « penseurs » actuels. C’est, contre toute attente, la voracité d’une critique mal fondée, et suspectant partout des relents de nazisme ou de xénophobie, qui apparaît finalement comme niaise, cotonneuse, affectée, fragile, et au contraire l’élaboration d’une topique et d’une éthique de l’amitié qui s’impose avec force et lucidité. On l’aura retenu : pour retrouver la culture, lever les yeux vers les étoiles d’amitiés en devenir vaudra toujours mieux que redescendre sempiternellement dans les cryptes de l’adversaire pour y déceler quelques traces de barbarie potentielle et de mépris de l’autre…
Conclusion
Ces Héritiers sans passé relèvent sans conteste avec brio les différents défis qu’ils s’étaient posés. Le lecteur trouvera simultanément un vaste vivier de citations de grands auteurs typiques de la culture européenne que justement il s’agit de défendre, une discussion serrée autour du diagnostic qui peut être fait de la « crise de la culture » que l’époque traverse, (ou dont elle n’est rien d’autre que la traversée ?), et une approche « géographique » ou « topologique » des conditions de possibilité d’une réactivation de la formation de soi sous le sceau de l’universel. A tous points de vue, ce livre constitue donc une méditation précieuse, mettant en œuvre elle-même l’idéal qu’elle promeut. Il nous semble proposer une solution crédible, et même enthousiasmante, à la scission entre raison et sens, rationalité technoscientifique et spiritualité. Disons, enfin, en toute honnêteté, qu’il nous a souvent rappelé au fil de la lecture, par l’étendue des références qu’il mobilise, à une modestie qui, sur les chemins de la culture vers le « Simple », ne peut être que salutaire.
- Françoise Bonardel, Des héritiers sans passé. Essai sur la crise de l’identité culturelle européenne, La Transparence, Chatou, 2010.
- ibid., p. 87
- ibid., p. 40
- ibid., p. 32.
- C’est ici que l’essai aurait pu accroître la précision de son diagnostic, en examinant plus concrètement des faits culturels illustrant à la perfection cette alternative, et cette scission dommageable entre raison et sens, ou entre rationalité et spiritualité : l’apologie de l’internet comme but en soi, et de l’immédiation, où tous sont connectés avec tous, d’une part, et d’autre part, par exemple, le succès de librairie de la fantasy, ou, plus significatif encore, celui des romans oscillant entre ésotérisme niais et théories du complot (Dan Brown…). Outre de savoureuses remarques sur le « crétinisme planétaire » qui découle de cette crise de la culture, nous aurions ainsi aimé lire davantage d’analyses ou de décryptages des phénomènes les plus massifs et les plus quotidiens qui découlent de la postmodernité.
- « Sur combien de prétendues « nouveautés » ne s’est-on pas extasié, dont le modèle avait été effrontément pillé ! Ainsi a-t-on de bonnes raisons de supposer que Le Monde de Sophie (Jostein Gaarder, 1991), devenu un best-seller mondial, ne soit en fait qu’une réplique contemporaine des merveilleuses Lettres à Zoé sur l’histoire des philosophies (Salomon Reinach, 1926), que personne ne lit plus. Les cas sont même devenus fréquents où le plagiaire s’est astucieusement donné les moyens d’accuser de plagiat l’auteur dont il s’est sans vergogne « inspiré ». »
- Ibid. p. 138
- Ibid. p. 56.
- ibid., p. 101
- ibid., p. 226.
- ibid., p. 38
- ibid., p. 47.
- ibid., p. 102-103.
- ibid., p. 73
- ibid., p. 105
- ibid., p. 242.
- Ibid. p. 245
- voir p. 74
- ibid., p. 254.








