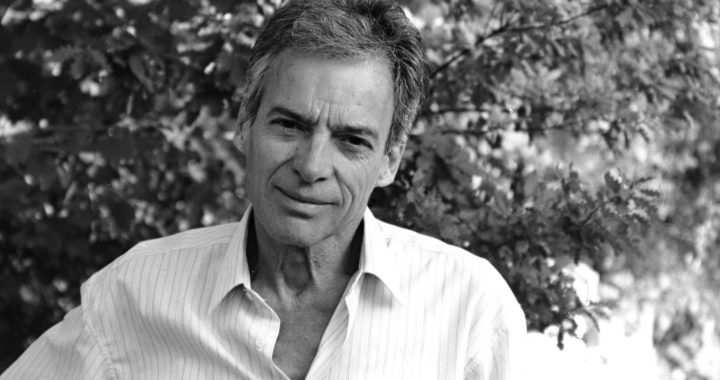Acheter Les puissances de l’apparaître
Acheter l’humanité à son insu.
Parce que le récent ouvrage de Grégori Jean, intitulé Les puissances de l’apparaître, Étude sur M. Henry, R. Barbaras et la phénoménologie contemporaine[1], représente à nos yeux un véritable belvédère philosophique, il nous paraissait important de restituer les perspectives majeures qui s’y entrecroisent et d’interroger la stimulante proposition qu’il articule. A plusieurs endroits Grégori Jean parle de son »petit livre » ou de sa »petite étude », néanmoins, disons-le sans ambage, Les puissances de l’apparaître est un ouvrage »petit mais costaud » ! »Costaud » d’abord au sens où en le lisant on remarque rapidement la robustesse de l’écriture. Cette robustesse propre à la prose johannique tient aussi bien à une syntaxe à plusieurs focales – en particulier le phénomène récurrent des inclusions entre tirets réclamé par un souci permanent de rigueur et d’explicitation –, à une densité accusée des idées – la prouesse de ramasser autant de choses en aussi peu de pages – qu’à un argumentaire serré qui, au moins jusqu’au chapitre conclusif, avance par une sorte de logique duale – d’ailleurs, en formalisant cet enchaînement de dualités et d’alternatives cela pourrait donner lieu à un véritable Tractatus phénoménologicus. Si la densité de cette étude renvoie avant tout au style de Grégori Jean, on peut également penser que la concision de l’ouvrage a renforcé l’effet de condensation. Mais le livre est encore »costaud » en un autre sens qui ne dépend aucunement de son format. En effet, ce qui marque le plus dans cette étude c’est la puissance de son argument, des visions qu’elle propose de la tradition phénoménologique. De manière générale, on pourrait dire que Les puissances de l’apparaître font montre d’une double puissance : une puissance rétrospective et une puissance prospective : je voudrais donc revenir sur le contenu de ces deux puissances d’éclairage et sur l’amplitude de leurs faisceaux pour donner à sentir l’événementialité de cette parution.
I/ Une puissance rétrospective
- L’insuffisance de dépassements encore kantiens.
De même que dans L’humanité à son insu[2], cette étude parvient à adopter une impressionnante hauteur de vue sur l’histoire de la philosophie transcendantale et sur la place qu’y occupe en particulier la phénoménologie. Ce surplomb philosophico-historique renouvelé va d’abord avoir pour vertu de mettre en évidence l’élément de continuité massif entre le transcendantalisme inaugural de Kant et la tradition phénoménologique depuis Husserl[3]. Nonobstant les multiples déclarations de ruptures et de dépassements qu’ont émises les différentes phénoménologies historiques à l’égard du kantisme, mais également nonobstant le bien-fondé de ces déclarations, Grégori Jean nous révèle en quoi ces ruptures ont en fait permis de drainer et de perpétuer en sous-main le cadre de pensée kantien. Plus exactement, jusqu’à peu, la tradition phénoménologique s’est montrée fidèle à la doctrine kantienne de l’apparaître en ratifiant implicitement par son développement même deux principes indiscutés et indiscutables, deux dogmes fondamentaux. Certes, cette étude ne s’appesantit pas historiquement sur le versant subjectif de l’a priori universel de la corrélation : c’est que cet a priori, matriciel pour toute phénoménologie, reconnaît minimalement avec Kant que « tout apparaître sera désormais un »m‘apparaître » »[4], que le sujet devient donc la condition de l’apparaître. Autrement dit, bien que la transcendantalité subjective sera repensée à fond et endossera diverses figures dans le courant phénoménologique, celui-ci reprend la prémisse kantienne selon laquelle le renvoi de l’apparaître au sujet est éidétiquement prescrit. En revanche, sur son versant objectif, la corrélation phénoménologique rompt avec la prémisse kantienne qui posait le distinguo entre »la chose dans le phénomène » (l’objet) et »la chose en soi » (hors phénomène). Au §43 des Ideen 1 Husserl dénoncera cette duplicité des apparaissants comme une « erreur principielle » et affirmera là-contre que la chose qui se manifeste pour nous c’est la chose en soi, c’est la chose elle-même. Par ce refus de la duplicité des apparaissants, la phénoménologie conteste et brouille « la duplicité de l’apparaître »[5] qui distinguait entre un apparaître relativisant, fini (ce qui est pour moi n’est pas l’être lui-même) et un apparaître absolu, infini (pour lequel l’être apparaît tel qu’il est en lui-même) puisque pour Husserl même Dieu percevrait par esquisses et la subjectivité atteint la chose en soi – fini et infini se dialectisernt. Ce premier dogme de la phénoménologie a beau dérelativiser l’expérience humaine, désanthropologiser la phénoménalité humaine, toutefois, et c’est « l’hypothèse »[6] de lecture de cette étude, il ne parvient pas à abattre la duplicité de l’apparaître, et à définitivement déconfiner l’humanité de la finitude à laquelle Kant l’avait astreinte. Effectivement, ce premier dogme présuppose que l’apparaître demeure « fini en un sens supérieur »[7], au sens où il ne fait pas être l’apparaissant, mais se contente de recevoir, de dévoiler une réalité qu’il n’engendre pas. A la rigueur, on pourrait dire que ce dogme infinitise déjà la finitude puisqu’il rend le sens de l’apparaître univoquement fini en posant un interdit absolu quant à l’ »existence » d’un apparaître proprement infini, c’est-à-dire productif de l’apparaissant, alors que Kant ne posait là qu’un interdit relatif en faisant d’un tel »apparaître engendrant » l’apanage du seul »Être suprême ». Dans la foulée, L’introduction de notre ouvrage énonce le second dogme de la phénoménologie historique : celle-ci a beau réinjecter de l’infini dans l’apparaître – soit en décrivant un infini potentiel, c’est-à-dire l’horizon du monde excédant l’étant ; soit en rendant compte d’ infinis actuels, c’est-à-dire d’événements excédant, débordant l’horizon – elle entérine systématiquement l’improductivité de l’apparaître. Le monde comme l’événement sont toujours reçus. Autrement dit, « Infinitiser la réceptivité »[8] n’est en rien la dépasser. Ce second dogme infinitise à nouveau et plus radicalement encore la finitude en son sens kantien fondamental. En repérant la double dogmatique du versant objectif de la corrélation phénoménologique, en montrant que ces deux principes théoriques ne font que renforcer le dogme kantien de la finitude, Grégori Jean exhibe l’appartenance profonde de la phénoménologie à la philosophie de Kant.
« En dépit des transgressions du kantisme »[9], dire que la phénoménologie historique est restée fidèle à la thèse rectrice de Kant qui condamne l’homme à la finitude, c’est signifier deux choses en même temps : d’une part, que la tradition phénoménologique s’est constituée comme « une doctrine de l’impuissance de l’apparaître »9 – dans le cas de la phénoménalité événementielle, on atteint même à une « archi-impuissance »[10] dans la mesure où la réception de l’apparaissant excessif devient problématique pour ne pas dire traumatique quant aux conditions ordinaires de manifestation. D’autre part, cette saisissante prise de recul sur la philosophie transcendantale permet de relativiser les dépassements : les deux dogmes de la phénoménologie renvoient à des ruptures et des transgressions réelles mais locales qui n’ont fait que consolider, radicaliser le paradigme kantien qu’elles prétendaient délaisser. Et si ces dépassements ont bien adoubé la pensée de Kant comme archê – c’est-à-dire comme le commencement qui commande à la tradition transcendantale -, s’ils se sont montrés impuissants à faire advenir un nouveau paradigme, c’est qu’ils n’ont jamais entrepris le renversement du dogme fondamental de l’impuissance de l’apparaître.
- Les deux renversements et leur soumission secrète
Aux yeux de Grégori Jean seuls deux phénoménologues se sont aventurés à renverser les dogmes kantiens de la phénoménologie. Depuis les années 90, c’est d’abord la pensée de Michel Henry qui s’y attelle vigoureusement. Par contraste avec l’apparaître mondain essentiellement structuré par l’extériorité, la différence, l’indifférence et surtout l‘indigence ontico-ontologique ; l’apparaître vital se caractérisera par une intériorité réciproque, une identité et une non-indifférence avec son apparaissant subjectif, mais surtout par sa fécondité ontologique en tant que cet apparaître vital génère la subjectivité vivante seule capable de « faire être l’action effective », libre[11] – on peut même se demander s’il n’y a pas ici un double engendrement, du moins une dualisation du faire être : celui du vivant et celui de l’action. Quoiqu’il en soit cette étude démontre parfaitement qu’Henry envisage d’articuler deux apparaîtres : le puissant apparaître vital et l’impuissant apparaître du monde – bien entendu il faudrait montrer que pour Henry il s’agit d’une articulation hiérarchique, que l’apparaître du monde, l’hétéro-affection dérive de l’apparaître vital originaire, de l’auto-affection. En développant une phénoménologie où la Vie désigne cette puissance d’engendrement immanent du vivant libre, Henry aménage à l’humanité un accès à la phénoménalité originaire et générative que Kant lui avait refusé. Si cette pensée nous ouvre au faire être de l’apparaître de la vie – un faire être d’ailleurs scrupuleusement distingué des notions de création et de production au sens heideggerien -, si elle rend possible d’éprouver la puissance de l’apparaître et renverse par là les interdictions historiques relative ou absolue ; pour autant, elle ne tombe jamais dans l’illusion transcendantale, qu’Henry a plusieurs fois dénoncé, selon laquelle l’homme serait le détenteur de cette puissance. Bien que la phénoménalité humaine communique, via l’auto-affection, avec la phénoménalité proprement infinie, puissante, et pour tout dire divine ; elle demeure humaine, finie en ce que ce n’est pas elle qui s’apporte dans la vie : le vivant est engendré, auto-affecté il naît de la Vie absolue qu’Henry identifie à Dieu. Dans la mesure où l’action que le vivant engendre est conditionnée par la génération de celui-ci, par la Vie, on peut finalement se demander si le rétablissement henryen de la puissance de l’apparaître subjectif ne radicalise et n’aiguise pas à nouveau la finitude humaine, sa condition réceptive : le sujet n’est plus fini au sens où il est réceptif d’un contenu transcendant mais au sens où il se reçoit lui-même en tant qu’engendré immanent – seule la Vie divine détient véritablement la puissance de l’apparaître.

Face au renversement henryen du dogme de l’impuissance, du dévoilement, une autre figure de ce renversement est abordée : celle, préfigurée par Mikel Dufrenne dans les années 60 (et peut-être même par l’idéalisme allemand) mais véritablement opérée par la première phénoménologie de la nature de Renaud Barbaras. Avec une grande lucidité herméneutique, Grégori Jean repère l’enchevêtrement problématique de deux chemins de pensée au sein d’une première architectonique que la trilogie barbarassienne échafaude[12]:
1/ Le premier chemin de pensée – d’inspiration patočkienne et déjà défriché dans La vie lacunaire, ressort d’une « philosophie de la perception »[13] en tant qu’il en vient à penser la »phusis » comme « une dynamique phénoménologique »[14], un procès gestaltiste d’individuation (figure/fond). Outre que cette première voie ne parviendrait pas vraiment à penser un apparaître primaire anonyme, non-subjectif – le monde restant le « sujet » ou le « quasi-sujet » de ce premier niveau d’apparaître -, elle réduit cet apparaître primaire à n’être qu’un « proto-dévoilement »[15], et finalement conceptualise la »phusis » comme une archi-vie impuissante, source des essences mais non des existences. Ainsi, ce premier chemin de pensée trace une différence de degré entre l’apparaître »phusique » et l’apparaître des vivants : la visibilité rassemblée de celui-ci ne fait que prolonger la visibilité intrinsèque et éparse de celui-là. Dit autrement, Barbaras pense ici un pli dans l’ordre général de la visibilité, une « duplicité dans l’apparaître »[16] dévoilant, impuissant.
2/ Le second chemin de pensée barbarassien relève, lui, « d’une philosophie de la puissance »[17] et rétablit selon Grégori Jean une différence de nature entre les 2 apparaîtres. Tandis que l’apparaître secondaire, subjectif fait paraître, dévoile ; l’apparaître primaire lui est ressaisi comme une puissance ontogénétique qui fait advenir essence et existence, comme une surpuissance qu’on peut appeler alors à bon droit une phusis. Cette fécondité ontologique fait de la phusis un mode d’apparaître véritablement autre que celui du monde comme horizon indigent : cette seconde voie enjoindrait donc à « assumer une duplicité de l’apparaître lui-même »[18]. L’instance métaphysique qui assurera la suture entre les deux apparaîtres, entre la nature et le vivant sera identifiée à une scission archi-événementiale qui affecte et affaiblit la phusis en la séparant d’elle-même au sein d’elle-même. Sur ce point deux interrogations peuvent surgir :
- a) La différence entre la phusis surpuissante et le sujet dévoilant renvoie-t-elle bien à une différence de nature pour Barbaras ? N’aurait-on pas plutôt affaire à une »différence puissancielle » irréductible à une différence de degré et de nature ? En effet, bien que la nature fasse être les étants non-vivants, et que les sujets vivants ne fassent que paraître les étants, pour autant nature et vivant semblent demeurer dans l’ordre du faire, du mouvement. Phusis et vivants sont tous deux de nature dynamique, et c’est pourquoi l’impuissance fondamentale, l’indigence ontologique du sujet n’est pas synonyme d’impuissance absolue mais reste l’envers d’une puissance de dévoilement, d’une »force voyante » dirait Patočka.
- b) Si c’est bien la séparation archi-événementiale qui engendre les vivants ne doit-on pas reconnaître une puissance spécifique, une fécondité ontico-ontologique à l’archi-événement, ou du moins au mariage de sa négativité inapparaissante avec l’apparaître surpuissant de la phusis ?
Il n’en reste pas moins que pour Grégori Jean la superposition d’une différence de degré et d’une différence de nature, d’une différence de visibilisation et d’une différence de puissance demeure problématique. Plus exactement, cette tentative pour concilier la duplicité dans l’apparaître et la duplicité de l’apparaître aboutirait à deux écueils : d’une part, elle tomberait dans l’illusion transcendantale propre à l’idéalisme absolu que dénonce Henry : au fond, elle reconduirait une confusion éidétique qui consiste à pourvoir spéculativement d’une puissance ontogénétique l’apparaître du monde reconnu par ailleurs phénoménologiquement indigent. Bref, elle n’effectuerait qu’un renversement sophistique du dogme kantien et phénoménologique de l’impuissance de l’apparaître. D’autre part, cette superposition ferait vaciller l’architectonique de la trilogie : le discours cosmo-métaphysique serait contraint de faire osciller la nature de la dualité des apparaîtres, de la ressaisir tantôt suivant le degré tantôt suivant la nature, tantôt suivant la continuité tantôt suivant la rupture, et de compenser indéfiniment l’une par l’autre. Cette hésitation perpétuelle entre monisme ou dualisme de l’apparaître serait finalement le signe d’une incompatibilité structurelle, d’une fragilité architectonique appelant à révision.
En évitant de s’engouffrer dans une comparaison du concept de »vie » qui aurait abouti à opposer diamétralement la pensée de Henry à celle de Barbaras, la grande acuité de cette étude permet de mettre en évidence l’unité souterraine des deux démarches. L’une comme l’autre tentent de renverser le dogme de l’impuissance de l’apparaître, franchissent le mur de l’apparaître dérivé (intuitus derivatus) et investissent le territoire de l’apparaître originaire (intuitus originarius) – l’une comme l’autre défendant l’épreuve affective d’une origine engendrante (qu’elle soit la Vie ou la phusis). Bien entendu, il faut reconnaître qu’il y a bien deux façons de renverser ce dogme : soit avec la phénoménologie de la nature de la trilogie barbarassienne en affirmant un apparaître phusique surpuissant ; soit avec la phénoménologie henryenne de l’agir et son « renversement »anti-naturaliste » »[19] en affirmant la puissance de la vie subjective. Mais il faut aussi reconnaître que ces renversements restent sans doute imparfaits, inachevés car l’articulation entre les deux apparaîtres demeurent problématique dans ces deux versions : chez Barbaras on a vu qu’une superposition de différences compromettait la stabilité de l’édifice ; et chez Henry l’archi-factualité du dualisme de l’apparaître ne rend pas spécialement intelligible la dérivation de l’apparaître mondain à partir de l’apparaître vital. En réalité, la difficulté à articuler ces deux apparaîtres témoigne du caractère « contradictoire » de ce dualisme, de ce que Grégori Jean appelle « l’archi-dogme »[20] kantien. Ainsi, Henry et la trilogie barbarasienne demeurent soumis à l’archi-dogme de la duplicité des intuitions, des apparaîtres. Pour accomplir le renversement jusqu’au bout, il ne s’agit donc pas seulement de thématiser un apparaître fécond, il faut, plus profondément, considérer cette duplicité de l’apparaître comme dérivée, déjà abstraite, et penser l’unité de l’engendrer et du dévoilement au gré d’un monisme phénoménologique radical. Autrement dit, renverser le kantisme ne signifie plus seulement franchir le mur entre les deux apparaîtres, mais renverser le mur lui-même, abattre ce mur qu’on a toujours déjà présupposé, et saisir « qu’il n’y a là aucun mur à franchir »20. Aux dires de Grégori Jean, ce qui permet de franchir le pas en ne franchissant pas le mur, c’est la nouvelle phénoménologie de la nature que Barbaras élabore dans son ouvrage L’appartenance .
II/ Une puissance prospective
- L’imminence de la révolution
Au regard rétrospectif ample et acéré qui décèle à la fois les dogmes secrets qui cadenassent la tradition phénoménologique et l’importance des deux auteurs qui ébranlent ces verrous, répond un regard prospectif aussi massif qu’original. Sous forme d’une alternative, cette étude nous livre d’abord un diagnostic prédictif tout à fait saisissant. Ou bien la phénoménologie se referme sur ses deux dogmes fondamentaux, et fidèle à Kant, se mure dans une phénoménalité réceptive, impuissante ; mais alors « son histoire est tout simplement achevée. »[21]. Ou bien « la phénoménologie possède encore un avenir » si et seulement si, au-delà des transgressions qui infinitisent la finitude de l’apparaître, elle effectue « un authentique renversement »[22] pour renouer avec la puissance de l’apparaître. Selon Grégori Jean si ce renversement n’est réellement entrepris qu’à partir des années 90 (bien après son annonciation), c’est qu’auparavant les phénoménologies historiques investiguaient patiemment toutes les voies possibles au sein de l’apparaître impuissant. C’est donc suivant une logique de l’épuisement, que l’étude peut déduire que l’histoire de l’apparaître fini est finie. Certes, en conceptualisant un apparaître fécond, Henry et Barbaras ont permis que la fin de cette histoire ne soit pas synonyme de fin de la phénoménologie, ils ont bien initié « un puissant renouvellement collectif »[23]. Cependant, leurs deux perspectives n’ont pas accompli le renversement complet du kantisme : on l’a vu, elles sont restées prisonnières de l’archi-dogme kantien. Au final, la force de cette sentence disjonctive à propos de la phénoménologie contemporaine – promettant sa fin ou son renouvellement – consiste à faire sentir que le renversement authentique, la « révolution »[24]en tant que telle n’est ni à venir dans un futur indéterminé, ni déjà advenue, mais qu’elle est imminente. Et si la prospection des Puissances de l’apparaître ne vaticine jamais, si elle prédit à peine, c’est que son crucial chapitre conclusif se charge d’esquisser le programme de cette révolution de l’apparaître, de cette nouvelle voie hors de la duplicité de la phénoménalité.
- Vers un panthéisme phénoménologique
En fait, selon Grégori Jean c’est la « rotation ontologique »[25] revendiquée par L’appartenance[26] de Barbaras qui ouvre à l’imminence d’une révolution en phénoménologie, qui œuvre enfin à la possibilité de renverser l’archi-dogme. C’est que cette rotation, cet insigne mouvement sur place amène à identifier l’archi-mouvement de la phusis et l’archi-événement[27] – que la trilogie distinguait -, et par là, elle permet de nous débarrasser de la séparation événementiale, du mur de négativité pure entre les deux apparaîtres. Mais alors que pour notre auteur L’appartenance est encore marquée par des »déclarations résiduelles »[28] sur la dualité entre phusis et phénoménalité dévoilante, c’est la conclusion de l’étude qui accomplira explicitement cette rotation ontologique en identifiant purement et simplement ces deux instances, c’est-à-dire en affirmant la coïncidence originaire de l’engendrement et du dévoilement. Le mérite de cette conclusion c’est donc qu’elle ne se présente pas tant comme l’inflexion radicalement moniste, voire comme l’interprétation phénoménologico-spinoziste du livre de Barbaras ; mais plutôt comme une proposition autonome et consistante de »panthéisme phénoménologique » – bien que Grégori Jean puisse continuer de nourrir une « saine défiance »[29] envers ce syntagme – sur laquelle il me faut revenir. Le prodigieux monisme qui soutient l’unicité de l’apparaître et l’identité de sa puissance et de son impuissance doit être bien compris. La corrélation phénoménologique doit désormais être pensée comme un mode de la phusis, de l’engendrement cosmologique dans la mesure où « notre manière de dévoiler les étants est une manière pour la nature de les faire être »[30]. En effet, notre apparaître subjectif humain, en tant qu’expérience de la réalité indépendante de nous[31], signifie ipso facto l’avoir lieu de la nature. Dans ce cadre, on comprend vite que plus la réceptivité est patente, plus le dévoilement est opérant et plus le pouvoir de l’apparaître s’effectue, plus le sujet a affaire à une nature. Au fond, plus on ignore notre identité avec la nature, plus on accomplit la puissance ontogénétique de la nature. Ou encore, plus l’impuissance de notre phénoménalité est prégnante, plus cette même phénoménalité a la puissance d’engendrer la réalité. C’est pourquoi Jean peut conclure page 115 que l’humanité n’est la nature qu’à son insu – par là la philosophie johannique de l’insu se voit renouvelée et approfondie[32].

A la différence de l’architectonique de Barbaras, le panthéisme de Grégori Jean ne reconnaît plus d’impuissance à coïncider avec l’origine, la phusis ; il établit bien plutôt notre impuissance, notre incapacité à savoir notre coïncidence avec l’origine. Certes, il s’agit d’une impuissance paradoxale car elle est en même temps une puissance, dans la mesure où c’est notre ignorance de cette coïncidence qui l’assure et opère l’engendrement de la nature, sa production comme réalité. Cette ignorance féconde a pour envers une croyance fondamentale : tout homme se croit séparé du monde, exilé de la nature – sans pour autant se savoir séparé car alors il ne pourrait plus y croire et cela impliquerait qu’il soit en rapport à une patrie, à une origine distincte de lui (alors qu’il lui est identique). En ce sens, parce que l’oeuvre de Barbaras, L’appartenance y compris, ne cesse de travailler autour de la séparation ontologique et du désir de réconciliation, elle serait victime de cette croyance en la séparation qui constitue l’illusion transcendantale primordiale propre à notre condition humaine. De son côté Grégori Jean soutient qu’il n’y a en réalité aucune séparation et qu’il n’y a seulement qu’une indéracinable « apparence de négativité »[33] – à la rigueur seule l’ignorance de notre inséparation avec la nature représente une figure de négativité. Enfin dans ce »panthéisme par ignorance », le rôle de l’affectivité sera évidemment toute autre que chez Barbaras : le sentiment barbarassien signifiait la finitude de la finitude en octroyant un accès inespéré à la patrie phusique par-delà notre séparation réelle avec elle ; ici le sentiment johanique ne peut qu’être celui de la disparition de l’archi-dogme, de l’identité absolue des deux apparaîtres, un sentiment dégrisé où se donne « à éprouver la réalité même de nos vies, et rien de plus. »[34] On le voit, la puissante conclusion de cette étude fait être une proposition originale, ou plutôt elle lance les idées directrices d’une phénoménologie nouvelle libérée de l’archi-dogme kantien, elle ébauche, dans son dialogue critique avec L’appartenance, les fondements d’un monisme phénoménologique dont la radicale rotation ne peut susciter l’admiration sans appeler la discussion.
Cette présentation a tenté de rendre compte de l’itinéraire de cette étude aussi dense que conséquente : après avoir démontré l’insuffisance des dépassements – les dogmes directeurs de la phénoménologie rompant moins avec le dispositif kantien qu’ils ne manifestaient une parenté profonde avec lui autour de l’impuissance de l’apparaître -, Les puissances de l’apparaître nous ont fait apparaître deux puissances, deux apparaîtres féconds, productifs : la vie subjective ou l’archi-vie de la phusis selon qu’on se plaçait dans la phénoménologie henryenne ou dans celle de Barbaras. Toutefois, ces deux premiers ébranlements des dogmes phénoménologiques, ne représentèrent que le premier stade d’un renversement qu’il fallait redoubler et que Grégori Jean se proposa de mener à bien en tranchant en faveur d’une phénoménologie de la nature qui fit droit à un monisme de l’apparaître à la fois impuissant et puissant seul capable d’émanciper la phénoménologie de l’archi-duplicité kantienne. Cette esquisse programmatique d’un panthéisme phénoménologique imminent ne peut manquer de susciter quelques remarques et interrogations :
1/ Si l’ignorance insigne de l’homme est bien la manière dont la nature se produit comme réalité, alors ne devons-nous pas conclure que plus un étant se vit comme réceptif, dévoilant, et plus la nature est engendrée ? Et si plus en faisant paraître plus l’étant accomplit le faire être ; alors ne faut-il pas reconnaître que le monisme johannique ne radicalise pas seulement la rotation ontologique de L’appartenance, il en inverse également la prémisse selon laquelle plus l’étant participe à la phusis, plus elle le fait être, l’engendre proche d’elle, et plus il la fait paraître ? Bien entendu, il ne s’agit pas d’une consécution chronologique, mais d’une inversion ontologique qui signifierait que chez Jean le faire être dépendrait du faire paraître, quand le faire paraître dépend du faire être chez Barbaras.
2/ Ce panthéisme envisage-t-il de penser les autres modes de la nature ? En viendrait-il à échelonner les autres phénoménalités (animale, végétale, etc) selon des degrés d’ignorance où l’homme serait l’ignorant par excellent[35], c’est-à-dire celui qui se croit le plus séparé de la nature (et ainsi l’accomplit comme telle) ? Et dans ce cadre que deviendrait le minéral ? S’il ignore l’ignorance (comme la croyance), il n’y aurait pour lui pas de nature tellement sa coïncidence avec elle serait pleine et entière (la négativité de l’ignorance est absente) et il la serait seulement ; ou bien n’appartiendrait-il même plus à la nature en tant que par lui aucune nature ne s’engendre.
3/ Depuis l’Humanité à son insu, Grégori Jean séjourne dans une phénoménologie matérielle au sens henryen de sorte qu’il s’en tient à analyser la matière de l’apparaître. Mais cette perspective, aussi féconde soit-elle, n’appelle-t-elle pas à complément, c’est-à-dire à d’autres séries d’analyses concernant non plus la texture pure de l’apparaître en tant que tel, mais aussi la thématisation des moments de l’apparaître (l’ego, la nature) et la détermination précise de leur sens d’être ?
4/ Plus profondément, en revendiquant l’ « identité absolue (…) entre l’apparaître et l’être – rien d’autre par conséquent que cet »appar-être » »[36] Grégori Jean ne reprend-t-il pas en l’absolutisant la décision fondamentale de l’ontologie de Michel Henry qui défendait déjà cette identité pure et simple ? Alors que chez Henry, l’être originaire et puissant – la Vie qui engendre le vivant – est bien identique à son apparaître subjectif, affectif ; chez Grégori Jean, l’être originaire et puissant – la nature qui s’engendre comme réalité – doit être compris comme identique à l’apparaître subjectif, dévoilant, réceptif, impuissant. Si cette intuition est juste, alors on pourrait dire que le panthéisme de Grégori Jean est un henryanisme élevé à la puissance de la nature qui désormais peut faire l’économie d’un apparaître dérivé, et qui dès lors peut, plus radicalement encore qu’Henry, critiquer la pertinence ontologique de la séparation (elle n’est pas seulement secondaire, mais elle est inexistante pour ce panthéisme). En tous les cas, il y a là une véritable disjonction entre la décision d’identifier sans reste être et apparaître – d’ailleurs on peut aussi se demander si cette identité intégrale ne compromet pas la grammaire de l’apparaître – et celle de Barbaras qui veut qu’entre être et apparaître ne se joue ni une simple différence ni une simple identité puisque l’être et l’apparaître sont plutôt pensés dans L’appartenance comme l’avers et l’envers directionnels d’un même mouvement.
Conclusion
Ces remarques ouvertes étant faites, il faut à nouveau saluer Grégori Jean d’avoir su, comme le personnage de Roberto Juarroz qu’il cite en exergue, dessiner de larges fenêtres sur le passé et l’avenir de la phénoménologie, d’avoir su faire de ce »petit livre » un promontoire à tout le moins renversant.
[1] Grégori, Jean., Les puissances de l’apparaître. Études sur M. Henry, R. Barbaras, et la phénoménologie contemporaine, Wuppertal, Association Internationale de phénoménologie : Mémoires des Annales de phénoménologie, 2021. Désormais noté PA.
[2]Grégori, Jean., L’humanité à son insu. Phénoménologie, anthropologie, métaphysique, Wuppertal, Association Internationale de phénoménologie : Mémoire des Annales de phénoménologie, 2020.
[3]Au fond, L’humanité à son insu et Les puissances de l’apparaître représentent un dialogue continué avec Kant et l’infrastructure kantienne de la phénoménologie.
[4]PA, p24.
[5]PA, p24.
[6]Ibid., p25.
[7]Ibid., p26.
[8]Ibid., p30.
[9]Ibid., p27.
[10]Ibid., p70.
[11]Ibid., p72.
[12]Cette trilogie se compose de Dynamique de la manifestation (2013), Métaphysique du sentiment (2016) et Le désir et le monde (2016).
[13]PA, p90.
[14]Ibid., p81.
[15]Ibid., p89.
[16]Ibid., p84.
[17]Ibid., p90.
[18]Ibid., p88.
[19]Ibid., p67.
[20]Ibid., p101.
[21]Ibid., p70.
[22]Ibid., p71.
[23]Ibid., p9.
[24]Ibid., p23.
[25]Ibid., p103.
[26]Renaud, Barbaras., L’appartenance, vers une cosmologie phénoménologique, Louvain, Peeters, 2019.
[27]Voir la fameuse, parce que déterminante, note page 73 de L’appartenance.
[28]C’est l’expression que Grégori Jean utilise aux pages 107 et 122 et qu’il exemplifie à la page 125 de cette présente étude.
[29]PA, p10.
[30]Ibid., p110.
[31]L’humanité à son insu insistait déjà en ce sens sur le vécu proprement métaphysique, absolutisant de la phénoménalité humaine.
[32]Dans L’humanité à son insu la phénoménalité humaine ne se savait justement pas telle puisqu’elle désigne un vécu sans coefficient anthropologique, un vécu métaphysique.
[33]PA, p122.
[34]Ibid., p127-128.
[35]PA, p128 : « l’homme est un mode qui ignore la substance et participe de sa puissance à proportion de l’ignorance dans laquelle il se tient de le faire » de sorte que l’homme est « un mode qui ignore sa substantialité comme aucun autre étant que nous connaissons n’est capable de l’ignorer et qui, ce faisant, s’ignore comme »mode » et circonscrit ainsi, pour la puissance ontogénétique de la substance, un lieu qu’aucun autre étant ne peut lui ménager. » Ces ultimes formules laissent penser que les autres modes de phénoménalité sont accessibles d’une manière ou d’une autre.
[36]Ibid., p115.