Devoir présenter « Gilles Deleuze » dans un format court n’est pas tâche aisée, même si trois auteurs de langue française s’y étaient déjà essayés avec succès -, nous pensons à F. Zourabichvili, A. Badiou et, plus récemment, A. Bouaniche (respectivement : F. Zourabichvili, Deleuze. Une philosophie de l’évènement, Paris, PUF, 1994 ; A. Badiou, Deleuze « La clameur de l’Etre », Paris, Hachette, 1997 ; A. Bouaniche, Gilles Deleuze, une introduction, Paris, Pocket, 2007.).
Pour mener à bien une telle tâche, le premier avait fait le choix d’entrer dans la philosophie de Deleuze à partir du concept d’évènement, tandis que le second – pour des raisons qui tiennent à sa propre conception de la philosophie – interprétait la pensée deleuzienne comme une « ontologie de l’Un ». A. Bouaniche, dans la continuité d’un certain bergsonisme, identifiait quant à lui le projet deleuzien à celui de « penser la nouveauté ».
Un point de vue original : la notion d’œuvre
Face à ces trois tentatives, Igor Krtolica a dû rencontrer une difficulté, au moins initiale, qui est de devoir s’en démarquer, sans pour autant déroger au « genre » de l’exercice – surtout lorsqu’il s’agit de la collection « Que sais-je ? » – qui consiste à devoir synthétiser, en une centaine de pages, une philosophie aussi riche et complexe que celle de Deleuze. Or il nous semble que du fait même de son approche sélective et dense, I.K. réussit son entreprise1 tout en optant pour une approche assez différente que celle de ses prédécesseurs. En effet, il ne s’agit pas ici de réunir les thèses deleuziennes autour d’un maillon centralisateur mais, au contraire, de les faire rayonner à partir de sa logique immanente. Pour ce faire, I.K. fait le choix de ne pas élire un concept prépondérant (l’évènement, l’Un, etc.), mais s’appuie sur la richesse sémantique de la notion d’œuvre, laquelle nous apparaît comme un fil directeur de sa relecture de Deleuze. Non seulement l’œuvre, dans ce contexte, désigne objectivement « l’œuvre deleuzienne » – et donc la chose même qu’il s’agit d’exposer – mais, comme nous voudrions le montrer, elle permet d’adopter, sur la pensée deleuzienne, un regard très pertinent, parce qu’à la fois oblique et immanent.
Lecture oblique de l’œuvre deleuzienne
Oblique, en ce que la notion d’œuvre comporte l’avantage de ne pas avoir d’emblée à se situer en un point de référence interne à la philosophie de Deleuze, mais de l’envisager dans sa totalité dynamique. Pour ne prendre qu’un exemple, on trouve dans la première partie (« la vie et l’œuvre de Deleuze »), un premier chapitre qui retrace, dans ses grandes lignes, « la vie » de Deleuze, et dont la conclusion est la suivante : « Le 4 novembre 1995, Deleuze met fin à sa vie. Mais elle est passée dans son œuvre » (p. 18, nous soulignons).
Cette formulation retient notre attention car elle nous semble anticiper sur ce qu’il s’agit très exactement de démontrer dans ce (petit) livre, à savoir que « faire œuvre » pour Deleuze, c’est trouver le point de vue supérieur à partir duquel la vie et l’œuvre deviendraient, au moins virtuellement, indiscernables. D’où l’idée selon laquelle « la création de l’œuvre se confond avec la dissolution du moi » (p. 8), et que l’œuvre d’art soit pour Deleuze « l’expression d’un monde possible rendu indépendant du sujet qui l’exprime » (p. 54). Où « faire œuvre » signifie faire en sorte que l’œuvre réussisse à exprimer effectivement la vie dans sa plus grande intensité : « l’œuvre réussie, artistique ou philosophique, se définit par une certaine circularité dynamique où l’expérience nouvelle communiquée dans l’œuvre engendre à son tour un nouvel ordre d’expérience, à la fois vécu et pensé » (p. 28). Cette circularité entre l’expérience et l’œuvre, entre la vie et la pensée, parce qu’elle n’est pas simplement d’ordre philosophique, permet de comprendre en quoi l’art et la philosophie, chez Deleuze, reposent chez Deleuze sur un même problème : « le problème de l’œuvre est d’abord celui de Proust. Et si, chez lui, ce problème concerne l’art, Deleuze le revendique au même titre pour la philosophie. A quelles conditions exprimer le temps ou la différence dans une œuvre ? » (p. 51).
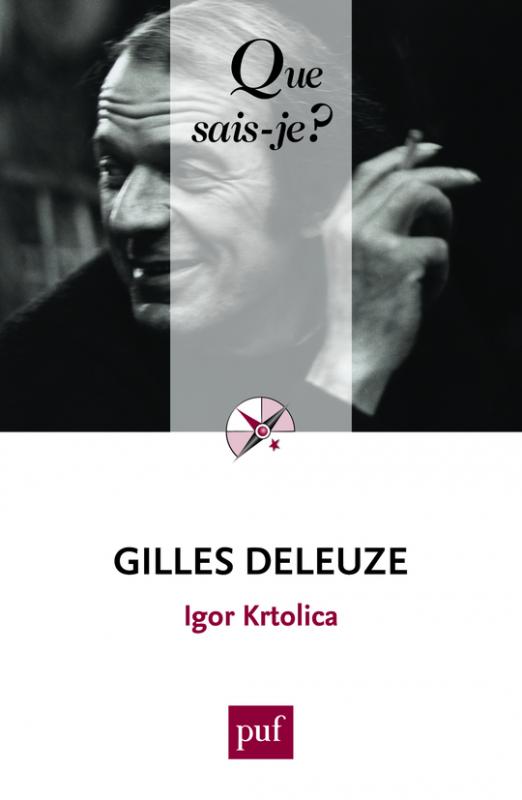
Mais, outre la lecture oblique que la notion d’œuvre rend possible, celle-ci permet également à I.K. de prendre parti pour une lecture immanente de Deleuze, ce qui a dès lors plusieurs implications.
La logique immanente à l’œuvre deleuzienne
La première consiste à montrer qu’il existe, par-delà l’hétérogénéité apparente des livres de Deleuze (histoire de la philosophie, littérature, cinéma, écriture à quatre mains avec F. Guattari etc.), une « logique de cette œuvre » (p. 20). Dans la continuité de sa thèse de doctorat « Le système philosophique de G. Deleuze (1953-1970) » (Thèse soutenue en 2013 sous la direction de P. F. Moreau) – I.K. identifie en effet la logique interne de l’œuvre deleuzienne à celle d’un système. La philosophie deleuzienne apparaît ainsi rétrospectivement comme une « philosophie systématique », à condition d’entendre ici par système non pas la grande identité réconciliatrice (Hegel) ou la « science rigoureuse » (Husserl), mais une « hétérogenèse » (p. 24) au sens où le système doit paradoxalement exprimer l’hétérogénéité du réel. Ce qui revient à dire que l’ambition systématique ne doit pas « contredire les exigences empiristes d’une philosophie de la différence » (p. 24). Si l’on suit la lecture de I.K., on trouve cette « théorie des systèmes » très tôt dans l’œuvre, dès Différence et répétition, et elle consiste à toujours penser deux mouvements parallèles ou deux « tendances de l’absolu » : le mouvement de la Nature (explication de la différence) et le mouvement de la Pensée (contraction de la différence). Où l’on retrouve la norme de « l’œuvre réussie », définie cette fois de manière systématique comme « une expression de la différence qui introduit la différence dans la pensée, c’est-à-dire une pensée qui force à penser » (p. 25).
La philosophie critique de Deleuze et Guattari
Mais la lecture immanente que poursuit I.K. comporte une autre implication qui nous semble plus décisive encore, en ce qu’elle permet de réunir ce que l’on a généralement tendance à opposer, à savoir le système et la critique. Ce qui conduisait, par exemple Alain Badiou, à dissocier nettement l’ontologie deleuzienne de la philosophie critique : « L’unifiant historial de la philosophie, comme voix de la pensée, comme clameur du dicible, c’est l’Etre lui-même. De ce point de vue, la philosophie de Deleuze n’est aucunement une philosophie critique »2.
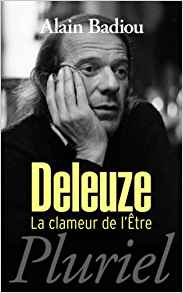
Or, ce que montre très bien I.K. – dans les trois chapitres qui composent la deuxième partie (« la philosophie de Deleuze ») -, en reconstruisant les deux versants, négatif et positif (destructeur et créateur), de la critique deleuzienne, c’est que Deleuze ne cesse, au contraire, d’articuler son système à la critique. Où il faut comprendre que la critique deleuzienne, dans le droit fil de Nietzsche (on y reviendra), ne découple jamais de son programme critique la destruction de la création. Forme immanente de critique s’appuyant sur une « théorie des devenirs », elle implique donc de toujours dégager de la négativité (destructrice) une positivité (créatrice).
Dans le premier chapitre (« Empirisme et critique »), il s’agit de « renverser le monde de la représentation » pour explorer un monde nouveau « subreprésentatif », celui de « l’œuvre à faire ». Dans le second chapitre (« Critique et politique ») consacré au projet commun de Deleuze et Guattari (L’Anti-Œdipe et Mille Plateaux), la critique a pour effet d’élargir la philosophie politique à une philosophie sociale du désir, où l’on retrouve comme un leitmotiv un versant négatif (l’auto-asservissement du désir au social) et un versant positif (former des agencements collectifs de désir capables de retourner la répression sociale du désir contre elle-même). Enfin, le dernier chapitre (« Politique et création ») s’attache, quant à lui, à montrer que dans les derniers ouvrages de Deleuze sur le cinéma jusqu’au « couronnement de son œuvre » (Qu’est-ce que la philosophie ?), il s’agit de « critiquer la civilisation du cliché (régime actuel de la représentation) pour lui arracher une « véritable image » (effort de création) » (p.102). De sorte que, sans renoncer à la périodisation classique de la philosophie de Deleuze (1953-1970 / 1970-1980 /1980-1993), I.K. dégage une profonde unité qui réside, méthodologiquement, dans l’exigence systématique et, matériellement, dans l’exigence critique :
« Pour Deleuze, la tâche critique ne se sépare donc pas du problème de l’œuvre à faire » (p. 27).
Dans le sillage de G. Sibertin-Blanc, l’auteur opte ainsi pour une lecture sociale et politique de l’ensemble de l’œuvre deleuzienne où par politique, il ne s’agit ni simplement d’un genre de la philosophie (la philosophie dite « politique »), ni d’un moment de l’œuvre (la collaboration avec Guattari), mais de la philosophie même telle que Deleuze l’a pratiquée toute sa vie : « sous ces conditions, nous n’avons plus aucune raison d’accepter l’alternative qu’on prétend parfois imposer au dernier Deleuze : ou bien la philosophie s’occupe des créations de la pensée, ou bien elle s’occupe de politique (spiritualisme ou bien matérialisme). Au contraire, le problème porte désormais sur le lien direct et secret entre les créations de la pensée et la résistance politique (spiritualisme = matérialisme) » (p. 102). Cette égalité, en dépit du fait qu’elle maintient des catégories qui n’ont peut-être plus de sens pour Deleuze, se justifie une fois de plus par la notion d’œuvre, l’œuvre réussie (dissolution du moi, expression de la différence dans la pensée) parvenant à faire fusionner la pensée et l’œuvre, la critique et la politique.
L’œuvre de Deleuze et Nietzsche
Si l’on adopte enfin une vue synoptique sur le devenir-œuvre de la pensée deleuzienne, on se rend compte que c’est Nietzsche qui fut la « révélation décisive » (p. 14). Il est d’abord celui qui a révélé « l’œuvre à faire » (p. 15), définissant un programme critique (la critique intempestive des valeurs et la création d’un avenir) que Deleuze réalisera durant la période guattarienne. Mais Nietzsche lui a révélé aussi tout un monde (subreprésentatif) que l’œuvre a justement pour tâche de porter à l’expression : « l’œuvre est un système qui s’est élevé au monde de la volonté de puissance, et qui est donc voué à l’éternel retour » (p. 59). Où l’on remarque que cette définition de l’œuvre rend caduque la question de savoir s’il s’agit ici de l’œuvre de Nietzsche ou celle de Deleuze, étant entendu que le point culminant de la pensée (son niveau supérieur, on l’a dit) se trouve atteint lorsqu’elle devient « œuvre de la pensée ». Reste le difficile problème de la pensée et de son œuvre que I.K. formule en termes de « précarité du partage entre l’œuvre et la folie » (p. 58). Et ce problème – ancré là aussi dans Nietzsche -, traverse, de manière plus ou moins explicite, l’ensemble de l’œuvre deleuzienne. D’abord lorsqu’elle recherche l’évènement du sens dans la coprésence du non-sens et du sens (Logique du sens). Puis – contre une certaine vulgate réduisant l’œuvre guattaro-deleuzienne à une apologie de la folie – lorsqu’il s’agit de sortir de l’alternative entre répression et schizophrénie par la création de concepts comme ceux d’agencement, de ligne de fuite et de déterritorialisation. Bref, si la référence nietzschéenne traverse l’ensemble de l’œuvre deleuzienne, ce n’est pas parce que Deleuze serait nietzschéen, auquel cas il serait usurpé de parler d’une œuvre deleuzienne, mais parce que c’est à travers la lecture de Nietzsche que Deleuze a conquis un « nom propre » en philosophie (p. 14) ; le paradoxe étant que ce nom propre signe une œuvre qui s’est donnée pour tâche de devenir œuvre de la pensée, et donc de dépasser la fonction-auteur.
Aussi, recommandons-nous vivement ce livre sur Deleuze qui, en dépit de ses contraintes éditoriales, réussit à reconstruire, par sa proposition de lecture immanente et critique, la philosophie deleuzienne dans son intensité et sa vitalité à travers l’insistance sur son devenir-œuvre.








