Jean-Marie Schaeffer a fait paraître, en 2007, un livre très profondément révolutionnaire, intitulé La fin de l’exception humaine1. Grossièrement résumée, la thèse de Schaeffer pourrait être ainsi énoncée : il n’est plus possible aujourd’hui de maintenir l’idée qu’il existe une spécificité non naturelle de l’homme. En d’autres termes, Schaeffer défend une position naturaliste, mais nuancée d’un refus du réductionnisme, qui constitue une tension permanente tout au long de l’ouvrage, et qui fait appel à des subtilités que ne semblent pas toujours avoir vues ses interlocuteurs. Quoi qu’il en soit de la réception de cet ouvrage, le livre décrit avec bonheur la raison pour laquelle les sciences contemporaines ne permettent plus de penser que l’homme constitue cela même qui se définirait comme un surcroît au vivant, sous le seul prétexte que la vie sociale, culturelle et politique témoigneraient de cette capacité d’arrachement à son inscription naturelle. Pour ce faire, Schaeffer propose de reconstruire le présupposé sur lequel repose cette idée d’une humanité définie comme surcroît par rapport à son inscription naturelle, cette idée selon laquelle l’homme serait doté d’une propriété émergente ontologique « en vertu de laquelle il transcenderait à la fois la réalité des autres formes de vie et sa propre « naturalité ». Cette conviction, je propose de l’appeler la thèse de l’exception humaine (autrement appelée désormais la Thèse). »2
I°) Sens et intention de la démarche de Schaeffer
Une bonne partie de l’ouvrage va consister à reconstruire cette fameuse Thèse, qui ne correspond pas à la pensée d’un auteur en particulier bien que, nous le verrons, Descartes constitue probablement quelque chose comme le paradigme de cette Thèse, mais qui désigne le présupposé métaphysique fondant l’idée d’une exception humaine et que partageraient un très grand nombre de philosophes dont Schaeffer retracera, dans les grandes lignes, les raisons pour lesquelles ces derniers adhèrent à la Thèse. La Thèse est donc quelque chose comme un « idéal-type » ainsi que le suggère Catherine Halpern3, à condition de préciser que cet idéal type n’a aucune portée sociologique, et demeure profondément philosophique.
Une fois précisé le statut épistémologique de la Thèse dont Schaeffer se fixe comme objectif de révéler l’inanité, il convient d’en fixer les caractéristiques principales ; Schaeffer en retient trois, qui lui paraissent essentielles :
– le refus d’adosser l’identité humaine à la vie biologique.
– La dimension sociale de l’homme permettrait à ce dernier de s’arracher à la nature.
– La culture constitue le lieu de l’identité humaine.
Ainsi que le révèlent ces trois caractéristiques majeures, il est certain que la Thèse n’existe pas comme telle dans une seule pensée ; ainsi, même chez Descartes qui sera conçu comme le paradigme même de la Thèse, on ne trouve pas l’idée que la culture soit le lieu de l’identité humaine ; ces caractéristiques éparses et non identifiables chez une philosophe en particulier, nous invitent donc non pas à chercher qui est visé, mais bien plutôt le présupposé idéologique structurant la Thèse : il est vrai que nous sommes habitués, héritiers du soupçon que nous sommes, à ne plus nous interroger sur le sens objectif des pensées, afin d’interroger exclusivement le qui es-tu au détriment du que dis-tu ? Schaeffer prend à rebrousse-poil cette manie héritée du soupçon et pousse le vice jusqu’à ne même plus se soucier de viser un auteur en particulier, comme si au fond le qui es-tu lui importait bien peu. Crime impardonnable à l’égard de la modernité, que ses détracteurs lui reprocheront, en essayant à tout prix d’identifier qui est visé par ses propos, créant ainsi un formidable décalage entre l’intention du texte et la réception qui en sera faite. Le présupposé donc qui structure les trois caractéristiques essentielles de la Thèse, c’est celui d’une transcendance ontologique de l’homme à l’égard de sa simple naturalité : est-il aujourd’hui possible de trouver dans les sciences contemporaines quelque chose comme une preuve ou un début de preuve, justifiant cette tradition instaurant l’exception humaine à partir d’une supposée transcendance à l’égard de la nature à laquelle il appartient ? La réponse de Schaeffer est, à cet égard, sans équivoque : non seulement, rien dans les sciences actuelles ne fait signe vers une telle transcendance, mais de surcroît, tout semble invalider cette Thèse d’une transcendance de l’homme à l’égard de la nature. Il me semble donc essentiel de bien voir ce point concernant la démarche de Schaeffer : il ne s’agit pas pour lui de savoir si, conceptuellement ou analytiquement, l’idée d’une auto-fondation du sujet est valable, ou si la société constitue conceptuellement une transcendance à l’égard de la nature ; non, il s’agit bien au contraire pour lui d’examiner si cette idée de transcendance résiste à l’expérience que nous proposent aujourd’hui les sciences.
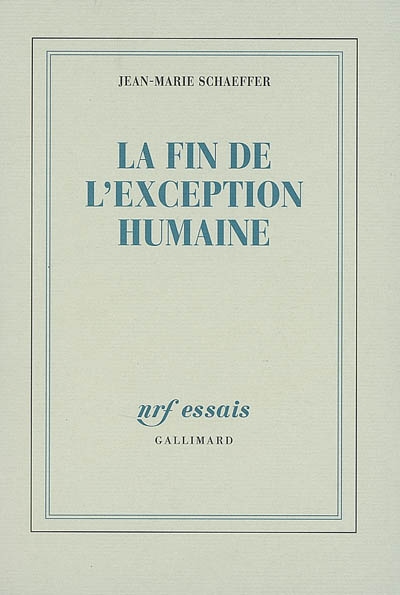
En ce sens, Elisabeth Lévy manque l’essentiel en posant la question suivante à l’auteur : « Quel sens a la démolition du « sujet » après Althusser, Deleuze ou Foucault ? »4 La question de la démolition analytique du sujet n’est ici pas au centre du livre, pour la raison expresse que Foucault, Deleuze et Althusser en sont restés à des positions analytiques de la destruction ; en d’autres termes, ils ont essayé de montrer par une analyse conceptuelle pourquoi, à leurs yeux, l’idée d’une auto-fondation de la subjectivité procédait d’une erreur fondamentale. Telle n’est pas la démarche de Schaeffer qui vise au contraire à confronter des savoirs empiriques à la notion intellectuelle du sujet, ce qui revient à dire que Schaeffer s’intéresse moins à la validité conceptuelle du sujet qu’à sa validité empirique. D’où sa réponse : « Mon but n’est pas de détruire le « sujet » ou la métaphysique, mais de réfléchir à une étude de l’humain qui intégrerait les connaissances apportées notamment par la biologie et la psychologie. »5 En d’autres termes, la démarche de Schaeffer est toute popperienne : la Thèse est invalidée par l’expérience, dont le rôle consiste précisément à falsifier une théorie. En outre, et c’est ce dont on s’aperçoit aisément dans le débat qui a suivi, les tenants de la Thèse cherchent à immuniser celle-ci, ou pour le dire en termes popperiens, cherchent à en refuser la falsifiabilité, c’est-à-dire en refusent eux-mêmes la scientificité sous le seul prétexte que l’étude de l’homme ne serait pas du même ordre que la science générale des étants, et que l’expérience scientifique ne saurait rien dire ni invalider de cette spécificité… C’est ce que Schaeffer appelle, me semble-t-il avec bonheur, le caractère « ségrégationniste » de la Thèse, c’est-à-dire cette espèce de pétition de principe voulant que les connaissances positives et expérimentales ne puissent pas atteindre le savoir réflexif que l’on aurait de soi, et ce en vertu de l’extériorité de ce dernier à toute science positive. La thèse ségrégationniste de la Thèse prétend « immuniser la théorie de l’exception humaine contre toute objection formulée au nom des connaissances externalistes que nous pouvons par ailleurs élaborer concernant l’être humain. »6 Et le responsable d’une telle connaissance ségrégationniste ne serait autre que le cogito cartésien…
II°) Plongée dans la Thèse
Pour le dire en un mot, la Thèse affirme que l’homme constitue cela même qui transcende son inscription naturelle et qui entretient une différence de nature avec les autres vivants qui, eux, demeurent intégralement soumis à leur inscription naturelle ; cette possibilité d’une transcendance à l’égard de l’inscription naturelle et d’une différence par rapport aux autres vivants désigne l’exception humaine que Schaeffer se donne comme mission de révéler comme fausse. La thèse repose donc sur un « dualisme ontologique »7 mais aussi sur ce que Schaeffer appelle, avec un suffixe tout derridien le gnoséocentrisme : qu’est-ce à dire ? Cela signifie que l’exception humaine reposerait sur la manière dont l’homme acquiert ses connaissances sur lui-même ou, pour le dire avec Schaeffer, « la Thèse pose que la connaissance de ce qui est proprement humain dans l’homme exige une voie d’accès et un type de connaissance qui se distinguent radicalement des moyens cognitifs qui nous font connaître les autres êtres vivants et la nature inanimée. »8 Pour le dire clairement, la réflexivité de la conscience ainsi que les sciences humaines incarneraient de manière privilégiée le lieu de l’illusion d’un homme autre ontologiquement parlant que la nature.
C’est donc tout naturellement que Schaeffer est porté à interroger les textes cartésiens afin d’en sonder la manière par laquelle la conscience de soi constituerait le lieu d’une transcendance à l’égard de l’ordre naturel. Ce passage obligé par Descartes n’est probablement la partie la plus heureuse du livre : d’une part, elle brouille le sens même de la Thèse, tant il semble que Descartes soit celui que vise la Thèse, alors que cette dernière est bien plus vaste et, d’autre part, la lecture que fait Schaeffer de Descartes n’est pas forcément la plus honnête qui soit. Ainsi insiste-t-il lourdement sur la distinction de la res cogitans et de la res extensa, distinction qui fonderait selon lui le dualisme ontologique, sans jamais véritablement rappeler le problème de l’union tout aussi réelle des deux substances chez Descartes. En outre, Schaeffer fait du cogito le fondement du cartésianisme alors que, rigoureusement parlant, le fondement réel, et la certitude première, me semble être bien plutôt l’ego comme certitude ontologique résistant à tous les doutes. Et, croyant que le cogito constitue la première certitude, il commet une troisième erreur consistant à penser que le cogito se fonde lui-même, ce qui reviendrait à dire que le système est auto-fondé. Or, cela n’est évidemment pas le cas dans les textes cartésiens dans la mesure où la première certitude est celle de l’ego et n’est fondée qu’en vertu de ce que Jean-Luc Marion a magnifiquement appelé « l’altérité originaire de l’ego ». Par conséquent, affirmer que tout repose sur une auto-fondation du cogito, c’est là tirer Descartes vers une sorte d’idéalisme a posteriori, qui contredit très nettement les textes réels des Méditations. De cette erreur inaugurale, Schaeffer croit pouvoir déduire ceci : « à travers sa démarche d’autofondation la conscience de soi se prouve à elle-même sa distinction d’essence avec toute hétérodétermination « physique », renvoyant du même coup tout ce qui relève de la corporéité au statut d’une extériorité radicale, non proprement humaine (puisque le corps est une machine). »9 Cela serait valable si, et seulement si, nous assistions vraiment à une auto-fondation chez Descartes ; mais les textes disent exactement le contraire, et interdisent donc de suivre l’interprétation de Schaeffer qui, du reste, interdit de comprendre la possibilité de l’union réelle des substances dans l’économie de la pensée cartésienne. Cette erreur de la part de Schaeffer est d’autant plus étonnante que des commentaires déjà anciens, avaient vu cette impossibilité d’une autofondation de l’esprit chez Descartes, et la nécessité de l’union. Ainsi Jean Laporte concluait-il sa magistrale étude consacrée à Descartes en ces termes : « Si les thèmes favoris des Rationalistes sont : nécessité radicale, activité spirituelle constituante, autonomie, immanence, ceux de Descartes sont : transcendance divine, hétéronomie de l’esprit humain, passivité de l’entendement dans la connaissance, liberté en l’homme et en Dieu. »10
La critique à l’encontre de Descartes de Schaeffer porte ensuite sur la nature performative du cogito : le « je suis, j’existe » n’aurait aucun statut spécial en tant que toute énonciation d’une proposition implique l’existence de celui qui la prononce. « Je suis, j’existe » n’a aucun statut spécial. Toute énonciation d’une proposition implique l’existence de celui qui l’énonce. On a là « une preuve performative de l’existence de celui qui l’énonce, parce que toute énonciation est une exemplification de l’existence de celui qui l’énonce. A cet égard, énoncer « Je suis un corps », « Je suis un carré rond », ou « rgeeeddddjtygfv » constituent des preuves performatives tout aussi irréfutables de mon existence (au moment où cette proposition est énoncée) que l’est l’énonciation du cogito. D’où le caractère superfétatoire de la relation d’implication dans la première formulation (« Je pense, donc je suis ») : le fait de penser n’implique pas qu’on soit, il coïncide avec ce fait, puisque le penser est une modalité d’être ou d’exister. »11 Ici encore, la lecture de Schaeffer est infiniment contestable : Schaeffer croit que Descartes interroge le sens de l’affirmation : quoi que j’affirme, je suis, puisque pour affirmer, il faut être : telle serait la nature performative de la pensée cartésienne. Mais lire Descartes ainsi me semble manquer radicalement le nerf de son argumentation : ce que Descartes propose, ce n’est pas une auto-fondation de l’ego, mais bien plutôt une découverte de l’ego comme résistance à l’action du Trompeur : s’il y a un Trompeur, et s’il me trompe, c’est donc que je suis, ce qui revient à dire que l’accusatif de la tromperie signe la certitude de mon existence. En oubliant le rôle essentiel du Trompeur, Schaeffer pervertit le texte des Méditations et en manque le sens réel.
La lecture de Schaeffer est donc profondément contestable, et l’on s’attendait à une véritable réfutation en règle de la part de Jean-Luc Marion, dans l’article qu’il a consacré à Schaeffer12 sur une invitation du Débat. Or, l’article de Marion s’avère proprement stupéfiant tant il attribue à Schaeffer des thèses qui ne sont aucunement les siennes : Marion accuse par exemple Schaeffer de situer le cogito ergo sum dans les Méditations et non dans le Discours ; or, rien dans le texte de ce dernier ne permet de tenir pareille accusation. Plus étonnant encore, Marion reproche à Schaeffer de présupposer la préséance de la conscience de soi par rapport au cogito, c’est-à-dire que la conscience de soi serait prédonnée dans le cogito. Cette accusation d’une préséance de la conscience de soi sur le cogito est à proprement parler stupéfiante : Schaeffer défend tout au contraire le caractère performatif du cogito, ce qui interdit évidemment que la conscience de soi précède le cogito puisque c’est l’affirmation du cogito qui crée la conscience de soi selon la logique performative même ! Mais ce débat d’histoire de la philosophie n’est pas encore le plus ahurissant de l’article de Marion : ce dernier croit pouvoir réfuter le primat de la conscience de soi en phénoménologie en rappelant que « tous les phénoménologues contemporains » (sic !) posent l’extériorité de l’objet à penser à l’égard de la conscience ; en d’autres termes, Marion croit pouvoir contrer l’interprétation de Schaeffer en affirmant que la phénoménologie vise une extériorité à la conscience et non une réflexivité de celle-ci. Schaeffer a beau jeu de répondre ainsi : « Selon moi, sa reconstruction est unilatérale, en ce qu’elle oublie l’autre face de la relation d’intentionnalité ; en se constituant comme relation à l’extériorité, la conscience s’autoconstitue du même coup comme relation à elle-même, puisque cette relation à l’extériorité lui est donnée comme étant foncièrement « sienne ». »13 Mais surtout ce n’est pas là l’essentiel : que fait Marion ? Il croit combattre l’idée selon laquelle la réflexivité de la conscience échapperait à son inscription naturelle en faisant remarquer que la conscience réflexive n’est pas première. Et alors ? Il y a là une confusion regrettable de deux problèmes radicalement différents : Schaeffer soulève la question de la nature de la conscience réflexive, ce qui incite à penser le problème du rapport de la conscience à la naturalité, et loin de penser cette question, Marion croit bon de rappeler la primauté de l’Appel extérieur à la conscience : cette réponse est, à proprement parler, parfaitement hors-sujet. En d’autres termes, ce que Marion n’aperçoit pas, c’est que le débat ne porte pas sur la primauté de la conscience, mais bien plutôt sur la dimension antinaturaliste des pensées cartésienne et phénoménologique : est-ce que, oui ou non, par exemple, le privilège du Dasein à l’égard de l’Etre procède d’un privilège naturel ou non ? Est-ce que, oui ou non, la différence cartésienne entre l’homme et l’animal procède de l’antinaturalisme ? Ce sont là les questions soulevées par Schaeffer, que Marion ne semble pas du tout apercevoir.
Le plus amusant est que, après avoir longuement expliqué que la Thèse reconstruite par Schaeffer ne correspondait à rien de réel, Marion va lui-même illustrer involontairement cette Thèse ; lisons plutôt : « Il n’y a aucune contradiction à dire que, d’une part, l’homme est un objet, soumis aux mêmes règles que tous les objets sans exception, et, d’autre part, que, quels que soient les progrès de l’objectivation de la connaissance incluant l’homme comme objet d’expérience, celui qui parle reste l’homme encore – là est toute la difficulté. »14 Cette déclaration est fascinante à bien des égards : Marion décrit très précisément, mais à son insu, ce que dénonce Schaeffer, à savoir cette illusion d’immunité que la Thèse s’octroie en déclarant inopérantes les sciences positives quant à la connaissance de ce qu’est l’homme au sens spécifique du terme. En d’autres termes, Marion réaffirme le dualisme absolu que ne cesse dénoncer Schaeffer : certes, l’homme est « d’une part », comme dit Marion, soumis à une dimension naturelle, et à cet égard il est étudiable comme vivant, mais d’autre part, cette connaissance de l’homme comme vivant n’épuise pas la connaissance de l’homme : cela revient nettement à dire que l’homme est constitué de deux parties, d’une partie naturelle et d’une partie qui transcende cette nature et que ne saurait épuiser la connaissance naturelle. Dualisme donc, présupposé par Marion, et immunité de la partie non naturelle, infalsifiable par les sciences naturelles, puisque relevant d’un autre ordre. Et même si l’on admet la primauté de l’Appel, par exemple celui du Visage chez Levinas, il est évident que ce Visage restitue un ordre autre que celui de la nature, impose un dualisme métaphysique, et relève d’un ordre tout autre que celui de la nature. Le Visage n’est donc ni un élément naturel, ni un thème, mais il est bien l’Appel de l’infini qui vient perturber de manière métaphysique – Levinas ne craint pas le mot – ce dont les connaissances naturelles sont capables. Ainsi, cette phénoménologie de l’Appel apparaît-elle comme parfaitement dualiste, et relève-t-elle pleinement de la Thèse que Marion ne semble pas avoir tout à fait comprise. On lui saura toutefois gré, après avoir nié que Descartes illustrât celle-ci, d’offrir sa propre pensée comme illustration involontaire de ce que dénonce Schaeffer…
III°) Où il apparaît que le naturalisme n’est pas un matérialisme
La partie précédente a accordé une certaine importance à l’histoire de la philosophie ; mais au fond, elle me semble surdéterminée par la discussion qui a suivi le livre de Schaeffer ; en effet, que Schaeffer se soit, oui ou non, trompé sur le sens véritable de la pensée cartésienne, cela importe peu : l’essentiel me semble bien plutôt de savoir s’il existe quelque chose comme un dualisme ontologique structurant la pensée moderne, et immunisant la connaissance de l’homme par rapport au naturalisme. C’est cette question-ci qui me paraît fondamentale, et non celle de savoir si Descartes est réellement dualiste ; en d’autres termes, ce qui compte, c’est la manière dont le cartésianisme a été reçu et a structuré la pensée moderne, plus que le fait de savoir si Descartes correspond vraiment, du point de vue des textes, à la doxa qui lui est attribuée. C’est en ce sens, me semble-t-il, que Schaeffer élabore une Thèse, qui n’a nulle prétention de désigner un auteur en particulier, mais qui cible bien plutôt les présupposés ontologiques de la pensée occidentale, dont cette dernière ne parviendrait pas à se débarrasser, ce qui fait dire plaisamment à Pascal Engel : « La Thèse est comme le sparadrap du capitaine Haddock. »15
On pourrait penser qu’un des moyens de sortir de ce dualisme serait de se référer à quelque chose comme un monisme matérialiste, affirmant qu’il n’y a que de la matière, et que, par conséquent, toute étude de l’homme se laisse ramener à l’étude matérielle de ses composantes. Tel pourrait être le sens, par exemple, de la démarche d’un Jean-Pierre Changeux ; pourtant, et de manière assez nuancée, Schaeffer refuse catégoriquement de se laisser embarquer dans le matérialisme, et y dénonce au contraire une « escalade ontologique », dans l’exacte mesure où le matérialisme conserve à son insu l’idée de dualisme puisqu’il ne fait que « réduire la substance pensante à la substance étendue. Les deux camps restent donc captifs du même modèle, pour lequel la question de l’identité humaine n’est que la reformulation « contemporaine » de la question ontologique. »16
Je crois que l’on peut toutefois ne pas être pleinement d’accord avec ce constat ; il me semble que Schaeffer pointe plus un problème de vocabulaire que d’ontologie ; en effet, il ne démontre pas que le monisme matérialiste pense de manière dualiste, il montre bien plutôt que le vocabulaire dans lequel le monisme s’exprime demeure dualiste ; ainsi Schaeffer écrit que les matérialistes « se sentent obligés de la [la question des faits mentaux] reformuler dans des termes acceptables du point de vue du réductionnisme physicaliste – bref de réduire l’identité humaine à celle d’une portion d’étendue. »17 Certes, mais ce n’est là qu’une question de vocabulaire, et non de concept ; par conséquent, on devrait plutôt parler d’une escalade sémantique plus qu’ontologique, puisque le problème consiste à reprendre une formulation mais pas forcément une ontologie. Schaeffer répondrait certainement que l’on ne peut parler de substance étendue que si l’on admet en amont le dualisme étendue / pensée, mais je ne crois pas que cette réponse serait vraiment valable car elle ne le serait que s’il était pertinent de renvoyer à une réalité ontologique que serait la substance étendue. Or il est évident que les matérialistes ne renvoient à cette étendue que par commodité sémantique et non par volonté ontologique. C’est pourquoi, je crois que le terme d’escalade ontologique demeure malheureux pour qualifier le matérialisme.
IV°) De la réfutation de la Thèse à l’absolutisation de la conjecture inverse
Les deux derniers chapitres du livre de Schaeffer s’élargissent au-delà de la philosophie, pour penser (chap. III) les problèmes de l’évolution et de la sélection naturelle, puis (chap. IV et V) ceux de la culture. Indépendamment de la thèse que défend Schaeffer, le chapitre consacré à la sélection naturelle constitue une excellente mise au point conceptuelle de la théorie de l’évolution. Il invite à ne pas confondre l’a-téléologie avec la fin de la causalité, et rappelle que la sélection naturelle ne choisit pas ce qu’il y a de plus performant, elle élimine plutôt ce qui est inapte à la survie. La sélection naturelle n’est donc pas une optimisation absolue des conditions de vie, elle désigne bien plutôt une optimisation relative, où un choix est effectué parmi un nombre restreint de possibles. La sélection naturelle ne saurait donc être un facteur d’optimisation absolue, puisqu’elle est condamnée à « choisir » parmi des variantes génétiques qui sont venues à l’existence sans aucun égard par rapport à quelque optimisation que ce soit. »18 Mais dans le cadre de la défense de son projet, Schaeffer prend bien soin de montrer combien l’homme n’est pas le produit final de l’évolution, ni la réalisation d’un projet divin ; il est plutôt le produit aléatoire d’une lignée, non nécessairement optimale, qui a mené à l’homme. Ce que Schaeffer tend à montrer, c’est que le caractère profondément atéléologique de l’évolution, c’est-à-dire que l’élimination circonstancielle de certaines formes de vie, et l’optimisation relative d’autres formes interdisent de penser que l’homme soit autre chose que le produit contingent du processus naturel.
Il est évident que cette thèse est présomptueuse et contestable ; ce qui est certain, ce que pour nous, humains, l’humanité semble être un produit purement contingent de l’évolution ; mais pourquoi ne pas penser que, ce qui nous paraît contingent ne relèverait pas d’une nécessité supérieure qui nous échappe ? De ce point de vue, la thèse de Schaeffer n’est pas inattaquable, car il subordonne le refus de toute téléologie à la connaissance que nous en avons ; mais rien n’interdit de penser qu’il existe une nécessité encore inaperçue qui en réalité dirige l’évolution. Evidemment, dire cela, c’est réactiver le dualisme de manière maximale, et Schaeffer n’aurait guère de peine à l’établir ; néanmoins, croire que l’état de nos connaissances actuelles épuise le sens à donner à l’évolution, n’est-ce pas là faire justement preuve de ce que dénonce Schaeffer, à savoir faire preuve de gnoséocentrisme ? La connaissance que nous aurions de la vie, connaissance partielle, limitée, et encore très largement inachevée, est considérée par Schaeffer comme capable de nous dire définitivement ce qu’est l’homme. Mais en fait, cela revient à accorder un verdict définitif sur l’homme à partir d’une connaissance qui ne l’est pas ; en d’autres termes, cela revient à accorder à la connaissance une puissance que son extension actuelle ne lui permet pas de revendiquer.
Il me semble en fait que Schaeffer passe d’un niveau à l’autre de critique ; que rien ne permette de dire que l’homme fasse exception au règne du vivant, c’est là quelque chose que tout pousse à lui accorder. En déduire que l’homme est un vivant comme les autres, c’est là franchir un pas et s’écarter de la démarche poperrienne qu’il semblait adopter : Schaeffer me semble pleinement habilité à réfuter la Thèse, mais il devrait se rappeler que au-delà la réfutation il n’y a que des conjectures, comme le disait si bien Popper, et que ces conjectures demeurent profondément tributaires de l’état des connaissances d’une situation donnée. Par conséquent, il me semble que Schaeffer commet une imprudence ontologique – la même que celle qu’il reproche aux tenants de la Thèse – en absolutisant une conjecture, c’est-à-dire en affirmant comme indiscutablement valide un fait positif : l’homme est un vivant comme les autres. Ainsi, autant il est séduisant de dire que la Thèse ne tient pas au regard de la science actuelle, autant cela ne signifie pas que l’inverse de la Thèse est vrai. Bref, la réfutation de la Thèse est certainement valide, l’absolutisation de la conjecture inverse demeure douteuse.
La suite du texte porte sur la culture. Mes très maigres compétences en ethnologie m’invitent à la prudence critique à l’égard de cette partie, dont je rendrai très brièvement compte. Si j’ai bien compris, Schaeffer, en bon patisan de la thèse naturaliste, considère la culture comme relevant de la nature biologique de l’homme, ou, pour le dire en ses termes : « la culture est un fait naturel veut dire simplement qu’elle fait partie de l’identité biologique de l’espèce humaine. »19 Cette remarque est intéressante : elle signifie que la culture ne se laisse pas réduire à une simple étude biologique – à cet égard Schaeffer a raison de rappeler qu’il n’est pas réductionniste – mais elle signifie plutôt que tout homme, en vertu de sa nature biologique, est destiné à créer une culture et à vivre en elle. En d’autres termes, la culture n’est possible qu’en vertu de la nature biologique de l’homme ; mais cela ne signifie pas que la culture soit biologique. Malgré cette nuance, il me semble que la question de Quentel demeure pertinente : « Et que la culture nécessite le biologique, et en dernier lieu le physique, n’empêche pas qu’elle manifeste, quoi qu’en dise Jean-Marie Schaeffer, une forme d’émancipation à l’égard du vivant. Car la culture, en tant qu’elle suppose une forme d’abstraction généralisée, en vient fondamentalement à échapper aux lois de la vie et même, paradoxalement, à les contredire. »20 Evidemment, Schaeffer refuserait cela, c’est-à-dire qu’il refuserait l’idée d’une émancipation ontologique de la culture à l’égard de ses conditions de possibilité, au point que la culture en vienne à désigner la spécificité de l’humain. Il est certain que Quentel adopte ici la Thèse, puisque si l’on adopte cette dernière, le dualisme inhérent à celle-ci fait que l’homme culturel s’oppose à l’homme biologique, et celui-là confère une spécificité à l’humanité. Le problème est que nous avons là deux conceptions pratiquement irréconciliables et probablement même incapables d’entrer en débat l’une avec l’autre : Schaeffer, en faisant de la culture, le produit d’une possibilité biologiquement inscrite en l’homme, fait de ce dernier un être naturellement social et culturel. Comme il le dit lui-même, ce n’est que si la culture elle-même est une donnée « naturelle », donc quelque chose qui fait partie de la « nature » humaine, qu’on peut comprendre à la fois comment l’identité subjective est intrinsèquement sociale, au sens où son existence même est celle d’une subjectivité socialisée, et comment en même temps tout individu dispose de potentialités de « (re) subjectivation » qui lui permettent de passer d’une société à l’autre. »21 Inversement, Quentel fait de la possibilité culturelle et / ou sociale cela même par quoi l’homme s’arrache à sa naturalité. Ce n’est donc pas sur la réalité de la dimension sociale et culturelle de l’homme que s’affrontent Quentel et Schaeffer, c’est sur la nature de cette possibilité : réalisation d’une identité biologique ou arrachement à cette identité ? Il est vrai que Quentel, en pensant la culture comme un arrachement, pense de manière dualiste. Et à cet égard Schaeffer a raison de le critiquer. Mais au fond, ce dualisme là est une hypothèse pas moins incertaine que celle de Schaeffer : ce dernier, dans sa réponse à Quentel, dit bien : « Et si je dis cela, ce n’est pas parce que je vénère la biologie, comme mon commentateur semble le penser, mais parce que je pars de l’hypothèse que l’homme est un être biologique. »22 En effet, il s’agit bien d’une hypothèse et à ce titre, Schaeffer a lui aussi ses propres présupposés, ses propres conjectures qu’il aimerait voir absolutisées.
Il me semble donc que là encore, Schaeffer a raison de dénoncer le dualisme de Quentel, et d’identifier cette pensée secrète qui structure l’ensemble de la pensée moderne : mais est-ce là une raison de dépasser le cadre de la réfutation pour proposer une conjecture qui se veut absolue : l’homme est un être biologique. Ce dépassement perpétuel de la réfutation vers l’absolution de ses conjectures amène des certitudes là où le questionnement eût été probablement de rigueur.
Paradoxalement, pour conclure, si l’on peut raisonnablement considérer que Schaeffer fait subir à la Thèse une réfutation à mes yeux irrévocable, on ne peut pas être pour autant certain qu’il est pertinent et surtout légitime d’en conclure la pleine et absolue naturalité de l’homme. La démarche popperienne qui est initialement adoptée en vue de réfuter la Thèse par les expériences positives actuelles est extrêmement convaincante ; en revanche, le moment où se trouve abandonnée cette réfutation pour affirmer comme évidentes des propositions qui demeurent encore conjecturelles l’est infiniment moins : on ne peut en effet pas conclure du refus de la Thèse à l’affirmation de son inverse, et c’est pourtant ce que me semble vouloir faire Schaeffer. C’est pourquoi, les dernières phrases de l’ouvrage peuvent paraître étonnantes ; Schaeffer remarque en effet que les neurosciences risquent, à plus ou moins brève échéance de rendre obsolète le fondationnalisme de l’ontologie du sujet. »23 mais, aussitôt après ce constat, il jure par tous les dieux que « L’argumentation développée au fil du livre ne se voulait la défense d’aucune doctrine. »24 Certes, la logique de l’ouvrage eût souhaité que Schaeffer ne défendît aucune doctrine, et qu’il se contentât d’une réfutation de la Thèse ; mais, il me semble que ce n’est pas réellement le cas, tant la tentation des conjectures se fait sentir, et tant la simple réfutation de la Thèse ne semble guère le satisfaire. Toutefois, il serait absurde de refuser à Schaeffer l’audace dont il fait preuve, tant la lecture de ce livre est passionnante et intrigante et tant sa réflexion invite à remettre en cause beaucoup de nos croyances. Il s’agit donc là d’un livre majeur, probablement clé dans l’histoire de la pensée sur l’homme, et dont la lecture sans a priori ne saurait être trop recommandée.
- Jean-Marie Schaeffer, La fin de l’exception humaine, Gallimard, 2007
- Ibid. p. 14
- Catherine Halpern, L’homme à part, in Libération, 27 septembre 2007
- Elisabeth Lévy et Jean-Marie Schaeffer, L’homme un animal comme les autres ?, in Le Point, n° 1890, 4 décembre 2008, p. 108
- Ibid.
- Ibid. p. 67
- Schaeffer, op. cit., p. 27
- Ibid. p. 29
- Ibid. p. 49
- Jean Laporte, Le rationalisme de Descartes, PUF, 1950², p. 472
- Ibid. pp. 75-76
- cf. à ce sujet l’ensemble des cinq articles réunis par Le Débat : autour de l’exception humaine de Jean-Marie Schaeffer, numéro 152, novembre-décembre, Gallimard, 2008
- Ibid. p. 149
- Jean-Luc Marion, « quelle exception ? », in Le Débat…. p. 135
- Pascal Engel, « Le naturalisme sans la nature ? », in Le Débat, p. 125
- Schaeffer, p. 131
- Ibid.
- Ibid. p. 176
- Ibid. p. 224
- Jean-Claude Quentel, « Le paradoxe de l’humain », in Le Débat, p. 140
- Schaeffer, p. 236
- Schaeffer, « Pour une connaissance de l’homme », in Le Débat, p. 151
- Schaeffer, La fin de l’exception humaine, op. cit., p. 381
- Ibid. p. 383








