Après une étude sur La philosophie stoïcienne de l’art1, Mary-Anne Zagdoun s’attache à ce qu’elle propose ici de nommer L’esthétique d’Aristote2. Il y a donc une continuité aussi bien d’objet que de méthode puisque, comme elle l’avait fait pour les Stoïciens, il s’agit à nouveau de réinscrire la conception aristotélicienne des arts mimétiques dans l’ensemble de sa philosophie (ontologie, psychologie, physique, logique, éthique et politique). À ce projet, trois raisons essentielles sont avancées par l’A. : d’une part, la relative dispersion des ouvrages et articles sur ce thème, qui invite à opérer une synthèse offrant une sorte d’état des lieux de la question ; la nécessité, d’autre part, de confronter la pensée d’Aristote aux données récentes de l’archéologie, afin de déterminer le degré de proximité ou de « décalage » qui existe entre cette pensée et la réalité de son temps. Enfin, l’absence de publication récente sur le sujet, autrement dit sur l’esthétique d’Aristote et son inscription dans la globalité de sa philosophie. On notera d’emblée que c’est là un argument assez curieux quand on sait le nombre et l’importance des travaux qui, depuis au moins deux décennies, ont entrepris d’articuler les analyses de la Poétique à celles de l’éthique3 et/ou de l’ontologie4 aristotélicienne, ou de mettre au jour, à travers la notion de mimêsis, l’existence d’une conception unifiée de l’art dans l’Antiquité5.
De cet ouvrage, on peut dégager d’emblée une triple thèse, d’ailleurs énoncée dès l’Introduction. Première thèse, qui justifie en un sens le titre du livre : la pensée d’Aristote présenterait non pas une « esthétique » à proprement parler (on sait que le terme, forgé par Baumgarten6, date du XVIIIè), mais une « attitude esthétique » (p. 12) consistant essentiellement dans le processus de « stylisation » qui caractérise la mimêsis, ainsi que dans une certaine distance instituée par Aristote par rapport à la cité. Seconde thèse, corrélative : l’esthétique d’Aristote n’en est qu’à ses « premiers balbutiements » (p. 64), en ce qu’elle n’est pas encore parvenue à une véritable autonomie mais demeure dépendante d’autres domaines : l’ontologie, la physique, la psychologie et, surtout, la politique et l’éthique. Troisième thèse, qui découle cette fois d’une démarche davantage historique, et qui est sans doute la plus intéressante : la façon dont Aristote définit les arts mimétiques manifeste un certain nombre de décalages par rapport aux pratiques de son temps, et qui atteste le caractère foncièrement normatif de sa conception. Ces décalages, l’A. les fait apparaître en montrant en particulier la façon dont la conception aristotélicienne du rapport entre dessin et couleur se révèle être en opposition au développement de la peinture macédonienne – on y reviendra. Ce dont elle dégage l’idée, qui est un fil directeur de l’ouvrage et que l’on pourrait presque à ce titre considérer comme une quatrième thèse, d’un Aristote aux goûts « conservateurs ». Présentons désormais de plus près ces thèses en les réinscrivant dans la construction générale de cet ouvrage, qui comporte huit chapitres.
De la mimêsis au plaisir esthétique
Le premier chapitre, intitulé « Prolégomènes », présente de façon très générale la façon dont Platon et Aristote envisagent les arts mimétiques et la technè, en montrant que la conception aristotélicienne repose sur une double opposition à sa détermination platonicienne. Concernant la technè, la première opposition tient selon l’A. à son extension (celle-ci revêtirait un sens très large chez Platon ; spécifique chez Aristote) ainsi qu’à son rapport à la poésie (dépourvue selon Platon de technè, puisqu’elle procède uniquement d’une inspiration divine ; fondée selon Aristote sur la technè en tant qu’elle conditionne la mimêsis représentative). D’où une seconde opposition concernant cette fois la mimêsis, la Poétique pouvant, comme on sait, se lire comme une entreprise de réhabilitation consistant à montrer que, loin de se réduire à une logique du simulacre, celle-ci est une tendance naturelle inscrite au cœur du désir de savoir (Poétique 4 ; Métaphysique A, 1).
« L’art imite la nature » : quel art ?
Le second chapitre vise à « rechercher les fondements métaphysiques et psychologiques de l’art chez Aristote » (p. 42) en analysant successivement les notions indiquées dans son titre (« Technè, production, plaisir esthétique et beauté »). La notion d’art (technè) se trouve examinée à partir de son rapport à la nature (physis) puisque, comme le rappelle l’A., le processus technique se définit par analogie au processus naturel. C’est là, en soi, un choix parfaitement justifiable, mais qui se révèle néanmoins problématique dans la mesure où aucun effort de distinction entre l’art en général et les arts mimétiques (peinture, poésie, sculpture, musique) n’est ici opéré, ce qui donne lieu à un certain nombre de confusions dont nous ne relèverons que les plus gênantes. La première se trouve dans la façon dont l’A. justifie la nécessité d’étudier le lien de la technè à la physis : « Ceci paraît fondamental pour comprendre la mimêsis qui, bien qu’elle soit stylisation créatrice, est aussi représentation imitative. » (p. 42). L’A. paraît en effet ici niveler deux sens de la mimêsis qui, sans être explicitement distingués par Aristote, entretiennent en réalité une relation très complexe l’un à l’autre : celui que l’on trouve en Physique II, 194a 21-22 à travers la thèse bien connue d’un art qui « imite la nature » (mimeîtai tèn physin), et qui est de l’ordre de ce qu’on pourrait appeler la production technique ; et l’autre dans la Poétique qui, de cette production, fait, comme l’a montré S. Halliwell, une représentation7. En d’autres termes, même appliquée à celle de technè, la notion aristotélicienne de mimêsis n’est pas univoque8 mais désigne des processus qui, tout en étant tous deux téléologiques (d’où l’homologie avec la physis), se distinguent précisément en fonction de leur fin. Ce n’est par conséquent pas toute mimêsis qui peut être considérée comme « représentation imitative », mais seulement celle qui est à la base de ce que l’A. nomme les arts mimétiques.
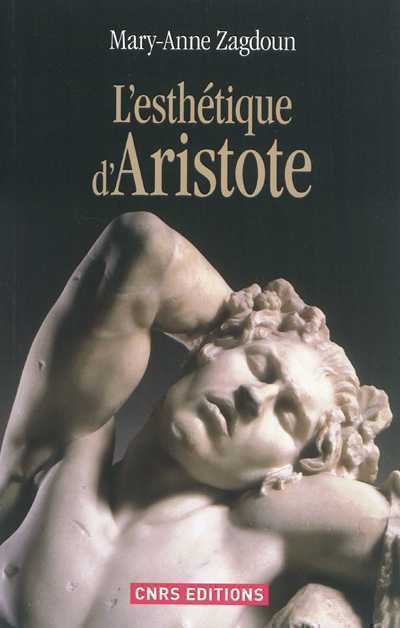
Apparaît donc ici une indistinction d’autant plus gênante qu’on en connaît la fortune dès la Renaissance où la formule aristotélicienne se verra de fait investie d’un sens artistique, absent chez Aristote, pour donner lieu à toute une série de préceptes sur le rapport que l’artiste doit entretenir aux choses de la nature : celui d’une imitazione chez Léonard de Vinci ou, plus tard, d’une imitation chez Boileau. Or si c’est là, nous semble-t-il, un problème important, c’est parce que ce nivellement de sens n’a pas dans l’ouvrage une place locale, mais est ce qui, au chapitre consacré à la mimêsis, sera utilisé par l’A. pour justifier le choix de traduire mimêsis par « représentation » qui « a le mérite d’uniformiser presque tous les emplois de la mimêsis dans la Poétique et d’une façon plus générale dans une grande partie de l’œuvre d’Aristote » (p. 69). Choisir, à la suite de S. Halliwell ou de R. Dupont-Roc et J. Lallot, de traduire mimêsis par « représentation » pour justement la dissocier de l’idée d’imitation est parfaitement légitime pour la Poétique. En revanche, faire comme si cette traduction pouvait valoir « dans une grande partie de l’œuvre d’Aristote », autrement dit également pour les emplois que l’on trouve en Physique II mais aussi, pourquoi pas, dans les écrits biologiques, c’est là une extension qui semble beaucoup plus difficile à défendre, à moins évidemment de voir tous les objets techniques comme des « représentations ».
Technè et substance
Après avoir rappelé que l’art (mais lequel ?) était donc imitation de la nature, l’A. dégage alors une conclusion assez surprenante et qui, en tous les cas, mériterait d’être quelque peu nuancée, à moins de considérer que la technè et ses œuvres soient, chez Aristote, exclus de l’être : « Les réalisations de l’art ne sont pas des substances. Elles n’ont pas en elles le principe de leur mouvement, mais elles sont analogues aux substances naturelles, l’art étant pour Aristote une imitation de la nature. » (p. 43). Le problème, ici, tient au fait que si les réalisations de l’art ne sont pas des substances, on voit mal quel statut elles pourraient bien revêtir dans l’ontologie d’Aristote qui, comme on sait, assimile l’être comme tel à l’ousia. On s’attendrait donc à plus de prudence sur un sujet aussi complexe dont l’on aimerait que l’A. nous présente les coordonnées du problème9 plutôt qu’une solution un peu vite expédiée. L’une des difficultés principales, exposées par Aristote en Métaphysique B4, H3 et Λ3, c’est en effet que, dans l’artefact, contrairement à ce qui se passe pour la substance naturelle, la forme n’existe pas de façon séparée, ce qui le conduit, en Mét. H3, à se demander – et non à affirmer – si l’on ne doit pas limiter la substance aux seuls êtres naturels. Ce qui est certain, c’est que la nature revêt dans l’examen sur la substance un rôle paradigmatique10, et certains commentateurs n’ont en effet pas hésité à en conclure à la non-substantialité des produits de la technique11. Reste que c’est là s’exposer à de redoutables difficultés puisqu’il faut alors expliquer : i/ pourquoi Aristote ne cesse de recourir à des exemples techniques (notamment la maison, la statue) pour penser la substance ; ii/ ce qu’elle devient ou, plutôt, ce qu’elle est, si les produits de la technique ne sont pas des substances ; iii/ enfin, et corrélativement, ce qu’il en est de l’ambition expressément formulée par Aristote de penser, à travers la substance, la totalité de ce qui est.
Technè et dynamis
Le second problème, toujours au sujet de la technè, se trouve ensuite dans la façon dont l’A. présente son identification, en Métaphysique Θ 2, à une puissance active et, plus précisément, à une puissance rationnelle (dynamis meta logou). Il est certes important de rappeler que la technè constitue chez Aristote une puissance active, autrement dit le « principe de changement dans un autre être ou dans le même en tant qu’autre », mais que, sans médiation, on utilise, comme le fait l’A., cette idée pour comprendre le rapport de l’art, entendu cette fois au sens de la représentation, à son public, c’est là une extension pour le moins périlleuse. « Des arts poétiques, Aristote nous dit qu’ils sont des puissances, car ils sont principes de changement dans un autre être ou dans l’artiste lui-même en tant qu’autre. L’art modifie l’âme de tous ceux sur lesquels il a une emprise, que ce soit le public ou l’artiste lui-même. » (p. 45). On a là, une fois encore, l’exemple d’une torsion qui n’est possible qu’à ne pas prendre soin de distinguer les domaines, en faisant comme si les arts dits « poétiques » chez Aristote (en ce qu’ils concernent une poiêsis, soit une production) avaient tous un sens poétique au sens cette fois moderne du terme, et comme si on pouvait sans détour utiliser les analyses de Métaphysique Θ 2 pour penser l’action d’une œuvre artistique sur son public. Au passage, on relèvera une bizarrerie, la technè étant assimilée par l’A. non seulement à une puissance active (l’architecte), mais également à une puissance passive (les matériaux), ce qui paraît tout de même difficilement conciliable avec la position aristotélicienne puisqu’on voit mal ce qui, en la matière, pourrait s’apparenter à une technè. Que l’actualisation de toute technè et, plus généralement, de toute puissance active requiert la présence d’une puissance passive n’implique pas en effet que la seconde puisse être incluse dans la première.
Du plaisir à la beauté
Sans entrer dans le détail, les analyses sur la production, puis sur le plaisir esthétique et la beauté souffrent, selon nous, d’une même imprécision. De la production (poiêsis), l’auteur prend soin de rappeler les grands traits dans la philosophie d’Aristote : qu’elle s’enracine, comme l’art dont elle est l’accomplissement, dans la partie rationnelle et calculatrice de l’âme et que, contrairement à la prudence, sa fin lui est extérieure (EN VI, 2). Le lecteur restera en revanche quelque peu surpris par la traduction du terme de poiêsis indifféremment traduit par « production » et « création » (« les beaux-arts et l’art » définis comme « faculté de création » (p. 48)). Or quand on sait l’origine du terme de création – catégorie absente du monde grec – et la façon dont il sera utilisé pour décrire le génie et l’activité artistique, on ne peut que s’étonner d’un tel flottement, à plus forte raison dans un ouvrage consacré à la problématique « esthétique », et qui n’est donc pas sans ignorer les implications du terme – comme l’atteste l’expression anachronique de « beaux arts ».
L’A. passe ensuite à l’analyse du plaisir esthétique et de la beauté, son but étant de montrer qu’il y a la place, chez Aristote, pour un plaisir spécifiquement esthétique, soit un plaisir pris à la contemplation des œuvres des arts mimétiques. C’est là un point particulièrement important dans la démonstration puisque c’est ce plaisir qui permet de distinguer les arts mimétiques des autres technai (p. 58). Afin de le montrer, l’A. passe donc en revue et analyse les différentes modalités de ce plaisir qui est, prévient-elle d’emblée, de nature indissociablement cognitif et sensitif : « plaisir de la mimêsis, plaisir accompagnant la catharsis, plaisir propre, plaisir du spectacle, tous ces plaisirs apparaissent comme des composantes du plaisir esthétique qu’Aristote toutefois n’a jamais considéré dans son ensemble. » (p. 60-61). Il s’agit alors de réinscrire ce plaisir esthétique dans la conception plus générale du plaisir que l’on trouve en EN X, 4, où celui-ci se trouve défini comme un « parachèvement de l’activité » (p. 61), ce qui permet à l’A. de comprendre les plaisirs esthétiques comme des « fins qui se surajoutent aux activités artistiques ». Un pas de plus est néanmoins fait pour clore cette analyse du plaisir esthétique, en direction cette fois de la beauté. Aristote ne thématisant pas ce rapport entre « plaisir esthétique » et beauté, l’A. utilise pour ce faire un passage de EN X, 4 où Aristote montre que pour que le plaisir soit le plus complet possible, il faut que le sens et l’objet soient disposés au mieux, autrement dit que l’objet soit beau. Ce dont l’A. déduit alors la nécessité de la beauté pour le plaisir esthétique, beauté qu’elle analyse à partir d’un passage de Métaphysique M, 3 où le beau, appliqué dans ce texte aux entités mathématiques, se trouve caractérisé selon les trois critères de la symétrie (symmetria), de l’ordre (taxis) et de la limite (horismenon). Il s’agit alors de retrouver ces éléments dans la Poétique, tout en soulignant que le beau, chez Aristote, demeure étroitement lié au bien et revêt donc un « sens esthétique et moral », d’où ce constat : « C’est à cause de cela qu’on peut affirmer que l’esthétique n’en est chez lui qu’à ses premiers balbutiements » (p. 64) .
Hormis ce constat sur lequel on reviendra, l’analyse se justifie et il est intéressant de tenter de caractériser la catégorie du beau telle qu’elle se trouve utilisée par Aristote en Poétique, dans la mesure où Aristote n’entreprend effectivement à aucun moment de la définir. De cette articulation du plaisir esthétique à la beauté, on peut néanmoins regretter qu’elle ne soit pas davantage problématisée, autrement dit que l’A. ne questionne pas davantage les raisons pour lesquelles, justement, la Poétique d’Aristote ne présente aucune théorie du beau12, pas plus d’ailleurs qu’elle ne fait place à une théorie du goût ou du génie.
Lecture de la Poétique
Les trois chapitres suivants sont consacrés à une lecture de la Poétique d’Aristote. Le chapitre III analyse la mimêsis chez Aristote, en revenant d’abord sur l’opposition à Platon, puis en l’abordant sous un aspect psychologique en la liant à l’analyse de l’imagination (phantasia) que l’on trouve en DA III, 3. L’A. propose en effet de lire la mimêsis telle qu’elle est définie en Poétique 4 comme l’ « une des activités de la phantasia » et, plus précisément, de l’imagination délibérative (phantasia bouleutikè) : au principe de la reconnaissance permise par la mimêsis se trouverait une sorte de syllogisme, dont l’analyse et la conceptualisation seraient à chercher dans celle de l’imagination délibérative.
Le chapitre IV se propose d’examiner la thèse poétique de la priorité de l’action sur le caractère – posée par Aristote en analogie à celle du dessin sur la couleur – en recourant à celle, ontologique et plus générale, de la relation de la matière et de la forme, ce qui conduit à rappeler les grandes lignes de l’hylémorphisme aristotélicien. Dans cette perspective, la priorité de l’action et du dessin serait à comprendre comme celle de la détermination sur l’indétermination, qu’il s’agit alors de comprendre en étudiant l’ « effacement du caractère devant l’action », puis l’ « effacement de la couleur devant le caractère ». Le fait d’interpréter cette priorité de l’action et du dessin en recourant à la problématique du rapport matière / forme est, en soi, très intéressant. Le problème, c’est que cette articulation est davantage présupposée que démontrée, alors qu’il s’agit là une fois de plus de domaines très différents.. Par ailleurs, ce choix méthodologique rencontre ici une autre limite. Ayant d’emblée présupposé que cette priorité était tributaire de l’ontologie d’Aristote et faisant comme si l’éthique permettait également de comprendre cette priorité, l’A. n’aborde en effet pas ses enjeux les plus importants que sont ceux, à l’inverse, des écarts et de la distance entre l’éthique et la tragédie, laquelle est dès lors conçue comme exprimant, de façon finalement purement « imitative », des ordres et logiques qui sont ceux de l’être et de l’expérience pratique.
Le chapitre V aborde les concepts clés, dans la Poétique, du général, du vraisemblable, du nécessaire et de la fortune, ce qui est l’occasion de présenter l’opposition bien connue de la poésie à l’histoire (Poétique 9) et de rappeler, en se référant notamment à S. Halliwell et E. Belfiore, le rapport du général, du nécessaire et du vraisemblable à l’unité de l’action ou encore à l’intelligibilité de l’intrigue. L’A. analyse également le hasard comme élément à part entière de l’action tragique. On observera à ce propos une tension, qu’il eût été intéressant d’interroger, entre trois conceptions du hasard et de la fortune que l’A. paraît ici mêler : le hasard comme « irrationnel », le hasard comme « surnaturel » ou « intervention divine », et enfin le hasard comme dimension irréductible de la praxis. Cette indistinction paraît en effet problématique, en particulier pour comprendre le lien très complexe de la tragédie à la praxis, dans la mesure où elle ne permet pas de questionner le sens et le statut du hasard dans la tragédie : étant réintégré à l’action une et nécessaire, dans quelle mesure s’agit-il encore d’un hasard, au sens d’une véritable contingence et d’une accidentalité ? N’a-t-on pas plutôt ici, comme l’ont montré chacun à leur manière V. Goldschmidt, P. Ricœur et J.-P. Vernant, une sorte d’inversion de la contingence en nécessité, qui rendrait dès lors très complexe le lien de ses modalités tragiques aux modalités proprement pratiques.
Le chapitre VI est consacré à l’analyse de ce qu’Aristote, en Poétique 6, présente lui-même comme la finalité de la tragédie : la catharsis. Rappelant d’emblée la complexité et, en un sens, l’insolubilité de cette question, l’A. propose d’ « indiquer simplement les éléments du problème, montrer leur connexion possible et proposer une solution qui, sans s’éloigner des textes, paraisse à la fois simple et plausible » (148). Indiquer les éléments du problème, c’est donc ce que commence par faire l’A. en présentant d’abord les « données aristotéliciennes » (p. 150-163), autrement dit les textes (Politiques VIII, 7 où la notion se trouve utilisée en rapport à l’effet de la musique enthousiasmante ; Poétique 6 où elle est utilisée en rapport aux émotions de pitié et de crainte suscitées par la tragédie) ; les sens traditionnels et pré-aristotéliciens du terme (celui médical de « purgation » ; et celui religieux de « purification »). Enfin, les interprétations (celles notamment de Else, Golden qui séparent les textes des Politiques et de la Poétique) pour retenir finalement, à partir d’une analyse des émotions de pitié et de crainte, celles de Bernays (pour la catharsis enthousiasmante) et, surtout, de Halliwell, celle d’un apprentissage de la modération et de la vertu, qu’elle présente comme « très plausible, sinon définitive » (p. 178).
Les arts mimétiques et la cité
Le chapitre VII aborde le rapport des arts mimétiques à la politique en montrant que si l’on a certes une amorce d’autonomisation des arts par rapport à la cité, celle-ci demeure néanmoins le cadre de référence et l’arrière-plan des conceptions d’Aristote (« malgré la tendance de la Poétique à dissocier tragédie et cité, la tragédie reste liée à la cité » (p. 186). Cette dépendance vis-à-vis du politique, l’A. entreprend de la faire valoir à partir de plusieurs éléments. D’abord, celui de la valeur qu’Aristote accorde en Politiques III, 11, 1281b 3-24 à ce qu’elle appelle, de façon assez peu heureuse, le « jugement de masse » (p. 182-185). Celui-ci consiste dans le fait le jugement des citoyens pris collectivement surpasse celui des sophoi et des gens cultivés, ce en quoi l’A. voit un « exemple d’intrusion de la politique dans l’art » (p. 185). Deuxième signe d’une telle intrusion : les occurrences directes ou indirectes de la polis dans la Poétique (notamment, la remarque d’Aristote que la comédie, née de chants phalliques, est encore en vogue dans quelques cités en Poétique 4, 1149a 12), passage pouvant selon l’A. être « considéré comme mettant en relation poétique et politique » (p. 187). Dernière marque enfin de cette dépendance : la signification essentiellement morale de la Poétique, affirmée au chapitre précédent, et dont, par voie de conséquence, elle conclut à sa signification politique, la morale n’étant, comme on sait, pas indépendante de la politique chez Aristote (p. 193). Forte de ces preuves, que l’on peut somme toute considérer comme peu probantes, l’A. peut alors dégager la « triple leçon politique » de la tragédie : l’incitation à la prudence à partir de la mise en évidence de la faute (hamartia) tragique ; la mise en garde contre l’excès de pouvoir en tant qu’il est incompatible avec « la liberté et le bonheur » ; enfin, l’importance de la philia qui doit être « préservée à l’aide d’institutions » (p. 193). Tout comme elle peut, de façon plus générale, conclure à une sorte d’analogie de la tragédie à la cité, toutes deux « naturelles » (puisque la mimêsis l’est) et régies par un « processus interne » : celui de la famille à la cité, pour la cité ; et celui qui résulte de la ressemblance à un être vivant pour la tragédie. D’où une sorte de naturalisation générale et ce constat, fort éloigné finalement de l’idée d’une « attitude esthétique », selon lequel : « Aristote se pose en biologiste et se réfère à la nature, aussi bien dans l’analyse de la cité et de sa constitution que dans son examen de la tragédie » (p. 194). Une différence tout de même, souligne en conclusion l’auteur, puisque tandis que la politique se meut dans le domaine du contingent, la tragédie est tout entière soumise à la nécessité du destin. Ce qui est très juste, et aurait peut-être pu inviter à davantage de prudence dans ce rapprochement quelque peu forcé et artificiel. Car ici encore, ce qui reste à interroger, c’est l’absence de la politique, la distance prise par rapport à la cité, que note du reste l’A., tout comme celle des dieux et de la morale (en sa dimension du moins prescriptive). Absence qui conduit par exemple O. Höffe13 à parler de « dépolitisation » (Entpolitisierung), de « sécularisation » (Säkularisierung) et d’« amoralisation » (Entmoralisierung), en montrant que la mise à l’écart du politique ne relève pas d’un oubli, mais d’une thèse philosophique consistant à envisager chaque domaine – et la rationalité qui lui est propre – dans sa spécificité.
Aristote et ses contemporains
Le dernier chapitre vise à confronter les écrits d’Aristote à la « réalité de l’art », en se basant sur le théâtre puis sur les « arts figurés ». De cette confrontation résulte un constat nuancé : d’un côté, Aristote a « admirablement ‘‘conceptualisé’’ des idées artistiques qui étaient dans l’ ‘‘air du temps’’ » (p. 239) ; de l’autre, sa pensée manifeste des décalages évidents par rapport aux pratiques de ses contemporains (en particulier, l’éviction par Aristote des dieux, très présents dans les pièces des trois grands tragiques) ; enfin, certaines œuvres (notamment, en sculpture, le Kairos de Lysippe et, au théâtre, la Comédie Nouvelle de Ménandre) hériteraient des normes aristotéliciennes. Au final, la pensée d’Aristote apparaît donc fondamentalement normative, les exigences posées par lui devant en réalité se comprendre comme autant de prises de position. De ce point de vue, puisque c’est là un ouvrage important sur cette question, on s’étonnera de ne trouver aucune référence à F. Dupont14 qui, elle aussi, a pointé ce décalage et cette normativité (la Poétique comme « machine de guerre dirigée contre l’institution théâtrale »15), pour les interroger de façon critique dans leurs significations politiques ainsi que dans leurs effets sur l’histoire du théâtre occidental.
Les « premiers balbutiements de l’esthétique »…
Si l’idée d’une synthèse replaçant la conception des arts mimétiques dans l’ensemble de la pensée d’Aristote et la confrontant à la réalité artistique de son temps ne peut qu’être approuvée, il nous semble que l’ouvrage se heurte à un certain nombre de problèmes qui résultent peut-être de son projet même. Premier problème : la généralité et les nécessaires simplifications auxquelles conduit la réinscription systématique des concepts de la Poétique dans l’ensemble de la philosophie d’Aristote. Méthode qui a l’inconvénient de donner lieu à des catalogues de concepts qui ne permettent pas de montrer la complexité du lien qu’on peut opérer entre les sens qu’ils revêtent dans les différents domaines. Le second problème tient cette fois à ce qu’on pourrait, avec Bergson, appeler celui d’un « mouvement rétrograde du vrai » qui, en raison même de l’objectif poursuivi par l’A., nous paraît être à l’œuvre dans l’ouvrage, et ce de deux façons : la volonté, d’abord, de chercher à tout prix la présence de concepts ou de problématiques qui ne sont pas ceux de l’auteur ou, du moins, pas de façon centrale (le beau, le goût), plutôt que de chercher à penser leur absence ou leur marginalité ; l’inévitable conséquence, ensuite, d’une telle méthode, à savoir le fait d’insister sur le caractère nécessairement inchoatif de ce que l’on y trouve dès lors (des « balbutiements », une « attitude esthétique » plutôt qu’une esthétique, etc.). Suivant un thème à nouveau bergsonien, les solutions sont donc à la mesure des problèmes, et on voit les risques d’une méthode qui préfère plaquer des concepts et des cadres pour voir dans quelle mesure ceux-ci peuvent ou non correspondre, et dans quelle mesure, surtout, ceux-ci ne sont pas encore parvenus à leur pleine maturité (et cela vaut aussi quand il s’agit d’analyser Platon à partir d’Aristote). Par ailleurs, il est une question qu’on aimerait pour notre part poser à l’A., et qui est de savoir en quoi le fait, pour une philosophie de l’art, d’utiliser des concepts construits sur un plan ontologique (mouvement, acte, puissance) ou pratique (action, caractère, etc.) fait obstacle à son autonomie. Car, après tout, des auteurs comme Kant, Hegel, Schelling ou, plus récemment, Merleau-Ponty ou Deleuze n’ont-ils pas fondé leurs théories de l’art avec les mêmes outils conceptuels que ceux qui leur ont servi à penser l’être, l’éthique ou encore, pour Hegel, le politique ?
Si le projet était de montrer la place, chez Aristote, pour quelque chose comme une esthétique et un plaisir esthétique, l’ouvrage aboutit donc paradoxalement à une conclusion qui, à nos yeux, fait finalement beaucoup moins honneur à l’originalité de l’apport aristotélicien que ne le prétend l’A. : « La théorie aristotélicienne de l’art est riche de leçons pour nous encore aujourd’hui. Bien qu’elle soit inachevée et partielle, bien que nous ayons aimé avoir plus de développements sur bien des points et que nous nous heurtions à de très nombreuses difficultés et à des contradictions parfois insolubles, elle reste un ensemble grandiose et porteur d’espoir pour le bonheur de l’humanité. Quoi de plus beau en effet que de devenir meilleur et même plus vertueux, simplement en contemplant de belles œuvres ou en écoutant de la musique ? » (p. 245, nous soulignons).
- Mary-Anne Zagdoun, La philosophie stoïcienne de l’art, Paris, Éditions CNRS, 2000.
- Mary-Anne Zagdoun, L’esthétique d’Aristote, CNRS-éditions, 2011
- Pour cette approche, voir par exemple le numéro des Études Philosophiques, 2003/4 (n°67), « La Poétique d’Aristote : lectures morales et politiques de la tragédie » (éd. P. Destrée).
- M. Husain, An Approach to Aristotle’s Poetics. Ontology and the Art of Tragedy, New York Press, 2002.
- S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton Universiy Press, 2002.
- Baumgarten, Meditationes Philosophicae de Nonnullis ad Poema Pertinentibus (Méditations philosophiques sur quelques aspects de l’essence du poème), 1735 ; Aesthetica (Esthétique), 1750.
- S. Halliwell, op. cit., p. 14-16.
- P.-M. Morel, Aristote. Une philosophie de l’activité, Paris, GF, 2003, p. 257. Voir aussi l’analyse de M. Husain qui propose de façon très éclairante de distinguer ces deux niveaux de la technè et de la mimêsis en nommant « techne-physis » ou « mimesis 1 » la techne qui a un but seulement utile, et « artistic techne » ou « mimesis 2 » celle qui vise à la représentation (An Approach to Aristotle’s Poetics. Ontology and the Art of Tragedy, New York Press, 2002, p. 26-28).
- Pour une exploration de ce problème, voir E. Katayama, Aristotle on Artifacts. A Metaphysical Puzzle, New York, University of New York Press, 1999.
- M.-H. Gauthier-Muzellec, « Le paradigme naturaliste dans la Métaphysique d’Aristote », dans Aristote et la notion de nature: enjeux épistémologiques et pratiques, J.-F. Balaudé, P.-M. Morel (éd.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, p. 69-94.
- Ce que fait par exemple C. Shields, « Substance and Life in Aristotle », dans Aristotle on Life, John Mouracade (ed.), Kelowna, BC, Academic Printing and Publishing, 2008.
- Sur cette non-centralité du beau dans la conception aristotélicienne de la tragédie, voir M. Husain, op. cit., p. 28.
- O. Höffe, « Einführung in Aristoteles’ Poetik », dans Aristoteles. Poetik, (ed. O. Höffe), Berlin, Akademie Verlag, 2009, p. 1-28.
- F. Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007.
- Id., p. 30.








