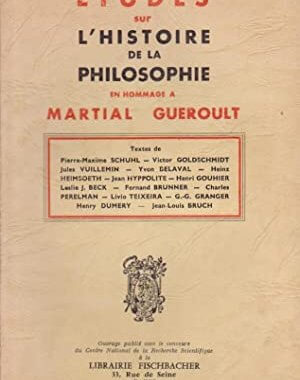Présentation de la structure de l’ouvrage
Le livre est paru en 2018 aux éditions Vrin dans la collection Textes clés de l’histoire de la philosophie, et se présente comme un cours aussi précis que complet sur les relations entre l’histoire et la philosophie, du point de vue de la problématisation de la première par la seconde. La philosophie de l’histoire est une discipline auto-réflexive et non autonome, en tant qu’elle dépend à la fois des réflexes des historiens et du support de la philosophie comme pratique. Le livre se découpe selon cinq grandes parties, une première Présentation générale (p. 7-p. 49), et quatre séries de recueils thématiquement définis : Thèmes et concepts (p. 53-p. 96) ; Genèses et structures (p. 99-p. 169) ; Textes, contextes, constellations (p. 173-p. 295) ; Progrès, récurrences, discontinuités. Vers une histoire antiquaire de la philosophie ? (p. 299-p. 373). Il s’agit d’un point historique de l’ordre du repère, puisqu’il s’y trouve l’exposition de différents points dominants dans les polémiques de l’histoire des idées des dernières années. En effet, l’histoire de la philosophie, comme l’histoire des théories littéraires, d’ailleurs — pour parler très rapidement — a traversé ces dernières années une grande intensification des débats entre une histoire des énoncés et une histoires des prises de paroles. L’enjeu statuant sur l’importance ou non de l’inclusion des biographies des auteurs, de la notion de contexte historique, ou psychologique, et s’inscrit en fait en philosophie dans les ramifications du grand schisme en philosophie qui, avec la conférence de Davos, en 1929, trouva l’un de ses points culminants. La philosophie s’est effondrée — ou a menacé de se dissoudre dans le tout de la vie intellectuelle prise au sens large — au XIXe siècle[1] et l’un des enjeux de sa survie passa par la place que la doxographie donne au sujet. Quid de la prévalence entre l’énoncé — la forme d’une idée, la singularité d’une expression de la problématisation d’un universel vis-à-vis de l’activité de l’esprit — et l’auteur qui s’en saisit ?
Voilà ce dont le livre se fait une sorte de rappel des enjeux contemporains, dans une série de parties tout à fait pratiques pour une connaissance précise de son actualité. Les différentes parties présentent chacune une présentation plus resserré du problème choisi par Patrick Cerutti — le livre est extraordinairement érudit et précis — et le détail se décompose comme suit :

Thèmes et concepts : une présentation de dix pages puis : dix pages pour Leçons sur l’histoire de la philosophie (Manuscrit de 1820, extraits), de Hegel ; quatorze pages pout Le cercle de la philosophie et de l’histoire de la philosophie (1907), de Gentile ; neuf pages pour Les conceptions opératoires dans la phénoménologie de Husserl (1957, extraits), de Fink.
Genèses et structures : une présentation de quinze pages puis : huit pages pour La philosophie et son passé (1940, extraits), de Bréhier ; dix-neuf pages pou Logique, architectonique et structures constitutives des systèmes philosophiques (1957), de Gueroult ; onze pages pour Temps historique et temps logique dans l’interprétation des systèmes philosophiques (1953), de Goldschmidt ; quatorze pages pour Intention et détermination philosophique (1973), d’Alquié.
Textes, contextes, constellations : une présentation de douze pages puis : vingt pages pour La grande chaîne de l’être. Préface (1936), de Lovejoy ; cinquante-neuf pages pour Signification et compréhension en histoire de la philosophie (1969-2002), de Skinner ; vingt pages pour L’analyse des constellations en philosophie classique allemande (2005), de Henrich.
Progrès, récurrences, discontinuités. Vers une histoire antiquaire de la philosophie ? : une présentation de dix pages puis : quatorze pages pour Continu et discontinu en histoire de la philosophie (1974), de Belaval ; trente pages pour La relation de la philosophie à son passé (1984), de MacIntyre ; douze pages pour Vers une histoire antiquaire de la philosophie (2003), de Garber.
Notons simplement, avant de passer à l’étude plus minutieuse de l’argument de cette vaste et riche problématisation des liens réciproques entre histoire et philosophie, que la mise en problématisation du titre de la dernière partie est un objet extrêmement contemporain, saisi par bien d’autres penseurs dans l’histoire actuelle. Que l’on songe seulement à l’écho que trouve cette partie dans le titre donné par Martin Rueff, professeur auprès de l’Université de Genève, à sa série de conférence auprès du Centre de Recherche en Histoire des Idées de l’Université Côte d’Azur : «Chacun a ses ruptures spécifiques» : le sens des ruptures de Bachelard à Foucault. En l’espèce, c’est la philosophie de la science qui se trouve interrogée, par ses voix les plus importantes, du point de vue de ses continuités et ses ruptures — et du point de vue du sens que l’on pourrait donner à ces ruptures.
Contexte et démarche
La relation de la philosophie à l’histoire a, ces cinquante dernières années pour ne parler que de cet intervalle de temps, posé de sérieux problèmes du point de vue de la justification de sa pratique. On sait de quelle façon l’édifice hégélien, aussi beau qu’il est massif, a déformé bien des champs de la pratique de la philosophie, et parmi ses interstices, le rapport à la philosophie de l’histoire. On a ainsi trouvé dans toutes les strates de la théorie, de la philosophie aux lettres, de la forme rhétorique à la linguistique, et enfin, de la théologie à l’histoire, l’onde de choc, si l’on voulait, des différents héritages de Hegel, et des positions antagonistes possibles dérivant du maître. Le problème de l’histoire de la philosophie est certes plurivalent et se décompose à chaque époque selon des paradigmes problématiques différents. Par exemple, dans l’ouvrage qui nous occupe, il concerne certes l’histoire, certes la philosophie, mais aussi les théories conflictuelles à propos de la façon d’aborder l’intrication de l’activité de la pensée dans le déploiement des modes de constitution de la pensée. Il faudrait aussi chercher à déterminer dans quelle part et à quel degré les différents aspects de l’activité de l’esprit participent du geste, à la fois spéculatif, théorique et programmatique — entre historiographie de cette activité et compréhension des mécanismes de cette activité et des conditions formelles de l’historiographie, ainsi qu’une sorte de conscientisation des mécanismes. L’ouvrage Histoire de la philosophie, Idées, temporalités et contextes, paru en 2018 et commandé par l’éditeur à Patrick Cerutti, propose donc de relever un tel nœud de défi, sans avoir pour autant recours au glaive d’Alexandre. La singularité de l’auteur se trouve précisément dans la capacité à la plurivalence des focalisations, car, comme il l’écrit lui-même, le problème de l’histoire de la philosophie (en particulier) est très complexe (comme le sont en particulier chacun des problèmes de l’histoire d’une discipline).
Qui, aujourd’hui, regarde l’histoire de la philosophie comme un but en soi ? Mais, dans une discipline qui a toujours beaucoup de mal à penser historiquement et à admettre que la pensée a une histoire, et même une préhistoire, une hérédité pré-rationnelle, il faut peut-être rappeler que, pour faire de l’histoire de la philosophie, il faut être philosophe, mais aussi historien.[2]
Nous reviendrons rapidement sur le cœur de ce paragraphe, qui s’oppose en tous points à la conception de l’histoire des idées qui est la nôtre, mais l’essentiel est pour le moment de souligner comment, « pour faire de l’histoire de la philosophie, il faut être philosophe, mais aussi historien ». C’est donc qu’il faut pouvoir proposer une telle histoire récente de l’histoire de la philosophie, et à ce titre, être à la fois spécialisé dans le domaine des périodes historiques de la philosophie concernés, mais aussi de la philosophie de l’histoire, c’est-à-dire historien. Réfléchir au sens de l’histoire de la philosophie et aux formes pédagogiques de son exposition. Si toute pédagogie enseigne l’efficacité d’une linéarité, comme pour démontrer la réalisation d’une discipline, alors l’enseignement de la philosophie revient à faire, de facto, de l’histoire de la philosophie et de la philosophie de l’histoire de cette discipline.
Or, voilà qui tombe bien, puisqu’après avoir suivi un cursus de khâgne à Henri IV, Patrick Cerutti est maintenant professeur agrégé de philosophie en CPGE, par ailleurs rattaché aux archives Husserl aussi bien qu’au Centre Emmanuel Levinas de Paris-Sorbonne. Docteur en philosophie depuis 2006, il a soutenu une thèse ayant eu pour titre Spéculation et expérience. Schelling au miroir de Jacobi. Sujet, d’ailleurs, comme nous le proposons par la suite à propos de la tradition à laquelle appartiendrait Barthes, qui n’est pas sans laisser sa marque sur la façon choisie par l’auteur de présenter certains des problèmes de l’histoire, entre idéalisme et « empirisme naïf » (p. 17). De là, la présentation des différents problèmes que se pose l’histoire de la philosophie bénéficie d’une pratique, par l’auteur, de l’exposition et la décomposition des enjeux complexes d’un phénomène historique à la fois stratifié et ramifié. Le cours extrêmement précis et complet, présente donc un corpus qui permet d’exposer — et non de répondre à — une tension dans l’histoire des idées qui, nous citons la quatrième de couverture, est ainsi présentée de façon synthétique :
La tâche de l’historien serait-elle donc de faire le relevé de ce qui change tandis que celle de la philosophie serait d’identifier ce que l’histoire n’altère pas, ce qui serait son domaine propre ? Les textes que nous réunissions ici témoignent de cette tension et disent tout à la fois les limites de l’appropriation historique du passé par la pensée et cette nécessaire école de la pensée qu’est à l’histoire l’histoire de la philosophie.
Ce que nous allons tâcher de proposer dans cette recension tient à la fois du « bottage en touche » — nous allons sortir de l’ouroboros « philosophie de l’histoire – histoire de la philosophie » — et de l’anachronisme — nous allons sortir du cadre temporel fixé par l’auteur. Ce qu’il faut reconnaître ici, c’est l’extrême qualité, et le caractère, du point de vue de sa problématisation, exhaustif de l’exposition proposés par Patrick Cerutti. Nous nous serions trouvés bien en peine de proposer pour recension, autre chose qu’une sorte de reproduction paraphrastique presque à l’identique, une sorte de sommaire général de l’ouvrage. C’est précisément parce que le recueil qui compose l’ouvrage et les commentaires qui les contextualisent (les uns par rapport aux autres, mais aussi comme des épisodes de la vie de la pensée, renvoyant aux exemples de figures majeures de l’histoire des idées) sont d’une telle qualité que nous avons voulu saisir l’occasion d’une réflexion aux limites du problème présenté.
Le caractère agonal esthétique contre l’univocité de la théorie
Pour entrer dans l’enchaînement causal des successions des différents auteurs qui se répondent dans les liens qui composent le nœud dont la présentation est l’objet de son ouvrage, Patrick Cerutti ouvre sur la formulation « la plus franche » du refus de soumettre la réception d’une œuvre à la nécessité de la biographie de son auteur. L’un des tenants les plus farouches, au moins dans ses énoncés, de cette doctrine, étant bien sûr Roland Barthes, professeur au Collège de France.
C’est chez Roland Barthes qu’on en trouve l’expression la plus franche : « l’œuvre est pour nous sans contingence, et c’est même peut-être là ce qui la définit le mieux : l’œuvre n’est entourée, désignée, protégée, dirigée par aucune situation ; aucune vie pratique n’est là pour lui dire le sens qu’il faut lui donner (…). En elle, l’ambiguïté est toute pure : si prolixe soit-elle, elle possède quelque chose de la concision pythique, paroles conformes à un premier code (la Pythie ne divaguait pas) et cependant ouverte à plusieurs sens, car elles étaient prononcées hors de toute situation — sinon la situation même de l’ambiguïté ».[3]
Il nous semble que l’on peut entendre de bien des façons ces quelques lignes de la main de Roland Barthes. Comme une sorte de détestation de toute réduction de la potentialité de l’œuvre par la détermination contenue dans la biographie de son auteur, certes, mais aussi comme une défense de la liberté de la performance de l’acte de lecture[4]. L’œuvre ainsi proposée comme support poétique d’inspiration du lecteur, comme partage d’un souffle (pour risquer une image), et non comme une vérité. Ce pourrait donc être moins un acte critique théorique chez Barthes, qu’un impératif de liberté dans l’acte de la lecture elle-même, comme créativité. L’œuvre serait de ce point de vue sans assignation, et la biographie de l’auteur ne serait qu’un appauvrissement du potentiel pratiquement infini de l’imagination du lecteur, en opposition au concept d’un prérequis, d’un cadre constituable à partir de la biographie de l’auteur de l’œuvre. Il paraîtrait donc vraiment très curieux de taxer les positions de Roland Barthes d’un conservatisme post-moderne, en supposant que le post-modernisme consisterait en une sorte de crispation hystérique sur des positions qui, vraisemblablement, étaient plus subtiles qu’elles ne sont comprises. Dès lors, en va-t-il par exemple ainsi lorsque l’auteur écrit :
Ces affirmations péremptoires (« je ne crois pas aux influences »), qui reviennent à fétichiser les textes et qui avaient il y a vingt ans encore le charme de la postmodernité, paraissent aujourd’hui tout à fait désuètes.[5]
Car justement, n’y aurait-il pas fétichisation de ces formules, certes péremptoires et sans doute, même, un peu faciles, en voulant les réduire au déterminisme de leurs seuls travers ? Précisément, si l’on pratique l’histoire des idées, ou de la philosophie, comment ne pas trouver dans le pas de Roland Barthes un geste qui réagissait aux gestes précédents et, si l’on veut aller jusqu’au bout du paradoxe d’une telle affirmation, comment ne pas voir dans les positions théoriques de Roland Barthes le bagage intellectuel qui était le sien ? Rappelons peut-être que Roland Barthes était pour sa génération l’un des plus fins lecteur de Marcel Proust, le même Marcel Proust qui écrivit un Contre Sainte-Beuve, paru à titre posthume en 1954, brûlot — élégant, comme toujours — de Proust contre la considération de la vie d’un auteur dans la réception de l’œuvre de celui-ci. En outre, et comme par ironie, s’il y a bien un auteur de littérature dont on a décortiqué l’existence dans ses moindres détails pour mieux saisir les ressorts de son œuvre, c’est bien Proust.
Autrement dit, Barthes appartenait à une tradition et il s’agirait peut-être de reconnaître sa filiation, relativisant la radicalité de ses énoncés à la lumière de son école. Il n’était pas philosophe, et ses travaux sur les mythologies sont (ou étaient) pleines d’excellentes intuitions du point de vue de l’herméneutique du mythe telle qu’elle peut se pratiquer aujourd’hui. Nous pourrions par exemple redonner à Barthes l’intérêt de son pas théorique en réduisant ses positions à la réception analytique (ou critique) d’une œuvre. Lorsqu’il écrit les phrases citées plus haut, nous y verrions, pour notre part, une défense de la pratique (praxis) de la réception, plutôt qu’un impératif théorique du traitement exégétique comme prescription catégorique. Une œuvre pourrait alors gagner à être aussi considérée hors de tout contexte et hors de toute influence, ainsi qu’une sorte de singularité totale, dans l’horizon des activités esthétiques. Si l’on accepte d’envisager le cas des théories littéraires de Barthes avec prudence, et depuis le bord d’une pratique littéraire de la littérature, la suite du paragraphe est encore plus étonnante :
MacIntyre n’a pas tort de faire remarquer que le postmodernisme le plus avancé rejoint en fin de compte le conservatisme le plus intransigeant dans son incapacité à comprendre que la vie intellectuelle et même la vie culturelle dans son ensemble sont structurées par des traditions.[6]
On pourrait trouver tout à fait édifiant de voir de quelle façon l’intransigeance de son énoncé pourrait être retourné contre MacIntyre lui-même. Combien de textes majeurs dans l’histoire des idées ont bénéficié d’une certaine tendresse et d’une auto-censure de la part de leurs exégètes vis-à-vis de certains points problématiques ou certaines démonstrations par la suite invalidées par la progression des théories de la connaissance ? Combien de philosophes ont trouvé plus intéressant d’enjamber un problème plutôt que de condamner toute la démonstration ? Ce qu’il y a chez Barthes est tout à fait utilisable, même en se satisfaisant d’en limiter la portée, par exemple, comme nous le proposions à l’instant, à la simple réception esthétique d’un texte. L’intransigeance et la férocité de MacIntyre pourraient bien être assimilées à l’énième étape d’un processus historique majeur : la succession des générations et, ce faisant, la nécessité de déboulonner la statue de la figure antérieure. De ce fait, les penseurs qui construisent à partir de ce qui vînt avant, nous paraissent souvent moins suspects que ceux qui construisent uniquement dans les ruines du passé, méticuleusement démembrées, et, parfois, encore fumantes. Nous prenons cet exemple pour son caractère démonstratif mais il ne s’agit pas non plus de défendre au-delà d’une certaine limite le degré zéro de l’écriture et la mort de l’auteur. En revanche, souligner par son exemplification un mécanisme dans l’histoire des idées nous paraît tout aussi intéressant dans la démarche visant à exposer un ouvrage aussi riche et aussi complet que celui de Patrick Cerutti.
Car, comme il l’écrit lui-même, « on ne peut être un grand auteur sans être ou avoir été un grand lecteur »[7], or il se pourrait bien que l’une des qualités qui distingue un lecteur d’un grand lecteur serait — outre la quantité — la bienveillance. C’est-à-dire que la lecture pourrait s’accompagner d’une tendresse rejaillissant sur l’auteur, et qui compenserait spontanément les moments de creux, soit qu’il s’agisse d’une aporie résolue par l’histoire de la pensée depuis, soit que nous soyons en présence d’un aspect qui serait peut-être un peu moins sérieux que ne le serait le reste de l’énoncé[8]. Comment tenir qualitativement au long terme dans l’activité de lecture si l’on s’agace et s’indigne dès qu’un auteur pèche par excès d’enthousiasme ou par insuffisance démonstrative ? Un tel ethos de la lecture pourrait bien permettre de retrouver le caractère cumulatif des possibilités que proposait Roland Barthes, c’est-à-dire en accumulant les significations potentielles et les pistes de solutions, plutôt qu’en procédant en terme d’éliminations, de vérités, de preuves et de triomphe. Si l’on suivait une telle diététique de lecteur — déjà, nous nous illustrerions comme un grand lecteur —, le recueil des textes et les présentations qu’en fait Patrick Cerutti en ressortiraient plus intéressants encore.
Les différents protagonistes, quittant le statut de belligérants, gagneraient celui de délibérants tous ensemble, et, comme en un colloque, laisserait au lecteur — ou au spectateur — le loisir de se constituer sa propre pédagogie. Patrick Cerutti ne nous paraît pas mettre autre chose en avant, dans la présentation de la dernière partie de son recueil :
Étudier l’histoire de lac philosophie revient à considérer les problèmes sous l’angle de leur nouveauté, ou à montrer comment des problèmes apparemment éternels se présentent chaque fois suivant des perspectives nouvelles. L’histoire de la philosophie n’est pas une quête de la vérité, une quête des réponses que l’on peut donner aux questions philosophiques, mais une quête des questions elles-mêmes, ce qui, en fin de compte, est tout aussi valable. Son importance ne se mesure pas aux réponses qu’elle apporte, mais aux questions qu’elle pose, affirme encore Garber.
Nous sommes là assez près de ce que défend aujourd’hui Alain de Libera par exemple, quand il pose que l’histoire de la philosophie n’est pas l’histoire des réponses, mais l’histoire des « complexes de questions et de réponses ».[9]
— Autrement dit, des systèmes et des édifices de systèmes de sens. Notons par ailleurs que c’est une démarche que soutient Paulin Ismard dans son ouvrage de 2013 sur Socrate[10] : l’histoire non pas simplement comme l’alignement des événements, ni comme la problématisation de cet alignement, mais comme la problématisation de l’imaginaire soulevé par ces événements. En effet, une idée soulève des réactions, inspire des récits, en sciences comme en littérature, ou dans n’importe lequel des arts qui sont apparus et se sont densifiés dans l’histoire. Une idée ne reste pas sans onde de choc, nous avons déjà saisi l’image tout à l’heure, et de même que toute déformation d’une idée s’accompagne d’un cortège de modifications dans le champ des représentations, le contexte de son apparition conditionne les contextes de ses déformations. Autrement dit, une idée s’accompagne nécessairement des imaginaires dont elle est le produit, comme des imaginaires dont elle est le lieu de production. Aussi, rien dans les propos suivants de Patrick Cerutti ne nous paraît s’opposer à l’idée de cette revalorisation de l’histoire comme une intensification des imaginaires (et que l’on peut étendre aux imaginaires sur les textes, imaginaires critiques inclus), et même, nous trouverions certains rapprochements possibles.

À notre époque, il semble de plus en plus difficile de croire à l’autonomie des idées par rapport à leur contexte culturel, et d’adhérer à l’intellectualisme qui sous-tend cette croyance. Comment sans connaissance du contexte, procéder au repérage des innovations ? Comment croire que l’étude des similarités ou la détection des récurrences à travers de longs espaces de temps suffit à établir une véritable connexion historique et, à plus forte raison, à déceler une permanence ?
Aujourd’hui, une tendance forte à retremper les discours canoniques de la philosophie dans le bain des discours ambiants les plus humbles semble avoir définitivement périmé l’idée d’une histoire des idées autonome. À partir du moment où l’on se convainc que la pensée est moins un jeu d’idées qu’une activité sociale, l’idée perd sa prééminence, au même titre que la figure du grand créateur. L’histoire des idées ne peut être que celle de leurs usages en tant qu’arguments[11], ce qui suppose que l’on reconstitue des contextes ou les différentes matrices dans lesquelles elles ont été forgées et à travers lesquelles elles ont été lues.[12]
Et en effet, nous semble-t-il, l’histoire des idées ou philosophie de l’histoire des idées, ne saurait être ainsi distinguée ou distinguable d’une philosophie des imaginaires (une « activité sociale »), c’est-à-dire du champ le plus inclusif possible, incluant même pour et par sa reconnaissance, l’activité sensible de l’esprit pour répondre à la première des questions de Kant (Que puis-je savoir ?), une philosophie de la culture. C’est même là, à notre sens, tout l’enjeu — et ce n’est pas tant l’idée, qui perdrait ainsi sa prééminence, mais le concept. L’idée serait le nouveau module possible pour le transfert des imaginaires — dans la catégorie desquels entrerait tout aussi bien le concept. Ainsi, l’histoire des idées qui ne pourrait être que « celle de leurs usages en tant qu’arguments » soutiendrait la perspective d’une téléologie des imaginaires, et, ce faisant, d’une histoire pensée comme histoire du déplacement téléologique des formes, des sens et des fonctions de l’idée ; qu’il s’agisse d’un concept ou d’une image.
Limites et vertus d’une historiographie critique sans critique de l’histoire de l’Histoire de la philosophie
Il faut se demander dans quelle mesure une partie de l’énoncé que nous avons cité quelques lignes plus haut pose un problème, du point de vue d’un historico-centrisme. Ne pourrait-on pas être plus humble — être un « lecteur modèle » — avec les doctrines qui sont antérieures aux nôtres ? Présentant les auteurs qu’il va exposer, Patrick Cerutti parle d’une « préhistoire, une hérédité prérationnelle »[13], comme s’il y avait, de même que l’individu passe de l’enfance à l’adolescence, une sorte d’âge rationnel qui correspondrait à une sorte de justesse méthodologique, donnant un horizon heuristique à l’histoire. On a déjà lu des auteurs, par le passé, qui écrivirent qu’il existait des sociétés « primitives » qui, non contente d’être une classification du degré d’institutionnalisation, hiérarchise scientifiquement en fonction de la complexité philosophique. Selon un tel réflexe représentationnel (autocentré), il devrait y avoir un mauvais état de la pensée, résorbé dans l’accomplissement d’un bon état suivant la ligne méliorative d’un progrès, comme une flèche tendue vers un horizon d’or et de miel de la Pensée Accomplie.
C’est à notre sens une erreur de considérer l’histoire comme une succession d’étapes formelles que discriminerait un vrai de la méthode menant jusqu’à nous — « vrai » accidentellement et étonnement conforme à la méthode que nous pratiquons, nous, qui jugeons le phénomène théorico-historique observé. Mais il faut supposer qu’il s’agit d’un réflexe linguistique, bien plus que d’une conviction idéologique, et que les historiens convoqués ne font pas partie de ces gens, par exemple, qui considèrent le mythe comme un stade pré-logique de la pensée.
Cependant, et même si ce n’est pas ici le lieu de discuter ce point particulier — passionnant — qui concerne tout autant l’histoire de la philosophie que l’histoire de la philosophie de l’histoire, et des théories de la connaissance, nous pourrions y songer telles qu’elle furent initiées par l’école des néokantiens de Marburg. Non plus comme la recherche d’une vérité, c’est-à-dire d’une inertie, mais comme poursuite infinitésimale de ce qu’il y a de signifiant dans un phénomène (le noumène). Il nous semble pourtant, si l’on avait voulu en discuter, que cela pourrait aurait pu correspondre exactement à ce que l’auteur écrit lui-même à propos des risques de confusion sur la méthode, contemporaine :
On ne peut en effet espérer comprendre une pensée tant qu’on n’a pas identifié la question à laquelle le penseur s’est efforcé de répondre. Or un auteur énonce rarement la question dont il part et comme celle-ci est oubliée une fois que ses contemporains sont morts, comme, en règle générale, les réponses entourent si bien les questions qu’elles finissent par les cacher, ce qu’il avait en tête ne peut être reconstruit qu’historiquement. Devant une ruine romaine, comment arriver à distinguer, sans étude historique, les différentes périodes de construction et de deviner à quoi pensaient les architectes ? Croirait-on que le Parménide soit plus facile à comprendre « qu’un petit fortin romain pourri » ? Penser historiquement ne revient pas, comme on le répète à loisir, à faire disparaître la vérité, mais à en modifier le concept : la vérité n’est pas la propriété d’une proposition élémentaire, mais ce qui s’élabore à l’intérieur d’un ensemble consistant en questions et en réponses. Une philosophie n’est pas l’histoire des différentes réponses données à une unique et même question, mais « l’histoire d’un problème qui se modifie plus ou moins constamment, et dont les solutions changent de ce fait ». Les motifs que les auteurs poursuivent ne déterminent pas seulement la façon dont ils résolvent les problèmes qui se posent à eux, mais ils affectent aussi ces problèmes.[14]
Avant de commenter ce passionnant paragraphe de l’auteur, nous voulons le mettre en vis-à-vis direct d’un paragraphe traitant, à notre sens, exactement du même objet, mais à partir d’une perspective toute différente, n’opposant plus la question à l’histoire de son auteur mais enchâssant l’économie téléologique de la question dans un processus structurel plus général :
On voit ainsi que les problèmes de la mythologie authentique, de la réception mythologique et finalement de la possibilité de remythisations, sont liés entre eux structurellement. C’est seulement lorsqu’on comprend le mythe comme distance vis-à-vis de ce qu’il a déjà laissé derrière lui — ce que l’on peut appeler effroi, dépendance absolue, rigueur du rituel et de la prescription sociale ou comme l’on voudra —, qu’on peut concevoir l’espace de jeu de l’imagination comme le principe de sa logique immanente, d’où proviennent les formes fondamentales de la sinuosité et des moyens détournés, de la répétition et de l’intégration, de l’antithèse et du parallèle. L’expression de « distance » doit rappeler l’observation éclairante de Burckhardt suivant laquelle nos difficultés vis-à-vis du mythe viennent de ce que, dans notre tradition, nous le rencontrons chez un peuple « qui a manifestement voulu oublier les anciennes significations de ses figures ». Avec l’authenticité du « chercheur sur le terrain », l’ethnologue moderne (B. Malinowski) observe également la mythologie dans sa fonction de dépotentialisation de ce qui angoisse, « comme réaction […] à l’idée la plus formidable et la plus obsédante » : « […] l’idée de la mort est enveloppée d’horreur, et l’homme cherche à en écarter la menace, avec le vague espoir, non de l’expliquer, mais de la supprimer, de la rendre iréelle, de la noyer dans la négation ». L’oubli des « anciennes significations » est la technique même de la constitution des mythes — et en même temps la raison qui explique qu’on retrouve toujours seulement la mythologie « passée au stade de sa réception ». La phénoménologie de la réception absoudre ce qui est supposé « agir » dans celle-ci.[15]
Dès lors, comment ne pas comprendre par quels biais, pour peu que l’on donne un certain crédit au parallèle ici proposé, l’histoire en général, mais l’histoire des énoncés philosophiques en particulier, serait propice à la mythologisation, c’est-à-dire, notamment, à la mystification ? Idem, pour peu que l’on accepte d’envisager la philosophie, ou ses questions, dans la plus antique tradition occidentale, c’est-à-dire panhellénistique, comme un péri phuséos, c’est-à-dire une réflexion sur la nature au sens cosmique, l’acte philosophique du poème de l’Être de Parménide est nécessairement une tentative élaborée de réponse à l’effroi, une conjuration. L’édifice dont parle Patrick Cerutti, qu’il s’agisse d’un fortin, d’une basilique ou d’un texte, procède donc par un enveloppement de sa propre nécessité qui opère cet « oubli » rassurant, et la dimension fragmentaire ou aporétique que l’historien doit avoir à charge de compenser, devient en tous points conforme au sous-titre de l’ouvrage de Collingwood, Toute histoire est histoire d’une pensée, à savoir Autobiographie d’un philosophe archéologue. En de telles conditions, comment ne pas être archéologue — ou ethnologue, propose un Blumenberg marqué en son temps par les progrès d’un structuralisme ethnologique, à la Malinowski, ou même, plus proche de nous, Lévi-Strauss, par exemple ?
Autrement dit la réception même de l’histoire de la philosophie — et de la philosophie du processus de son historicisation — correspond, ou pourrait correspondre, aux mécanismes de formation que Blumenberg associe ici au mythe. Une activité de travail de dissimulation des conditions formelles des énoncés afin de conjurer ce qui, dans l’économie de la nécessité de ces énoncés, pourrait rappeler le caractère traumatique des motifs fondamentaux. Sans aller jusqu’à verser dans une lecture dramatisante de l’histoire de la philosophie, nous pourrions garder en tête le caractère de l’obsolescence de ces motifs fondamentaux et, repensant à la prescription de Barthes, associer à l’ethnologie le caractère de la justesse pour soi d’un problème. Quoi que rechercher les questions essentielles auxquelles tentait de répondre Parménide dans son poème ancestral, l’une des pierres fondatrices de la philosophie occidentale, est d’un indiscutable apport pour l’histoire de la pensée, il se pourrait que considérer ce que ces questions recouvrent pour chaque lecteur, rendues actuelles par une lecture contemporaine anachronique, rendrait à la fois caduque toute polémique sur la prévalence ou non des biographies d’un auteur ou même d’une idée.
Il ne fait pas de doute pour nous, tout extérieur au livre que nous soyons, une idée s’inscrit dans sa progression et dans le caractère métamorphique de son processus historique, infléchissant et ses matérialisations et les conditions formelles de sa récurrence[16]. Nous ignorons si le débat peut encore avoir du sens, dans nos années, mais l’histoire de la philosophie passe aussi par la prise en compte de ses archives. À ce titre, cet ouvrage est décisif.
[1] — Il faut lire à ce titre Léo Freuler, La crise de la philosophie au XIXe siècle, Paris, Vrin, 1997.
[2] — Patrick Cerutti, Histoire de la philosophie. Idées, temporalités et contextes, Paris, Vrin, 2018, p. 17.
[3] — Ibid., pp. 12-13.
[4] — Il faudrait peut-être penser à la pratique des mêmes questions par la théorie littéraire, notamment français, et la sémiologie post-structuraliste, qui tâchait de répondre, du point de vue de la littérature et de disciplines perméables aux préoccupations philosophiques, à des questions semblables. On songe ici, notamment et pour ne parler que de lui, au travail du sémiologue, également spécialiste en esthétique médiévale, linguistique, philosophie ou même sur la communication de masse. Son ouvrage Lector in fabula, paru en 1979. L’objet du recueil est de faire un catalogue philosophique de la question, mais nous pourrions nous étonner de constater cette attaque de Roland Barthes sans le rattacher au continent critique auquel il appartenait, plus que majeur dans la post-modernité, et justifiant à plus d’un titre certains aspects présents dans la citation épinglée. En outre, nous nous étonnons que l’accusé n’ait pas eu plus de matériel pour se défendre : notamment parce que cet aspect spécifique de la doctrine de Barthes — et de cet aspect de la théorie postmoderne — s’inscrit dans une logique beaucoup plus vaste que ce simple désir de tuer l’auteur.
[5] — Ibid., p. 13.
[6] — Ibid
[7] — Ibid., p. 15.
[8] — Il s’agit là de renvoyer au texte de Lector in fabula, qui présente la théorie des différents types de lecteur et, ultimement, au type du « lecteur modèle » pour qui le texte est un « tissu de non-dit » qui doit actualiser par le lecteur. Umberto Eco a notamment puisé chez Gérard Genette et Roland Barthes les éléments qui ont contribué à l’homogénéité de sa théorie sur l’acte de lecture mais aussi, et peut-être surtout, à l’un des fondateurs du groupe allemand Poetik und Hermeneutik, Wolfgang Iser, et à son ouvrage L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, 1972, 1976 pour l’édition française. Ce dernier développe notamment, parmi toutes les idées passionnantes, le thème d’un « lecteur implicite ». Voir à ce titre ce qui pourrait bien être la recension, en français, de l’ouvrage, parue en 1983, dans Semen, revue de sémio-linguistique, premier numéro de 1983 sous la main de Yves Gilli : https://journals.openedition.org/semen/4261#ftn9
[9] — Ibid., p. 299.
[10] — Paulin Ismard, L’événement Socrate, Paris, Flammarion, 2013.
[11] — C’est nous qui soulignons.
[12] — p. 176
[13] — Ibid., p. 17.
[14] — Ibid., p. 18.
[15] — Hans Blumenberg, La raison du mythe, Paris, Gallimard, 2005, pp. 110-111.
[16] — On pourrait recommander, à ce stade, la lecture de plusieurs ouvrages de Cassirer, dont Substance et fonction. Éléments pour une théorie du concept, et notamment les trente premières pages, Paris, Minuit, 1977 pour l’édition française (1910 réimprimé en 1969 pour le texte allemand), mais aussi, et peut-être surtout, la somme des quatre volumes Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, parus en français aux éditions du Cerf.