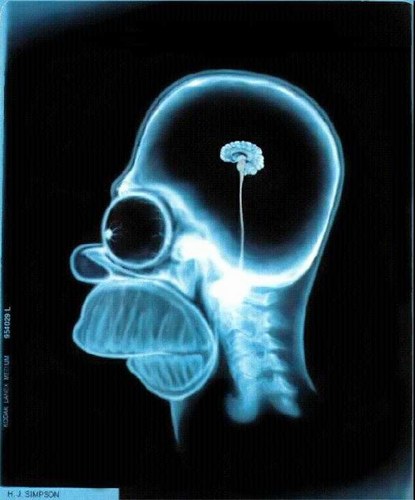« Mais puisque toutes les facultés de l’âme dépendent tellement de la propre organisation du cerveau et de tout le corps qu’elles ne sont visiblement que cette organisation même, voilà une machine bien éclairée ! (…) vous connaîtrez l’unité matérielle de l’homme. », écrit au XVIIIe siècle un neurophilosophe visionnaire : La Mettrie 1
L’ouvrage de Patrick Davous2 retrace l’histoire de la neurologie et interroge rapidement les implications philosophiques des savoir positifs que nous apportent les neurosciences. L’ambition de l’A. est donc d’introduire, voire de vulgariser la révolution que nous vivons, celle des neurosciences ; de la genèse de cette jeune discipline scientifique aux problèmes spécifiques de la localisation cérébrale ou de la mécanique des fonctions permettant mouvements, émotions, actions, une courte présentation historique s’achève sur l’actualité des problèmes et découvertes en question. On peut regretter la rapidité de la revue, on peut même se demander si la chronique est une pure chronologie commentée en passant, avec le talent espéré de celui qui sait conter une anecdote et faire science du singulier. La chronique se prête effectivement bien pour montrer le caractère paradigmatique de la petite histoire, les heureux « eurêka » des sciences qui permettent de vulgariser les grands découvertes, mais l’exercice est difficile et l’impression de dispersion est rapide. C’est parfois le cas, ici. En quelques centaines de pages, le pari est donc ambitieux : raconter l’essor d’une science aux multiples ramifications, raconter cet essor dans le temps long de son histoire – d’Hippocrate et Galien à Vésale et Broca – et dans sa densité actuelle, son destin actuel, c’est-à-dire son essor depuis le XVIIIe siècle et ses progrès exponentiels depuis l’imagerie cérébrale et le travail pluridisciplinaire des sciences cognitives ; mais aussi et surtout raconter une histoire nécessairement décevante, dont le suspens ne cesse de hanter l’aporie du scientisme, car identifier la pensée au cerveau, ce ne sera pas percer la chose en soi, mais percer son mystère structurel et fonctionnel. De la même manière que la physique moderne et l’astrophysique furent et sont promesses d’origine et de mondes parallèles, les neurosciences sont promesses métaphysiques déçues, mais peut-être en leur aspect neurologique promettent-elles ce dont elles ont les moyens. En effet, l’excitation persiste pourtant, non seulement l’excitation gnoséologique, il y a des découvertes faites et à venir, mais surtout l’excitation médicale, connaître le fonctionnement de l’homme neuronal et hormonal, c’est pouvoir le soigner. L’intérêt du présent livre est certainement à cet endroit-là, rappeler l’importance de la neurologie au sein des neurosciences, c’est-à-dire la fonction pratique de tels savoirs, en distinguant ce champ scientifique, a fortiori médical, du champ philosophique. Pour autant, l’A. ambitionne de présenter aussi quelques questions philosophiques, dont la neurophilosophie ; cette visée encyclopédique est une des limites de l’ouvrage : on ne peut chroniquer avec exhaustivité, tout comme on ne peut prendre le temps de l’argument au sein d’une chronique de quelques pages. La pertinence se justifie, cependant, car la révolution neuroscientifique apporte des contenus positifs susceptibles de nourrir les problèmes de la pensée, tout autant que de montrer la nécessité de la spéculation – on voit, par exemple avec l’antinomie du langage comme grammaire générative ou du langage comme outil social, que les savoirs positifs ne tranchent rien et relancent plutôt de grands arguments philosophiques. C’est pourquoi, notre recension ne se veut pas tant l’étalage encore plus rapide de l’introduction à a neurologie de P. Davous – une telle recension n’aurait aucun sens, la chronique ne se recense pas, elle se critique – mais plutôt la mise en perspective philosophique de certains de ces éléments positifs. L’A. ébauche cette réflexion-là, en plus de son travail de transmission que l’on doit saluer, mais il lui manque l’aspect dialectique de l’histoire de la pensée, c’est-à-dire la perspective critique et le sort spéculatif que le philosophe réserve à tout savoir positif. Tout autant, il faut rendre justice à la probité métaphysique de l’A., celui-ci ne commet pas de pétition de principe, il ne tire pas de la neurologie ce qu’elle postule : l’identité des hautes facultés intellectuelles et morales et de leurs conditions neurobiologiques, l’identité du mental et du cerveau. Il indique la frontière entre des territoires, par là il montre la modestie de nos savoirs et l’ambition démesurée de nos questions ; c’est certainement cette modestie métaphysique que P. Davous entend vulgariser, en cela il prend le contre-pied de l’époque et s’en démarque avec hauteur : il ne s’agira pas ici de faire de la réduction sensationnelle et de loger morale et mathématiques dans quelques réseaux de neurones.
1. Une brève histoire du cerveau
Genèse d’une révolution à venir
Le premier chapitre de l’ouvrage ne rend pas justice à ce dernier. En effet, retracer l’acte de naissance de la neurologie, de cette discipline si dense et en même temps si tentaculaire, en si peu de pages est intenable. D’autant plus qu’il va falloir se faire au style adopté par l’A., à savoir la chronique. Pour autant, le choix de chronique est un choix stylistique ici remarquable ; l’idée est géniale, car elle se prête particulièrement bien à l’histoire d’une science aux confins de plusieurs disciplines. Ainsi, un point de biologie ici, le récit historique d’une découverte la page suivante, la présentation biographique d’un grand personnage de la discipline ou d’une grande institution (l’histoire de la Salpêtrière par exemple), le compte-rendu d’une leçon d’un grand médecin (idée géniale : Davous retrace des leçons de médecins, comme Charcot par exemple), le récit d’une invention technique et des perspectives thérapeutiques ou gnoséologiques que celle-ci ouvre (comme par exemple la révolution de l’imagerie cérébrale), etc. Mais la chronique présente aussi des défauts : il faut lier et si l’A. ne donne pas de lignes directrices ordonnant exposés historiques, arguments et anecdotes, alors la lecture n’a pas d’ancrage et ne retient qu’une vague chronologie, quelques noms et quelques découvertes. De plus, elle les retient mal, car à vouloir présenter tous les acteurs, on fait une galerie de portraits sans âme et sans en dire suffisamment ; on ne peut pas en cinquante pages faire une historie de la neurologie, de la compréhension des pathologies mentales, de la neurochirurgie et de la neuropsychologie. Cependant, il reste que cette courte présentation donne envie de piocher dans la riche bibliographie thématique qu’a faite l’A., tout comme cette courte introduction présente un des apports fondamentaux de la connaissance du cerveau, l’apport démythifiant d’une connaissance cérébrale des pathologies mentales. La neurologie permet de neutraliser un certain nombre d’interprétations idéologiques de la folie, mais elle permet surtout de concevoir des soins : soins chirurgicaux, soins chimiques, etc. Libre à tout artisan du concept de prévoir cure par la parole, thérapie par le récit, reconstruction immanente du discours du fou, le neuropsychiatre peut remplir sa fonction de connaissance structurelle des pathologies mentales – en tentant de mesurer, cependant, qui et comment de l’inné et de l’acquis de celles-ci – et sa fonction thérapeutique.
Le cerveau est-il une machine comme les autres : des esprits animaux aux neurotransmetteurs
Le deuxième chapitre dit du cerveau-machine fait état des connaissances actuelles sur le cerveau, tout en retraçant comme à chaque fois l’histoire des découvertes. Comment se transmet l’information au sein du corps et plus précisément au sein du cerveau ? Quelle est cette énergie, ces esprits animaux ? La neurotransmission électrochimique peut-elle dévoiler les mystères du contenu sémantique ou émotionnel qu’elle peut porter ? Quelle est l’unité de base du cerveau, comment fonctionne-t-elle ; le neurone est-il le mystère à percer, n’est-ce pas plutôt son organisation complexe en réseau ; comment comprendre cette organisation, y a-t-il un niveau d’émergence ? Voir dans le cerveau, est-ce percer les mystères du cerveau ? La révolution de l’imagerie cérébrale et ses progrès sont-ils promesses métaphysiques ou promesses épistémo-médicales ? Dans ce chapitre, on a donc une courte présentation du cerveau en tant que machine biologique, faite de neurones et de synapses permettant la transmission d’informations d’un neurone à l’autre par un type de molécule chimique ; il présente la chimie des émotions, les découvertes thérapeutiques que l’on peut faire à partir de ces connaissances. D’aucuns ont critiqué l’absence de l’intelligence artificielle dans ce chapitre appelé le « cerveau-machine »3. Mais la critique est injuste : si l’A. préfère parler du magnétisme et de Mesmer, de neuroanatomie et de transmission électrochimique des informations, c’est qu’il a en tête la naissance de la neurologie et l’importance du paradigme de l’électricité animale pour comprendre le fonctionnement du cerveau comme celui d’une machine dont on peut percer les secrets. Comment comprendre la physiologie de la pensée, la transmission d’informations ? Voilà la question neuroscientifique qui guide sa genèse. L’intelligence artificielle est un paradigme bien plus tardif, or à ce stade du livre Davous entend chroniquer la naissance de cette conception du cerveau comme d’un système de traitement de l’information et non sa théorisation en paradigme, ce qui adviendra comme achèvement. Pour autant, on peut effectivement regretter l’absence de présentation des paradigmes neuroscientifiques, c’est-à-dire des grandes théories permettant de modéliser toutes les connaissances positives, car on y découvrirait avec grand intérêt que le modèle de l’intelligence artificielle n’est pas le seul modèle et qu’il supporte maintes objections. Il est pertinent de rappeler que le modèle computationnel, certes fondateur, comparant l’esprit à une machine de Turing (la pensée peut se comprendre comme une algèbre mentale, un langage symbolique programmant le cerveau comme un logiciel informatique traitant les données externes transmises par les sens) a de solides concurrents. Et surtout que cette concurrence nait de découvertes positives. Ainsi le paradigme du connexionnisme qui modélise la pensée selon les connexions entre des réseaux neuronaux et non sur le modèle du neurone comme atome de la pensée ou encore le paradigme de la cognition incarnée comprenant la pensée comme pensée d’un individu ayant un corps, des sensations et des émotions, ainsi qu’un environnement et non la pensée comme production interne d’une machine.
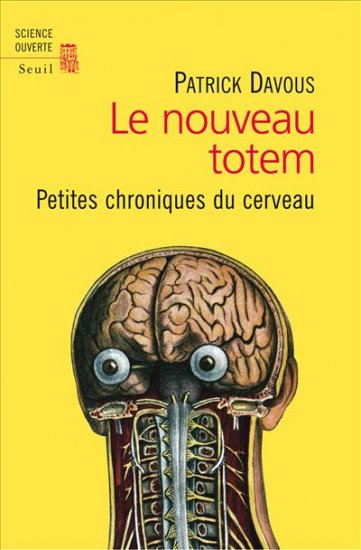
A ce stade du livre, ce qui importe est la présentation historique de nos connaissances sur le fonctionnement physiologique du cerveau, en aucun cas la modélisation paradigmatique de ces connaissances ; pour autant, une place aurait pu y être faite afin d’introduire aux différents modèles, ne serait-ce que parce que vulgariser, c’est aussi lutter contre le préjugé que l’intelligence artificielle serait le seul lieu de la synthèse du modèle.
La structure du cerveau a-t-elle une signification ?
Les chapitres suivants présentent la neurophysiologie du langage et des fonctions intellectuelles, du mouvement et de l’action, ainsi que de la mémoire et des émotions. C’est d’abord le problème de la structure du cerveau qui intéresse : cette masse blanchâtre et grisâtre, ces circonvolutions ont-elles une logique structurelle ? Poser la question d’une organisation à comprendre du cerveau, c’est déjà interroger scientifiquement cet objet et se mettre en posture de le faire parler ; ne pas reléguer cette question face à l’apparente uniformité de la cervelle va être un geste décisif pour les neurosciences. Connaître la structure du cerveau, est-ce alors connaître le lieu de l’âme, voire de son union avec le corps matériel ou est-ce connaître le simple lieu des fonctions végétatives, émotionnelles et intellectuelles ? Cette connaissance modeste sur le siège cérébral des facultés initie la possibilité de diagnostics et de thérapeutiques révolutionnaires à venir, mais aussi le jeu des corrélations actuelles entre état cérébral et état mental et la métaphysique sous-jacente identifiant corrélation, causalité et identité. Mais avant d’en venir à ce type de questionnements métaphysiques sur les corrélations neuro-psychologiques ou à ce genre de prouesses médicales, il restait premièrement à prouver qu’une fonction a une aire propre, ensuite à pouvoir les localiser précisément et à sonder le fonctionnement local et global du cerveau. Cela, avant l’imagerie cérébrale…et encore aujourd’hui. Où l’on apprend qu’ouvrir le crâne d’un chien, l’amputer d’une partie de son cerveau et l’observer fut une méthode des plus convaincantes pour montrer la localisation cérébrale des fonctions. En effet, avant l’imagerie, seuls les morts et les animaux parlaient, on pouvait déduire l’organisation cérébrale des lésions constatées post-mortem sur le cerveau des malades morts et on pouvait expérimenter sur les animaux.
De la même manière, se pose la question des deux hémisphères, c’est-à-dire de leurs rôles respectifs, de l’interchangeabilité ou pas de leurs fonctions propres, de leur lien réciproque et de leur possible indépendance. La symétrie structurelle du cerveau et la régionalisation cérébrale des fonctions psychiques remettent d’autre part en question la définition de la conscience – et plus généralement les définitions des facultés intellectuelles et morales du sujet. La conscience est-elle une, donnant unité et identité à l’homme, ne peut-on pas imaginer une pensée à double conscience ? Que reste-t-il de la conscience d’un homme dont les deux hémisphères sont radicalement séparés par un sectionnement du corps calleux (commissurotmisé) ? « Si, au premier abord, un malade commissurotomisé semble avoir un comportement et un langage normaux, si son quotidien intellectuel n’est pas modifié, les tests spécifiques indiquent en réalité que ces personnes vivent avec deux domaines de conscience séparés. » 4 Un malade peut ne pas savoir ce qu’il fait, voire ne pas reconnaître une partie de son corps ou un geste qu’il vient de faire ; ses actions appartiennent à deux consciences distinctes. Ne pas pouvoir synthétiser des actions causées par des hémisphères différents dans l’unité d’une personnalité individuée par son corps, qu’est-ce que cela peut dire de la conscience ? Qu’elle peut être multiple ? Qu’il n’existe pas un centre cérébral correspondant à un centre conscient, à un lieu de la conscience de soi ? De plus, quelle définition de la conscience est ici présupposée ? Il s’agit d’une définition fonctionnelle, comme la capacité de référer toutes ses actions à un soi unifié afin d’agir. La capacité générale de se référer à soi, ou d’être réflexif, ou encore la conscience phénoménale ne sont pas changées en leur essence ; la pathologie n’atteint pas les essences, elle montre une corrélation neurobiologique et psychologique. En effet ne plus pouvoir reconnaître ses actions, une partie de son corps, ne plus pouvoir être attentif ou être conscient de soi, cela indique que les facultés s’originent dans la matière dont elles dépendent en leur effectivité individuelle ; en aucun cas, donc, l’origine et la dépendance causale ou nomique ne disent l’essence de ce fait de la conscience.
Ici comme ailleurs en neuropathologie, on apprend qu’une lésion cérébrale est cause d’une pathologie mentale, que sans support matériel adéquat – en l’occurrence neurobiologique – la pensée ne saurait fonctionner ; en bref, on apprend la dépendance de fait de la pensée consciente. De ces considérations de fait, on ne peut rien conclure métaphysiquement. Certes, la tentation est grande de déclarer avec sensationnalisme qu’un malade split-brain a deux consciences, que la morale et l’amour sont hormonaux et résultats évolutionnaires, que les hautes facultés intellectuelles et morales se laissent localiser cérébralement, qu’elles peuvent peut-être se reconstruire dans une autre aire, etc. Premièrement on ne dit rien de la nature même de la conscience ou de tout autre faculté autonomisée du fonctionnel, on est au niveau de la causalité que l’on met au jour. La causalité ne dit rien des termes, de leur nature intrinsèque et c’est péché d’orgueil et épistémologique de faire tenir des propos métaphysiques à une connaissance naturelle et causale. Naturaliser, cela ne peut être que connaitre la causalité à l’œuvre ; si le pas est franchi de réduire tout phénomène à une explication purement causale, alors c’est un pas métaphysique d’exclusion qui est franchi. C’est pourquoi la sophistique sensationnelle des deux consciences, de la causalité hormonale ou neuronale des productions intellectuelles de l’homme doit appeler à la vigilance de celui qui vulgarise et initie.
La perception et la perspective transcendantale des neurosciences
« Que serait la vision sans aucun mouvement des yeux, et comment leur mouvement ne brouillerait-il pas les choses s’il était lui-même réflexe ou aveugle, s’il n’avait pas ses antennes, sa clairvoyance, si le vision ne se précédait en lui ? »5 L’A. cite ici le Merleau-Ponty de L’œil et l’esprit.
Dans ce chapitre sur la neuroperception, mais aussi dans les autres chapitres s’occupant des différentes fonctions cérébrales, P. Davous touche, sans jamais la poser clairement, la question transcendantale à nouveaux frais cognitifs. Son propos consiste à donner les éléments de connaissance neuroscientifique du fonctionnement du cerveau, avec toujours ce même pari de dire beaucoup en très peu d’espace. Le travail constitutif de représentation qu’effectuent nos facultés cognitives peut s’apparenter à la recherche de formes a priori de la perception et de la pensée, tout le problème étant le statut des schèmes cognitifs et le jeu entre l’apriorisme cognitif et leur construction génétique et culturelle –la recherche d’invariants transculturels et des variables est un terrain anthropologique très fructueux : l’anthropologie cognitive. C’est certainement là qu’on peut attendre P. Davous, car le débat est âpre et permanent dans tous les champs des neurosciences : de la linguistique à la perception, de la pensée conceptuelle au calcul mathématique, le paradigme cognitiviste présuppose la notion de modules de l’esprit spécialisés dans le traitement d’un certain genre d’informations, or le statut et la genèse de ces modules reste ouvert aux recherches. Cependant les neurosciences ne s’identifient pas au cognitivisme, malgré l’appellation de sciences cognitives ; si l’intelligence artificielle a beaucoup promis, reconstruire la pensée humaine reste encore un graal qui lui échappe, comme en témoigne le désormais traditionnel exemple de la traduction –un ordinateur ne peut traduire comme un homme le peut, son intelligence artificielle aussi complexe soit-elle est aveugle au sens, à la polysémie, aux figures de style : penser l’esprit sur le modèle de l’intelligence artificielle rend impossible la modélisation de nombreuses capacités. Mettre en perspective la thèse transcendantale ou cognitiviste demeurait une exigence que l’on est en droit d’attendre ici, discuter de la possibilité de tirer des conclusions théoriques à partir d’éléments positifs est aussi, en tant que défi épistémologique des neurosciences, une question essentielle.
Les émotions
Sur le domaine des émotions, dorénavant les neuroscientifiques sont très attendus, car le modèle émotionnel de la pensée est en cours, la dimension émotionnelle permettant de rendre compte de l’inscription de la pensée dans un environnement dont le corps est médiation constituante (il perçoit et agit). Dans la réflexion sur ce qu’est un homme, les émotions ne sont plus secondaires, sortes de phénomènes à mi-chemin entre l’animal et l’homme, événements du cœur de l’homme capables de bestialité ou de spiritualité ; au contraire les émotions sont redécouvertes comme ce qui permet le sentiment de soi, la conscience comme sujet connaissant, même si bien sûr les émotions sont aussi l’intelligence de la nature en nous, agissant à notre insu pour une adaptation rapide. Sur ce thème, donc, nos attentes sont gourmandes, l’époque neuroscientifique nous apporte de quoi nourrir nos intuitions. Une émotion étreint, succédant semble-t-il à une expérience phénoménale, lui donnant un sens affectif, bouleversant quelque chose au sein du sujet. En tout cas, semble-t-il. Car là encore la blessure naturaliste apparait brutale, déjà James et consort de pressentir que la problématique de l’émotion est dans la physiologie des émotions : celles-ci sont-elles causées par des faits physiologiques que l’émotion exprime comme synthèse consciente, est-ce l’émotion au contraire qui cause ce désordre physiologique ; enfin comment déterminer la priorité causale, quelles expérimentations pourront déceler, non pas simplement le pur ordre physiologique, mais la cause réelle des manifestations émotionnelles et affectives ? Là on attend une réflexion épistémologique sur les neurosciences et l’imagerie neuro-cérébrale très pointue : comment corréler telle émotion ou pensée en tant qu’état matériel à l’état psychologique sans devoir recourir à une méthode phénoménologique qui doit se définir. Certes, l’imagerie cérébrale est l’instrument technique qui a certainement permis la révolution neuroscientifique, mais c’est aussi l’instrument qui bat en brèche l’objectivisme des sciences. Car c’est nécessité de réinvestir ici la dimension phénoménale afin de pouvoir corréler les états neurobiologiques observés objectivement aux états mentaux phénoménologiques. Si l’A. n’oublie pas Damasio, il avait là l’occasion, sinon l’obligation, de présenter le travail de Varela. Ici encore, c’est une double occasion, car c’est précisément la compréhension de l’incarnation du cerveau qui va poser des objections majeures au paradigme cognitiviste.
D’autre part, découvrir l’origine anatomique, chimique, psychologique des émotions, leur rôle de conditions de l’action, et la possibilité neuropharmacologique de les contrôler et de les manipuler, c’est naturaliser ces affects, connaître leur structure, sans pour autant rendre compte du sens intrinsèque à celles-ci et de leur épigénèse. Que les émotions soit matière, en l’occurrence matière chimique en leur niveau causal le plus pertinent épistémologiquement, ne dit rien de commensurable à l’expérience phénoménale mais aussi à l’émotion travaillée de culture et spiritualisée.
2. « Le cerveau qui pense » et le neurologue qui philosophe
Le programme neurophilosophique
Dans ce dernier chapitre, P. Davous entreprend explicitement une réflexion philosophique. Il commence par imaginer une conversation qui aurait pu avoir lieu entre Spinoza et Descartes, afin d’introduire au problème de l’union de l’âme et du corps. Spinoza questionne Descartes : comment l’esprit, s’il n’est pas de la même nature que la matière, peut-il agir sur ce corps matériel et répondre au régime de la causalité physique ? Cette expérience que nous faisons de la causalité de notre esprit semble impossible à expliquer, sinon à matérialiser un lieu de l’âme agissant sur le corps – ou plutôt indiquer un lieu où l’âme donne une direction libre à la matière dont les lois sont alors respectées, en l’état actuel des connaissances pour Descartes. L’A. n’enchaine pas sur la postérité de cette question et sur sa fécondité contemporaine. Il esquissera la solution neurophilosophique, c’est-à-dire la solution du matérialisme éliminativiste identifiant état neurobiologique et état psychologique, éliminant cet état psychologique en postulant des neurosciences à venir complète pouvant donc se passer de recourir aux concepts psychologiques – le réductionnisme est donc à la fois ontologique et épistémologique. Le problème est que Patricia Churchland, fondatrice de la neurophilosophie, s’est accaparée le nom de neurophilosophie en identifiant sa thèse à la réflexion philosophique sur les résultats des neurosciences. Il existe tout un débat dit « philosophie de l’esprit » qui s’oppose à ladite neurophilosophie. L’auteur présente trop rapidement la neurophilosophie et surtout il ne présente pas l’état réel de la philosophie des neurosciences, l’aspect dialectique qu’elle prend en philosophie de l’esprit, loin du dogmatisme espérant un jour se fonder de la neurophilosophie.
Le problème que pose Descartes questionne le statut de l’esprit tel qu’il se manifeste à un sujet. Ce statut particulier que nous accordons à notre pensée peut-il être remis en cause par les neurosciences ? Cette question est éminente, elle est effectivement une des questions totem de l’époque : si les neurosciences vivent une période révolutionnaire, va-t-on voir notre théorie intuitive et spontanée de l’esprit vaciller et être totalement renversée, comme l’analogie avec l’avènement de la physique moderne et contemporaine contre-intuitive et théorique invite à le penser ? Est-ce que les neurosciences ont pour fin – aux deux sens du terme – d’élaborer une théorie complète et close de l’esprit, comme le pense Patricia Churchland ? La dimension phénoménologique de la pensée est-elle une illusion ou une limite à ce programme neurophilosophique, a-t-on là une réalité empêchant tout réductionnisme? Concluons comme l’A. avec cette citation de Ricoeur : « Mon cerveau ne pense pas, mais tandis que je pense, il se passe toujours quelque chose dans mon cerveau. »6 Complétons : enfin, c’est notre expérience et notre conviction et il nous revient d’argumenter cette position aussi rigoureusement qu’est argumentée la position cohérente du matérialisme éliminativiste ou fonctionnaliste.
Le poids de l’intelligence : définir et mesurer la raison
Percer les mystères de la boite noire – i.e. du cerveau – c’est espérer comprendre les ressorts ultimes de l’intelligence, du logos propre aux hommes. Peut-on objectiver entièrement l’intelligence ou plus exactement la raison, concept qui unifie ces différentes fonctions intellectuelles de l’homme en leur logos commun ? Mesurer la raison, objectiver via le cerveau les facultés intellectuelles de l’homme ne va pas sans problème épistémique de taille : comment définir ces fonctions intellectuelles, en leur unité générique et en leurs espèces ; comment objectiver ce qui est l’instrument même de cette objectivation ; comment mesurer ce qui mesure, objectiver ce qui objective sans retrouver ses propres formes ; la mesure elle-même ne définit-elle pas ladite intelligence ; que faire du mot d’ordre vulgarisé qu’il y a d’autres types d’intelligence ? La raison est-elle ratio mesurable, logos inobjectivable ; se comprend-elle en ses espèces ou en son genre ? Pour la mesurer, en somme, il faut la définir et définir la raison, c’est souvent l’amputer ; qu’on en fasse la continuité plastique de l’instinct, l’analogue d’un logiciel informatique, qu’on la naturalise ou qu’on l’automatise, on perd alors l’aspect sémantique de la raison, sa portée signifiante et créatrice d’une culture symbolique. On peut rire des tentatives anciennes de corréler l’intelligence au poids et à la taille du cerveau, d’espérer découvrir des bosses du génie, mais discriminer des critères homogènes et clairs de la rationalité, non réducteurs et complets, voilà un des enjeux majeurs d’un paradigme puissant à venir en neurosciences.
Ainsi se pose la question d’un modèle pour comprendre l’intelligence, non pas une simple analogie (avec l’instinct ou avec l’ordinateur), mais une véritable théorie de la rationalité consciente de l’homme. L’instinct, comme réponses adaptées à des problèmes à résoudre, est-il un modèle à partir duquel nous pourrions définir et comprendre l’intelligence ? L’intelligence artificielle est-elle un meilleur modèle : l’intelligence se laisse-t-elle comprendre comme procédures formelles traitant les informations entrantes? Quelles conséquences l’incarnation de l’intelligence a-t-elle sur celle-ci ; y a-t-il une séparation stricte entre les émotions et l’intelligence ou une continuité, voire une costructure, qui oblige à penser un paradigme adéquat ? Chaque modèle, en tout cas, a des limites ; l’analogie avec l’instinct trouve sa limite la plus franche dans la plasticité et la création de nouveauté, l’analogie avec l’intelligence artificielle rend rigide l’intelligence, l’automatise et la rend déterministe et systématique, internaliste et non interactionnelle et libre d’événement psychique.
Se pose aussi la question traditionnelle de la pensée et du langage : peut-il y avoir pensée sans langage ; peut-on définir le logos sans langage, et comment alors définir cette pensée sans langage ? Car si la conceptualisation et l’abstraction permises par le langage apparaissent comme de hautes facultés intellectuelles perçant l’essence de l’homme, il faut aussi penser la raison comme capacité à s’orienter dans le monde. Témoignant d’une patiente ayant perdu la faculté du langage mais restant indépendante pour les gestes quotidiens, P. Davous analyse ainsi ce spectre large de la pensée en son genre : « Jeanne, bien que ne parlant plus, avait encore cette capacité de « sortir de soi pour atteindre le monde » qui définit l’objectivité de la pensée. Elle restait très probablement capable de concepts, même s’ils n’étaient plus sémantiquement évalués. » Il est dommage que P. Davous en reste là : qu’est-ce qu’être capable de concepts qui ne sont plus sémantiques, sinon la traduction cognitive de la pensée ? La pensée est-elle schèmes a priori permettant la perception, la dimension spatio-temporelle, la permanence, la causalité, etc. ? Ces schèmes ne sont-ils pas dépendants d’une catégorisation dépendant de l’interaction avec un environnement particulier, une culture ? Le langage, lui-même, n’influe-t-il pas sur la pensée ; le paradigme cognitiviste nous empêche-t-il de penser une influence du langage sur notre pensée, notre perception ? Ici comme ailleurs, P. Davous présuppose la thèse cognitiviste, il ne la met pas en regard des développements contemporains.
D’autre part, dans ce travail de définition de l’intelligence, il est dommage de ne pas retrouver quelques éléments positifs sur la pensée inconsciente et sa part constitutive de la pensée rationnelle et consciente. Capacité de sortir de soi pour s’orienter, capacité d’innover pour trouver une solution ou d’adapter des moyens pour atteindre une fin, capacité syntaxique de compréhension et de construction d’un langage, capacité d’inhiber des instincts, capacité de prédire les comportements d’autrui à partir de croyances présumées, etc. ; l’intelligence est multiple. Il est donc dommage que l’A. ne développe pas plus les connaissances actuelles sur les processus inconscients, prédéfinis et émotionnels, participant à nos comportements intelligents ; processus inconscients mais intelligents eux-mêmes, procédant par raisonnement implicite, analogie, bref par des raisonnements encodés, déjà là ; soit que ces raisonnements nous viennent d’une intelligence de l’instinct, soit qu’ils nous viennent d’un apprentissage laborieux mais constituant une seconde nature aristotélicienne. Ce travail sur l’intelligence inconsciente permet de mieux comprendre la partie visible de l’iceberg, c’est-à-dire la rationalité consciente, élaborant délibérations et raisonnements, permettant de répondre aux situations individuelles et innovantes, permettant de varier par la création de nouvelles réponses. La plasticité permettant la créativité de l’haeccéité, l’advenue de l’individuel et du nouveau.
3. La carte neuroscientifique n’est pas le territoire
Le défi philosophique qui nous semble relever par l’A. est celui de la frontière ténue des disciplines : en quoi les connaissances positives des neurosciences apportent un matériau au philosophe, en quoi ce matériau a-critique est-il contraignant ; mais aussi comment délimiter le terrain du neuroscientifique et du philosophe pour éviter l’idéologie ? Si P. Davous entend vulgariser son domaine, il était tout aussi essentiel de vulgariser l’esprit scientifique, car la confusion est permanente de faire parler le scientifique sur Dieu, le libre-arbitre et la naturalisation des phénomènes culturels. « De cette rencontre imaginaire7, je ne tirerai pas de déduction philosophique ou scientifique entre les erreurs de l’un et les vérités (à venir) de l’autre comme l’a fait Damasio. »8 Car en effet, la science ne dira pas si l’esprit peut avoir une causalité sur la matière, si l’esprit est d’une autre nature ontologique que la matière ; la science ne peut que, à la limite, constater l’efficience heuristique de ses postulats métaphysiques, postulats eux-mêmes qui ne peuvent être justifiés que par cette efficience.
Comme nous l’avons dit, Davous a le mérite de montrer que les neurosciences n’ont pas de résultats métaphysiques, contrairement aux vulgarisations sensationnelles qui fleurissent et font le ton de l’époque : le scientisme démocratisé et la connaissance à la portée d’un click informatique. On peut regretter que la partie philosophique de l’ouvrage ne soit pas explicitement sur ce philosophème-là, à savoir la formation de l’esprit scientifique et sa distinction de l’esprit philosophique, la connaissance des territoires respectifs de la science et de la métaphysique et le danger de leur fusion (le corrélat nécessaire de cela étant l’émancipation du spéculatif). L’ambition de l’A. est en effet l’introduction, le dur travail de la vulgarisation, de l’initiation, il aurait donc été plus pertinent de vulgariser l’écueil scientiste et l’absence de lien logique, l’absence de nécessité entre neurosciences et neurophilosophie. En effet, on entend par « neurophilosophie », non pas les débats de philosophie de l’esprit, c’est-à-dire non pas l’argumentation du problème du corps et de l’esprit ou du problème de la nature du conceptuel, mais la philosophie prolongeant les découvertes neuroscientifiques. Cette philosophie se revendique d’ontologie matérialiste, elle pose l’identité du cérébral et du mental. Certes, elle est en dialogue constant avec des philosophes non réductionnistes, mais elle s’arroge le titre trompeur de neurophilosophie. Comme si les neurosciences pouvaient se dire en langage philosophique, se dire avec certitude ; comme si les connaissances actuelles et positives avaient une portée métaphysique à expliciter. Il nous semble que c’est ici qu’est le lieu pertinent de la vulgarisation, mais aussi que P. Davous, en rappelant brièvement la distinction entre le scientifique et le philosophe, rejoint ce lieu.
En bref, s’il avait fallu qu’il y ait philosophie dans un ouvrage de neurosciences, il aurait été plus pertinent, il nous semble, de thématiser plus longuement et plus explicitement le problème des territoires et de la formation de l’esprit scientifique.
L’exercice de style qui consiste à interroger philosophiquement les éléments positifs apportés par P. Davous correspond au programme de la neurophilosophie, prise en un sens plus large que celui de P. Churchland. Il consiste à poursuivre, dans le cadre de l’histoire des problèmes que rencontrent la pensée – philosophique -, les questions qu’ébauche l’A. La révolution médicale et thérapeutique appartient aux neurologues, dont les résultats connus chaque jour ne cessent d’impressionner, de soulager et de sauver, tout en donnant une perspective cyborg de l’humanité ; la révolution théorique, quant à elle, est ce qui peut aujourd’hui enthousiasmer avec ferveur un philosophe.
- Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine, 1747, Edition Bossard, 1921, p. 112
- Patrick Davous, Le nouveau totem. Petites chroniques du cerveau, Seuil, 2011
- cf. http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-du-jour-le-nouveau-totem-petites-chroniques-du-cerveau-de-patrick-davous-seuil-2011
- Ibid., p. 155
- Ibid., p. 267, citation de Merleau-Ponty
- P. Ricoeur et J.-P. Changeux, Ce qui nous fait penser. La nature et la règle, Paris, Odile Jacob, 2000
- l’auteur fait dialoguer Spinoza et Descartes sur le problème de l’union de l’âme et du corps
- Ibid., p. 290