Blues et philosophie
On imaginerait difficilement deux univers plus séparés que ceux de la philosophie et du blues. Des rues du quartier latin aux plaines cotonneuses du Mississippi, des cafés-philos aux junk joints poussiéreux du Tennessee, la route est longue.
La plainte, l’élégie, la déploration, caractéristiques de cette musique, ont leur équivalent plutôt chez nos poètes que chez nos penseurs. De leur côté, les bluesmen n’étaient pas des philosophes : ils chantaient la dureté de la vie, les femmes infidèles, l’alcool, l’errance, mais ne proposaient aucune voie de sagesse. Il est vrai que le philosophe peut parfois exprimer son « blues » existentiel, en écrivant sur l’inquiétude, l’angoisse, le néant, mais son expression de détresse paraît, même dans ce cas, très éthérée : Heidegger dit que notre détresse vient de ce que nous ne savons plus « habiter le monde » ; Howlin’ Wolf nous dit qu’avoir le blues, c’est n’avoir plus d’argent pour payer son loyer 1… Il y aurait à la rigueur une vision du monde selon le blues, qui est davantage reconnaissance des aspects les plus durs de l’existence, qu’une compréhension rationnelle et raisonnable du monde.
Il faut ajouter que, parmi les philosophes mélomanes qui ont pu connaître cette musique, bien peu ont été touchés par le blues, et même, dans les faits, aucun. On en dirait de même du jazz, auquel les philosophes traitant de la musique sont restés complètement sourds. Adorno n’y entendait qu’une musique barbare, mécanique A ce sujet, voir le livre de Christian Béthune, Adorno et le jazz. Analyse d’un déni esthétique, 2. Le même auteur a écrit une étude ethnographique sur le jazz, où il montre tout ce qui sépare cet art de l’univers culturel propre à la philosophie : 3. Je ne crois pas que Jankélévitch en parle. Au détour d’un entretien 4, Clément Rosset avoue y être sourd : il apprécie le fox-trot et le charleston, mais trouve qu’ensuite, le jazz est devenu du rock et y a perdu son originalité.
Pour ce qui concerne le blues, il y aurait bien un cas à part, celui de Deleuze. Il ne parle jamais explicitement du blues, mais il y fait implicitement référence (du moins est-ce l’hypothèse que je fais), presque à son corps défendant, dans son Abécédaire, à « J comme Joie ». Evoquant d’abord les pleureuses chinoises, il dit à quel point la plainte, loin d’être triste comme on pourrait le croire, est un véritable bonheur. Il n’y a rien de plus beau que de se plaindre, de porter la plainte à un degré absolu qui rejoint la joie la plus grande : se plaindre qu’on a du mal à vivre, qu’on vieillit, qu’on a mal etc. (comme Deleuze lui-même, qui joue volontiers le petit vieux à ce moment-là). Or, parlant de cet art de la plainte lyrique qui permet d’exprimer quelque chose pour nous de trop douloureux et de trop grand, Deleuze n’a-t-il pas parfaitement défini ce qu’est le blues ?…
Si la rencontre entre philosophie et blues peut se faire, il semble que ce soit, sur le plan conceptuel, dans le non-dit ; si cette rencontre a lieu réellement, elle se fait à titre privé. Ainsi, Pierre Bourdieu (que les bourdieusiens me pardonneront pour l’occasion de ranger parmi les philosophes) préféra fuir une ennuyeuse cérémonie en son honneur à l’université de Chicago, pour se rendre en plein quartier noir, dans le club de Muddy Waters, y écouter le meilleur blues et y entendre chanter, je suppose, toute la “misère du monde” 5
On peut trouver cette non-rencontre d’autant plus regrettable que le joueur de blues, comme le philosophe, cherche toujours à aller à l’essentiel, au coeur de ce qui fait notre vie, en sorte que pour certains, qui ne reculent pas devant une hypothèse hardie, la philosophie pourrait être le blues lui-même… Sans aller jusque là, Philippe Paraire s’est proposé de dégager une philosophie du blues, dans un essai très éclairant 6 qui se concentre sur le blues des origines, le blues rural, celui des descendants directs d’esclaves affranchis. Cette philosophie serait avant tout pratique et se caractériserait par une « éthique de l’errance solitaire ». L’auteur montre qu’une telle éthique trouve des échos dans notre société actuelle, notamment dans une jeunesse marquée par la culture rock, et désemparée face aux diverses crises qui agitent le monde.
« On étudiera dans ce livre, d’un point de vue en somme généalogique, comment et pourquoi les éléments les plus structurés du comportement des premiers musiciens vagabonds ont pu répandre de manière non normative, du seul fait de l’exemplarité de chansons autobiographiques, une éthique de l’errance solitaire, véritable colonne vertébrale secrète du blues des origines, qui est, par sa nature, l’expression de comportements assumés et vécus au quotidien » 7.
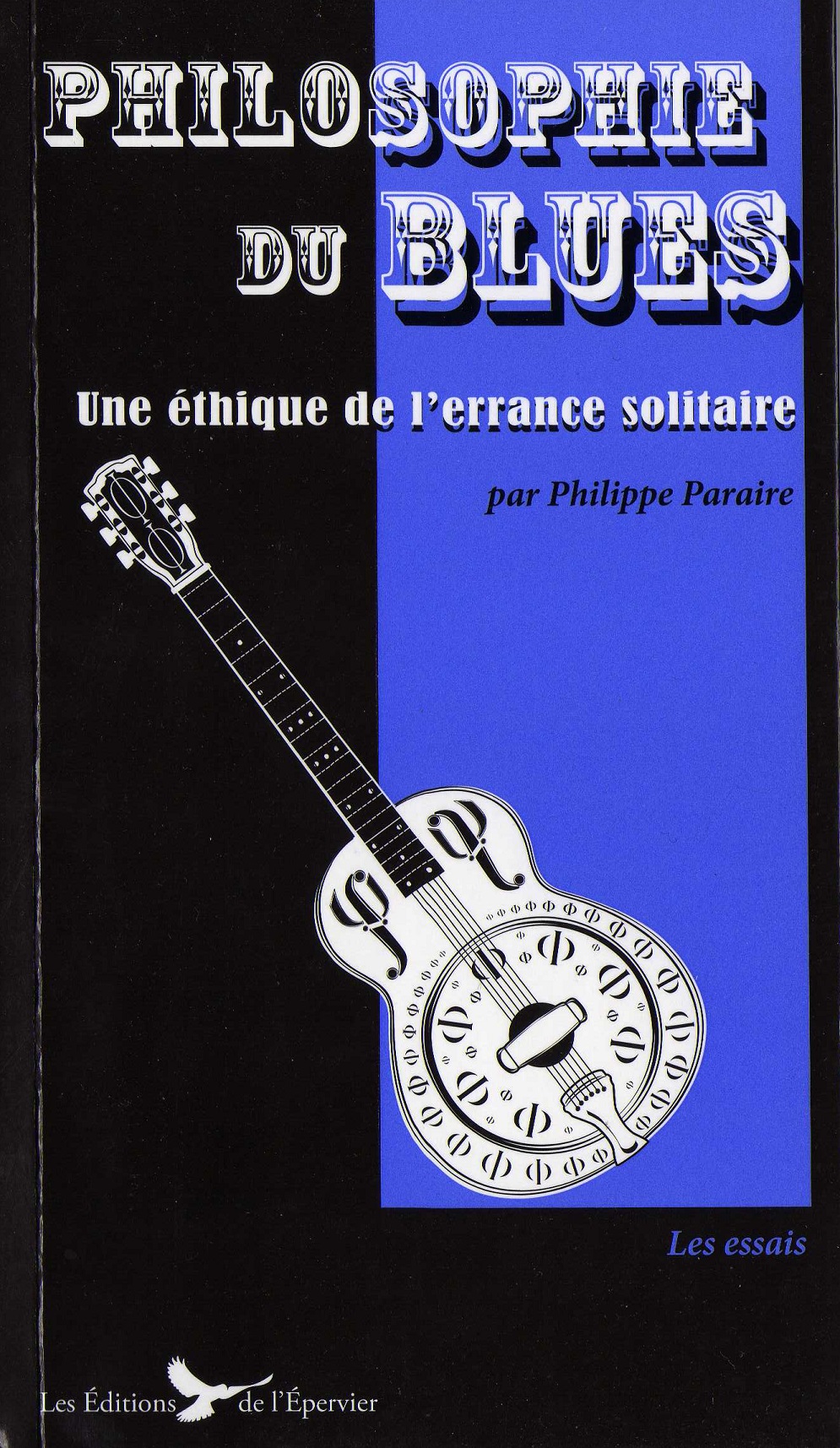
Le thème de l’errance
Bien que née dans une culture particulière, parmi les esclaves Noirs du sud des Etats-Unis, le blues possède à l’évidence une portée universelle ; il constitue un univers imaginaire cohérent, dont l’auteur décrit très bien les différentes thèmatiques :
« Avant de devenir une musique de rang mondial dans les années soixante, le blues a été un corpus éthique de références s’exprimant à travers une littérature orale chantée (comme le furent l’Illiade et l’Odyssée), qui s’est transportée d’une ferme, d’une fête, d’un quartier, d’une ville, d’un État à l’autre. Il a véhiculé un vocabulaire, des métaphores, des mélodies et une vision du monde à travers les récits aventureux de ses héros de roman : musiciens errants, maris trompés, femmes malheureuses, victimes en tout genre de la pauvreté, du racisme, de la maladie. Mais aussi à travers ses machos conquérants, ses hommes et femmes comblés par l’amour et les plaisirs de l’amour, ses femmes pugnaces, ses jeunes gens aventureux et libres. L’ensemble fait monde » 8.
Son influence ne saurait être sous-estimée d’après Michael Paraire. Elle s’est transmise à tout le monde occidental, et au-delà, via le rock, qui est son héritier. Derrière Led Zeppelin ou les Rolling Stones, ce sont toujours les vieux bluesmen qui chantent :
« Le blues est devenu une référence existentielle, un mode de vie, une philosophie concrète, non thématisée, mais réellement présente dans une très large fraction de la population, et particulièrement de la jeunesse, depuis deux générations, qui subit son influence sans savoir toujours la nommer, d’ailleurs » 9.
Le mode de vie des joueurs de blues, qui ne faisait pas, de leur part, l’objet d’un choix thématisé comme tel, retrouve aujourd’hui une actualité :
« Vaincre cette solitude personnelle et sociale par le voyage en solitaire, dans le but de quitter le particulier pour accéder à l’universel (la célébrité, pourquoi pas, au bout de la route ?) par le biais des rencontres de hasard, voilà une dialectique bien risquée, mais désormais si répandue qu’on ne peut plus parler de marginalité lorsque cette éthique du flou, de l’incertitude, de l’aléatoire, devient un mode de vie promu par plusieurs générations successives, aussi bien dans les pays développés que dans le monde pauvre et dans les pays émergents, où les départs à l’aventure sont parfois une recherche de survie » 10.
On pourra noter une certaine hésitation dans le propos de l’auteur : cette imitation contemporaine de l’errance solitaire, est-elle consciente ? Ou bien rejoue t-elle de façon semblable, mais involontairement, la situation des Noirs d’il y a un siècle ?
Philippe Paraire ne semble pas faire de choix dans cette alternative.
« La classe moyenne urbaine des pays avancés est partie prenante, pleinement, et s’est elle aussi approprié les prescriptions éthiques de l’errance solitaire. Plus qu’un simple choix musical, qu’une préférence esthétique, le blues s’est répandu en profondeur dans tous les aspects du mode de vie contemporain » 11. « L’errance contemporaine se décline sur les mêmes terrains que ceux qui étaient parcourus par les musiciens vagabonds. Elle est géographique, sentimentale, sexuelle, addictive mais aussi intérieure et, pour finir, sociale » 12.
En revanche, il montre que cette éthique a valeur de modèle pour tous ceux qui se sentent perdus aujourd’hui : non pour cesser leur errance mais pour lui donner un sens, une direction, un but, en sublimant cette détresse intérieur. Les bluesmen feraient figure de héros de l’errance ; ainsi Robert Johnson, l’homme dont on dit qu’il apprit le blues en vendant son âme au diable, la nuit à un carrefour désert :
« Des thèmes quotidiens : la vraie vie au jour le jour qui popularise une idée, blues is life, une thématique riche et personnelle, autobiographique ou universelle ; l’usage du bottleneck, appris auprès de Son House et Charley Patton, les basses permanentes de Big Joe Williams, les basses ambulantes du boogie woogie adaptées à la guitare pour la première fois, les arpèges aériens et les basses alternées de Blind Blake, des ragtimes et du folklore blanc des montagnes du Tennessee, tout cela fait du voyage de Robert Johnson un parcours magique et créateur » 13.
L’auteur décrit très bien cette vie hasardeuse, au jour le jour, d’une ville à l’autre, d’un hameau à l’autre, par la route, par un wagon de train pris à l’improviste. Un bluesmen arrive en ville, se trouve une femme qui va l’accueillir pour quelques temps ; puis elle le mettra dehors ou bien de lui-même, il repartira en voyage. Tout se passe comme si une ou deux générations d’esclaves libérés avaient vécu la liberté soudaine à l’état sauvage, comme une errance sans but et sans limite. Cela fait évidemment partie du mode de vie des musiciens, toujours sur la route entre deux clubs, mais aurait constitué de plus une sorte de vie nomade « voulue » comme telle, comme s’il était difficile pour ces musiciens de se fixer quelque part. Et cette errance est en fait l’expression d’une errance intérieure :
« L’homme noir s’était vu refuser durant les siècles de l’esclavage toute capacité à une vraie réflexion consciente, au point que la fonction – pourtant reconnue à toute l’humanité – de l’introspection ne faisait officiellement pas partie de ce dont l’intellect des esclaves était capable […] Collectivement, donc, ceux-ci, durant huit à dix générations, ont dû apprendre à cacher leurs sentiments, leurs réflexions, leurs impressions, en enfermant l’ensemble dans une sorte de jardin intérieur qui est vite devenu pour eux le seul lieu de refuge où, par réflexe, ils pouvaient se replier à l’approche d’une menace réelle ou supposée. Il s’agit sans doute d’une forme de résistance passive à l’oppression, par le retrait, simulant même une forme d’hébétude qui devait conforter les planteurs dans l’idée rassurante que les Noirs esclaves n’avaient pas de vie intérieure […] Cette radicale propension au repli sur soi, au malheur comme faisant partie de la vie, va constituer l’errance intérieure des Noirs libérés : de plainte individuelle, celle-ci va devenir culture collective du fait que chacun d’eux a eu à subir le refus de toute identité humaine » 14.
S’étant vus privés de leur humanité, les bluesmen auraient alors découvert, dans cette privation même, le coeur même de l’humanité et de sa souffrance. Selon le modèle hégélien, ils auraient pris conscience d’eux-mêmes en surmontant la négation de leur conscience par leurs anciens maîtres. En affrontant la privation absolue de leur individualité, ils auraient accédé à l’universel.
Ce qui nous parle, évidemment, dans leurs chansons, ce sont les thèmes, traités d’une façon simple et chargée d’émotions ; des histoires tristes et banales qui acquièrent un statut quasiment mythologique :
« Car, des plus anciens blues traditionnels comme Frankie and Johnny et Stack O’Lee (Mississippi John Hurt, 1928, OK 8560 et OK 8654) à Hey Joe, c’est plutôt le fait divers en tant que tel qui a intéressé les artistes, désireux de captiver le public avec une histoire édifiante et tragique qui, à la manière proposée par le vieil Aristote, joue un rôle cathartique en suscitant la terreur et la pitié » 15.
La richesse indéniable du livre de Philippe Paraire provient des très nombreux extraits de chansons que l’auteur a traduits. Il nous fait découvrir des textes beaux et émouvants par leur simplicité. Du grotesque au sublime, du désespoir à la colère, les bluesmen savent tout dire, en vrais poètes, de leur “paysage intérieur” :
« C’est l’une des techniques stylistiques les plus employées de la poésie classique que de faire coïncider la description métaphorique d’un paysage réel avec ce que l’on veut donner comme représentation d’un paysage intérieur, d’un faisceau d’émotions. Il est sûr que sans avoir jamais lu un seul poète européen ou américain, les créateurs du blues authentique ont retrouvé là un moyen universel d’évocation, capable de toucher la sensibilité de tout être humain » 16.

Mississippi John Hurt
L’apolitisme du blues
Alcool, dépression, drogue, sexe, mort, cruauté des rapports hommes-femmes, aucun grand thème ne manque à l’appel dans le blues ; on pourra découvrir, grâce à ce livre, nombre de de textes savoureux, montrant toutes les variations que les grands chanteurs, les Robert Johnson, Son House, John Hurt, Fred McDowell et tant d’autres, ont su proposer sur un matériau vécu riche et accessible à tous. Contre une certaine idée reçue, qui enferme le blues dans un stéréotype, cette musique n’est pas seulement plainte, mélancolie, déploration de la misère de vivre. Les bluesmen savaient aussi être des bons vivants (Muddy Waters, Champagne and Reefer) et ne se privaient pas d’exprimer la puissance de leur vitalité, en particulier de leur sexualité :
« Pour l’anecdote, à l’article de la mort, John Lee Hooker a produit un des clips les plus torrides de l’histoire du blues. En bon vert-galant, il invite sur l’un de ses disques la chanteuse-guitariste de country Bonnie Rait à interpréter avec lui I’m in the mood. Au-delà de la performance musicale de chacun des deux protagonistes, tous deux excellents, le tournage de la prestation dégage une extraordinaire impression de sensualité “partagée” ! Voilà qui est très rassurant sur la longévité, autre que commerciale, des grands artistes du blues. Ils ne se vantaient donc pas ? On comprend mieux pourquoi cette errance sexuelle peut devenir un idéal universel !… » 17
Le blues ne chante pas que la tristesse ; sa palette émotive est totale : joie, gaieté, ressentiment, colère, regret… Voilà pourquoi cette musique peut parler directement à chacun. Elle n’est pas qu’une musique de prolétaires et d’esclaves Noirs.
En revanche, comme le montre bien l’auteur, le blues n’a jamais eu de dimension politique : l’expression de la colère face à l’injustice ne débouche pas sur un appel à changer l’ordre des choses.
« Le blues, musique d’une communauté opprimée, n’est pas un chant de combat social ou politique de manière explicite, à quelques très rares exceptions près » 18. « Les blues ne sont pas des chants de lutte politique ni syndicale, pas même des hymnes à l’égalité sociale ou raciale. Leur dimension revendicative est faible car, lorsqu’elle est présente, elle se limite de manière quasi-unanime à une plainte solitaire […] Les exigences sont rarement formulées, le style des chansons privilégie une peinture critique de la situation d’inégalité » 19.
On n’attendra pas non plus du blues une revalorisation de la condition féminine : généralement, le machisme y est la règle. La femme peut être certes être peinte comme fière, indomptable, comme la Carmen de Bizet :
« La prédation féminine, apanage ancien du sexe fort semble avoir quelque peu affaibli la domination masculine. Nul doute qu’elle ne trouve son origine dans cette liberté toute nouvelle, conquise par les femmes noires il y a un siècle, de dire non et de s’en aller, elles aussi, à l’aventure » 20.
Mais le plus souvent, le blues est une musique d’hommes et ceux-ci se gardent le beau rôle : ils pleurent la femme qui est partie et qu’ils vont chercher en vain, ils s’en prennent à celle qu’ils auraient dû quitter depuis longtemps, avec qui ils souffrent de rester, qu’ils détestent au point de vouloir la tuer etc.
« Cette banalisation du machisme des bluesmen est un fait désormais universel. La lutte des femmes a encore une longue route à parcourir, et ce n’est pas dans le blues qu’elle trouvera les solutions au problème de l’inégalité des sexes, thème qui n’apparaît jamais de manière explicite, si ce n’est, comme on l’a vu dans la partie précédente, à travers une forme particulière d’indocilité des femmes noires, très vite après l’affranchissement du joug de l’esclavage, et que l’on observe dans les chansons » 21.
Le blues se concentre sur la transmission d’une émotion, d’une philosophie intuitive, à la fois constat de la dureté de la vie et impuissance à y faire face. Sans doute ce double caractère, à la fois violemment émotif et complètement apolitique, fait-il l’universalité du blues. Plus partisan, plus idéologique, il rebuterait nécessairement bien des gens, et y perdrait peut-être en vérité. Un peu comme dans la nouvelle littéraire telle que la voit Paul Morand, on trouve dans le blues « un révolté, oui, la Révolte, non » (voir la préface de son recueil, Ouvert la nuit).
L’errance musicale
Le blues tourne toujours autour des mêmes thèmes, comme si l’émotion du blues avait été créée une fois pour toute, de sorte qu’il n’y aurait rien à y ajouter, seulement à la re-chercher toujours pour l’incarner toujours plus intensément, tel Willie Dixon affirmant avec orgueil : I am the Blues. L’errance est non seulement dans le blues un mode de vie, une philosophie, mais un art musical à part entière :
« La pulsion du déplacement en liberté, qui fonde l’errance active et volontaire (inner directed) s’impose au bluesman qui va errer dans sa vie, dans ses textes mais aussi sur le manche de sa guitare, sur le clavier de son piano, sur les ouvertures de son harmonica.
La forme musicale de l’errance solitaire est celle d’une technique radicalement nouvelle, l’improvisation.
Dans le blues, elle est placée au poste de commandement. Elle va, au sens strict, devenir une condition de possibilité : elle portera sur la mélodie, la structure de la chanson, le rythme et la cadence, mais aussi la versification, la métrique, la prononciation, le choix des mots et du niveau de langue » 22.
On peut objecter que le blues n’a pas inventé l’improvisation (Mozart en était un virtuose) ; l’idée de faire de l’errance non seulement un style de vie, un état d’âme mais encore un principe technique, est nettement plus originale. L’errance serait l’idée directrice du blues : errer mais en sachant où l’on va, que ce soit dans la vie ou lors d’un concert, donnant ainsi l’impression d’un déplacement au hasard, en réalité très maîtrisé. On voit ici la racine commune avec le jazz, art de l’improvisation extrêmement travaillée. La différence principale est que si le blues est d’origine rural, le jazz est né en ville (Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans) :
« Le blues s’est séparé du jazz, qui est l’une des formes urbaines du blues rural, ce que pensent beaucoup de musicologues contemporains. Il s’est ainsi écarté d’un genre harmoniquement complexe et très inventif de ce point de vue, mais structuré d’une manière qui ne pouvait laisser de place à la création de textes improvisés. Dans le jazz, en fin de compte, les paroles ont disparu pour laisser la place à un genre exclusivement instrumental, privé de la possibilité de délivrer le moindre message explicite » 23.
Il existe tout de même dans le jazz des exceptions et non des moindres. Pensons au chef-d’oeuvre composé pour Billie Holiday, Strange Fruit (1939), sur le lynchage des Noirs. ; le morceau de Charles Mingus, Fables of Faubus (1959), sorti il est vrai dans une version censurée, uniquement instrumentale, sur le racisme institutionnel ; ou encore les textes lyriques et satiriques de Roland Kirk (Bright Moments, 1973) ; autant de textes explicitement consacrés à la condition des Noirs et aux maux de la société américaine. 24
Jazz et blues ont une racine commune, puis se séparent, pour ensuite mieux se retrouver et s’entrecroiser, comme deux branches de lierre enserrées l’une dans l’autre.
Mythologie du blues
Si l’on voulait comparer la philosophie et le blues, on pourrait voir ce qui sépare une éthique de l’errance solitaire d’une éthique de recherche commune de la vérité. Il y aurait bien d’autres raisons, certainement, pour lesquelles le blues n’a jamais fait l’objet véritablement d’une philosophie, notamment l’opposition entre deux univers, celui de la raison et celui de l’émotion, qui revient à peu près à celle de l’apollinien et du dionysiaque. Le philosophe ne peut pas se résoudre à errer.
J’émettrais pour finir une réserve concernant la valeur de l’éthique prêtée au blues : si la philosophie du blues est bien, originellement, celle de l’errance solitaire, est-elle bien celle dont on a besoin, aujourd’hui, quand on se sent désemparé, au bout du rouleau ?… Proposer cette fuite en avant hasardeuse, floue, sans but, n’est-ce pas enfoncer encore plus les gens dans leur détresse ? Ou bien est-ce une façon de surmonter son errance intérieure et d’arriver à une expression personnelle de sa détresse -voie qui est, peut-être celle suggérée par Ph. Paraire ? 25
Le blues, en tant que musique universelle, n’est-il pas devenu, non une plainte solitaire, mais un art fédérateur, capable de rassembler des gens d’âges et de milieux sociaux très différents, autour de ces morceaux simples et directs qui nous parlent d’amour, de mort, de douleur ? Le blues, c’est ce qu’il nous reste quand on a tout perdu, l’énergie du désespoir qui se transcende dans son expression artistique 26 ; et c’est pourquoi il peut aider les désespérés à trouver dans cette plainte sublime l’énergie pour surmonter leur mélancolie, et faire quelque chose de leur errance. On conçoit également que cette figure du migrant, de par sa dimension quasi-mythologique, ait de quoi fasciner, mais dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux parler d’une mythologie du blues ?
Dans le blues, il y a je crois cette idée de plonger dans un univers nocturne, dionysiaque, dans le fond de souffrance de toute vie et d’en tirer malgré tout une force joyeuse. Il y a aussi l’idée d’une osmose totale avec son instrument et avec soi-même. Selon les mots de Mississippi Fred McDowell : « ce que je chante, la guitare le chante. Et ce que dit la guitare, je le dis ».
Mythologie de l’errance solitaire, me semble t-il, plus que philosophie ; mythologie dont Philippe Paraire parle toutefois très bien, dans un livre qu’on sent écrit par un admirateur inconditionnel du blues. Il fait très bien ressentir cette errance solitaire et silencieuse, cette errance déroutante, comme celle d’un Noir marchant sous un soleil de plomb, seul en bordure de route dans le Névada, chargé de deux lourds sacs, et qui, quand on le prend en stop, s’endort aussitôt, pour ne se réveiller qu’une fois arrivé à Kingman, un bled à l’entrée de l’ancienne route 66, et continuer son chemin sans rien dire.

- « When you ain’t got no money, and can’t pay your house rent and can’t buy you no food, you sure damn got the blues… »
- Klincksieck, 2003
- Le Jazz et l’Occident. Culture afro-américaine et philosophie, Klincksieck, 2008. Lire la recension sur ce site.
- Michel Polac, Clément Rosset, Franchise postale, PUF, 2003
- L’anecdote est rapportée par Loïc Wacquant dans un article écrit à la mort du sociologue.
- Philippe Paraire, Philosophie du blues, éditions de l’Épervier, 2013.
- Page 8.
- Pages 9-10.
- Page 13.
- Page 20.
- Page 24.
- Page 32.
- Page 54.
- Pages 97-99.
- Page 76.
- Pages 112-113.
- Page 91. Je pense aussi à la chanson de Mississippi John Hurt, Salty Dog Blues, ou à celle, très drôle, de Roosevelt Sykes, Ice Cream Freezer.
- Page 84.
- Page 133.
- Page 87.
- Page 85.
- Page 159.
- Page 162
- L’improvisation sur les textes refait vraiment surface dans le hip-hop, notamment dans les rap battles, affrontements verbaux et dansés codifiés. Si le jazz vient de la ville et le blues de la campagne, le hip-hop vient de la rue.
- Et comme y invite Nietzsche au §56 du Gai savoir : savoir donner un caractère personnel à sa plainte.
- En quoi il se rapproche du flamenco, autre très grand art d’origine populaire, qui nous parle lui aussi de l’amour, de la mort, de la douleur d’exister.








