En 2006, les éditions Gallimard ont republié en Tel le bel ouvrage de Pierre Manent consacré à Tocqueville et à la nature de la démocratie. « La nature de la démocratie » précise Manent car la démocratie ne possède pas d’essence évidente : fluctuante, malléable, elle induit elle-même une transformation profonde des rapports humains et sociaux, elle est « quelque chose qui nous arrive, qui nous transforme, qui modifie la profondeur comme la surface de notre vie, quelque chose que nous ne désirons pas à proprement parler puisque nous ne la reconnaissons pas lorsqu’elle le plus à l’œuvre, qu’elle nous a le plus transformés. La démocratie, c’est donc d’une part le régime le plus propre à la nature humaine quand celle-ci est enfin libre d’exprimer ses vœux, mais c’est aussi quelque chose qui arrive à la nature humaine sans qu’elle sache ni veuille vraiment ce qui lui arrive. »1C’est cette ambivalence fondamentale de la démocratie selon Tocqueville que Manent se propose d’étudier, et ce sur un mode brillant qu’on lui connaît, ne cédant ni à la fascination bête d’un démocratisme courant dans les années 80 ni à une critique facile des imperfections de tout régime démocratique, ce qui offre au lecteur un très bel ouvrage où se croisent une analyse profonde de la pensée de Tocqueville et la pensée plus personnelle de Manent dont on perçoit nettement la dette à l’égard de l’auteur de de la Démocratie en Amérique.
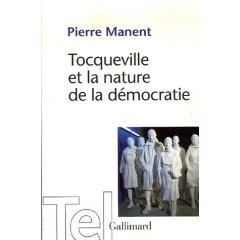
Ainsi que le titre le laisse entendre, c’est de la nature de la démocratie qu’il s’agit, c’est-à-dire de son essence, si tant est que ce régime si récent, si historial, puisse revêtir une essence éternelle. De cette difficulté évidente résulte le fait – paradoxal en apparence – que cette essence n’aura de sens que dans le devenir ; l’essence même de la démocratie, c’est le devenir social des conditions. Autrement dit, la démocratie est ce régime dont l’essence n’est autre que l’impossibilité de fixer dans l’être la stabilité sociale. Et cette essence porte un nom chez Tocqueville, dont le suffixe marque le mouvement : l’égalisation des conditions. « L’égalisation des conditions peut être considérée comme le fil conducteur de l’histoire européenne parce que l’égalité des conditions est le fait générateur de la République américaine, fille de l’Europe. »2
L’égalisation des conditions, on le sait, c’est aux yeux de Tocqueville le fait social majeur, générateur, par lequel advient un fait social lui-même démocratique. Ainsi, le fait social se trouve être aussi bien la cause comme mouvement d’égalisation des conditions, que l’effet, comme société démocratique, ambiguïté qui montre à quel point il est difficile de poser dans l’éternité une essence d’un état social, d’un régime politique dont le principe même se trouve être ce mouvement d’égalisation. A cet état social, Tocqueville ajoute le fameux « fait générateur » qu’il identifie dans la souveraineté du peuple, et dont il déduit la réalité de l’exercice démocratique. Ce qui n’est pas sans soulever des interrogations de fond : quels rapports entretiennent alors le fait social et le fait générateur ? C’est là évidemment une des questions les plus délicates de l’exégèse tocquevillienne car si le fait générateur est unilatéralement et univoquement cause de l’exercice démocratique, le fait social s’insère dans une causalité bien plus lâche. « La définition directement politique de la démocratie écrit Manent paraît, d’après les termes mêmes de l’analyse tocquevillienne, plus immédiatement et plus complètement compréhensive que la définition de l’état social. Si le développement de toutes les conséquences de la souveraineté du peuple est à ce point explicatif de la démocratie en Amérique, quelle nécessité subsiste-t-il de voir dans l’état social le fait générateur ? »3 On ne saurait mieux poser les termes du débat.
Comment donc discriminer efficacement le rôle qui revient à l’état social et celui qui revient au fait générateur dans le cadre de l’exercice démocratique ? La réponse de Manent est fort subtile ; la souveraineté du peuple ne s’exerce que dans un cadre déjà démocratique, tandis que le fait social comme égalisation des conditions peut s’exercer en dehors d’un cadre démocratique et ainsi ménager une transition vers un tel régime. En d’autres termes, la souveraineté populaire n’aurait de sens que dans l’immanence même d’une démocratie accomplie tandis que l’état social, en raison même de son ambiguïté, excède la réalité du régime démocratique pour en préparer l’avènement. Ainsi, la souveraineté populaire n’est-elle que la condition politique du régime démocratique tandis que l’état social meut les conditions sociales d’une réalisation politique. Néanmoins, reconnaît Manent, Tocqueville nous paraît hésiter entre une détermination essentiellement sociale et une détermination essentiellement politique de la démocratie. »4 Pourquoi cette hésitation de Tocqueville ? Parce que ce dont il parle, c’est d’un régime qui est déjà démocratique et donc au sein duquel l’exercice politique de la démocratie se confond avec son état social, lequel recouvre à son tour la forme classique de souveraineté populaire, à savoir l’opinion. « Tocqueville s’efforce de viser une même chose en désignant successivement l’état social, puis la souveraineté du peuple, enfin l’opinion publique comme le principe générateur des mœurs et des lois de la démocratie américaine. »5 Ce qui est fort bien mis en valeur par Manent c’est ce fait que Tocqueville travaille sur la société américaine où l’égalisation des conditions, la souveraineté populaire et la force de l’opinion s’exercent déjà à plein régime de telle sorte que la forme politique de la démocratie se confonde avec le mouvement même de son devenir social.
Cette analyse de la société américaine est l’occasion pour Tocqueville de comparer la société aristocratique à la société démocratique. C’est à cet égard que l’on perçoit combien Tocqueville s’avère être un auteur de nuances, et combien le manichéisme contemporain lui est étranger ; il lui faut en effet répertorier les effets pervers de chacune des sociétés sans pour autant condamner les sociétés en question, eussent-elles des effets détestables. L’effet détestable de la démocratie c’est ce que nous appellerions aujourd’hui avec quelque facilité le nivellement par le bas. La démocratie ne permet pas de produire de grands hommes, de grandes idées, de grands idéaux. Elle ne produit que des êtres serviles, à l’âme rabougrie, que toute idée de grandeur a désertés. De là ce paradoxe admirablement restitué par Manent : la société aristocratique théorise une idée fausse de la liberté dont les effets sont pourtant meilleurs que ceux de la société démocratique qui thématise correctement l’idée de liberté. Ce que Manent met ici en valeur très subtilement c’est un point à mes yeux central : on n’obtient jamais l’effet souhaité de façon directe, il faut toujours une médiation, un détour. Ainsi, la société aristocratique obtient-elle des êtres plus libres que ceux de la démocratie malgré une thématisation de la liberté moins juste. Pourquoi cela ? Pourquoi cette incapacité démocratique à produire des effets conformes à ses idéaux ? « La perfection de sa définition accroît l’improbabilité de sa réalisation, pis, suscite naturellement des comportements ennemis de la liberté. »6 C’est là véritablement un point nodal de la pensée de Tocqueville, inhérent à l’ensemble de la pensée libérale au demeurant, pour laquelle c’est faire preuve d’une extraordinaire naïveté que de croire qu’il est possible d’obtenir un effet en recherchant directement celui-ci. Ainsi, l’effet pervers n’est-il rien d’autre que la marque de l’impossibilité d’échapper à la médiation, à l’indirect, dans le cadre des idéaux qui cherchent sans cesse à oublier le réel pour mieux en regretter le manque de pureté.
Après ces remarques sur les conditions de possibilité de l’exercice démocratique, Manent s’interroge sur ce qui, selon Tocqueville, est profondément transformé par l’état social démocratique. Nous l’avons dit, ce sont les rapports sociaux : mais il nous les faut préciser. Ce qui se trouve bouleversé en démocratie, c’est l’idée de servir ; on sert par obéissance démocratique et non par nature, donc par contrat. « Le principal effet de la démocratie est de rendre le maître et le serviteur étrangers l’un à l’autre, de les poser pour ainsi dire l’un à côté de l’autre, bien plus que l’un au-dessus de l’autre. Ainsi la relation la plus inégalitaire est-elle transformée de fond en comble par la démocratie. »7 Les rapports de domination et de servitude se trouvent profondément renouvelés en démocratie, l’égalisation des conditions faisant que la différence hiérarchique naturelle perd toute pertinence, toute légitimité également. De ce fait, on n’obéit plus parce qu’on est naturellement inférieur mais bien plutôt parce qu’on décide contractuellement de se subordonner à un Etat, une institution, une personne. C’est là un bouleversement inouï des relations sociales que Tocqueville relève. Autre bouleversement, l’introduction de la douceur et le refus de la cruauté dont Tocqueville ne cache pas les évidents effets pervers, notamment dans le cadre judiciaire.
A cette ambivalence fondamentale de tous les bouleversements démocratiques, il serait illusoire de dissimuler le plus troublant d’entre eux, l’avènement de l’opinion majoritaire, hypostase du vrai en entité abstraite, fluctuante et indécise, malléable selon le gré du vent, dangereuse et efficace. La démocratie est ce régime où l’opinion légitime provient non plus de son intrinsèque véracité – qualité – mais bien de la quantité – la majorité. L’opinion légitime est l’opinion majoritaire, c’est-à-dire l’opinion la moins individualisée, la moins personnelle, la moins rationnelle aussi. « Le présupposé ultime de l’idée majoritaire est que le plus juste est dans le plus fort : ce même par quoi les hommes démocratiques se ressemblent de plus en plus, ce même à travers quoi ils se pensent et se perçoivent, ce même qui leur est plus intime et plus cher qu’eux-mêmes, n’est rien d’humain. »8 Cette importance de l’opinion majoritaire est centrale dans la problématique démocratique car il s’agit d’un régime représentatif ; par conséquent, la question centrale du politique revient à se demander ce qui, politiquement, mérite d’être représenté. La démocratie répond quantitativement et non qualitativement, en affirmant que c’est la majorité qui accède à la représentation politique. Manent avait insisté sur cette question dans sa très belle Histoire intellectuelle du libéralisme où il avait remarqué que l’une des questions centrales de Tocqueville, contrairement à Constant et Guizot, résidait dans une interrogation sur « ce qui est à représenter »9
La démocratie, disait Manent au début de son ouvrage sur Tocqueville, c’est non seulement cet état social au sein duquel les relations sociales se trouvent très profondément modifiées, mais c’est également un régime où il y va de la nature humaine elle-même. C’est un régime où la nature humaine se trouve systématiquement mise en question, où l’inégalité de nature est incessamment bouleversée par l’égalisation des conditions. Mais d’un autre côté, toujours en raison de cette ambivalence fondamentale de la démocratie, la démocratie se présente également comme ce régime qui est le plus naturel à l’homme, si bien qu’elle ne contrarie la nature humaine que pour mieux le naturaliser. Manent condense cette ambiguïté dans une belle formule selon laquelle « la démocratie c’est la nature qui met en danger la nature. »10 La démocratie, pour le dire clairement, revêt un aspect naturel en ceci qu’elle pose l’égalité des hommes et anti-naturel en ceci que la nature ne cesse de produire des inégalités. On ne saurait mieux établir l’ambivalence de ce régime au sein duquel se jouent la nature humaine et son éventuelle évolution.
Autre ambivalence du régime démocratique : l’utilisation qui est faite de la religion. Kant, on s’en souvient, avait établi dans La religion dans les limites de la simple raison la nécessité de passer par la religion pour ceux dont la raison était inapte à l’autonomie, à la condition pressante que la religion s’accordât et même se calquât sur les prescriptions rationnelles de la loi morale immanente. De la sorte, la religion revêtait un caractère utile à la société en raison même de sa véracité issue de sa conformité à la loi morale. Tocqueville conserve la nécessaire utilité de la religion mais il en évacue la vérité, ce qui revient à dire que la religion est utile indépendamment de son contenu. « Pour remplir dignement et virilement leur tâche humaine, les hommes ont besoin d’un savoir ou d’une opinion sur le Tout, qui les enveloppe et les dépasse ; or l’immense majorité des hommes ne peuvent se former une telle opinion à partir des ressources de leur seule raison. »11 Qu’est-ce à dire ? Manent analyse finement cette utilité religieuse libérée de l’impératif de véracité, et y voit une sorte de ruse de la société. « Dans l’Amérique puritaine, en effet, la religion règle certes tous les détails de la vie sociale ; mais dans la mesure où ce pouvoir de la religion est exercé par tous les membres du corps social sur chacun et par chacun sur tous, on peut décrire ce pouvoir non comme celui de la religion sur la société mais, plus judicieusement, comme celui de la société sur elle-même par le moyen de la religion. »12
Quelle est alors la portée de la nature politique de la démocratie ? Ce qu’il y a de remarquable aux Etats-Unis, c’est que la démocratie assume à elle-seule la totalité du fait politique. En d’autres termes, il n’y a pas d’extériorité à la démocratie bien que la démocratie et le politique ne se recouvrent pas ; ce que les Etats-Unis nous apprennent, c’est que la démocratie excède infiniment le politique ; que la démocratie désigne un mouvement infiniment plus vaste que ne le circonscrit le champ politique. En réalité, la démocratie ne se focalise pas davantage sur le politique que sur les autres champs sociaux ; elle investit le politique avec cette ambivalence fondamentale de l’indifférence et de la nécessité. Indifférence parce que le politique n’est qu’un champ social parmi d’autres, nécessité parce que la démocratie considère qu’il est nécessaire que les hommes vivent ensemble sous des conditions égales. Cette ambivalence démocratique fait que Manent conclut sur une relation elle-même ambiguë que nous devons entretenir avec ce fait social, tout aussi aimable que détestable : « Il est difficile d’être l’ami de la démocratie ; il est nécessaire d’être l’ami de la démocratie : tel est l’enseignement de Tocqueville. »13
- Pierre Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie, Tel Gallimard, 2006, p. II
- Ibid. p. 12
- Ibid. p. 17
- Ibid. p. 18
- Ibid. p. 21
- Ibid. p. 41
- Ibid. p. 55
- Ibid. p. 71
- Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Hachette, coll. Pluriel, 1987, p. 221
- Pierre Manent, Tocqueville…, op. cit., p. 99
- Ibid. p. 122
- Ibid. p. 132
- Ibid. p. 181








