Les terminales ES qui ont planché cette année sur « Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l’histoire ? » auraient pu tirer parti du dernier livre de Régis Debray, Madame H. 1. Tout à fois autobiographique, philosophique et historique, cet essai est à tous les sens du terme un récit sur la fin de l’histoire : fin des grands événements, des grands récits et des grands hommes ; fin de l’intérêt pour les études historiques, à une époque où la politique devient une affaire de technogestionnaires et de spécialistes en communication ; fin aussi des illusions de Régis Debray sur l’histoire, qui constate l’échec des idéaux progressistes et cherche quelle philosophie adopter face à un monde qui ne veut plus croire aux idées mais à l’efficacité et au management.
Quand s’en va madame H., cette grande illusioniste, ou qu’on la congédie comme une indigne, il ne reste qu’à chercher les faveurs de madame Sophie qui, même si elle a bien des malheurs en ce moment, reste une maîtresse accueillante quand un idéaliste déçu a besoin de bras consolateurs. C’est vers une certaine philosophie du présent que se tournera finalement Régis Debray au terme de ce bref parcours à travers notre histoire.
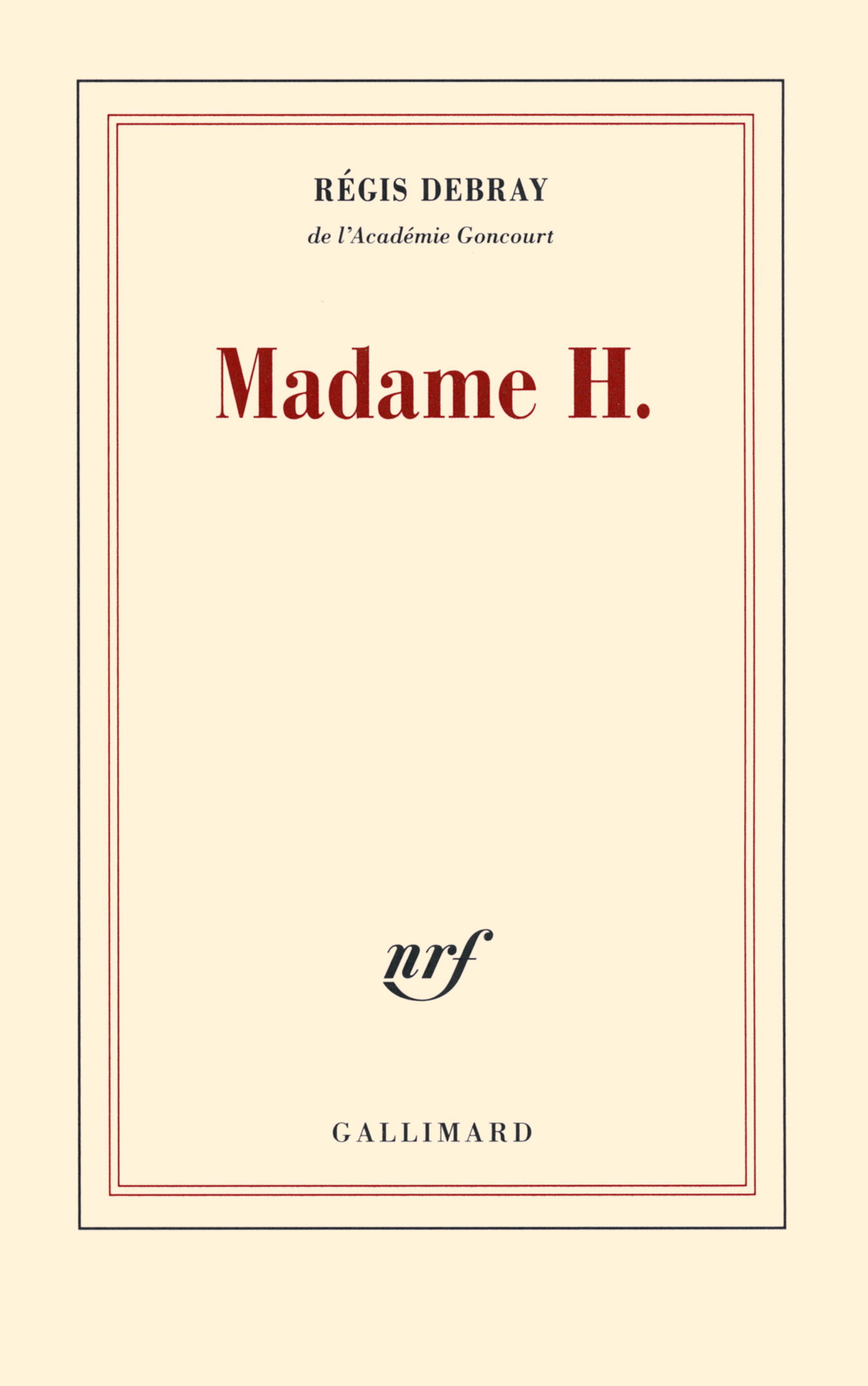
Debray commence par raconter l’histoire de quelques-uns de ses ancêtres, comme son aïeul « … Pierre-Charles Debray, meunier de son état, Montmartrois, et propriétaire du Moulin de la Galette, tendance ronchon. En voyant l’armée impériale russe arriver porte de Pantin, le 30 mars 1814, il eut l’idée intempestive de sortir son escopette et d’abattre un ou deux cosaques. Ce que voyant, la soldatesque ennemie découpa son corps « en quatre portions égales » (le vice égalitaire, déjà) pour en étoiler les ailes du moulin, afin de produire du haut de la Butte un effet de terreur en contrebas. Cette exposition eut raison des timidités parisiennes et le faubourg Saint-Germain ouvrit peu après sa porte aux officiers du tsar, comme nos cafetiers aux troufions (bistro ! bistro !). Le fils de Pierre-Charles, Nicolas, survécut au coup de lance qui l’avait transpercé en accourant défendre son paternel et flanqua bientôt le Moulin d’une guinguette, « le bal Debray » : toute liesse est un deuil surmonté. Là s’illustrèrent, à la Belle Epoque, au son de la polka, du quadrille et du french cancan, Grille d’Egout, La Goulue, Valentin le Déssossé et autres vieux copains de la famille. Avec cette musette dans mes gènes, je dois à ces marlous l’essentiel de ma vocation : insuffler au music-hall le sens du religieux, ou l’inverse, et aux bas-fonds l’instinct des hauteurs » (pages 13-14).
Quand Debray tente ensuite d’insérer sa propre histoire dans l’histoire du vingtième siècle, ce sera toujours pour constater un irréductible décalage entre les événements et son propre parcours. Le sentiment lancinant d’avoir raté le coche ou d’être passé à côté des grands moments (mais ont-ils eu lieu ?) pourrait se résumer au dépit de Fabrice à Waterloo : « Jamais je ne serai comme ça… Jamais je ne serai un héros. »
« Qu’est-ce qui vous arrive quand le mal d’Histoire vous prend ? Rien. On attend. On ne se lasse pas d’attendre. Et quand ce que l’on a attendu n’arrive pas, on continue d’attendre, un autre mirage, puis un troisième. Quand je n’ai plus de rouge, je mets du vert. Plus de rose ? Du bleu. C’est l’attente, notre virus, et ce n’est pas l’apanage des rastafaris, des raëliens ou des adeptes de l’ère du Verseau : c’est de fondation » (page 53).
Voici donc l’amant de Clio réduit à attendre l’Histoire comme d’autres le Messie : « Avec ces points de suspension intercalés depuis deux mille ans entre l’Annonce et l’Avènement, la vie du chrétien, ou de son descendant moins bien famé, désormais au funérarium, le révolutionnaire, est un roman inachevé, un salus interruptus, suspendu à un rendez-vous à la fois immanquable, puisque fixé par Dieu, et hasardeux, puisque sans heure ni jour. Les gens du Livre sont appelés à patienter toute leur vie dans la salle d’attente d’une gare où aucun horaire n’est affiché et dont la seule porte de sortie sur les quais, la mort, débouche sur une seconde et angoissante attente, la Résurrection » (page 54). « Aussi aurai-je passé ma vie à attendre l’inattendu après lequel il n’y aura plus rien à attendre, l’événement qui changerait la vie, celle du genre humain et la mienne en passant. J’avais l’idée apparemment évidente, comme toutes les fausses bonnes idées, que demain serait un autre jour » (page 58).
*
Debray s’aperçoit qu’il est devenu dérisoire de s’émouvoir devant l’action des grands hommes et tout ce tintamarre qui nous donne le sentiment que l’histoire est en marche. Mais la puissance d’émotion demeure : « « C’est quoi l’Histoire pour vous ? » Réponse : ce qui me met les larmes aux yeux, point final » (page 32).
Adieu aux armes, adieu aux larmes, mais pour Debray, c’est justement cela qui est à pleurer. Et s’il exalte l’histoire, c’est davantage pour les sentiments qu’elle suscite en nous que pour sa réalité, sur laquelle notre auteur ne se fait guère d’illusions. On peut se demander du reste si telle qu’il la voit, elle est plutôt tragique ou comique : « Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la déculottée, et le courage malheureux, spécialiste du terroir, donne son cachet à l’épopée maison. Vercingétorix a eu du flair quand il est venu sur son cheval blanc jeter son épée aux pieds d’un Jules César bien calé sur sa chaise curule, mi-dégoûté mi-ironique, un peu absent, roulant déjà dans sa tête ses veni, vidi, vici. Plus favorisés, nos amis d’Outre-Rhin sont moins bien lotis. L’homologue là-bas du héros fondateur, Arminius, alias Hermann, a défait les légions romaines au fin fond de la Forêt noire. De cette matrice premier degré sont sortis Frédéric II, Bismarck, Rommel, Mercedes et Mme Merkel. Plus malins, nous continuons pour notre part à célébrer la Légion à Camerone, Roland à Roncevaux, Jeanne au bûcher, Napoléon sur son roche, les communards au mur des Fédérés. On a beau donner des médailles en chocolat au gagnant, le cœur gaulois en tient pour Poulidor » (page 27).
La devise d’Ernesto Guevara, « de défaite en défaite jusqu’à la victoire finale » serait-elle de la France ? C’est celle de Debray en tous les cas. Et c’est encore une consolation, peut-être, d’être d’uni dans la défaite, pourvu qu’il y ait un combat à mener… C’est pourquoi Debray préfère encore la grandeur et la décadence de l’histoire, cette courtisane, que le monde sinistre et gris qui lui succède. Qu’allons-nous devenir après la mort de Dieu et de ses derniers avatars ? « La question de fond est de savoir si un Occidental peut briser le moule chrétien sans devenir un salaud. Vaste question. Laissons les philosophes y réfléchir à tête reposée. Ils ont l’habitude et le jargon pour cela. Chacun son niveau et ses urgences. Je m’en tiens aux questions d’organisation. Comment rester fidèle à sa jeunesse dans un monde où un dîner intéressant est celui où l’on ne parle pas de politique ? » (page 140)
Désabusé, Debray se montre aussi en vieux révolutionnaire qui n’a jamais pu mener à bien la révolution mais a gardé au fond de lui sa colère intacte -intacte car toujours justifiée, mais aussi parce qu’elle est restée inassouvie.
Le constat de Debray n’est pas qu’il n’y a plus d’histoire, qu’il ne se passe plus rien, mais que l’étude du passé et la vision historique ne sont plus à l’ordre du jour. Le discours républicain ne s’inscrit plus dans une tradition, ou si peu, ou tellement que cela n’est plus crédible (qui ne s’est pas réclamé de Jaurès depuis cinq ans ?). Debray n’affirme donc pas que l’Histoire est arrivée à sa fin, mais que nous ne savons plus faire face à elle, ni poursuivre la nôtre. Ainsi, pourquoi se battre contre le terrorisme islamiste si on ne croit plus en l’Occident ? Le défendre dans le déni ne peut pas suffire, pas plus que de penser que tout cela finira par s’arrêter. Par exemple, qui peut encore croire, comme Philippe Muray dans « Chers djihadistes… » que les conflits s’arrêteront d’eux-mêmes et que l’Occident annihilera par son inertie même toute velléité de lutte contre lui ? Les prophéties de Muray ne se sont pas réalisées : les « barbares » n’ont pas rejoint la tribu des homo festivus. Comme on l’a vu en janvier et novembre 2015, le djihadisme n’est pas soluble dans le Paris de la gay pride et des vendredi soirs en rollers. Or, on ne peut pas faire mine de dénigrer l’occidental contemporain, tout en espérant que le calife noir de Raqqa veuille bien cesser de s’en prendre à lui.
*
La philosophie politique de Debray, s’il acceptait ce terme, pourrait s’appeler le « progressisme rétrograde », vision du monde qu’on peut résumer à l’idée que le progrès, c’était mieux avant ! Il n’y a peut-être pas d’espoir de changement sans une nostalgie du passé : tout révolutionnaire est d’abord un romantique. « Un étudiant en lettres dépourvu de compétence particulière et que n’obsède pas l’argent – soit le parfait inadapté social – peut espérer se rendre intéressant de deux façons : en faisant un beau livre ou une belle guerre. S’il fait les deux à la fois, ou l’un après l’autre, c’est le pompon : Hemingway, Jünger, Genevoix, Malraux… » (page 76).
Debray, dont l’art d’écrivain consiste à défendre des idées de gauche dans un style de droite (en somme Paul Morand défendant le Che et de Gaulle, si on peut concevoir une chose pareille) 2 n’est cependant pas tendre avec Mitterrand. Ce qui aurait pu être un triomphe a été le début des grandes désillusions de l’ancien compagnon de route de Che Guevara. En mettant sa plume et ses idées au service de la « propagande » du candidat Mitterrand (à l’époque, on ne parlait pas encore de «communication »), il espère insuffler un certain souffle historique au combat de la gauche :
« Quand on ne peut plus mettre une charge de plastic, on se rabat sur le bulletin de vote.
Pas étonnant, puisqu’il faut faire avec ce qu’on a sous la main, que, le 10 mai 1981, à 8 heures du soir, un « recommençant » chevronné, mais non repenti, n’ait pu s’empêcher d’avoir les larmes aux yeux (…) Le nouvel élu de la Providence (auquel j’avais déjà soufflé quelques formules salvatrices, « vous êtes l’homme du passif » et autres lazzis désobligeants) me demanda d’écrire son grand discours pour la cérémonie d’investiture à l’Élysée. Où trouver l’inspiration ? Le cistercien universel et calabrais Joachim de Flore (v. 1130-1202) me parut seul à la hauteur des circonstances (…) Son schéma tout-terrain d’un temps à trois temps peut alimenter les prospectus. Il y avait eu le premier règne, celui du Christ ; puis celui de l’Antéchrist ; il y aurait enfin celui de l’Esprit, au cours duquel l’Eglise institutionnelle serait relayée par une nouvelle. J’en fis la traduction : il y eut Jaurès et Blum, puis Pompidou et Giscard, il y aurait, jusqu’à la fin des temps, le Programme commun de gouvernement » (pages 88-89).
Il faut être bien idéaliste pour avoir ce genre de scrupules, car les chances que d’autres conseillers politiques repèrent dans un discours une allusion à Joachim de Flore sont bien minces, pour ne pas dire inexistantes. Mais ce genre de cas de conscience honore évidemment l’homme de lettres qu’est Debray, à défaut d’honorer les conseillers qui n’auraient jamais vu le recopiage. Après tout, tout le monde n’a pas la culture pour faire des antisèches avec un moine cistercien du 12ème siècle !
Et il est au passage intéressant de voir que ce schéma tripartite pourrait aussi bien être qualifié d’hégélien !
Au fond, cette anecdote, pour amusante qu’elle soit, ne fait que mieux ressortir le décalage entre la culture de l’homme de lettres et la réalité du tournant mitterrandien, où la littérature et l’histoire vont finir d’être congédiées du discours politique : « L’Elysée alla jusqu’à me réquisitionner pour composer un discours ennuyeusement présidentiel afin d’honorer les mânes d’un dénommé Jean Monnet, un homme d’affaires franco-américain panthéonisé pour services rendus au marché libre et non faussé. La goutte froide de trop. Elle me fit sursauter, comme au sortir d’un mauvais rêve. La très politicienne période que je venais de traverser, était-ce pour de vrai ? Réaliste, sans aucun doute, mais réelle, j’en doutais. Un faiseur de songes est ainsi fait que l’actualité devient onirique à ses yeux dès qu’elle ne le fait plus rêver » (pages 99-100).
*
Dans un chapitre assez loufoque, Debray nous raconte comme il fut invité à Colombey-les-deux-Eglises par un De Gaulle tout juste retiré du pouvoir. Terrorisé à l’idée de rencontrer le grand homme, il fait en route la tournée des comptoirs pour se donner du courage, et, de bistrot en bistrot, arrive finalement ivre mort à la Boisserie. Il y est reçu par le secrétaire des lieux, qui constate l’état lamentable de l’invité. Le général fera une apparition très brève, simple silhouette comme dans L’armée des ombres de Melville, et le pauvre Debray ne pourra qu’entendre l’homme du 6 juin intimer l’ordre qu’on flanque à la porte ce malpropre !
On peut se demander pourquoi Debray éprouve le besoin de raconter ce genre d’anecdotes peu glorieuses, où il se comporte comme un VRP de province d’un film de Chabrol, plutôt qu’en individu ayant rendez-vous avec l’Histoire. Néanmoins, ceux qui se sont laissé prendre à ce récit montrent plutôt qu’ils n’ont, pour le coup, pas étudié les dates. En effet, en 1969, il n’était pas possible que Debray soit en France, encore moins invité chez le président à la retraite, puisqu’il était en Bolivie pour quelques années encore, et n’avait pas vraiment sa liberté de mouvement…
Preuve est faite que le récit est plus vraisemblable, même dans son invraisemblance, que l’histoire, puisqu’il donne l’illusion que ce qu’il raconte ne s’invente pas ! Car qui s’inventerait une rencontre avec un grand homme pour la tourner en dérision à ce point ? Et au contraire, combien ont l’impression d’avoir fait l’histoire parce qu’ils ont déjeuné une fois avec Albert Camus ou Mitterrand, et vivent le reste de leur vie dans l’illusion de leur avoir soufflé une idée essentielle ?
Pour Debray, cette traversée de l’histoire s’achève donc sur un constat désespéré au bon sens du terme, si l’on peut dire : « Il n’y a pas de leçon de l’Histoire, c’est bien connu, sauf celle-ci : le roulement de tambour est mauvais signe. Et le nombre de téléspectateurs, ou de personnes défilant dans la rue, n’est en rien une garantie. Numérisé jusqu’au trognon, l’Occident se drogue au chiffre, l’opium des élites (et vient d’ajouter à l’album le 11 janvier 2015 au seul motif que quatre millions de Français ont alors vaillamment tourné en rond). M’est avis que les vrais tournants ne paient pas de mine et ne coûtent pas cher. Les journées qui feront date ne se programment pas, elles adviennent. Pattes de colombe, petit budget, cinq lignes en page 18 : c’est le moment d’ouvrir l’œil, et le bon » (page 61).
In fine, Debray choisit donc la vie contre les études historiques, la fin des illusions contre l’exaltation sentimentale du passé et l’attention aux événements minuscules qui sont masqués par le tintamarre de l’histoire monumentale, comme pour dépouiller Madame H. de ses grands atours. Mais que reste-t-il alors de l’histoire ? L’anecdote, les faits insolites, l’accidentel et l’éphémère, en somme plus du tout l’histoire mais instants éparpillés à saisir au vol. Profiter du présent et espérer réussir sa sortie, en espérant qu’il y ait du monde à l’église le jour venu, comme il le raconte dans un beau dernier chapitre.
Ayant ainsi traversé l’Histoire comme d’autres leurs fantasmes, Debray parvient enfin à se défaire de sa nostalgie et de l’attente eschatologique pour profiter du moment présent : gilet rouge à la Théophile Gautier (le romantisme, toujours), la veste de chasseurs aux poches pleines de stylo prêts à dégainer, pour boire un café place de l’Odéon tant que la France n’est pas totalement devenue une colonie américaine.








