Le dernier livre de Rémi Brague, Le règne de l’homme[Rémi Brague, Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Paris, Gallimard, 2015[/efn_note] constitue le troisième volet d’une vaste réflexion sur l’homme développée initialement dans La sagesse du monde1 et La loi de Dieu2 et dont on peut trouver trace dans [cet entretien réalisé dans nos propres colonnes. Dans Le règne de l’homme, il s’agit pour l’auteur de sonder comment se sont effondrés deux ordres anciens, celui du cosmos ordonné donnant sa règle aux hommes, puis celui de Dieu délivrant ses commandements par la médiation d’une révélation, tout en analysant l’émergence d’un ordre nouveau que l’on peut appeler la modernité. « L’ensemble des normes qui régissent et définissent l’humain est apparu d’abord comme préfiguré, illustré ou au moins garanti par la structure de l’univers physique ; puis comme réglé par des commandements divins révélés dans une histoire ou inscrits dans une conscience. Mes deux récits avaient en commun de s’achever avec les Temps Modernes, où le savoir de l’homme s’affranchit de la nature et du divin. Il me reste à appréhender de face ce qui résulte d’un tel décrochage : le refus pour l’humanité d’avoir un quelconque contexte, et de tirer son existence et sa légitimité d’ailleurs que d’elle-même. »3
Nous retrouvons avec cet ouvrage toute l’érudition de l’auteur, toute sa hauteur de vue, ainsi que sa remarquable capacité à synthétiser des éléments complexes sous une forme claire et marquante en vigueur depuis La sagesse du monde. Sans être un ouvrage de vulgarisation – il s’en faut de beaucoup –, Le règne de l’homme allie rigueur des références et clarté d’exposition, ce qui constitue un certain exploit au regard de la difficulté de l’entreprise.
A : La notion de contexte
Un des concepts importants de l’ouvrage réside dans celui de « contexte » ; ce terme était déjà présent dans le sous-titre d’Aristote et la question du monde, sous-titré Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie4 De facture heideggérienne – nous reviendrons sur la patte très heideggérienne des textes de Brague en conclusion – l’ouvrage ambitionnait de penser l’ontologie à partir de l’Univers comme présence durable donnant un sens précis à l’être ; de la même manière, l’être en général était rabattu sur l’être de l’étant particulier qu’est l’homme, de sorte que l’ontologie aristotélicienne était pensée à partir des à-côté, de l’environnement aussi bien cosmologique qu’anthropologique, ce qui revenait à dire que l’être comme tel ne se comprenait pas à partir de lui-même mais à partir d’un environnement précis.
Dans Le règne de l’homme, Rémi Brague reprend ce concept de contexte pour qualifier les différents paradigmes qui ont prévalu à travers les âge ; le cosmologique des Grecs, analysé dans La sagesse du monde permettait de comprendre comment la présence du cosmos n’était justement pas qu’une présence mais aussi un modèle ayant valeur de règle et de norme. Le contexte cosmologique donnait ainsi à l’homme l’ordonnance réglée de son comportement ; de la même manière, la révélation divine, quelle qu’elle fût, donnait à l’homme un ensemble de préceptes et de devoirs demandés par Dieu en personne réglant la vie morale de chaque sujet. Il y allait bien dans les deux cas d’un contexte puisque l’homme devait sortir de lui-même pour trouver la norme et la loi réglant sa conduite et ses croyances ; en d’autres termes, le contexte désigne l’en-dehors de l’homme par lequel les préoccupations de l’homme trouvaient un sens.
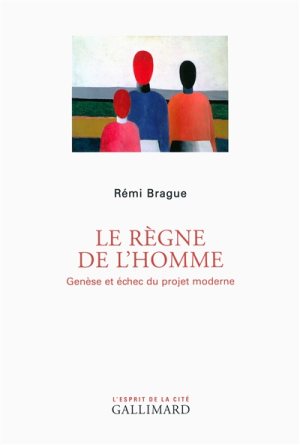
Le projet moderne est alors défini par Rémi Brague par le refus de ce contexte, c’est-à-dire le refus de considérer l’à-côté de l’homme comme étant une source légitime en matière normative et morale. Dans ces conditions, le projet moderne est conçu comme refus, comme rejet du contexte, comme rejet de l’extériorité normative ; le cosmos est toujours là, certes, et Dieu peut-être encore un peu là, mais ils n’ont plus de légitimité pour normer la vie, pour dicter à l’homme ses règles de conduite, de sorte que du point de vue de la légitimité de sa conduite, l’homme se retrouve seul ou, plus exactement, ne peut plus que se prendre lui-même comme fondement légitime de ses propres actions.
Si le contexte disparaît que reste-t-il ? L’homme, et l’homme seul. Et plus précisément le projet humain. Rémi Brague consacre de belles analyses à cette notion de projectus qui signifie proéminent avec l’idée d’une démesure ; il y a de l’hybris sans aucun doute à croire que l’homme puisse être à lui-même son propre fondement, il y a une fabuleuse affirmation d’autonomie qui eût déplu aux Grecs ; mais dans cette hybris, il y a aussi de la négativité : soumettre le cosmos et soumettre le divin à l’ordre humain. Car c’est bien d’ordre qu’il s’agit et de source de l’ordre : si le cosmos est en lui-même ordonné, alors il peut être normatif et même législateur, tout comme l’ordre divin peut régler les affaires humaines ; mais si l’homme devient lui-même législateur en vertu de son autonomie, alors le Monde comme Dieu est vidé de son ordre et n’en reçoit qu’à la mesure de ce que lui donne l’homme : « au lieu que ce soit le cosmos qui donne sa mesure à l’homme, c’est l’homme qui doit se créer un habitat à sa mesure. »5 Plus généralement, ce n’est plus l’ordre céleste et cosmique qui règle les affaires humaines, car dans le projet moderne l’environnement, c’est-à-dire le « contexte », est un « chaos »6 Par conséquent, dans cette démesure de l’agir humain, le projet se substitue à l’ordre pré-humain de sorte que le projet moderne soit précisément moderne en tant que projet.
B : Obstacles à la thèse
Pour défendre sa thèse, Rémi Brague doit donc montrer – ce sera l’objet de la première partie – qu’avant la période moderne, aucun rapport à la nature et au divin ne s’était manifesté comme maîtrise ni et encore moins comme projet. Pourtant, l’homme biblique doit soumettre la terre et surtout ne pas rendre de culte à la Nature ; n’est-ce pas déjà là trace d’un projet moderne de domination humaine de la Nature ? « L’homme biblique est image de Dieu, mais sa domination, ne pouvant plus porter sur l’autre homme, s’exerce désormais sur la nature. »7 A cette difficulté, Rémi Brague répond que l’homme n’est seigneur de la création que comme fils de Dieu : cette domination n’implique donc pas de contrôle absolu puisqu’elle ne provient pas de l’homme lui-même, mais de la légitimité que lui confère Dieu. De là cette conclusion : « Quoi qu’il en soit, la réalisation de la supériorité de l’homme représente un commandement à exécuter ; elle résulte d’une consigne reçue du dehors, non d’une aventure spontanément planifiée. Elle est tâche et non projet. »8
Un autre obstacle est celui de la « maîtrise ». Dans cet idéal antique qu’analyse Rémi Brague (p. 51), n’y a-t-il pas également un risque de faire de l’homme un maître de la nature avant l’heure ? La maîtrise est une question sociale et en même temps une question portant sur le rapport à soi. La maîtrise de soi importe davantage que la maîtrise de la nature. « La maîtrise à l’antique ne préfigure pas le projet moderne. Car, loin de se poser soi-même, le sujet de la maîtrise commence par se recevoir d’ailleurs. »9 Plus précisément, l’homme se reçoit de la nature et c’est ainsi qu’il se fait maître de lui-même. Même chez Plotin, la célèbre image de la sculpture de sa propre statue signifie s’assimiler aux dieux, et non marquer sa domination sur l’environnement.
Il reste un obstacle, celui de la domination intellectuelle ; doté d’un intellect, l’homme n’est-il pas alors capable de dominer le monde à défaut de dominer Dieu ? « Avant même le projet d’une domination concrète de la nature apparaît celui d’une domination intellectuelle, avec l’idée de construction qui va devenir le paradigme dominant du savoir moderne. D’origine géométrique, elle s’étend à tous les produits de l’imagination. »10 L’argument de Rémi Brague pour neutraliser le risque que fait peser la domination intellectuelle sur sa thèse générale nous semble un peu moins convaincant que les précédents : il s’agit selon lui d’une « domination métaphorique » qui ne se prétend pas réelle. Les mathématiques donnent un modèle purement rationnel qui ne prétend pas à l’effectivité ce qui atténuerait, selon l’auteur, l’audace de cette domination intellectuelle. C’est là une thèse intéressante mais sans doute contestable : quelle place accorder dans ce cas au pythagorisme qui confère à l’Etre même une structure mathématique ? Dans une optique pythagoricienne, la maîtrise des mathématiques s’apparente à une maîtrise de la Nature, bien que l’homme ne soit pas créateur de l’outil mathématique comme tel. Il y a là quelque élément qui mériterait sans doute de longs développements. Le même raisonnement est appliqué au droit, qui est neutralisé en tant qu’il ne concernerait que les rapports d’homme à homme et non d’homme à environnement avant que d’être étendu au rapport au non-humain.
C : Quelle domination par quelle humanité ?
De quand date l’émergence du projet moderne ? De quand date cette revendication d’affranchissement autonome ? Rémi Brague la situe lors de la fin de la Renaissance, notamment avec Francis Bacon. « Francis Bacon a le premier, semble-t-il, émis l’idée d’une domination de l’homme sur la nature, non sans avoir été influencé par l’alchimie et la « magie naturelle » comme il le reconnaît parfois. »11 L’homme ne tire plus son humanité de la contemplation et le projet – démesuré ? – est de réparer la Chute, donc de changer en partie la nature humaine. « L’expérimentation représente un premier aspect de la domination, provisoire parce qu’elle ne débouche que sur la connaissance, mais nécessaire : l’action qui révèle la nature précède celle qui la transformera. La nature se présente comme devant être forcée à avouer. »12 Un des points intéressants de l’ouvrage est que Rémi Brague montre comment une même idée peut selon le paradigme en vigueur ne pas avoir le même sens : Hippocrate, rappelle l’auteur, avait déjà théorisé l’expérimentation mais elle n’avait pas le même sens que chez Bacon qui lui confère ainsi le sens d’une mise à la question de la nature. De la même manière, chez Descartes, le « maître et possesseur » résonne de manière juridique puisque Dominium et possessio sont des termes juridiques. Le serf était sous la domination du suzerain et ses biens étaient en possession du suzerain. Donc conclut Rémi Brague, il s’agit d’asservir la nature au sens juridique du terme. Soit ; mais pourquoi ne pas insister sur le « comme » introduit par Descartes qui relativise nettement la portée de la domination ? Et pourquoi ne pas plutôt en conclure qu’il s’agit de faire comme si l’homme pouvait asservir la nature au sens juridique du terme, tout en sachant que tel n’est pas le cas, puisque le comme interdit de faire de l’homme le possesseur et le maître réels de la nature ?
Ici se joue une difficulté très réelle : pourquoi Descartes ne va-t-il pas jusqu’au bout de la domination et de la possession ? Pourquoi ce « comme » ? Si l’on suit la logique de la thèse de Rémi Brague, il faut en conclure que l’auteur du Discours de la méthode refuse que l’homme maîtrise réellement la nature, entretienne avec elle un rapport réel de domination ; il doit bien plutôt mimer un tel rapport, faire comme s’il pouvait la maîtriser, bien qu’il ne le puisse pas. Que l’un des fondateurs décisifs de la modernité ne franchisse pas le pas d’une domination réelle de la nature ne devrait-il pas inciter à infléchir quelque peu la thèse générale de l’ouvrage et à se demander si la modernité ne joue pas à dominer la nature, comme s’il s’agissait là d’une scène où chacun sait que les rôles sont fictifs ? En d’autres termes, nous nous demandons si les fondateurs intellectuels de la modernité ont été dupes du pouvoir qu’ils conféraient à l’homme et si, à notre tour, nous ne faisons pas dire à ces derniers bien plus qu’ils n’avaient réellement dit ; ce ne sont là que des interrogations qui nous semblent autorisées par l’extrême prudence du texte cartésien qui nous semble difficilement rattachable à la thèse d’une domination pleine et assumée de la nature.
Quoi qu’il en soit, et bien avant Bacon, il y eut des préfigurations apparues dès le début de la Renaissance. A cet effet, l’auteur analyse la mutation du sens du travail, et la nouvelle noblesse conférée à qui transforme la nature par le travail. « Le travail était pour l’Antiquité le contraire même de la noblesse sociale, le triste privilège des esclaves ; à la Renaissance, il devient au contraire le signe de la noblesse ontologique de l’homme. »13 Il mentionne évidemment l’importance du traité de Manetti sur la dignité de l’homme auquel répondit Pogio Bracciolini, faisant du thème de la dignité humaine un thème obligatoire. De la même manière, Bovelles reprendra les intuitions de Ficin dans son Liber de sapiente de 1510.
L’ultime garde-fou contre le projet moderne, dont Rémi Brague semble sans cesse penser qu’il est intrinsèquement une démesure, est que jusqu’à la Renaissance, toutes les entreprises de maîtrise de la nature, fussent-elles magiques, alchimiques, ne sont pas tant l’œuvre de l’homme que de quelque chose en l’homme qui accomplit les opérations magiques. Certes Pic de la Mirandole peut expliquer comment l’on peut maîtriser par la magie le cours de la nature, mais ce n’est pas vraiment l’homme qui accomplit cela ; il faudrait plutôt dire qu’en l’homme quelque chose rend possible cela. « Cependant, tous ces changements, pour spectaculaires qu’ils soient, ne se replacent pas dans un programme de prise de contrôle de la nature par l’homme. L’instance qui les commande, voire les commandite, est en effet beaucoup moins l’homme que l’intellect agent, tel qu’il se communique à l’homme. De la sorte, le véritable seigneur de la nature n’est pas l’homme, mais l’intellect auquel il participe et qui lui transmet les ordres de Dieu, ou les formes selon lesquelles Celui-ci crée les choses. »14
Cet argument est intéressant mais il ne nous semble pas décisif pour la raison suivante : lorsque le projet moderne soumettra la nature et le divin à la raison (pensons à la religion dans les limites de la simple raison de Kant par exemple ou encore à la religion prise dans l’esprit absolu de Hegel), de quelle raison s’agira-t-il ? Non seulement il ne s’agira pas d’une raison individuelle mais bien plutôt universelle, mais de surcroît, au moins dans le cadre pratique il ne s’agira pas d’une raison spécifiquement humaine ; la raison pratique chez Kant et Fichte est celle de tous les « êtres raisonnables » en général que Kant refuse explicitement de limiter aux seuls humains. A cet égard, il est possible de considérer que la raison pratique au cœur du projet moderne où l’homme se fait auto-législateur ne s’accomplit nullement par une prérogative spécifiquement humaine. En d’autres termes, que le projet moderne conteste la légitimité du cosmos et de Dieu n’implique absolument pas qu’il ouvre sur les prérogatives exclusives de l’humanité seule : on peut penser comme Kant une rationalité pratique excédant les bornes de l’humanité, une cosmologie des êtres raisonnables dont l’homme ne serait qu’un échantillon. Par conséquent, il ne nous semble pas probant que l’intellect agent soit réellement davantage extra-humain que ne l’est la raison pratique chez Kant, et nous en concluons que la convocation de l’intellect agent ne permet pas de discriminer entre projet moderne et tâche pré-moderne.
La rupture entre pré-modernité et modernité est donc loin d’être nette ; ce serait toutefois faire preuve de malhonnêteté que de prêter à Rémi Brague l’idée d’une rupture soudaine et décisive. « Le Moyen Âge occidental a représenté pour les Temps modernes une période qui n’est pas seulement de latence, mais tout aussi décidément de préparation et de mûrissement, en apportant des innovations dans les techniques dans les représentations. »15 Les avancées techniques ont précédé la prise de conscience de leur nouveauté. Le problème n’est donc pas tant celui des préfigurations que celui du critère permettant d’affirmer que la modernité a pris conscience d’elle-même : le paradoxe que ne nous semble pas relever l’auteur est que l’affranchissement à l’égard du cosmos et du divin dont découle une certaine autonomie ne peut pas être conçu comme un pur synonyme de l’exclusivité humaine. L’homme de la morale kantienne ne se réfère ni à Dieu ni à l’ordre du monde pour se représenter la loi morale, mais la raison qui la lui représente n’est pas sa raison : elle est la raison de tous les êtres raisonnables ce qui permet d’apparenter l’homme à un ensemble d’êtres raisonnables à échelle cosmique, dont on pourrait d’ailleurs se demander jusqu’à quel point ces êtres-là ne forment pas un certain « contexte » au sens de Rémi Brague.
C’est pourquoi, nous ne sommes pas sûr de partager cette affirmation : « Avec l’effacement de ses rivaux les plus directs, l’homme se voit pour ainsi dire contraint d’occuper la première place dans l’échelle des créatures. »16 Rémi Brague étudie ici des représentations du monde et, à cet égard, pour qui lit Galilée, Kepler, Fontenelle et donc Kant, qui n’ont pas contribué pour peu à l’émergence de cette représentation moderne du monde, il est plus que délicat de considérer qu’à leurs yeux l’homme occupe le premier rang dansl’échelle des créatures. Rémi Brague le sait évidemment fort bien et il qualifiera d’ailleurs un peu plus bas les Lumières de mouvement misanthrope ; ce n’est donc pas tant une objection que nous lui apportons qu’une manière de nuancer avec l’auteur lui-même l’affirmation de la page 91. Citons là encore Kant pour étayer notre propos, notamment dans sa trop peu lue Théorie du ciel :
« Si l’on recherche la cause des obstacles qui maintiennent la nature humaine dans un si profond abaissement, on la trouvera dans la grossièreté de la matière en laquelle sa partie spirituelle est plongée, dans l’absence de souplesse des fibres, dans l’inertie et le manque de mobilité des humeurs qui doivent obéir à ses stimulations. Les nerfs et liquides de son cerveau lui livrent seulement des concepts grossiers et indistincts, et parce qu’il ne peut opposer, à l’intérieur de son pouvoir de penser, pour équilibrer l’attrait des impressions sensibles, des représentations suffisamment fortes, il est entraîné par ses passions, il est étourdi et troublé par le tumulte des éléments qui entretiennent sa machine. »17
Ou encore :
« Il est donc clair d’après cela, que les facultés de l’âme humaine sont limitées et entravées par les obstacles d’une matière grossière, à laquelle elles sont intimement liées ; mais il y a encore plus remarquable, c’est que cette disposition spécifique de la matière a une relation essentielle au degré du rayonnement avec lequel le Soleil, à la mesure de sa distance, l’anime, et la rend apte aux fonctions de l’économie animale. Cette relation nécessaire au feu qui se répand depuis le centre du système du monde, pour maintenir la matière dans l’état d’activité nécessaire, est le fondement d’une analogie qui suit de là, entre les divers habitants des planètes ; et chaque classe d’entre eux est liée, en raison de ce rapport, par nécessité de nature, au lieu qui lui a été assigné dans l’Univers. »18
D : La valeur des choses
Malgré cette réserve, il faut savoir gré à Rémi Brague de braquer le projecteur sur l’évolution du sens des mots, notamment sur celui de l’homme qui a littéralement changé de valeur. L’idée de dignité elle-même se déplace : elle ne désigne plus l’homme comme objet de savoir mais la science même qui porte sur lui ; la science de l’homme comme telle devient digne. Le sens de l’adjectif « humain » évolue : de péjoratif qu’il était dans l’Antiquité, il devient positif. Il passe même du descriptif au normatif : il désigne ce qu’il faut être. Bakounine parlera même d’ « humanisation ». Cf. Voltaire, Beccaria, Pietro Verri et « inhumain » devient synonyme de tous les vices. Les Lumières veulent donc réhabiliter la nature humaine, Rémi Brague convoquant assez curieusement Rousseau pour illustrer sa thèse selon laquelle les Lumières veulent en finir avec le péché originel. Certes, mais Rousseau est-il vraiment emblématique des Lumières ? N’appartient-il pas à ce courant tout à fait opposé aux Lumières pour lequel rien ne mérite plus de méfiance que la raison dont les Lumières ne cessent de produire l’éloge ? Ce n’est là encore une fois qu’une interrogation.
Mais en même temps, s’il n’y a plus de péché originel ou si en tout cas sa vertu explicative est neutralisée, alors demeure justement la question de l’origine du mal : d’où vient ce dernier ? Et si l’homme est rendu autonome, ne doit-il pas paradoxalement endosser la totalité du mal au moment exact où disparaît le péché originel ? « En revendiquant la bonté de l’homme, en même temps qu’elle en affirmait l’indépendance par rapport à toute instance supérieure, la pensée moderne le rendait responsable de tout, y compris du mal. »19
Il y a là des éléments passionnants qui, dans le détail – et il va de soi qu’une grande fresque ne peut matériellement se le permettre – mériteraient d’être creusés. On peut par exemple songer à la question complexe du jansénisme qui, aux yeux de beaucoup de commentateurs, Jean Lafond en tête20 ainsi que Philippe Sellier21 constitue le lieu d’accomplissement de la modernité dessinant un monde spécifiquement humain, autonome, étudiable pour lui-même indépendamment de Dieu – les maximes de la Rochefoucauld en étant l’illustration la plus parfaite – alors même que le péché originel demeure plus présent que jamais. Paul Bénichou synthétise d’ailleurs la modernité du Jansénisme en ces termes : « L’hérésie sociale du jansénisme a consisté surtout dans l’affirmation d’une certaine indépendance de la conscience, que Port-Royal liait indissolublement à la rigueur morale. »22 L’affirmation de la modernité, c’est-à-dire de la conscience morale autonome, était du même geste reliée à la « rigueur morale » augustinienne et au péché originel. En d’autres termes, s’il est vrai que les Lumières ont globalement voulu en finir avec le péché originel, il n’en demeure pas moins que les courants les plus « modernes » à leur corps défendant étaient pénétrés du péché originel et l’exaltaient avec l’onction augustinienne. Là se trouve quelque chose à penser et qui introduit une complexité dans la fresque générale de Rémi Brague.
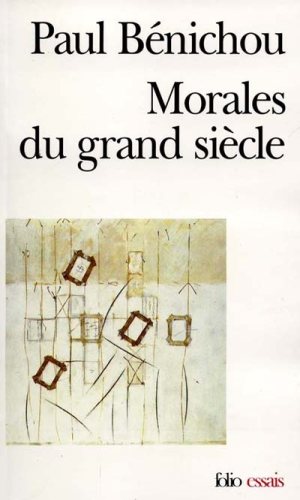
Tout cela tourne au fond autour de la notion de « valeur » dont Rémi Brague montre admirablement comment elle innerve la modernité. Valeur des mots, valeur des actes, valeur de l’individu, valeur de l’humanité. Or, la valeur ou l’évaluation est toujours liée à une estimation qui contient une part structurellement subjective ; Montaigne l’assume (Essais, I, 14) et Descartes va plus loin en établissant le rôle de la raison pour établir la juste valeur du bien et du mal. Cf. Lettre à Elisabeth, 1er septembre 1645. De là cette très belle analyse de Brague sur le changement de sens du bien : « Le bien ne vaut plus directement comme bien, mais, justement, comme ce qui vaut : il ne tire plus sa bonté de soi-même, mais de la valeur qui lui est assignée. »23 La modernité est ainsi capable d’évaluer ce qui, jadis, s’imposait, et de discriminer entre ce qui est valeureux et ce qui ne l’est pas. Tel est le sens de la volonté bonne chez Kant qui évalue la maxime : mais une fois encore, la volonté bonne n’évalue que selon la raison pratique qui ne saurait être conçue comme spécifiquement humaine, ce qui relativise la portée de la thèse de Brague. Avec le travail, la valorisation s’accroît et devient quantitative. Chez Kant, ce sera la volonté bonne qui donnera sa valeur au monde.
E : Evolutions et mutations de la Modernité
L’ultime mérite de l’ouvrage de Rémi Brague est de faire sentir à quel point la modernité n’est pas un bloc monolithique. S’il lui assigne des fondements globalement stables, il en révèle également la part mouvante, instable, perpétuellement changeante.
La vérité, par exemple, préoccupation centrale du XVIIème et du XVIIIème devient de moins en moins importante du point de vue pragmatique ; la technique de gestion se substitue à l’exigence du vrai. Mais derrière cette évolution, un invariant demeure : « La maîtrise reste le critère ultime, même si elle se présente sous la forme édulcorée de la maîtrise de soi du groupe humain qui, rejetant toute influence extérieure, n’obéit qu’à ses propres exigences. »24 De la même manière, le rapport à la nature évolue : « Le mouvement industriel est en phase avec une dévalorisation théorique de la nature, d’abord sous l’aspect purement technique. »25
Mais le changement le plus spectaculaire porte sur l’humanisme : l’affranchissement initial de l’homme laisse progressivement la place à une méfiance accrue envers ce dernier. D’autonome et sublime, il devient perturbateur et danger. D’Holbach imagine déjà la fin de l’humanité tandis que Flaubert on caresse le rêve d’une nature libérée de l’homme, sans homme. Ainsi, à côté de la dignité de l’homme existe une tradition de dévalorisation de ce dernier. « L’idée de dignité de l’homme se fondait sur une anthropologie théologique ou philosophique. Une fois l’anthropologie réduite à une science naturelle, cette idée doit subir une mutation. »26 Réduit à un être biologique pris dans un réseau physique et biologique, il devient une menace pour la survie des espèces et se voit régulièrement traîné sur le banc des accusés. Mais cette ambivalence du projet moderne est en fait inscrite dès le début ou, à tout le moins, dès les Lumières : « Les Lumières passent pour avoir été humanistes. En fait, les auteurs qui les représentent expriment souvent envers l’homme une défiance qui frise la misanthropie. »27 On comprend mieux dans ce cas les textes de Kant cités précédemment mais on a alors plus de mal à comprendre ce que Brague entendait par « la première place dans l’ordre des créatures » lorsqu’il cherchait à cerner la structure du projet moderne.
Cette mutation et cette instabilité du projet moderne se reporte aussi sur l’homme ; ce dernier est jugé capable de changer infiniment, de sorte que l’homme soit comme aspiré par le rythme fou de la modernité à laquelle il a donné naissance. « L’homme est dominé par la domination elle-même. Le projet d’un règne de l’homme aboutit à une dépossession de l’homme, au nom même du règne à réaliser. »28 Dominé comme la nature, il devient un objet passif d’expérience, réduit à son statut de pur être biologique expérimentable. Il y a là une ambivalence extraordinaire du projet moderne puisque le même homme qui était érigé en dominateur législateur devient en même temps l’objet de la domination et de l’expérimentation. C’est là un immense mérite de Brague que de montrer à quel point le plus grand affranchissement de l’homme peut s’accompagner de sa plus grande infériorisation et de sa plus totale soumission à la manipulation de l’étant pour parler comme Heidegger. Ce paradoxe constitutif de la modernité est ici remarquablement restitué et mis en scène.
A ce titre, l’anti-humanisme contemporain n’est pas interprété par Brague comme l’inversion du projet moderne mais bien au contraire comme son accomplissement ou, plus exactement comme l’accomplissement d’un de ses versants. Rémi Brague conclut sur cette ambivalence du projet moderne d’une formule lumineuse : « le projet moderne est parfaitement à même de produire les biens, matériels, culturels et moraux, qu’il se fait fort de donner à l’homme ; il n’a besoin pour cela de rien d’autre que des ressources qu’il trouve en lui. En revanche, il paraît incapable d’expliquer en quoi c’est un bien qu’il y ait des hommes pour jouir des biens ainsi mis à leur disposition. »29
Conclusion
Ce livre constitue une fresque remarquable de la modernité, structurée par l’érudition toujours impressionnante de l’auteur, et par la clarté de formules qui font souvent mouche. Accessible à un large public quoique richement documenté, l’ouvrage procure des clés d’intelligibilité de la modernité, et inscrit cette dernière dans un mouvement historique plus large permettant de la comparer à l’Antiquité et aux mondes judéo-chrétiens.
On peut regretter çà et là que le format choisi, celui de la fresque généraliste, rende impossible l’examen précis de certaines parties – le rôle du jansénisme – ou n’empêche de rendre justice à la subtilité de certaines thèses abordées faute de place – le comme du « comme maître et possesseur de la nature » de Descartes – mais on ne peut contester la grande maîtrise – sans mauvais jeu de mots – avec laquelle l’auteur restitue ces quatre siècles mouvants et qui définissent encore notre propre situation.
Par cette approche généraliste s’affirme une thèse que la conclusion expose clairement. Contre cet homme de la Modernité privé de contexte, contre ce refus du péché originel inhérent à la modernité, Rémi Brague émet des réserves et s’appuie sur la réduction contemporaine de l’homme à un étant biologique susceptible d’expérimentations, ce qu’il déplore, pour incriminer le projet moderne en sa racine même. « Notre humanisme, écrit Rémi Brague, est un anti-antihumanisme plutôt qu’une affirmation directe de la bonté de l’humain. »30 En d’autres termes, une telle situation – celle de la perte de l’éminente dignité de l’homme – semble inéluctable lorsque celui-ci s’affranchit de tout « contexte » et se croit capable de s’auto-affirmer sans se référer à une quelconque transcendance. D’où cette formule saisissante : « La question n’est pas de savoir si l’homme peut savoir par lui-même comment il devrait bien vivre. Elle est plutôt de savoir s’il peut vouloir survivre sans une instance extérieure pour l’affirmer. »31 Telle est ce que nous pourrions appeler la thèse explicite du livre.
Mais il est une autre thèse, bien plus implicite, qui se confond avec la méthode et qui nous semble tout à fait discutable. Rémi Brague semble en effet considérer que les œuvres philosophiques convoquées disent quelque chose de l’époque à laquelle elles appartiennent. Mais, et c’est là pour nous un regret, il ne nous semble pas que l’auteur nous dise ce que disent les œuvres : sont-elles ce qui rend intelligible une époque, auquel cas elles en seraient les causes en tant qu’elles informeraient celle-ci ? Sont-elles des symptômes auquel cas elles ne permettraient pas tant de comprendre comment on en est arrivé à telle ou telle situation qu’elles ne seraient des reflets idéologiques ? La thèse implicite que nous semble adopter Rémi Brague est celle de la cause, les idées semblant donc déterminer l’être effectif.
Nous ne sommes pas sûrs qu’une telle approche méthodologique soit indiscutable. Ce présupposé heideggérien que l’on retrouve par exemple chez Alain Finkielkraut, nous semble hautement discutable pour deux raisons : d’une part, il n’est pas certain que les écrits philosophiques aient une efficace sur l’effectivité d’une époque ; d’autre part, à supposer que la philosophie informe une époque donnée, qui serait réellement concerné par son impact, et à quelle distance temporelle les individus seraient réellement transformés par cette force philosophique ? Lorsque Rémi Brague convoque l’explication par l’intellect agent pour rendre compte de la maîtrise médiévale de la nature, cela ne peut concerner qu’un nombre extrêmement restreint d’individus. Mais dans ce cas, il est strictement impossible d’étendre à l’époque tout entière le gain d’intelligibilité.
Cette ambiguïté méthodologique rejaillit ainsi sur l’objet du livre : ce dernier parle-t-il de l’homme moderne en général ou de l’homme philosophant et réfléchissant l’homme de la modernité ? Cet ouvrage restitue-t-il des représentations étendues du monde ou des représentations très localisées dans une sphère intellectuelle donnée ? Ce n’est pas là un reproche adressé à l’ouvrage – l’économie de ce dernier rend impossible l’ajout d’une réflexion sur le rapport entre ordre du monde et pensée philosophique – mais une question que le lecteur est amené à se poser après avoir lu l’ouvrage et qui va stimuler sa réflexion propre. Il y a en effet des visions du monde à chaque époque, et nul ne saurait le contester ; mais qu’est-ce qui informe de telles visions du monde ? Et surtout quel rôle la philosophie joue-t-elle dans cette vision du monde ? En est-elle la racine ou l’illustration ? Rémi Brague note par exemple que « Le mouvement d’ensemble de la modernité constitue un passage de la magie à la technique, qui prend le relais de la magie déconsidérée. Parmi les scolastiques, Albert le Grand et Roger Bacon s’intéressent aux techniques. »32. Soit. Mais alors ? Que dit réellement le fait qu’Albert le Grand et Roger bacon s’intéressent aux techniques ? Cela peut-il réellement changer le rapport effectif de l’homme au monde ? N’est-ce là qu’une discussion entre philosophes ? Ou est-ce l’illustration intellectuelle d’un changement effectif qui a déjà eu lieu dans la vie pratique de l’homme médiéval ? Autant de questions vertigineuses quant au sens même de l’histoire que ce beau livre de Rémi Brague nous invite à soulever et nous donne comme programme implicite de penser : que demander de plus à un ouvrage d’histoire de la philosophie ?
- Rémi Brague, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris, LGF, 2002
- Rémi Brague, La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Paris, Gallimard, coll. folio-essais, 2008
- Rémi Brague, Le règne de l’homme, op. cit., p. 7
- Rémi Brague, Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, Paris, PUF, coll. Epiméthée, 1988, réed. Cerf
- Rémi Brague, Le règne de l’homme, op. cit., p. 14
- Ibid.
- Ibid., p. 35
- Ibid., p. 37-38
- Ibid., p. 52
- Ibid., p. 53
- Ibid., p. 91
- Ibid., p. 93
- Ibid., p. 67
- Ibid., p. 75
- Ibid., p. 85
- Ibid., p. 91
- Emmanuel Kant, Théorie du ciel, AK I, 356 ; Œuvres Philosophiques I, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, p. 102
- Ibid., AK I, 357-358, OP I, p. 103-104
- Ibid., p. 118
- cf. Jean Lafond, La Rochefoucauld. Augustinisme et Littérature, Paris, Klincksieck, 1977
- « Saint Augustin, Pascal, La Rochefoucauld » in RHLF, mai-août 1969, p. 551-575
- Paul Bénichou, Morales du Grand Siècle, Paris, Gallimard, coll. folio-essais, p. 153
- Ibid., p. 130
- Ibid., p. 145
- Ibid., p. 147
- Ibid., p. 192
- Ibid., p. 195
- Ibid., p. 231
- Ibid., p. 267
- Ibid., p. 267
- Ibid., p. 270
- Ibid., p. 77








