On saluera le geste audacieux de Renaud Barbaras qui, dans ce remarquable essai publié chez Vrin1, nous conduit à l’accomplissement de la déréification du sujet – celle au bout de laquelle les phénoménologues n’étaient pas allés.
Renaud Barbaras établit le sujet comme un mouvement (un désir) et le monde auquel il appartient comme une réalité processuelle : notre mouvement procède de l’archi-mouvement du monde ; la phénoménologie dynamique renvoie à une dynamique phénoménologique qui est synonyme d’une cosmologie pour notre auteur. Dès lors, la différence du sujet, sans laquelle il n’y a pas de corrélation, ne peut que correspondre à une scission, plus originaire encore, qui affecte le procès même de la manifestation sans néanmoins en procéder. Cette scission au cœur de l’archi-mouvement doit être comprise comme un archi-événement : celui-ci fait l’objet d’une métaphysique en un sens très singulier, qui recueille l’ultime condition de possibilité de la phénoménologie elle-même.
C’est là le trait de génie de cet essai qui ose un geste radicalement novateur en philosophie. La phénoménologie est pour ainsi dire plus qu’elle-même, est en excès sur elle-même sans jamais devenir autre. Ainsi faire de la phénoménologie c’est toujours faire plus que de la phénoménologie. La tâche de la phénoménologie est d’élaborer l’a priori universel de la corrélation. Or cette tâche, Renaud Barbaras nous montre qu’elle ne va pas de soi car, dans la mesure où le sens d’être des termes est tributaire de la relation, penser la corrélation ne saurait consister à interroger pour lui-même ce sens d’être afin de s’interroger ensuite sur le mode de rapport entre les termes.
Tel est bien l’écueil permanent que rencontre la phénoménologie : présupposer le sens d’être des termes en relation, partir d’une idée préconçue du sujet et de la réalité au lieu de ressaisir ce sens d’être à partir de la relation. Penser la relation ne signifie pas partir des termes en relation pour interroger ensuite leur mode de rapport possible mais, tout au contraire, penser selon la relation, c’est-à-dire définir les termes à partir de leur relation même. Or la difficulté tient au fait que s’il n’est pas question de partir des pôles transcendant et subjectif, tout au moins d’un sens prédéterminé de ces pôles, il n’est pas non plus possible de s’installer dans la relation comme telle sans courir le risque de l’hypostasier et de la détruire comme relation, c’est-à-dire comme rapport entre des termes. Cette relation n’est finalement rien d’autre que le lieu même de la phénoménalité ou de l’apparaître comme tel, l’élément où le sujet et le monde se rapportent l’un à l’autre et dont, en vérité, ils naissent comme monde (pour un sujet) et comme sujet (pour un monde). C’est pourquoi Renaud Barabaras ressaisit le sens d’être de chacun des pôles à la lumière de l’a priori corrélationnel, autrement dit dans un régime d’épochè phénoménologique radicale neutralisant tout présupposé concernant ces termes. C’est pourquoi une telle demarche conduit notre auteur à redéfinir la réalité et le sujet : « Aborder chacun de ces termes selon la relation reviendra à découvrir que chacun d’eux est comme défait ou dessaisi de lui-même par la relation dans laquelle il s’inscrit, comme s’il ne pouvait être lui-même qu’en passant en elle, ou plutôt en son autre, en perdant donc son identité stable au profit d’un mode d’être essentiellement dynamique. » (p. 17) Or Renaud Barbaras nous montre que c’est parce que son mode d’être est celui du mouvement que le sujet pourra être traversé en son être par la corrélation et exister pour ainsi dire en elle.
Toutefois, tant que l’on s’en tient à la polarité des apparitions et de l’apparaissant, du sujet et du monde, la corrélation ne peut pas signifier beaucoup plus qu’une relation transcendantale, grâce à laquelle le sens d’être de la réalité se trouve constitué dans l’élément d’une conscience. En dépit des affirmations des Ideen I de Husserl, Renaud Barbaras va montrer que la conscience constituante est également tributaire en son être de cela qu’elle constitue. Il n’en reste pas moins que les deux relativités ne sont en aucun cas équivalentes et qu’une profonde dissymétrie s’installe entre la conscience et la réalité : leur relation demeure relation de l’absolu au relatif. Le sujet est relatif au monde non seulement parce qu’il le vise mais aussi parce qu’il en est, ou plutôt parce que, pour le viser, il doit en être. Alors que la prise en considération de la première relativité, c’est-à-dire du premier versant de la corrélation (celui qui rapporte l’apparaissant au sujet) nous situait dans les parages d’une philosophie transcendantale, la prise en compte de l’autre versant de la correlation nous conduit dans une direction opposée, direction qui nous permet de donner une consistance à la relation comme telle. Nous découvrons, en effet, grâce à la reconnaissance d’une appartenance constitutive du sujet à la réalité, appartenance qui n’est pas contingente mais inhérente à la vie du sujet, que la relation comme telle renvoie bien à une « réalité », certes singulière puisqu’elle se distingue de celle qui se manifeste à la conscience ou est constituée par elle.
Cette quête du sol conduit Renaud Barbaras à défaire la figure de la substantialité plus profondément que la phénoménologie qui a affronté ces questions ne l’a fait. Ce sol ou cet être n’est en effet pas un socle ou un être autonome et consistant, dont surgirait la relation, mais un être ou un sol pour la relation et qui existe comme relation : un être d’une nature telle qu’il soit capable d’ouvrir la relation, de la porter comme telle, d’être « affecté par cette déhiscence fondamentale ». Or l’être de la relation, qui rapporte l’un à l’autre le sujet et l’apparaissant pour les faire exister, ne peut être cherché ailleurs que sur le versant d’une nature. Et cette nature est ce qui déborde la conscience, nous dit Renaud Barbaras, non seulement comme le monde dans lequel elle s’inscrit mais, plus encore, comme la puissance dont elle procède. Cette nature va défaire le cadre transcendantal. Or seule une conception dynamique de la nature permet de penser ensemble la communauté d’être et l’écart, la co-dépendance et la différence du sujet et du monde, sous la forme d’une puissance de production et, partant, de différenciation. Mais si Renaud Barbaras ne veut pas faire prévaloir la distance intentionnelle, s’il veut affronter la question de l’être de la corrélation, il doit justement passer au plan d’un tissu ou d’un fond commun, d’une parenté ontologique entre le sujet et le monde et c’est la raison pour laquelle, selon notre auteur, “la différence ne peut que relever d’un devenir et, en ce sens, être dérivée”. La difficulté se concentre dans l’idée que la distance intentionnelle soit engendrée, que son avènement soit une production. En d’autres termes nous passons ici immédiatement par-dessus la corrélation en posant un fond de nature étranger à la lumière, à l’apparaître.
Dire que le sens d’être de l’étant enveloppe sa relativité à des apparitions, c’est-à-dire implique son apparaître, c’est souligner que jamais l’être ne pourrait se présenter à un sujet s’il n’était pas déjà du côté de l’apparaître. Or en partant d’une nature obscure et indifférente, la perspective que Renaud Barbaras constate se situe d’emblée en-deçà de l’apparaître et c’est pourquoi celui-ci ne peut être qu’engendré ou suscité. Mais en raison de cette distance de la nature, de son indifférence à la phénoménalité, son accès à l’apparaître ne peut signifier quelque chose qui lui arrive en propre : si elle pouvait être phénoménale par elle-même elle le serait d’emblée et depuis toujours. Cet accès est médiatisé par l’avènement d’un étant singulier, l’homme, qui porte tout entier la charge de l’apparaître : c’est seulement par lui qu’elle produit, et jamais par elle-même que la nature paraît. Mais quel sens peuvent avoir ce mouvement et ce telos pour une nature qui est en son fond étrangère à la phénoménalité ? Renaud Barbaras critique l’idéalisme d’une démarche qui part d’un monde coupé de son apparaître, où « l’indice de subjectivité viendra nécessairement étouffer la dimension de transcendance ». L’apparaître se voit scindé de ce qui en lui apparaît, excessivement subjectivé après avoir été radicalement naturalisé. Cette approche ne peut que faire reposer le surgissement de l’apparaître sur une humanité que produit la nature et elle aboutit ainsi, sous la figure de ce sujet et de ses phénomènes, à un apparaître qui est coupé de son monde.
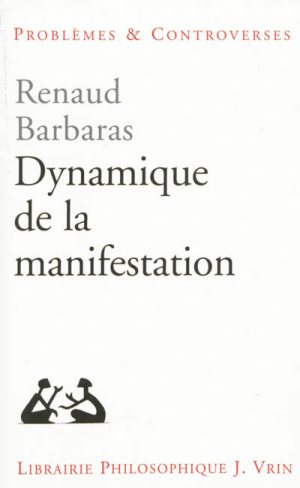
Or ce que Renaud Barbaras va montrer c’est qu’une telle perspective fait se succéder le plan ontologique et le plan transcendantal, le plan de l’être de la relation et celui de la distance qui l’affecte comme relation : elle ne permet pas d’en penser l’unité véritable. Le devenir est l’autre nom de cette succession, ou plutôt est conféré à cette succession, qui n’est en vérité qu’un jeu abstrait de compensations, le visage du devenir. Mais le devenir conçu comme une nature habitée par le telos d’une auto-manifestation, est-il vraiment un devenir ? On peut en effet se demander si le devenir où la fin du procès est déjà un commencement, où rien d’absolument nouveau, de vraiment inattendu ne peut finalement surgir, est un vrai devenir. Renaud Barbaras va montrer qu’un devenir où tout événement est absent, n’en est pas réellement un. Il pose alors la question en des termes identiques au sujet de la nature : une nature qui n’est rien d’autre que la puissance et le procès de son auto-manifestation n’est pas vraiment une nature. La critique de la perspective téléologique et dialectique menée par Renaud Barbaras se fonde sur le fait que celle-ci continue de subordonner la tension transcendantale à l’identité, cette fois sous la figure de la puissance productrice, c’est-à-dire d’une identité devenue. Autrement dit, le sujet est le même que le monde et le monde est le même que le sujet, mais moyennant le devenir. C’est lui, par le procès qui est censé préserver la distance de la correlation. Toutefois, Renaud Barbaras nous montre qu’il s’agit là d’un faux procès car il est voué à se clore et s’achever et, par là même, à basculer dans l’identité : celle d’une conscience qui se retrouve dans son monde ou d’une nature qui a rejoint son être-connu. Ainsi, le recours à une nature n’a de sens qu’à la stricte condition de refuser toute forme de téléologie, c’est-à-dire de préserver la dimension sauvage, étrangère à l’homme et au sens, sans laquelle il n’y a pas de nature. Il faut chercher l’être de la corrélation du côté du devenir pour Renaud Barbaras : il s’agit d’un devenir non dialectique, d’un devenir qui ne peut s’abolir lui-même dans une synthèse : un devenir où tout est possible, peut-être même l’impensable, où rien n’est joué et que des événements radicalement nouveaux peuvent donc affecter. Par suite, ce n’est pas du côté d’une téléologie que l’essence du devenir doit être recherchée. En ce sens, la phénoménologie est assurément une philosophie anti-dialectique. Ainsi, Renaud Barbaras pense un procès en lequel l’homme, à savoir la dimension proprement transcendantale de la corrélation, ne saurait être produit, sans quoi la différence qui est constitutive de la corrélation se trouverait téléologiquement dissoute dans l’identité. Renaud Barbaras montre que c’est dans la mesure où la nature est comprise comme étrangère à la phénoménalité, située en-deçà d’elle, que l’on est conduit à faire dépendre le surgissement de la phénoménalité de la production de l’homme. Ainsi la condition nécessaire, sinon suffisante, permettant de penser le procès de la nature autrement que comme production de l’homme, sera de situer l’apparaître au niveau même de cette nature, comme constitutive de son être même.
1°) Scission au sein de la surpuissance
Pour répondre à cette perspective de clôture, Renaud Barbaras développe une pensée de l’ouverture, une pensée de l’événement. Pour notre auteur, toutes nos considérations convergent vers une défaillance (scission) au sein de la surpuissance du monde : « une fracture au cœur de ce qui en constitue le sol d’appartenance ontologique. » (p. 254) Le sujet est ce qui appartient de part en part au monde, il est radicalement du monde et en diffère cependant tout aussi radicalement pour autant que la scission dont il procède n’a rien à voir avec une simple individuation au sein du monde, qu’elle affecte le procès mondain lui-même. Le sujet naît de cette scission. Mais cette scission n’est pas plus l’œuvre du monde qu’elle n’est celle du sujet. Or cette scission affecte en profondeur et de part en part l’archi-mouvement du monde comme si elle en provenait. Pour Renaud Barbaras, on a affaire à un devenir singulier qui affecte le mouvement et le divise pour ainsi dire en son sein mais ne peut être son œuvre, à une altération fondamentale qui est un pur surgissement. Cette altération qui affecte le mouvement mais n’est pas elle-même mouvement, qui en infléchit le cours sans avoir sa raison en lui ne peut être qu’un événement. Et l’archi-événement est précisément pour notre auteur cette scission qui sépare d’elle-même la puissance mondifiante, qui l’atteint en son cœur sans se préméditer en elle. L’événement est toujours un certain mouvement dans le mouvement. Dans la mesure où l’archi-mouvement du monde est tout le mouvement, ce qui vient la libérer ne peut être le mouvement proprement dit. L’événement affecte le mouvement, mais il est autre que lui et dans cette mesure il n’est pas à proprement parler un mouvement. Cela a lieu, c’est du mouvement mais cela veut dire aussi cela survient. On pourrait penser au clinamen (il infléchit de manière intime le mouvement des atomes) : en effet, le clinamen affecte le mouvement des atomes mais ne procède d’aucune façon de leur mouvement, et pourtant il ne renvoie à rien d’autre. Néanmoins les effets du clinamen sont aussi puissants qu’il est infime.
Un événement est un pur surgissement : quelque chose qui est sans cause ni raison. Ainsi, la caractéristique première de l’événement est d’échapper au principe de raison suffisante : « La puissance mondifiante se brise en son cœur alors que tout en elle en exclut la possibilité. » (p. 256). Il s’ensuit que l’événement est caractérisé par une négativité fondamentale : non seulement il ne surgit de rien mais il n’est rien. Et c’est dans la mesure exacte où il est pur surgissement qu’il n’est rien. Il n’y a d’authentique négativité que comme événement : « en tant que scission affectant l’être tel que nous l’entendons, à savoir le procès mondifiant, l’événement est un pur non-être. » La négativité concrète correspond au mouvement. La substantialité peut être conféré au devenir lui-même, comme la seule réalité substantielle. Cette première négativité ne s’oppose pas tant à la substance qu’à une certaine modalité de celle-ci : chose ou essence. De cette première négativité, il faut distinguer celle de l’archi-événement, qui est, quant à elle, pure négativité. En tant que brisure, elle n’a aucune positivité, pas même celle que posséderait un pur néant distingué de l’être. « Cet événement de la séparation, s’épuisant dans son œuvre séparatrice, n’a pas d’autre réalité que celle de cela qu’il sépare, dit Renaud Barbaras. » Autrement dit, il n’a même pas la consistance d’une distance ou d’un écart, de quelque chose comme une poche de négatif à laquelle on pourrait conférer un statut. C’est un creux ou un pli qui n’a pas la substantialité d’un trou – contrairement à ce que Sartre pensait. Il n’est rien d’autre que ce qu’il creuse ou ce qu’il plie. L’événement n’est pas cette négation en acte qu’est le mouvement. Le négatif pur est l’événement ; mais ce n’est pas un pur néant. Il n’est pas le néant parce qu’il fait. Il est advenir dans le devenir. Par l’événement quelque chose arrive au monde mais ce qui arrive au monde est aussi étranger à son essence et ses possibilités, aussi indéterminé en ce sens que l’événement est en lui-même dépourvu de positivité. C’est le statut même de l’archi-événement pour Renaud Barbaras. Or l’apparaître proprement dit et le sujet qui lui correspond, pour autant qu’ils renvoient à cet archi-événement, sont sans raison, « le sans raison par excellence, dit notre auteur, et non pas la source ou le lieu de toute raison. » Et l’archi-événement est aussi unique et éternel que l’est la puissance mondifiante. La subjectivation est nécessairement coprésente à l’archi-mouvement, même si elle ne lui est pas co-substantielle puisqu’elle n’en est d’aucune manière constitutive. Or, dans un remarquable chapitre consacré à la finitude, Renaud Barbaras établit la moralité comme le fait même de l’archi-événement et la mort comme le triomphe de l’archi-vie : « S’il est vrai que l’archi-événement ne peut être que celui de la mortalité, force est de conclure que ce n’est pas la mortalité qui est une propriété du vivant mais le vivant qui est le produit de la mortalité. » (p. 267). Nous sommes des sujets vivants pour Renaud Barbaras parce que nous sommes mortels, parce que l’archi-vie se trouve frappée de faiblesse et comme séparée d’elle-même par l’archi-événement.
Notre identité de sujets vivants est ainsi prise ou inscrite dans une mortalité qui n’est pas d’abord la nôtre, mortalité impersonnelle qui coïncide avec la surrection anonyme de l’archi-événement et qui ne devient véritablement nôtre que lorsqu’elle se fait mort, s’accomplit et se nie à la fois dans la mort, « reprise de l’archi-événement par la puissance de la vie, guérison de la blessure », dit Renaud Barbaras. C’est pourquoi l’avènement de l’archi-événement doit être compris comme finitude. Sa signification n’est pas anthropologique mais métaphysique.
2°) Échapper au subjectivisme
La mise au jour d’un procès anonyme de manifestation est la seule manière d’échapper au subjectivisme et à l’idéalisme sans tomber dans le réalisme. En s’interdisant de rabattre le paraître sur sa dimension subjective, Renaud Barbaras rend compte de la différence de l’apparaître subjectif au sein de l’apparaître primaire ou anonyme. S’il correspond bien à quelque chose qui arrive aux étants du monde, l’apparaître subjectif n’est pas l’œuvre du monde : il suppose l’intervention d’un nouveau type d’étant. Alors que l’apparaître primaire est ce qui arrive à l’apparaissant en raison de sa relation avec le monde, l’apparaître subjectif désigne ce qui arrive à ce même apparaissant en raison de sa relation avec un certain étant du monde. La première relation est la production ; la seconde est de phénoménalisation. La question de l’apparaître subjectif renvoie à celle du mode d’être de l’étant qui donne naissance à cet apparaître. Cette question conduit Renaud Barbaras à sa condition d’existence. La démarche progressive qui consiste à rendre compte de la différence subjective à partir du monde, à remonter du monde vers cet étant qui se distingue de tous les autres, peut donner lieu à nouveau à une démarche régressive : découverte du retentissement du mode d’être du sujet, en sa différence, sur le monde. R. Barbaras met au jour la puissance phénoménalisante du sujet. Alors que le mouvement mondifiant fait être des étants, le mouvement subjectif, ou plutôt ce sujet qu’est le mouvement ne fait rien être mais se contente d’être ce qu’il est, c’est-à-dire de se mouvoir. Il est comme la rose d’Angelus Silesius : il fleurit parce qu’il fleurit. Le sujet qu’est le mouvement ne se dépasse hors de lui-même mais il est plutôt sa propre réalisation, son propre accomplissement. Mais cela ne signifie pas qu’il sera sans effet sur le tissu du monde, précise Renaud Barbaras. Le sujet est donc cet étant qui procède d’une forme de détachement ou de dérive au sein du procès du monde. Le sujet est plus éminemment mouvement que ne l’est le monde car il est seulement mouvement, car son œuvre consiste dans sa propre effectuation. Seul le sujet se meut, car le monde ne se meut pas puisqu’il se fait être en faisant être les étants, c’est-à-dire en se multipliant en son sein. La subjectivité du mouvement subjectif n’a pas d’autre réalité que celle de ce mouvement même. Or ce mouvement est tout autre chose qu’un déplacement : il tend de lui-même vers sa source ontologique, s’accomplit comme aspiration.
En tant que mouvement, le sujet est pleinement immergé dans le monde, il lui appartient au même titre que tout autre mouvement. Pourtant, à cette condition d’appartenance s’adjoint une différence tout aussi radicale, qui tient justement au fait que le sujet n’est que son mouvement, c’est-à-dire séparé de sa source ; inscrit dans le monde, le sujet n’est pourtant pas du monde comme les autres étants car il n’est plus animé par la puissance du monde (il est privé de la surpuissance). Renaud Barbaras nous montre qu’avec le mouvement du sujet se creuse au sein du monde une sorte d’abîme, de faille ontologique dont la profondeur est mesurée par la puissance de l’archi-événement. Le sujet est cet étant qui est capable d’être à distance du monde au cœur du monde. En ce sens, le sujet n’est nulle part dans le monde, introuvable en lui, même si son mouvement implique une forme de localisation. Quand R. Barbaras dit qu’il échappe à la puissance mondifiante du monde au sein du monde, il affirme qu’il n’est que dans le monde sans y être situé, qu’il est caractérisé par une forme d’atopicité fondamentale. Or il voit dans cette atopicité la dimension de la subjectivité proprement dite.
Par suite, la réalité du psychisme est une non-réalité pour Renaud Barbaras : non pas au sens où il n’est absolument rien mais en tant que son être s’épuise dans cette négativité singulière qu’est le non-lieu, c’est-à-dire l’atopicité. La réalité du psychisme coïncide avec cette négation singulière qu’est le sans lieu de la séparation ontologique. C’est dans la mesure où le sujet est ontologiquement séparé du monde, c’est-à-dire dans la mesure où il est nulle part, qu’il est un psychisme (psychisme qui se confond donc avec l’atopicité). C’est pourquoi, Renaud Barbaras écrit à la page 307 que « le psychisme ne saurait avoir d’autre contenu que cette absence, ce qui revient à dire qu’il est situé au lieu même, qui est par essence un non-lieu, de l’archi-événement. La réalité du psychisme est celle d’un détachement – concept qu’il faut ressaisir en son indistinction entre le sens psychologique et le sens à la fois spatial et ontologique. » Or le mouvement subjectif ne constitue ni la différence ni l’appartenance comme telles ; il suppose au contraire la différence sous la forme de l’archi-événément et l’appartenance dès lors qu’il ne peut être que mouvement au sein du monde ; mais, dans ce cadre qui circonscrit sa mobilité propre, Renaud Barbaras nous dit qu’il constitue sa différence sous la forme du sujet qu’il ne cesse de faire advenir et son appartenance sous la forme du substrat qu’il ne cesse de constituer. Il convient alors de distinguer deux sens du corps : le corps comme incarnation : ce corps qui est chair, autre nom du mouvement – cela qui est à la fois corps et âme parce qu’il est mouvement vivant. Ce corps charnel ou moteur est ce qui n’advient que par archi-événement. Et il y a ce corps qui est déposé par le mouvement vivant au titre de son propre substrat au sein du monde, comme son véritable point d’appui dans ce monde, ce qui l’insère en lui. Ce corps constitué par le vivre est l’organisme. Or à la différence du mouvement subjectif, l’organisme fait pleinement partie du monde. Ainsi l’organisme rend possible la mort : déposé dans le monde par le mouvement subjectif, il est « voué à finir », dit Renaud Barbaras. Seul l’organisme meurt et la mortalité du sujet n’est, en ce sens, pas tant celle de son mouvement (de sa chair) que de son organisme.
3°) Le mouvement du vivre et du désir
Ce mouvement comme désir fait qu’il n’y a de corps que comme corps de désir. Ainsi le désir ne peut être conçu comme une propriété du corps parmi d’autres, une manière singulière de se rapporter aux autres. Si le mouvement subjectif est désir, et si le mouvement de ce désir est celui de la chair, Renaud Barbaras en conclut que le corps est le désir même ressaisi sous le versant de son appartenance et, tout autant, que le désir est le mode d’être propre du corps.
Nous demeurons dans le monde mais sommes séparés du monde lui-même. Notre mouvement est comme détaché de la surpuissance qui procède de la finitisation. On peut dire qu’au fond, ce régime d’individuation se situe plus près et plus loin du monde. Nous sommes plus loin du monde que les autres étants parce que nous en sommes détachés, nous en sommes détachés. Nous ne sommes pas individués par la puissance du monde, mais par ce qui limite la puissance. Nous en sommes plus près parce que, contrairement aux autres étants, nous sommes mouvement : notre différence est une différence de degrés. Alors que les choses sont en mouvement, nous sommes mouvement. Nous sommes plus près du monde : nous lui ressemblons plus. C’est parce que nous sommes près que nous sommes loin. Une puissance ne peut se limiter elle-même qu’en se séparant d’elle-même : nous sommes le résultat de cette séparation. Nous sommes à l’instar du monde, une puissance et pour cette raison, nous sommes face à lui comme microcosme. Il correspond à l’espace intérieur du monde chez le poète Rainer Maria Rilke : le plus intime est le plus extime. C’est par ce que nous avons de plus subjectif que nous nous transcendons ; nous différons du monde par ce qui nous différencie de lui. La raison de notre existence c’est donc notre unité ontologique pour Renaud Barbaras. La source de notre appartenance est la source de notre différence. Il suit de là que notre modalité d’individuation est différente des étants intramondains qui ne sont rien d’autre que des productions de la puissance du monde (ils sont déterminés ; ils sont détermination). Les étants intramondains sont déterminés parce que dépendants ; et pour cette raison jamais pleinement individués. Ainsi, pour Renaud Barbaras, « le désir vient disjoindre ce que l’archi-mouvement ne cesse de rassembler, à savoir le monde comme tel et les étants individués ; il libère la détermination de l’étant de la plénitude et de la puissance du monde en se portant à la hauteur de cette plénitude, en la saisissant selon son être, à savoir dans sa distance irréductible, distance à la faveur de laquelle l’étant peut s’approcher, c’est-à-dire paraître. Cette scission au sein du monde entre le monde et les individus qui le peuplent, scission qui est indistinctement éloignement du monde et approche de l’étant, est pour ainsi dire l’écho ou l’effet au sein du monde de la scission archi-événementiale dont procède le désir. » (p. 323).
En effet, la survenue de l’archi-événement est scission du procès mondifiant, c’est-à-dire séparation vis-à-vis de lui-même, chute hors de lui-même. Cette scission creuse certes avec le monde un écart qui est insurmontable mais cela ne signifie cependant pas que le procès mondifiant se perd lui-même, sombre dans le néant. Avec l’archi-événement, naît un procès qui tend à en combler la béance et l’archi-événement n’est en vérité rien d’autre que la naissance même de ce procès. Celui-ci tend à réaliser une coïncidence impossible, à rejoindre cette origine à jamais perdue ; procès infini pour autant qu’il fait paraître la distance dans le mouvement qui la franchit, éloigne à mesure qu’il s’approche, creuse la béance en même temps qu’il la comble. On retrouve le même mouvement à travers l’oxymore développé par Grégoire de Nysse pour traduire la voie du désir comme épectase dans la colombe et la ténèbre : il nous parle d’eros impassible ou de sobre ivresse. Or pour Renaud Barbaras ce procès n’est autre que la temporalisation. En lui, le monde se donne comme son propre avenir, et finalement comme l’horizon d’une temporalisation par principe infinie. « Il a pour envers ce mouvement « subjectif » visant à le combler » (p. 326). Le temps est l’œuvre du désir : il n’y a de temps que comme temps du désir. Car pour Renaud Barbaras « le propre du désir est que le désiré l’exacerbe à mesure qu’il le satisfait, que ce qu’il fait paraître se donne toujours comme négation du véritable désiré, qui se trouve ainsi repoussé à mesure qu’il est rejoint, recule devant l’avancée. » (p. 326). C’est pourquoi le désir est sans cesse relancé par ce qu’il rencontre. Il n’y a donc pour lui de présent qui ne possède un avenir et ne soit voué à être dépassé par cet avenir. Le désir est donc ouverture de l’avenir, temporalisation. Le sujet ouvre le temps en cela qu’il le constitue. Dans cette temporalité, il y va du sujet lui-même, d’une manière de se réaliser, d’une réconciliation avec lui-même.
S’il est vrai que, comme tout étant, nous provenons de l’archi-vie du monde, nous nous singularisons cependant, au même titre que tous les autres vivants, par le fait que nous en procédons en nous en séparant (ou plutôt en en étant séparés par l’archi-événement), que notre rapport à cette archi-vie est marqué par la distance, distance dont la tentative de franchissement est synonyme de phénoménalisation subjective. La singularité des vivants renvoie à leur vivre, à l’épreuve transitive du monde au sein de ce monde, il n’y a pas de vivre et donc pas de vivants sans la distance ontologique, la profondeur d’une faille que le vivre transitif vise à combler.
Or, pour Renaud Barbaras, « il n’y a pas de distance ontologique sans une séparation qui met certains étants à l’écart du procès de mondification, autrement dit sans la perte en eux de la puissance de l’archi-vie du monde, sans une sorte de chute hors de la vie. » (p. 333) Le vivant est négation plutôt que pleine affirmation de la vie : il n’apporte la vie que s’il s’en déporte, ne la prolonge que dans la mesure où il s’en sépare. C’est là un point que sépare Renaud Barbaras de Michel Henry. Alors que pour lui la vie absolue est tout entière présente dans la vie de l’affectivité, s’affirme en elle au point que celle-ci n’est que la vie absolue s’apportant elle-même et se rapportant à elle-même, pour Renaud Barbaras, la vie des vivants procède d’une négation de l’archi-vie, qui, en outre, est aussi transcendante que la vie absolue henryenne est immanente et aussi dynamique que celle-ci est finalement immobile.
Dès lors, comment penser une négation de la vie si la vie est ce qui ne peut accepter la négation ? Renaud Barbaras nous montre que la réponse réside dans la question elle-même : “Seuls les vivants sont mortels et la mort ne peut donc signifier que l’accomplissement de cette mortalité, c’est-à-dire la fin du vivant. Dès lors que les vivants procèdent, en leur individualité de vivants, d’une privation de l’archi-vie, privation qui est l’oeuvre même de l’archi-événement, la mort ne peut avoir d’autre sens que celui d’une négation de celui-ci, c’est-à-dire d’un retour à l’archi-mouvement.” (p. 352). Dire d’un vivant qu’il meurt ne signifie donc pas qu’il perd la vie comme telle mais plutôt qu’il la retrouve sous la forme de l’oeuvre anonyme de l’archi-puissance du monde. Il ne perd donc que son identité de vivant reposant tout entière sur la scission archi-événementiale et, en ce sens, la mort n’est pas disparition mais dé-différenciation ou désindividuation.
Renaud Barbaras nous montre donc que la mort est perte de l’individuation par separation, franchissement de la faille archi-événementiale. Or, cela est possible et même necessaire car, en vertu de son caractère événemential, notre auteur nous a montré que l’événement n’est rien d’autre que le monde, même s’il n’a aucune cause dans le monde, de sorte que, bien qu’il l’affecte de part en part, il demeure sous son emprise. “Il y a donc une relation de tension ou de double enveloppement entre l’archi-mouvement et l’archi-événement : la blessure que celui-ci inflige dans le tissu du monde et qui coïncide avec la naissance des vivants est vouée à guérir, dit Renaud Barbaras, même si elle est tout autant condamnée à s’ouvrir sans cesse.” (p. 353) La mort se situe alors au point d’articulation entre la puissance mondifiante et l’archi-événement ; retour de l’un à l’autre ou passage de l’un dans l’autre, elle exprime finalement la subordination du métaphysique à l’ontologique. Or, notre auteur affirme qu’elle n’est en cela que l’envers de l’archi-événement, qui correspond, quant à lui, à la chute du monde hors de lui-même, au dépassement de l’ontologique dans le métaphysique. Il correspond donc au devenir vivant de la vie. Ainsi, pour Renaud Barbaras il n’y a de pulsion que comme pulsion de vie et celle-ci a pour mode propre de manifestation ou d’existence le désir lui-même.
Comme les grands mystiques, et nous pensons à Maître Eckhart, Renaud Barbaras nous a montré dans ce livre que le désir tend vers une coïncidence avec le monde (il en avait déjà parlé dans La vie lacunaire), vers une réinscription dans son archi-mouvement, réinscription qui se solde par sa désindividuation. Ainsi, en tendant vers la vie, le vivant tend vers sa mort, et les deux pulsions n’en font qu’une. Le propre de tout vivant est d’être traversé par l’archi-vie dont il est séparé comme vivant et de tendre vers une forme accomplie de cette vie, en une sorte d’aspiration cosmologique qui est synonyme de sa propre mort. Or cette aspiration est un désir d’un dépassement incessant de soi en se renonçant, à la fois perte d’une vie et retour à la vie.








