A : Projet de l’ouvrage
Berkeley est un philosophe qui souffre d’une telle réputation que rares aujourd’hui sont ceux qui se hasardent à ouvrir un de ses livres. Dans un tel contexte, il importait de restituer ce qui constitue le noyau de sa pensée, c’est à cela que s’attelle Roselyne Dégremont dans les leçons qu’elle publie chez Ellipses1. D’emblée, elle explique que sa démarche a pour but d’introduire à la pensée du philosophe irlandais et non de discuter des controverses et conflits d’interprétations auxquels elle a donné lieu. Au risque de paraître scolaire, il s’agit donc, pour elle, de partir des principaux textes de Berkeley et de les expliciter.
Ce parti pris se justifie dans la mesure où la doctrine de Berkeley reste très peu connue. Comme le montre brièvement l’auteur dans son introduction, la mauvaise réputation de Berkeley ne repose pas sur une information suffisante. La plupart des critiques substituent à une réfutation en règle, une raillerie facile. A les en croire, Berkeley serait l’auteur fantasque d’un idéalisme qui nierait la matérialité du monde extérieur. Rien n’existerait pour Berkeley en dehors de sa perception de sujet. De tels chefs d’accusation, relayés sur le continent par un jugement de l’histoire partisan, favorisant les jésuites au détriment d’un évêque anglican, seraient toujours de mise faute d’une restitution en bonne et due forme.
Sans prétendre être exhaustif, le propos du livre contribue à rendre de façon claire et précise ce qui constitue le noyau central de l’immatérialisme berkeleyen. Roselyne Dégremont montre ainsi que l’interprétation simpliste qui fait de Berkeley un solipsiste (un égoïste dans le vocabulaire vieilli des Encyclopédistes), repose sur une ignoratio elenchi se basant généralement sur une citation incomplète et sortie de son contexte. A en croire ses détracteurs, Berkeley aurait dit que l’existence est l’être perçu, ce qui signifierait que l’existence se réduirait aux sens d’un sujet percevant. Mais Berkeley ne dit pas « Existence is percipi», mais « Existence is percipi or percipere * (* or velle i.e. agere) ». On aurait donc réduit Berkeley à une formule dont on n’aurait retenu que la première partie. Si on restitue cette formule en son entier, il apparaît que Berkeley ne dit pas seulement qu’ « exister, c’est être perçu », mais qu’il ajoute que c’est également « percevoir ». Il y aurait ainsi un principe disjonctif à la base de la doctrine de Berkeley. L’auteur s’attache alors à montrer comment en complétant la doctrine de l’être perçu par une théorie du percevoir, on obtient une pensée beaucoup plus riche.
On reprochera cependant deux choses à l’auteur. D’une part, elle ne souligne pas le côté novateur et extrêmement original de proposer un principe disjonctif à la base d’une doctrine. D’autre part, elle fait de l’incise « (ou vouloir, c’est-à-dire agir) » un simple complément explicatif du percevoir. A notre sens, une autre lecture est ici possible. Selon celle-ci, l’appel de note signifierait que la disjonction entre le percevoir et l’être perçu pourrait être unifiée dans le vouloir, c’est-à-dire, si l’on suit Berkeley, dans l’agir, qui serait comme une alternative au principe disjonctif (voire une synthèse de ce principe). On aurait alors une disjonction entre un principe disjonctif et un principe unitaire fondé sur l’action. Au niveau architectonique, il y a là des possibilités extrêmement stimulantes sur lesquelles glisse, à notre sens, le commentaire de Dégremont trop obnubilé à corriger un préjugé tenace.
B : Perception et langage
Heureusement, l’auteur ne fonde pas toute sa lecture sur l’interprétation de cette note de Berkeley. Grande connaisseuse des textes de Berkeley, elle interprète sa doctrine comme se fondant sur les sensations. En ce sens, les mots ne seraient pas premiers, il y aurait avant le langage discursif un langage perceptif. Ce langage perceptif se composerait du toucher et du voir, l’un conduisant à l’autre. Comme tout langage, il serait, par ailleurs, le fruit d’un apprentissage. « Il faut du temps et de l’expérience pour acquérir par des actes répétés l’habitude de reconnaître la connexion entre signes et choses unifiées : c’est-à-dire de comprendre ou le langage des yeux, ou le langage des oreilles ». 2
Le passage du langage perceptif au langage discursif reposerait sur l’utilité pratique de fixer certaines choses, c’est cette traduction de la perception dans les mots qui ferait exister les différents genres. L’ontologie se fonderait ainsi sur le langage et non l’inverse. Comme le fait voir l’auteur dans la cinquième leçon, la position de Berkeley en la matière est donc nominaliste. Selon cette acception, le nom définirait l’usage possible d’un mot et non sa supposée nature. Le concept expliquerait moins en compréhension une chose, qu’il ne définirait l’extension de son usage. A l’appui de son interprétation, l’auteur cite Berkeley qui écrit : « Un mot devient général, quand on en fait le signe, non d’une idée générale, mais d’un grand nombre d’idées particulières. » 3 Comme le fait remarquer Dégremont, une telle vision des choses n’est pas sans originalité dans le contexte philosophique d’alors. Pour Berkeley, on n’aurait aucunement, comme le voulait Locke, des qualités premières qui seraient subsistantes et des qualités secondes qui s’ajouteraient dans la perception. On n’aurait que des qualités perçues que l’on regrouperait arbitrairement, pour des raisons d’usages, sous un nom unique. Une telle interprétation se voit corroborée par Berkeley qui note dans ses Principes: « Je ne nie pas de façon absolue qu’il y ait des idées générales, mais seulement qu’il y ait des idées générales abstraites ». 4
Si l’on suit la stimulante lecture de Roselyne Dégremont, les qualités perçues ne seraient pas chez Berkeley des singularités que l’on pourrait, par un processus d’abstraction, généraliser sous forme de concept. L’individuation ne serait pas première. On percevrait d’abord quelque chose d’indéfini qui se particulariserait au fil de l’expérience. L’auteur remarque ainsi que « la langue commence avec le général et va vers la dénomination du singulier » (66). Elle reconnaît naturellement qu’on peut partir du particulier pour le généraliser, mais cela ne traduirait pas, selon elle, notre expérience de l’acquisition du langage. L’auteur note alors « Ce que décrit Locke relève d’une démarche zoologique, aristotélicienne, qui est très réflexive et seconde ; qui est le fait de ceux qui désirent oublier la langue maternelle, la langue en usage, pour connaître les vivants avec plus de vérité » (68). Pour Berkeley, on aurait une réalité perçue qui serait ensuite traduite dans des noms qui dénoteraient une certaine régularité dans l’expérience.
Même la géométrie, réputée a priori, n’échapperait à cette perspective. Comme le note Dégremont, dans la leçon 6, « les triangles, lignes et cercles, ne sont pas des idées de l’esprit pur ; ces figures de la géométrie sont les signifiants – dans les mots et dans le visuel – d’un signifié tangible qui lui est pris dans les dimensions, dans la structure des corps » (89). Les concepts ne feraient donc que traduire un monde de sensations. L’auteur note alors que « qui dit ‘la neige est blanche et froide’ dit exactement ‘la neige, m’est douleur, elle m’éblouit les yeux, elle me brûle la peau’ ! Ni plus ni moins. » (95).
C : La question de Dieu
Après avoir exploré la perception et son langage dans les premières leçons, l’auteur revient dans sa huitième leçon, sur l’équation entre l’existence et le fait de percevoir ou d’être perçu. Elle montre que le sens de cette corrélation ne serait nullement restreint à ma sphère individuelle. Les choses que je ne perçois pas et qui ne perçoivent pas ne cesseraient pas d’exister, car Dieu percevrait tout. Resterait à prouver Dieu. Pour l’auteur, Berkeley estimerait pouvoir prouver le principe par l’absurde en montrant qu’il n’existerait pas d’imperceptibles en soi. Tout pourrait être perçu. A défaut de pouvoir être assurée, la possibilité d’un Dieu qui percevrait tout ne serait donc pas à rejeter.
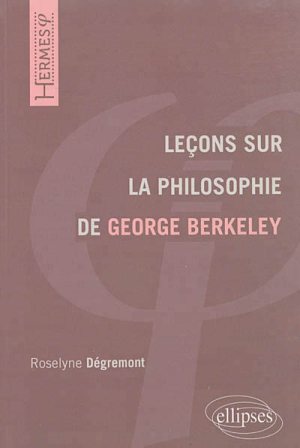
Au niveau des conséquences, un tel procédé permettrait de fonder les aspects les plus originaux de la philosophie de Berkeley. Comme rien ne fonderait absolument l’hypothèse d’une matière informe et imperceptible qui subsisterait au-delà de la perception d’un être tout puissant, l’idée d’un « immatérialisme » s’imposerait naturellement.
Mais on voit mal comment prouver à travers les moyens perceptifs (éventuellement prolongés par des outils) qu’il n’y a pas d’imperceptibles en soi. Il y aurait ici une pétition de principe. L’argument de Bradley en faveur de Dieu est à notre sens à chercher ailleurs que dans un argument apagogique douteux, il relève plutôt du phénoménologique (ce que l’auteur établira d’ailleurs plus loin, pp. 173-175). Pour Berkeley, on peut dire que Dieu perçoit tout, parce qu’il est perçu dans tout. Le théologique ne fonderait donc le phénoménologique que parce qu’il serait en retour fondé par celui-ci. Mais tout ceci reste ici insuffisamment mis en avant par l’auteur.
Ce n’est que rétrospectivement, en lisant le problème en regard du remarquable chapitre sur Dieu (pp. 167-177), qu’une solution plus satisfaisante se dessine. Dieu serait perçu dans tout parce que ma perception dénoterait d’une certaine cohérence qui semblerait indiquer une volonté. Ma perception serait parlante, parce que Dieu me parlerait en quelque sorte en elle. Or si une volonté divine organise le champ de ma perception, cela signifie que Dieu perçoit tout, maintenant par là l’existence du monde. Mais l’auteur échoue, à notre sens, à exposer clairement ce raisonnement, faute d’avoir suffisamment débrouillé l’architectonique de la doctrine berkeleyenne.
Il s’agirait toutefois plus d’une négligence que d’une mécompréhension de la doctrine de l’évêque irlandais. En effet, on ne peut que souligner la pertinence des chapitres qui suivent. Le seul reproche qu’on pourrait faire et qui rejoindrait notre problème est le caractère rapsodique de l’exposé. Il n’y a pas de fil directeur clairement défini, l’auteur, parlant tour à tour de l’esprit, du nombre, du point, du réel, de son double, de Dieu, de l’immatière, des lois de la nature, de la vérité, de la culture, de la nature et de la fin. Le moins que l’on puisse dire est que tout cela est livré en vrac. Si dès lors les analyses sont pointues, elles manquent souvent de connexion, ce qui se révèle problématique quand l’auteur touche à ce qui unifie en quelque sorte la doctrine de Berkeley. Quand il s’agit de critiquer le dualisme d’un réel doublé par un intelligible qui subsisterait hors de lui, l’auteur est décisive, mais quand il s’agit d’affirmer l’unité de la pensée de Berkeley, cela apparaît plus confus.
Pourtant si l’on veut éviter que Berkeley soit réduit à une théorie subjectiviste de l’être perçu, comme c’est le cas dans les lectures de Husserl et de Schopenhauer que commente brièvement l’auteur (pp. 186-190), il faudrait revenir au problème de l’unité complexe de la doctrine, c’est-à-dire au problème de Dieu. Par commodité, ces philosophes ont repris de Berkeley ce qui semblait faire sens et ils ont laissé tomber ce qui apparaissait dogmatique ou métaphysique, son affirmation de Dieu. Ils ont alors réduit l’immatérialisme, le refus en quelque sorte d’une chose en soi, à un idéalisme subjectif. Il est en effet commode d’obtenir l’unité de la doctrine de Berkeley en la dépouillant de sa complexité. Contre une telle façon de faire, il ne suffit toutefois pas de critiquer ces réductions, il faut encore montrer comment la complexité s’unifie en Dieu. Par rapport à ce problème, l’auteur ne nous a pas donné pleinement satisfaction.
Roselyne Dégremont n’a toutefois jamais eu la prétention de clore le débat. Son intention était plutôt de nous rendre Berkeley plus proche et de stimuler, par ce biais, un intérêt pour un philosophe injustement décrié. Le livre constitue ainsi une introduction utile qui couvre des aspects variés de la pensée théorique de Berkeley et contribue à faire de lui un philosophe recevable.
D : Originalité de l’ouvrage
D’aucuns pourraient regretter que des aspects plus pratiques de l’œuvre, l’esthétique, la morale, la politique et la médecine ne soient guère abordés, mais la faute, si l’on peut dire, est imputable à la richesse de l’œuvre du philosophe irlandais dont le corpus ne se laisse pas exposer en sa complexité en quelques pages. Face à ce problème, l’auteur a fait le bon choix. Plutôt que de donner un aperçu superficiel qui aurait donné l’impression que Berkeley était un philosophe fantasque, elle a préféré exposer les principaux aspects théoriques de sa pensée.
Cette exposition, si elle se veut avant tout introductive, si elle entend rester en dehors des polémiques et du style universitaire des thèses, n’en est pas moins originale sous plusieurs aspects. Le point le plus marquant est certainement l’insistance de l’auteur sur le langage. Loin d’être un artifice pour nous rendre Berkeley proche des préoccupations philosophiques d’une certaine tradition anglo-saxonne, il s’agit là d’un intérêt que Berkeley a pour le langage qui est propre et original, même si certains traits, comme le montre pertinemment Roselyne Dégremont, peuvent être rapprochés de Wittgenstein.
E : Aspect linguistique de la pensée de Berkeley
Avant de clore cette recension, il n’est pas inintéressant de toucher un mot de cet aspect linguistique de la pensée de Berkeley. Ainsi que le fait apparaître l’auteur, la nature, pour Berkeley, ne serait pas écrite en langage mathématique, comme le voudrait une certaine tradition qui court de Galilée à la technoscience contemporaine, elle serait seulement traduite dans un langage mathématique. Plus originairement, elle s’exprimerait dans le langage de la perception. Il y aurait ainsi un langage pré-discursif qui se lierait aux sens de la vue et du toucher. Ce langage pré-discursif de la perception se déclinerait ensuite en différents jeux de langage qui se répartiraient entre des langages tirant sur l’être perçu et des langages touchant au percevoir. Comme le remarque l’auteur (p. 139), le langage de la géométrie serait ainsi attaché chez Berkeley au fait d’être perçu, au caractère tangible des choses, tandis que le langage des nombres s’attacherait plutôt à l’activité de l’esprit qui consiste à percevoir. Quant à Dieu, il parlerait un langage qui ferait être les choses. Le logos prophorikos du Dieu de la genèse est ainsi repris par Berkeley. A notre sens, même si l’auteur ne le fait pas clairement apparaître, ce langage de la volonté divine synthétiserait les deux langages de la perception, il toucherait au percevoir et à l’être perçu, car percevoir, ce serait, pour Dieu, faire percevoir.
Le langage des mathématiques, qui s’exemplifie dans les lois de la nature, n’exprimerait donc qu’une traduction du sensible, il n’impliquerait aucune préséance. C’est pourquoi Berkeley « tient à penser comme le peuple ; et à parler avec le plus possible de simplicité » (p. 217). Pour l’auteur, avec Berkeley, on ne partirait pas de notions abstraites comme le temps, l’espace, la matière ou les nombres, mais de l’expérience perceptive et quand il s’agirait d’aller au-delà du langage perceptif premier, le langage mathématique ne s’imposerait nullement. Ce que la cohésion du langage premier, ce que les lois de la nature, sembleraient indiquer pour Berkeley, ce serait une volonté divine. Une telle lecture ne serait pas sans conséquences pratiques. Comme le montre Dégremont, une fois que le perçu est ramené au percevoir divin, le descriptif se ferait prescriptif. On voudrait le monde tel qu’il est, car le fait d’être comme il est dénoterait la présence d’une volonté divine. Tel serait le thème de l’Obéissance passive qui nous montrerait bien comment le langage de la nature interprété par Berkeley comme langage divin nous fait passer de la singularité des sensations à l’universalité de la volonté, ce qui nous ouvrirait, soit dit en passant, à une compréhension performative du langage de la nature, qui ferait être les choses, c’est-à-dire qui, tout à la fois, les formulerait et les ferait entendre.
On aurait là un partage suggestif des attitudes quant au monde suivant que l’on fait de la nature un langage mathématique ou un langage divin. Dans un cas, on serait conduit à un humanisme technophile, dans l’autre, on serait conduit à une obéissance passive regardant l’ordre établi. Roselyne Dégremont dégage ainsi une intéressante philosophie berkeleyenne du langage qui se décline en quatre étapes : « voir et dégager les règles ou lois de la nature (physique) ; puis élever l’esprit à la perception de l’ordre et de la beauté du monde sensible ; puis élever l’esprit à la compréhension de Dieu (grand, sage, bienveillant) ; et enfin saisir les fins et de Dieu, et de la Nature, et de nous-mêmes » (203). Cette progression n’irait certes pas sans reste, puisqu’elle nous ferait perdre une certaine candeur esthétique au profit d’une morale du devoir. Il y a là un aspect rigoriste qui pourrait rendre Berkeley impopulaire. Mais derrière, cet aspect se fait voir les prémisses d’une philosophie du langage qui lierait et articulerait différents jeux de langage selon une hiérarchie qui nous conduirait du langage prédiscursif de la perception au langage performatif de la religion.
Sans prétendre suivre Berkeley jusqu’au bout de cet itinéraire, on soulignera le caractère stimulant de sa pensée. De nombreuses questions se posent, en effet, à partir de l’appréhension de l’expérience qu’il propose et que Roselyne Dégremont nous expose avec soin. Si l’on admet que la perception forme un langage, ce qui n’est pas sans extension possible du côté de l’éthologie animale, comme le note d’ailleurs l’auteur au passage, alors se pose la question de la traduction de ce langage premier en un langage second. Quelle traduction choisir ? Quelle loi organise le passage d’un jeu de langage à un autre ? Comment hiérarchiser les différents langages ? Faut-il d’ailleurs admettre une supériorité d’un jeu de langage sur un autre ? Si l’on parle de langage, ne faut-il pas présupposer, par ailleurs, un auteur derrière le langage ? Et, si une telle présupposition est trop lourde pour certains, ne faudrait-il pas abandonner l’idée d’une sémantique de la nature ?
Conclusion
En conclusion, les enjeux que posent les éléments sémantiques qui sous-tendent la doctrine de Berkeley sont actuels et, pour le moins, stimulants. On s’est habitué à penser sans Berkeley ou, éventuellement contre lui. Une des grandes réussites de ce livre est de nous donner envie de penser avec Berkeley. Pour cette raison, on ne peut que recommander à l’étudiant de combler les lacunes éventuelles de sa formation par la lecture de ce livre suggestif.
- Roselyne Dégremont, Leçons sur la philosophie de Berkeley, Paris, Ellipses, 2013
- George Berkeley, Alciphron, in Œuvres, Paris, PUF, « Epiméthée », vol. 4, p. 11
- George Berkeley, Introduction manuscrite aux Principes de la connaissance humaine, Œuvres, op. cit., vol. 1, p. 17.
- George Berkeley, Introduction aux Principes de la Connaissance humaine, in Œuvre, op. cit., p. 12.








