De façon curieuse ou amusante, cette Introduction à la métaphysique de Thomas d’Aquin est davantage une conclusion, un bilan de vingt-cinq années d’étude et de recherches sur Thomas d’Aquin, un surgeon de trois épais livres[1] : plus de 3000 grosses pages prolongées aujourd’hui en 300 petites !
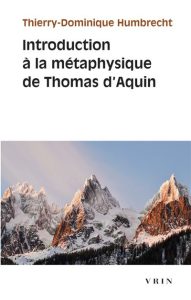 Qu’a fait le Père Thierry-Dominique Humbrecht ? On peut dire, en une phrase, qu’il a travaillé à retrouver la pensée de saint Thomas d’Aquin, sous la scolastique prétendument « thomiste », à l’aide de la méthode historique critique en usage chez les historiens de la philosophie. Autrement dit, il joint le spéculatif à tendance anhistorique des thomistes et l’historique à tendance historiciste des historiens. Savant mélange, périlleux équilibre. Certes, il n’est pas seul sur ce chemin et peut se revendiquer du glorieux précédent d’Étienne Gilson, admirable historien et philosophe thomiste, qu’il cite abondamment[2]. Il sait aussi entendre les critiques des historiens universitaires non-thomistes traitant de la philosophie médiévale, versions plutôt foucaldienne (Alain de Libera, Catherine König-Pralong) ou plutôt heideggerienne (Jean-Luc Marion, Jean-François Courtine, Olivier Boulnois, Vincent Carraud). Tout au long de son œuvre, il y fait droit, quitte à les discuter ou à plaider pour une exception thomasienne. Quoi qu’il en soit, il en hérite une méthode historique rigoureuse, retournant à la lettre des textes, déconstruisant ici et là ce qui semblait établi et qui se révèle postérieur et infidèle car inconsciemment différent. Mais il n’en faut pas rester à une analyse de détail, sans également situer chaque partie dans l’édifice total, ce qui suppose une vue d’ensemble.
Qu’a fait le Père Thierry-Dominique Humbrecht ? On peut dire, en une phrase, qu’il a travaillé à retrouver la pensée de saint Thomas d’Aquin, sous la scolastique prétendument « thomiste », à l’aide de la méthode historique critique en usage chez les historiens de la philosophie. Autrement dit, il joint le spéculatif à tendance anhistorique des thomistes et l’historique à tendance historiciste des historiens. Savant mélange, périlleux équilibre. Certes, il n’est pas seul sur ce chemin et peut se revendiquer du glorieux précédent d’Étienne Gilson, admirable historien et philosophe thomiste, qu’il cite abondamment[2]. Il sait aussi entendre les critiques des historiens universitaires non-thomistes traitant de la philosophie médiévale, versions plutôt foucaldienne (Alain de Libera, Catherine König-Pralong) ou plutôt heideggerienne (Jean-Luc Marion, Jean-François Courtine, Olivier Boulnois, Vincent Carraud). Tout au long de son œuvre, il y fait droit, quitte à les discuter ou à plaider pour une exception thomasienne. Quoi qu’il en soit, il en hérite une méthode historique rigoureuse, retournant à la lettre des textes, déconstruisant ici et là ce qui semblait établi et qui se révèle postérieur et infidèle car inconsciemment différent. Mais il n’en faut pas rester à une analyse de détail, sans également situer chaque partie dans l’édifice total, ce qui suppose une vue d’ensemble.
I. Thomas l’écrivain
Le mot d’ordre est peut-être celui-ci, selon une belle métaphore : « Qu’il [le lecteur] abatte la statue pour animer le marbre » (p. 299). Il s’agit de retrouver l’œuvre sous l’apparent système, et l’homme sous l’œuvre. Saint Thomas d’Aquin, en raison de sa gloire posthume, a pu sembler hiératique et surhumain, si ce n’est irréel ; il s’agit de retrouver l’homme vivant et son travail réel, donc singulier et contingent – on pourrait dire retrouver frère Thomas, dominicain, humble théologien et grand universitaire de l’Université de Paris au XIIIème siècle, avant qu’il fût saint Thomas d’Aquin, le glorieux Docteur commun de l’Église. C’est pourquoi le P. Humbrecht introduit son Introduction par le rappel de quelques événements de la vie du jeune Thomas, tout juste maître en théologie à l’Université de Paris, à l’aube de sa production magistrale. En pleine polémique contre les Ordres mendiants, il consentit à la charge d’intellectuel universitaire – « triple charge de la recherche et de l’enseignement, de la controverse et de la prédication universitaire » (p. 16) – qui allait être la sienne, non sans larmes, note Humbrecht. « Les larmes de Thomas sont celles d’une œuvre à venir, entre noblesse de l’objet, création, astreinte, lectures infinies, écriture, corrections et fatigues, livre après livre. Ce serait sa vie, il pleura, elle le devint » (p. 16). Dès lors, comme tout penseur, Thomas d’Aquin devient un auteur problématique, dont l’interprétation est ardue : sa pensée reste constante pour une part, fidèle aux principes qu’elle s’est choisie, malgré d’apparentes discontinuités, mais, pour une autre part, elle évolue, progresse, sous une apparente constance de langage, et cela en fonction des contextes, des genres littéraires, mais aussi des événements de la vie de Thomas et de ses intentions. La décision de l’interprète de saint Thomas que veut être le P. Humbrecht est donc nette : « Plutôt que d’une forme scolaire, mieux vaut s’approcher d’une forme vivante, des textes dans leur contexte, et dont on n’a pas fini d’épuiser la signification. Celle-ci tient à un ensemble organiquement écrit et distribué, et non à quelques phrases érigées en principes quelque peu fabriqués » (p. 43). Non pas lisser les difficultés et élaguer ce qui sort du cadre a priori qu’on a fixé à l’interprétation, mais retrouver les équilibres de cet « ensemble organiquement écrit et distribué », voilà l’enjeu, et il est titanesque.
II. Contre la métaphysique séparée, les interactions entre philosophie et théologie
L’alternative que dresse le P. Humbrecht, et qui est tout sauf anodine, est celle entre restitution et reconstruction. Ce fut l’opposition entre Étienne Gilson, qui s’était prononcé contre la reconstruction de la philosophie de saint Thomas d’Aquin : « Extraire des œuvres théologiques de saint Thomas les données philosophiques qu’elles contiennent, puis les reconstruire selon l’ordre que lui-même assigne à la philosophie, ce serait faire croire qu’il ait voulu construire sa philosophie en vue de fins purement philosophiques, non en vue de fins propres du Docteur chrétien[3]», et Fernand Van Steenberghen, qui y était favorable : « À l’aide de tous ces matériaux, l’historien de la philosophie peut et doit s’efforcer de reconstruire la synthèse philosophique qui pénètre et anime toute l’œuvre littéraire du Docteur Angélique[4] ».
Peut-on faire ce que saint Thomas n’a pas voulu faire ? Peut-on faire une philosophie pure, séparée de la théologie, qui serait celle de saint Thomas, quoiqu’il ne l’ait jamais écrite ? Certes, ces reconstructions s’appuient sur ce que saint Thomas dit de la philosophie lorsqu’il traite de la distinction des sciences. Elles se revendiquent en particulier de la mention d’une « théologie philosophique », hapax du Commentaire sur la Trinité de Boèce (q. 5, a. 4, resp.). Néanmoins, encore une fois, si Thomas non seulement ne reprit jamais l’expression dans ses œuvres ultérieures, et surtout n’écrivit jamais une telle philosophie autonome et séparée de sa théologie, une telle chose est-elle seulement possible dans l’esprit de Thomas ?
« Reconstruire est plus qu’une mise en ordre. C’est plier un auteur au cadre tracé à sa place et qu’il faudrait nommer, ou bien le soumettre plus qu’il ne l’a voulu à son propre cadre » (p. 22), écrit le P. Humbrecht. C’est dire qu’il y a deux manières de croire interpréter saint Thomas mais tout en le manquant : le lire à partir de principes qui ne sont pas les siens (le cas le plus fréquent fut une lecture de Thomas à travers Duns Scot), ou bien, plus subtilement, le lire à travers certains principes qu’il a certes effectivement énoncés, mais en leur accordant plus de place qu’ils n’en ont en réalité dans l’équilibre de l’édifice thomasien. Par exemple, reconstruire une philosophie de Thomas parce qu’il a, une fois, dans un ouvrage de jeunesse, parlé de la possibilité d’une « théologie philosophique », distinguée de la théologie appuyée sur les principes de la foi chrétienne.
 Tout ce débat est moins formel qu’il n’y paraît si on le place dans la distinction plus vaste entre foi et raison, laquelle, suivant une remarque de Gilson[5], est corrélée à la distinction entre la grâce et la nature. « Il se pourrait que toute philosophie se présentant comme préalable fût en réalité un exercice de nature pure : tel ancrage religieux et théologique étant supposé, au besoin dissimulé, la philosophie se prétend solitaire, au nom de sa capacité de procéder par induction et puis d’argumenter, au mieux désireuse d’atteindre à son sommet le début de la théologie. L’artifice d’intention, et donc de modalité, commence à apparaître. » (p. 71-72). La critique du P. Humbrecht est ici profonde : prétendre poser une philosophie séparée de la théologie, non-religieuse, qui retrouve, au moins pour une part, les données chrétiennes révélées, équivaut à poser l’existence d’une nature pure. Qu’est-ce à dire ? Certains thomistes modernes ont cherché à poser, d’abord à titre d’hypothèse, puis en le systématisant, qu’une nature pure était possible, même dans l’état historique, indépendamment de toute grâce, laquelle n’est que surajoutée. Or, le P. Humbrecht, avec Gilson et après le P. Henri de Lubac[6], qui batailla en son temps contre les scolastiques de type suarézien, tient à l’inanité théologique d’une telle « pure nature ». Au contraire, dans l’état historique et concret des choses, « c’est la grâce qui rend la nature naturelle. La nature, restée seule, n’y fût pas aussi bien parvenue » (p. 93), « la grâce rend la nature à elle-même et la mène à sa perfection[7] ». La nature est soit déchue, soit sauvée, elle n’existe pas pure et indépendante : de même, la raison est blessée ou sauvée, mais elle ne fonctionne jamais par ses seules forces, indépendamment de la grâce. La raison n’est elle-même que par la grâce – la grâce de la foi –, qui la restaure et la guérit ; « la foi rend la raison à elle-même[8] ».
Tout ce débat est moins formel qu’il n’y paraît si on le place dans la distinction plus vaste entre foi et raison, laquelle, suivant une remarque de Gilson[5], est corrélée à la distinction entre la grâce et la nature. « Il se pourrait que toute philosophie se présentant comme préalable fût en réalité un exercice de nature pure : tel ancrage religieux et théologique étant supposé, au besoin dissimulé, la philosophie se prétend solitaire, au nom de sa capacité de procéder par induction et puis d’argumenter, au mieux désireuse d’atteindre à son sommet le début de la théologie. L’artifice d’intention, et donc de modalité, commence à apparaître. » (p. 71-72). La critique du P. Humbrecht est ici profonde : prétendre poser une philosophie séparée de la théologie, non-religieuse, qui retrouve, au moins pour une part, les données chrétiennes révélées, équivaut à poser l’existence d’une nature pure. Qu’est-ce à dire ? Certains thomistes modernes ont cherché à poser, d’abord à titre d’hypothèse, puis en le systématisant, qu’une nature pure était possible, même dans l’état historique, indépendamment de toute grâce, laquelle n’est que surajoutée. Or, le P. Humbrecht, avec Gilson et après le P. Henri de Lubac[6], qui batailla en son temps contre les scolastiques de type suarézien, tient à l’inanité théologique d’une telle « pure nature ». Au contraire, dans l’état historique et concret des choses, « c’est la grâce qui rend la nature naturelle. La nature, restée seule, n’y fût pas aussi bien parvenue » (p. 93), « la grâce rend la nature à elle-même et la mène à sa perfection[7] ». La nature est soit déchue, soit sauvée, elle n’existe pas pure et indépendante : de même, la raison est blessée ou sauvée, mais elle ne fonctionne jamais par ses seules forces, indépendamment de la grâce. La raison n’est elle-même que par la grâce – la grâce de la foi –, qui la restaure et la guérit ; « la foi rend la raison à elle-même[8] ».
La décision de reconstruire une philosophie de saint Thomas est donc lourde de présupposés théologiques, qui proviennent moins de Thomas lui-même que de théologiens modernes. Contre une telle volonté, Humbrecht pense plutôt trois modalités de la métaphysique, dans son rapport à la doctrine sacrée ou théologie. Ces trois modalités sont aussi trois types d’interaction entre foi et raison, « trois façons d’articuler raison et foi » (p. 37). Entrons dans le détail de cette thèse interprétative, de cette modélisation bien utile pour saisir l’entrelacs unique de la foi et de la raison qu’a réalisé saint Thomas[9].
1/ La métaphysique intégrée. « Cette première modalité désigne toute la métaphysique reçue et assumée des philosophes, certes travaillée à neuf, mais en faisant le maximum pour approfondir son apport. » (p. 38). On sait combien saint Thomas commenta les philosophes, tout spécialement Aristote et ses commentateurs arabes, mais aussi les néoplatoniciens (Livre des causes), et reçut leurs pensées selon une ampleur jusque-là inédite en Occident. En va-t-il de la foi, ou bien est-ce un travail purement rationnel ? Humbrecht tient que même cette réception philosophique des philosophes est celle de Thomas, c’est-à-dire d’un docteur chrétien. « Même si jamais la foi ne sert ni de principe ni de moyen terme, il arrive, si l’on regarde bien, que Thomas laisse entrevoir une finalisation des plus hauts résultats des philosophes en direction de la foi et, surtout, une certaine correction de ceux-ci par celle-là » (p. 38). Nous y reviendrons plus loin en traitant du rapport de Thomas à Aristote, mais retenons déjà que Thomas ne laisse rien de ce qu’il utilise indemne. « Thomas modifie tout ce qu’il touche, au sens où, lorsqu’il assume, il éclaircit l’auteur réemployé, lui restituant toute son intelligibilité, au besoin en améliorant celle-ci » (p. 87).
2/ La métaphysique constituée. « Elle recouvre toute la métaphysique produite par la doctrine sacrée et pour son propre usage » (p. 28). La métaphysique n’est pas l’œuvre exclusive des philosophes purs, païens, mais elle peut aussi être l’œuvre d’un théologien. Ainsi, le docteur chrétien, qui tient par la foi certains vérités, peut-il pousser la métaphysique plus loin qu’elle fût allée par ses seules forces. La théologie suscite de la métaphysique, « de haut en bas », pour ainsi dire. « En d’autres termes, si la métaphysique peut certaines choses, elle en voit d’autres lui échapper. » (p. 101). Et le P. Humbrecht de déterminer ce qu’elle atteint par elle-même – « l’étude de l’étant, de ses structures et modalités (comme substance et accidents, forme et matière, acte et puissance, un et multiple) » (p. 101-102), ainsi qu’« un Dieu premier moteur, substance, acte pur, vie, intellect, contemplation éternelle de soi, et cause finale des étants » (p. 102) –, mais aussi ce qu’elle n’eût découvert sans la stimulation de la raison par la foi – principalement la création et l’acte d’être, mais aussi le gouvernement divin des créatures.
Étienne Gilson, « prince[10]» de cette seconde modalité, fut le premier à redécouvrir en historien la portée philosophique de la théologie. Ce fut la fameuse et controversée « métaphysique de l’Exode[11]» de 1932, qu’il présente comme un fait d’histoire de la philosophie. « L’Écriture, reçue par les juifs et les chrétiens, devient pour ceux-ci une stimulation exceptionnelle, et amorce une évolution décisive de la pensée » (p. 104), résume le P. Humbrecht. La nomination biblique de Dieu comme être (« Je suis celui qui est », Exode 3, 14) donne lieu, en particulier chez saint Thomas, à un considérable et magistral approfondissement de la notion métaphysique d’être, sur laquelle nous reviendrons bientôt. La révélation, qui transcende assurément la métaphysique, ne la ruine pas, mais la féconde, comme la grâce ne supprime pas la nature, mais la parfait. Cette grande thèse gilsonienne est assumée par le P. Humbrecht, qui en fait le principe organisateur du dialogue entre foi et raison chez saint Thomas.
3/ La métaphysique manifestée. Saint Thomas d’Aquin pratique cette modalité dans la Somme contre les Gentils, dont le projet est « de manifester la vérité de la foi catholique et de réfuter les erreurs contraires, et cela, pour les livres I à III, selon des raisons et donc selon les natures des choses » (p. 38). Il y va d’une « manifestation rationnelle de la foi », non d’une démonstration rationnelle de la foi, mais d’une défense de la vérité de la foi à l’aide de raisons – « projet théologique unique en son genre, qui argumente non en s’appuyant sur les données de la foi, mais sur ce que celle-ci comporte aussi de rationnel » (p. 39). Le signe en est que les autorités de l’Écriture ne sont citées qu’après les arguments rationnels, comme une confirmation et non comme une preuve. On ne peut croire que la première Somme ne contienne pas de philosophie, mais on ne peut non plus la réduire à une « somme philosophique », car l’intention y est clairement théologique. C’est dire que la philosophie n’épuise pas la rationalité. « Le domaine de la raison est donc plus vaste que celui de la philosophie » (p. 39). Ces raisons ne relèvent ni exclusivement de la philosophie, ni non plus de la seule théologie. Il faut « accorder à toutes ces raisons un statut métaphysique, mais au sens élargi que nous lui accordons : ni philosophique, ni théologique, plutôt celui d’un ensemble de notions développées selon la raison dans le cadre, et au service, d’un dessin théologique » (p. 270). La métaphysique, mue par la théologie, déborde ici la philosophie comme œuvre de la seule raison. Par conséquent, la théologie élargit la métaphysique. « Le docteur chrétien, en tant qu’il fait usage de métaphysique et aussi en tant qu’il la transforme, lui confère un domaine plus vaste que celui que lui lègue la philosophie » (p. 273).
Ces trois modalités permettent de comprendre en quel sens on peut parler de « métaphysique de Thomas d’Aquin », et en quel sens on ne le peut pas. Il n’est pas question de reconstruire une métaphysique complète avant et sans réception de la révélation, comme si le thomisme pût être une philosophie aussi séparée et indemne de la foi chrétienne que celle d’Aristote ou des néoplatoniciens, à laquelle on eût seulement juxtaposé une théologie chrétienne. Thomas d’Aquin fait de la métaphysique comme théologien et docteur chrétien. Le théologien aussi fait de la métaphysique, et il se pourrait qu’il en fît même mieux et plus que le philosophe, quoiqu’il la fît servir à ses propres besoins théologiques. Le P. Humbrecht relève l’importance décisive de cette « question de l’opérateur : si c’est un docteur chrétien qui fait de la philosophie, celle-ci s’en trouve, sinon modifiée quant à sa méthode, du moins dirigée d’une certaine façon » (p. 40). La théologie régit et guide la métaphysique, sans s’y substituer, mais en la stimulant pour qu’elle aille le plus loin possible en son propre domaine. Cette régence fut exprimée de manière fameuse par le thème de la philosophie auxiliaire ou servante (ancilla) de la théologie. La philosophie est servante de la théologie, mais cela est son honneur, et elle fait en quelque sorte partie de la maison ; c’est en servant une tâche plus haute et plus grande qu’elle s’accomplit elle-même et se développe le plus, parce qu’elle reçoit en retour la stimulation de la science supérieure qu’est la théologie. Elle est grande d’être servie par celle qu’elle sert. Leur relation est une interaction, qui profite aux deux : « La doctrine sacrée [sc. la théologie] a donc pour double fonction de s’enrichir de métaphysique, pour servir d’auxiliaire à la foi, et d’enrichir la métaphysique en la portant au-delà de ce que la philosophie peut en dire » (p. 272). Car « la foi est pour la raison non pas une chape de plomb, mais au contraire une puissante stimulation. La foi apporte à la raison un surcroît de rationalité » (p. 265). Étienne Gilson exprime la même chose en une autre image – celle du théologien qui descend vers le philosophe pour les conduire là où il désirait aller quoique sans en avoir l’idée, pour achever leur quête aussi courageuse qu’impuissante : « De la hauteur de la foi, le théologien redescend vers les philosophes, les rejoint sur la route, chemine un temps avec eux, prend bientôt les devants et atteignant enfin d’un bond leur but commun, il les appelle tous ensemble à l’y rejoindre[12]». C’est à l’aune de ce rapport complexe qu’on peut traiter à nouveaux frais du rapport entre Thomas et Aristote.
III. Thomas ou Aristote
Autant la foi transcende la raison, autant le théologien domine le philosophe. C’est ainsi qu’il faut interroger le rapport que Thomas entretient à Aristote. Rien ne répugne plus au P. Humbrecht que de faire passer saint Thomas pour un aristotélicien strict en philosophie, qui, par ailleurs, aurait conçu une théologie chrétienne. Que saint Thomas emprunte aux merveilleux outils philosophiques forgés par Aristote, c’est certain ; mais la mesure dans laquelle il le fait, et reste fidèle à Aristote, cela est plus incertain. La conclusion dégagée par le P. Humbrecht au fil de ses lectures de l’œuvre thomasienne est nette : « En un sens, Thomas d’Aquin reconnaît aux philosophies qu’il intègre tout ce qu’elles comportent de rationalité. […] Cependant, en un autre sens, Thomas juge ces philosophies au nom de la vérité, de la vérité philosophique et aussi de la vérité de la foi. Il arrive donc à Aristote d’être évalué, comparé, voire rectifié, à la lumière de la foi et parfois de la raison » (p. 275).
Humbrecht le montre à propos des preuves de l’existence de Dieu (Somme de théologie, I, q. 2, a. 3). On sait que Thomas les reprend ici à Aristote, là à Avicenne ou à Averroès et Maïmonide, là encore à saint Jean Damascène, etc. Il reçoit donc d’abord, hérite, intègre les arguments des philosophes passés, mais il n’en use que pour ses besoins, se permettant de corriger ou de surinterpréter la lettre ici ou là pour mieux dire la vérité des choses : « son travail de récapitulation est tout autant une refonte, procédant d’une intention de signifier » (p. 88). Tout cela est manifeste de la manière la plus éclatante lorsque, dans la quatrième voie, il use d’une sentence anodine d’Aristote, mais devenue célèbre à cause de son ambiguïté même, sur la causalité du maximum[13] qu’il entend de manière platonicienne comme signifiant la participation, dont on sait qu’Aristote la critique par ailleurs. La vérité d’Aristote lui importe moins ici que la vérité tout court, qui est l’existence d’un premier parfait, cause de perfection en ses effets. Autrement dit, comme on l’a déjà souligné, « Thomas modifie tout ce qu’il touche » (p. 87), et en particulier Aristote. Il en résulte que les cinq voies présentent « un sens de la synthèse qui trahit la main de Thomas. Encore ne s’agit-il pas seulement de maîtrise ou de style. Il y a autre chose, un point de vue supérieur. C’est un docteur chrétien qui investit les voies philosophiques, et c’est Thomas d’Aquin » (p. 88). C’est encore la « question de l’opérateur », comme nous le mentionnons. Certes, les preuves thomasiennes présentent la plus grande rigueur philosophique, mais elles n’en sont pas moins d’intention théologique, en tant qu’elles prennent place à l’orée d’une Somme de théologie, et sont placées, rappelle Humbrecht, sous l’égide de la parole de Dieu lui-même : « Je suis celui qui est » (Exode 3, 14), citée en Sed contra de l’article. « Ces voies, tirées des philosophes au moins pour les quatre premières, sont pensées ensemble et écrites par un seul, ce qui n’a jamais été le cas pour elles, par un docteur chrétien avec le surplomb biblique qui les introduit, et par Thomas d’Aquin qui, en les établissant ainsi, porte leur degré de rationalité presqu’au-delà de leur production originelle, au moins pour la reprise de certains éléments » (p. 92). Comment exprimer cela sinon en disant qu’ici encore, c’est la foi qui sauve la raison, la guérit et la parfait ? Le docteur chrétien accomplit les efforts des philosophes.
Thierry-Dominique Humbrecht repère d’autres interventions du docteur chrétien dans sa réception d’Aristote. La plus remarquable porte sur l’attribution à Aristote de la doctrine d’un Dieu cause efficiente du monde, et pas seulement son premier moteur. Nous sommes en effet dans le contexte de la querelle sur l’éternité du monde, et Thomas veut « sauver » Aristote, si l’on peut dire. Chacun sait bien qu’Aristote a posé l’éternité du monde, mais on peut l’en excuser si on l’innocente de l’idée selon laquelle il n’a pas fait le monde. Un monde éternel mais causé par Dieu, c’est une erreur de fait, mais il aurait pu en être ainsi, explique Thomas. Au contraire, poser un monde éternel et non-causé par Dieu, ce serait « une erreur abominable » (L’éternité du monde, §1, cité ici p. 223), dont Thomas veut préserver Aristote face aux théologiens prompts à le frapper d’anathèmes. Thomas est donc capable de corriger un auteur pour lui faire dire la vérité qu’il n’a pas dite. Car c’est la vérité de la chose même qui compte, et non celle du texte, a fortiori lorsque celui-ci se trompe. Thomas sait tout ce qu’il doit à Aristote, mais sait aussi qu’il tient encore plus – et encore mieux – de la révélation. Il aime Aristote, mais il préfère la vérité.
IV. L’être avec Dieu
Après cette présentation quelque peu formelle des rapports entre les différentes sciences et entre la foi et la raison, on peut s’attacher à relever quelques thèmes métaphysiques développés par Humbrecht.
 Le premier est le rapport de l’être à Dieu. Jean-Luc Marion avait fait grand bruit en 1982 en appelant à penser « Dieu sans l’être », c’est-à-dire hors de tout ce que Heidegger avait nommé « onto-théo-logie ». Cependant, il avait fini par dédouaner saint Thomas d’Aquin d’une telle accusation, dans un chapitre ajouté, au demeurant remarquable, dans lequel il ose l’énigmatique formule d’un « esse sans l’être[14] ». Quoi qu’il en soit, le P. Humbrecht emboîte le pas de Marion lorsqu’il s’agit de critiquer l’ontothéologie, dont la paternité en contexte scolastique est désormais attribuée à Duns Scot[15], et même avant lui à Henri de Gand, selon Olivier Boulnois[16]. « L’ontothéologie désigne le discours sur l’étant et sur Dieu, tel qu’il prétende maîtriser l’un et l’autre comme des objets, c’est-à-dire des concepts produits par l’esprit et maîtrisés par lui, des concepts représentés » (p. 32). Elle est la soumission de Dieu au concept commun univoque d’étant. Dieu devient un étant comme les autres, le plus grand certes, mais concevable sous le même horizon que les autres dont il est cause. De Dieu, on a dès lors un concept, comme des autres choses, il est connu comme un objet, fût-il infini. Nommer Dieu implique-t-il dès lors de lui dénier l’être ? La discussion est ouverte depuis le coup d’éclat de Marion.
Le premier est le rapport de l’être à Dieu. Jean-Luc Marion avait fait grand bruit en 1982 en appelant à penser « Dieu sans l’être », c’est-à-dire hors de tout ce que Heidegger avait nommé « onto-théo-logie ». Cependant, il avait fini par dédouaner saint Thomas d’Aquin d’une telle accusation, dans un chapitre ajouté, au demeurant remarquable, dans lequel il ose l’énigmatique formule d’un « esse sans l’être[14] ». Quoi qu’il en soit, le P. Humbrecht emboîte le pas de Marion lorsqu’il s’agit de critiquer l’ontothéologie, dont la paternité en contexte scolastique est désormais attribuée à Duns Scot[15], et même avant lui à Henri de Gand, selon Olivier Boulnois[16]. « L’ontothéologie désigne le discours sur l’étant et sur Dieu, tel qu’il prétende maîtriser l’un et l’autre comme des objets, c’est-à-dire des concepts produits par l’esprit et maîtrisés par lui, des concepts représentés » (p. 32). Elle est la soumission de Dieu au concept commun univoque d’étant. Dieu devient un étant comme les autres, le plus grand certes, mais concevable sous le même horizon que les autres dont il est cause. De Dieu, on a dès lors un concept, comme des autres choses, il est connu comme un objet, fût-il infini. Nommer Dieu implique-t-il dès lors de lui dénier l’être ? La discussion est ouverte depuis le coup d’éclat de Marion.
Comment saint Thomas conçoit-il le rapport entre l’être et Dieu ? Pour commencer, il faut caractériser le rapport entre Dieu et le sujet de la métaphysique. Dieu est-il le sujet de la métaphysique, comme l’a pensé Averroès ? Dans son Commentaire de la Métaphysique d’Aristote, Thomas suit Avicenne, et affirme que c’est l’étant commun qui est le sujet de la métaphysique. Dieu fait-il dès lors partie de la métaphysique ? Duns Scot, concevant l’étant commun comme sujet de la métaphysique, faisait à ce titre entrer Dieu dans la métaphysique et le soumettait à la raison d’étant, à la commune et univoque étantité. Il en va autrement chez saint Thomas. Dieu n’est pas le sujet de la métaphysique, mais il est la cause de ce sujet. Or, « il revient à la même science de considérer les causes propres d’un genre donné et le genre en question » (Commentaire de la Métaphysique, Prologue, cité ici p. 61). La métaphysique traitera donc de Dieu non comme de son sujet, mais comme de la cause de son sujet. Ainsi Thomas pense-t-il à la fois la transcendance de Dieu, qui n’est pas inclus dans l’étant commun, et son appartenance à la métaphysique. « Décisive donc, cette instauration postule en même temps que Dieu n’est pas maîtrisé par la métaphysique ; qu’il entretient vis-à-vis de tout ce qui est étant un rapport de transcendance ; qu’il n’appartient pas à l’étant commun ; mais que, toutefois, il n’est pas évacué de tout lien avec l’être, en tant qu’il est la cause de tout ce qui est étant ; qu’il est mesure sans être mesuré. » (p. 64). D’où il apparaît que la métaphysique de Thomas d’Aquin n’est pas une onto-théo-logie. L’honneur est sauf.
Reste à éclaircir ce « lien avec l’être ». Le P. Humbrecht introduit subtilement le problème : « ne devrait-on pas parler de l’être à partir de Dieu et après lui, plutôt qu’avant lui et pour l’y inclure ? » (p. 100)[17]. Une telle formulation dit déjà tout, en tant qu’elle met le doigt sur l’inversion thomasienne du rapport entre l’être et Dieu. Plus précisément, il en va ici d’une inversion de l’ordre d’invention et de l’ordre de perfection. Si, dans l’ordre d’invention, nous connaissons d’abord l’étant commun, par abstraction des déterminations particulières des étants, cependant, dans l’ordre de perfection, c’est Dieu qui est à titre premier et principal, et le reste est causé par lui et donc est secondairement. Il faut tâcher de ne pas perdre de vue cette inversion qu’opère notre mode fini de connaître, et la renverser – la remettre à l’endroit – autant que possible. « Du point de vue du métaphysicien au travail, il y a donc une double opération de bascule, ascendante puis descendante. D’un côté, l’intellect accède à Dieu comme premier étant à partir des effets, de bas en haut, au titre unique de sa situation éminente et parfaite, bref, de la transcendance de sa divinité ; de l’autre, ce statut transcendant de la divinité impose, de haut en bas, une certaine façon de parler de l’être […], pour lui d’abord et ensuite pour tous les autres, par contraste et par conséquence. » (p. 101). Qu’est-ce à dire ? C’est dire que l’être est d’abord avec Dieu, que Dieu est d’abord l’être, et que nous ne sommes que par lui, par dérivation. L’être ne nous convient pas en soi premièrement, mais il est d’abord le propre de Dieu. Ce renversement est décisif : « la façon dont Dieu est être précède et cause la façon dont les étants reçoivent l’être autant que l’essence » (p. 101). Il faut commencer par Dieu, qui est le commencement.
À cet égard, le P. Humbrecht donne toute sa place et son importance à l’attribut de simplicité qui est le premier qu’envisage saint Thomas dans la Somme théologique (q. 3) et qui marque tout discours sur Dieu. Dieu est simple, toutes ses propriétés ne font qu’un en lui, sont identiques entre elles et à lui. Toutes les perfections qui existent dans les créatures – être, vivre, penser, aimer, etc. – existent à titre premier en Dieu, sur un mode parfaitement simple, inimaginable pour nous. La multiplicité que nous constatons à chaque instant dans le créé a sa source en Dieu qui est pur et simple. Connaître et parler de l’être suppose donc de l’étudier en Dieu même où il se réalise parfaitement et simplement. « L’interrogation sur l’être et l’essence présente donc une double exigence : celle de diffracter désormais dans les créatures ce qui est un en Dieu, et celle de n’envisager cette diffraction que par contraposition avec la situation de Dieu, premier envisagé, et, pour tout dire, forge de ces concepts-là. » (p. 113). On voit donc à quelle condition on peut attribuer l’être à Dieu : à condition de penser l’être à partir de Dieu. On n’évitera de réduire Dieu à notre mode fini d’être et de connaître à moins qu’on renverse le sens de la métaphysique, et qu’on la commence à Dieu. L’être ne peut valoir pour Dieu que s’il vaut d’abord et principalement pour lui. La transcendance de Dieu n’est pas signifiée en l’excluant de l’être, qui ne vaudrait que pour le fini, mais au contraire, elle est signifiée par et dans l’être même. « C’est par son être même que Dieu diffère de tout autre étant » (De Potentia, q. 7, a. 2, ad 4, cité p. 119). Ce n’est pas que Dieu transcende l’être, mais que l’être de Dieu est transcendant. Dieu n’est pas Dieu sans l’être, mais par l’être. Pour le dire autrement, Dieu est « situé au-delà de l’étant, connu et commun, mais il n’est pas au-delà de l’être. » (p. 65). L’équilibre thomasien est parfait : Dieu « n’est pas au-delà de l’être » – ce qui rend possible la métaphysique –, mais il est « au-delà de l’étant » – ce qui évite et exclut toute onto-théo-logie.
Qu’est l’être de Dieu ? Le P. Humbrecht ne s’étend guère sur le sujet, de sorte que son ouvrage est, si l’on peut dire, plutôt un « discours de la méthode » de lecture et de pratique du thomisme que des « méditations métaphysiques » ; il introduit à la lecture des œuvres de Thomas en éclaircissant l’intention et le projet, plutôt qu’en résumant ses thèses. L’auteur considère toutefois le nom que privilégie Thomas, et qu’il invente : « l’Être même subsistant » (Ipsum Esse subsistens). Que signifie-t-il ? « S’il est l’Être même subsistant, c’est qu’il subsiste, en vertu de son essence, qu’il contient en soi la perfection de l’être, que nulle perfection ne lui manque, et qu’aucune ne peut lui être ajoutée » (p. 117-118). Ce nom manifeste « le caractère universel, illimité et infini de l’être divin » (p. 118), qui est « la mesure, non mesurée elle-même de tout l’être » (p. 118). Humbrecht remarque l’alliance thomasienne de l’aristotélisme et du néoplatonisme : « En définitive, « Être même subsistant » est une expression signée Thomas d’Aquin, qui désigne Dieu au bénéfice de sa double tradition néoplatonicienne et aristotélicienne, comme réconciliée par elle » (p. 123). Se trouve confirmé encore une fois le génie thomasien de la synthèse, qui est aussi une création.
V. L’acte d’être
Nous pouvons nommer Dieu « être » parce que l’être est une perfection, et même la première de tous, ce qui en fait le nom divin le plus approprié. Mais qu’est-ce que l’être ? Nous avons noté la puissante thèse selon laquelle « la façon dont Dieu est être précède et cause la façon dont les étants reçoivent l’être autant que l’essence » (p. 101). La doctrine sacrée, ou théologie, produit de la métaphysique ; en l’occurrence, elle mène la métaphysique à la considération la plus profonde qui soit de l’être : elle découvre l’esse, ou acte d’être. Humbrecht rappelle la grande thèse de Gilson[18], selon laquelle « la métaphysique de l’Exode », c’est-à-dire la nomination de Dieu par lui-même en tant que « Celui qui est », est à l’origine du progrès considérable, et même ultime, en métaphysique. Les formulations de ce progrès décisif et capital abondent dans l’ouvrage – citons-en une : « L’être est l’acte de l’essence et non l’essence en acte. Il est l’acte premier de la substance (ou forme substantielle), et non un mode de celle-ci ou acte second, une concrétisation de l’essence mais qui n’ajouterait rien à l’essence elle-même. Dans l’ordre de l’être, l’acte est antérieur à la substance et non postérieur à l’essence » (p. 190). Un étant se définit comme ce qui a l’être ; c’est dire qu’il est composé d’essence et d’être – essence par laquelle il est ce qu’il est, être (esse) par lequel il est. L’essence ou substance est en puissance par rapport à l’être, qui l’actue et la fait être. Thomas assume Aristote, pour qui c’est la forme ou la substance qui est l’acte de l’étant, mais il le dépasse, en posant un second niveau, selon lequel l’être est l’acte de cette forme substantielle. « Il y a donc aussi deux actes dans tout étant : l’acte qu’est la forme, et l’acte qu’est l’être pour la forme substantielle » (p. 196)[19].
Aristote, ou un autre philosophe, pouvait-il atteindre ce niveau ? Non, répond clairement Humbrecht, après Gilson, puisqu’une telle métaphysique de l’acte d’être trouve sa source dans la doctrine de la causalité divine efficiente, c’est-à-dire de la création. « Si donc Aristote parle des substances en acte, il revient à Thomas de postuler l’acte d’être de ces substances mêmes. Entre la substance en acte d’Aristote et l’être comme acte (de la substance) de Thomas, ce n’est pas le même acte. L’un a été découvert par le Philosophe, l’autre l’est par Thomas, en tant que docteur chrétien, même s’il l’exprime en termes métaphysiques » (p. 197-198). Nous sommes dans la seconde modalité de la métaphysique : une métaphysique produite et constituée par la théologie.
En même temps, l’auteur souhaite qu’on ne réduise pas la métaphysique de saint Thomas à une seule « métaphysique de l’acte d’être ». Le joyau thomasien, magnifié par Gilson, ne prend sa valeur que replacé dans un ensemble plus vaste, « au cœur de son écosystème » (p. 226). La notion est capitale, et il fallait y insister après des siècles d’oubli, mais elle n’est pas pour autant le principe duquel tout se déduirait, la vérité première d’un système qui en découlerait. « Peut-être l’acte d’être jouit-il malgré lui et paradoxalement du prestige de l’essence, couronne perdue pour elle et transporté sur lui. » (p. 183). Le temps est venu, selon Humbrecht, de remettre l’acte d’être à sa juste place, sans le mystifier ou le glorifier outre mesure. Thomas lui-même, d’ailleurs, n’en parle que peu, quoiqu’en des passages décisifs. Rien ne sert non plus, dans le sillage de certains textes de Gilson, de critiquer ou de dévaloriser l’essence, laquelle importe tout autant que l’être[20]. Il faut penser leur composition, non leur opposition. Pour emprunter une formule plus équilibrée de Gilson, on dira que la métaphysique thomasienne de l’être n’est ni un existentialisme ni un essentialisme, mais une troisième voie, car « l’être n’est ni l’existence ni l’essence, il est leur unité[21]».
VI. L’analogie
Reste enfin à étudier un dernier point majeur de l’œuvre thomasienne, aussi célèbre que discuté : la question de l’analogie. Là encore, T.-D. Humbrecht joue la différence entre Thomas et Aristote : si l’idée d’analogie – ou plutôt « deux moitiés d’analogie » (p. 148) – provient du Philosophe, Thomas n’en hérite pas sans la modifier et la transformer radicalement. Plus encore, pour une histoire de la philosophie médiévale suffisamment attentive aux discontinuités et variations, « parmi les Médiévaux latins, chacun a sa propre conception de l’analogie. Elle est la traduction sémantique de décisions qui la précèdent et qui la dépassent » (p. 140) – de décisions métaphysiques, bien entendu, et peut-être même théologiques.
Le P. Humbrecht s’inscrit dans le sillage du travail de la « révolution interprétative » (p. 144) que constitua La doctrine de l’analogie de l’être selon saint Thomas d’Aquin (1963) du P. Bernard Montagnes. Révolution, parce qu’une certaine analogie attribuée à saint Thomas se révélait celle de Cajetan, laquelle était autre chose qu’une interprétation, et qu’il devenait manifeste que la doctrine thomasienne de l’analogie n’était pas sans variations ni tâtonnements.
Pour résumer ces transformations de l’analogie, on dira simplement que c’est une certaine conception métaphysique de la causalité (et de la participation) qui commande la doctrine de l’analogie. La métaphysique commande la logique, et non l’inverse. Thomas tient d’abord la causalité divine comme une causalité formelle et exemplaire : « Dieu est un modèle, il est imité, et cette imperfection de l’imitation par les créatures pourrait suffire à marquer la déclivité depuis la transcendance de Dieu » (p. 152). Sauf que Thomas se rend compte de la tendance irrésistiblement univocisante d’une telle conception, ou plutôt de la dialectique qu’elle implique, entre univocité et équivocité. « Denys et surtout Maïmonide ont manifesté qu’une telle causalité exemplaire supposait une dangereuse univocité, qu’ils ne parvenaient à empêcher qu’au prix d’un renoncement à une connaissance conceptuelle pour le premier, et surtout celui de l’équivocité radicale pour le second » (p. 153). Il faut donc trouver un équilibre, un juste milieu, c’est-à-dire une véritable analogie, qui n’est de l’ordre ni d’« équivocités atténuées » ni d’« univocités partielles » (p. 150).
Cet équilibre est atteint par la primauté accordée à la causalité efficiente pour penser la création divine. La cause efficiente donne l’être aux créatures qui sont donc des effets, ce qui implique une infranchissable distance. Celle-ci permet l’articulation admirable de la ressemblance, opérée par la causalité exemplaire, et de la dissemblance, œuvre de la causalité efficiente. « L’usage conjoint des deux causalités offre à Thomas une liberté d’énonciation inouïe, celle de pouvoir parler des créatures sans rien atténuer de leur part de ressemblance à Dieu, puisque celle-ci se fonde sur une dissemblance constitutive de l’être divin, établie par l’action créatrice » (p. 158). Par nature, la créature est créée, autre que Dieu, infiniment distante et dépendante, comme l’effet l’est de sa cause. Mais cette création est à l’image de Dieu, donc lui ressemble. Cette ressemblance permet de parler de Dieu à partir des perfections créées.
Comment connaître et dire Dieu ? Humbrecht résume en quelques rapides pages ce qu’il étudia longuement dans son ouvrage Théologie négative et noms divins chez saint Thomas d’Aquin, paru en 2006. La distinction capitale est entre la réalité signifiée (res significata) et le mode de signifier (modus significandi) : on attribue à Dieu la perfection ou la réalité signifiée de manière vraie, mais sans savoir comment et à quel point cette réalité signifiée se réalise en Dieu, parce que notre mode de signifier est insuffisant. Par exemple, pour l’être, « l’intellect, en attribuant l’être à Dieu, transcende le mode de signifier, en attribuant à Dieu ce qui est signifié, et non pas le mode de signifier » (De Potentia, q. 7, ad 7, cité p. 168). « Ni identité, ni rupture, le langage ne repose pas sur la saisie de concepts communs à Dieu et aux créatures mais plutôt sur la vérité d’un discours, dont les perfections assurent le transfert selon l’être et la distance quant à notre mode de connaître. Thomas, pour en rendre compte, distingue le mode d’être divin, qui nous reste aussi inconnu que son essence, et la vérité de nos énonciations au sujet de Dieu, certes selon les limites de notre mode de connaître, mais vraies quant à leur intention de signifier. » (p. 171).
*
Que conclure de tout cela ? Quoique le livre soit de taille modeste (paru en poche directement), j’espère que l’on a pu mesurer la densité et l’importance de ces pages. Écrites dans un style alerte, précis, travaillé et plaisant – l’auteur a aussi écrit deux romans –, elles nous font plonger au cœur des débats interprétatifs du siècle dernier, les parcourent et en tirent conclusions et avertissements. Surtout, elles nous dévoilent une œuvre exceptionnelle, celle de saint Thomas, peut-être trop connue et par conséquent mal connue, comme disait Hegel, et qui mérite d’être lue et relue avec attention et rigueur. On ne peut délaisser l’histoire sous prétexte d’atteindre la vérité des choses mêmes, si c’est pour ensuite attribuer à Thomas ce que nous voudrions qu’il ait dit mais qu’il n’a pas dit.
Un tel ouvrage, « publié dans la perspective du triple centenaire de Thomas d’Aquin : canonisation (1323-2023), mort (1274-2024) et naissance (1225-2025) », selon la quatrième de couverture, donne une nouvelle jeunesse au grand saint et docteur de l’Église, parce qu’elle le fait redécouvrir, dans sa nouveauté et son intrépidité, par-delà les légendes et les images d’Épinal qui ont fait tant de mal à son œuvre. Plus que jamais, le P. Humbrecht nous invite à nous faire thomasien, plutôt que thomiste ; lecteur patient, minutieux et éventuellement critique, plutôt qu’idéologue paresseux se contentant de poncifs ou de faux-semblants. « Que le lecteur s’attaque sans différer à son œuvre, au moins par questions entières, sans effroi ni fausse pudeur, avec ce qu’il faut de volonté d’en découdre. Qu’il abatte la statue pour animer le marbre. Que saint Thomas lui devienne familier » (p. 299-300). Voilà l’invitation finale d’un disciple mûr et expérimenté de saint Thomas d’Aquin, qui résonnera assurément dans le cœur des jeunes amoureux de la vérité.
***
[1] Trois livres qui sont trois thèses : Théologie négative et noms divins chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2006 (thèse de philosophie) ; Trinité et création au prisme de la voie négative chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Parole et Silence, 2011 (thèse de théologie) ; Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique. Nature, modalités et fonctions de la métaphysique, comprenant le rapport à Dieu de cette science, ainsi que sa confrontation avec la doctrine sacrée, Paris, Parole et Silence, 2021 (thèse d’habilitation à diriger des recherches en philosophie).
[2] T.-D. Humbrecht a présenté plusieurs rééditions de livres de Gilson, dont celle d’Introduction à la philosophie chrétienne (Paris, Vrin, 2007), qui est en réalité… une « Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin », soit ce que Humbrecht fait présentement !
[3] Étienne Gilson, Le Thomisme, Paris, Vrin, 1965, p. 16, cité ici p. 21-22.
[4] Fernand Van Steenberghen, La Philosophie au XIIIème siècle, Leuven, Peeters, 1991, p. 318, cité ici p. 22. T.-D. Humbrecht cite et s’oppose aussi au thomiste américain John Wippel, auteur d’un monumental La Métaphysique de saint Thomas d’Aquin. De l’être fini à l’être incréé, trad. fr., Paris, Cerf, 2022) : « Comme tous ces éléments [fondamentaux de sa métaphysique] sont présents dans ses écrits, ils constituent une invitation pressante, pour l’historien contemporain de la philosophie à prendre Thomas au mot et à les utiliser comme appui pour reconstituer sa pensée métaphysique. C’est ce que je veux essayer de faire dans ce livre » (cité ici p. 22).
[5] Remarque citée en exergue de Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, op. cit., p. 9 : « On peut poser comme loi philosophique historiquement vérifiable qu’il y a une corrélation nécessaire entre la manière dont on conçoit le rapport de l’État à l’Église, celle dont on conçoit le rapport de la philosophique à la théologie et celle dont on conçoit le rapport de la nature à la grâce » (Étienne Gilson, Dante et la philosophie, Paris, Vrin, 1939, p. 200).
[6] Henri de Lubac, Surnaturel, éd. Paris, Cerf, 2021 ; voir aussi la correspondance avec Gilson, Lettres de monsieur Étienne Gilson au père de Lubac et commentées par celui-ci, éd. Paris, Cerf, 2013. Le problème a occupé une bonne partie des réflexions thomistes, voir en particulier Surnaturel : une controverse au cœur du thomisme au XXème siècle, Toulouse, Revue Thomiste, t. CI, n°1-2, 2001, et Marie de l’Assomption, Nature et grâce chez saint Thomas d’Aquin. L’homme capable de Dieu, Paris, Parole et silence, 2020.
[7] Marie-Dominique Chenu, St Thomas d’Aquin et la théologie, p. 17, cité ici p. 93, n.1.
[8] Ibid.
[9] La thèse est d’abord présentée en conclusion de Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, op. cit., p. 1311 sq.
[10] Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, op. cit., p. 1317.
[11] Étienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 19321, 1944², p. 50, n.1.
[12] Étienne Gilson, Le Philosophe et la théologie, Paris, Vrin, 2005, p. 97.
[13] Aristote, Métaphysique, 993b25 : « Et chaque chose par laquelle la propriété de même définition appartient aussi aux autres choses est cause au plus haut point entre toutes les autres ».
[14] Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, éd. Paris, PUF, 2013, chap. VIII, §8, p. 329. Ce chapitre est issu du colloque, « Saint Thomas et l’onto-théologie », Actes du colloque tenu à l’Institut catholique de Toulouse les 3 et 4 juin 1994, Revue thomiste, t. VC, 1995, n°1.
[15] Voir les travaux d’Olivier Boulnois : (éd.) Duns Scot, Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant, Paris, PUF, 1988 ; Être et représentation. Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot, Paris, PUF, 1999 ; Métaphysiques rebelles. Genèse et structure d’une science au Moyen-Âge, Paris, PUF, 2013.
[16] O. Boulnois, Métaphysiques rebelles, op. cit., p. 249.
[17] T.-D. Humbrecht s’inspire-t-il d’une tout aussi subtile formule de Jean-Luc Marion : « Prendre au sérieux Thomas d’Aquin demande-t-il de penser Dieu à partir de l’être ou l’être au départ de Dieu ? » (Dieu sans l’être, op. cit., p. 331) ?
[18] Étienne Gilson découvre l’acte d’être chez saint Thomas d’Aquin à la fin des années 1930. Il le situe à sa juste place dans l’écosystème thomasien dans la quatrième édition du Thomisme de 1942, puis relit l’histoire de la métaphysique à l’aune de cette découverte dans son grand livre L’Être et l’essence en 1948, et continue à traiter de l’acte d’être dans ses textes ultérieurs de métaphysique, Introduction à la philosophie chrétienne (1960), Le Philosophe et la théologie (1960) et Constantes philosophiques de l’être (posthume, 1983). Deux autres thomistes à la même époque mettent l’accent sur l’acte d’être : Cornelio Fabro (Participation et causalité selon saint Thomas d’Aquin, 1961) et Joseph de Finance (Être et agir dans la philosophie de saint Thomas, 1945).
[19] Relevons que certains thomistes récusent la présence chez Thomas d’une telle doctrine de l’acte d’être, qui ne serait qu’une invention gilsonienne. Un exemple de cette interprétation diamétralement à celle de Gilson et donc de Humbrecht est la critique de Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, développée par Guy Delaporte sur son site : https://www.thomas-d-aquin.com/page-lectures-31.html. La métaphysique de saint Thomas s’en trouve ramenée pour l’essentiel à celle d’Aristote. Cela confirme au moins que c’est la doctrine de l’acte d’être qui fait le départ entre Aristote et Thomas.
[20] Voir Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, op. cit., p. 664 et 1335.
[21] Étienne Gilson, L’être et l’essence, éd. Paris, Vrin, 1987, p. 301. Dans cette même page, il renvoie dos-à-dos existentialisme et essentialisme comme aussi partiels l’un que l’autre : « De même que l’essentialisme est une philosophie de l’être moins l’existence, l’existentialisme est une philosophie de l’être moins l’essence ».








