« Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement »
La Rochefoucauld
I Enjeux et méthode
L’ouvrage de William Néria, Le mythe de la caverne. Platon face à Heidegger, est issu de son travail de doctorat. Dans la ligné de ses travaux antérieurs, consacrés à Plotin, Spinoza ou Shankara, et à la question d’un dépassement de la raison, il propose dans ce livre une confrontation des interprétations platonicienne et heideggérienne du mythe de la caverne. Il rend compte de la préoccupation qui l’a animé dans l’élaboration de ce projet, et qui devait initialement trouver son expression dans une problématique néoplatonicienne consistant à voir dans quelle mesure le mythe de la caverne devait se révéler « structurellement orienté vers un dépassement de la raison et, par conséquent, de l’ontologie[1] ». Or, ce projet initial a été réorienté vers la mise en évidence des similitudes et différences qui se découvrent par la confrontation des philosophies de Platon et de Heidegger. Rappelant que la lecture de Platon par Heidegger a fait l’objet d’une réélaboration progressive dans son œuvre, W. Néria met particulièrement en évidence l’interprétation que celui-ci livre de l’allégorie de la caverne dans le cours de 1931-1932, intitulé De l’essence de la vérité. Approche de l’ « allégorie de la caverne » et du Théétète de Platon[2]. Il s’agit donc de mettre en évidence l’avènement de la question de la vérité comme alètheia, soit comme « l’ouvert sans retrait », et notamment son articulation avec la question de la rectitude, qui sera affirmée avec davantage de force dans le texte de 1940, La doctrine de Platon sur la vérité[3]. En revanche, W. Néria passe sous silence l’enjeu de cette question au sein de Être et temps, qui y joue pourtant un rôle fondamental dans la constitution d’une approche existentiale du Dasein. Ce manque est cependant la plupart du temps conjuré, en ce que le cours de 1931-1932 se fonde sur une conceptualité assez proche de celle qui est mobilisée dans le grand ouvrage de Heidegger.
Sur la forme, le style de l’ouvrage est parfois très enthousiaste (usage récurrent des points d’exclamation, d’interrogation, et des points de suspension), ce qui a pour conséquence de voiler quelques enjeux qui auraient mérité des développements plus rigoureux. Par exemple, à la page 65 de l’ouvrage, W. Néria remarque que « Heidegger ajoute, par rapport à la traduction de Georges Leroux, la dimension des mains. » (65), pour conclure ensuite qu’« Heidegger s’écarte du texte d’origine, certes, mais l’embellit et l’éclaire à sa façon » (67). Or, la question des « mains » aurait pu être questionnée de manière plus analytique : d’une part, l’allégorie laisse entendre que les mains des prisonniers sont libres, ce qui peut laisser penser qu’ils peuvent en user notamment par l’exercice du vote, propre du régime démocratique[4]. Parallèlement, le rapport du Dasein au monde sur le mode de l’ustensilité par le biais des outils[5] aurait pu être mobilisé ici pour approfondir la divergence des interprétations.
Concernant le mode d’exposition, la divergence des projets platoniciens et heideggériens, telle qu’elle est mise en œuvre par W. Néria, trouve son expression la plus aboutie dans la conclusion de l’ouvrage. Peut-être aurait-il fallu insister sur ce point dès l’introduction, afin d’en préciser les enjeux, et de marquer les divergences structurelles avec plus de force tout au long du commentaire. La question de la métaphysique pouvait en effet, dès le début, être franchement discutée, d’autant plus que le statut du méta-physique n’est pas le propre de la philosophie platonicienne[6]. Y a-t-il donc une « métaphysique » platonicienne, ou faut-il caractériser sa philosophie comme « spirituelle » ? Et s’il y a métaphysique, en quoi se distingue-t-elle de la caractérisation onto-théo-logique qu’en donne Heidegger ? L’ouvrage de W. Néria a le mérite de mettre en évidence, quoi qu’il en soit, une ligne de partage nette entre deux courants structurants de l’histoire de la métaphysique : l’approche heideggérienne qui fait de l’oubli de l’être le destin de la philosophie occidentale, ouvrant ainsi la voie à une interrogation sur le sens de l’être, et une approche « spirituelle », dont on trouve les échos dans une certaine tradition philosophique et mystique. Cette deuxième possibilité est nettement privilégiée par l’auteur, au sens où elle s’inscrit dans la lignée de ses travaux précédents et actuels.
II Etapes de l’analyse
L’introduction justifie le projet de l’ouvrage dans son enjeu philosophique général, ainsi que la méthode que l’auteur compte déployer. Une des questions qui anime ce travail dans sa globalité consiste à mettre en évidence la différence d’interprétation qui se joue entre la « signification spirituelle » (36) du commentaire que Platon réalise de son propre mythe, et « l’assignation métaphysique » (36) heideggérienne, qui voit dans celui-ci les ferments du destin occidental d’une compréhension de l’être. Selon Heidegger, l’identification de l’être à la présence, sous l’aspect de l’idea, contient ainsi les principes de la « métaphysique ». Le cours de 1931-1932 met ainsi en évidence l’articulation de l’ouvert sans retrait avec l’idée du Bien comme telos de toute pensée philosophique. En outre, il dégage l’articulation chiasmatique[7] qui lie la vérité comme hors-retrait, à la non-vérité comme seul chemin permettant d’accéder à la première. Structurellement, donc, les deux penseurs relèvent ce qui fait obstacle dans la quête de la vérité, ainsi que les conditions auxquelles la philosophie va conquérir sa propre essence. La confrontation des deux interprétations, selon William Néria, doit se faire suivant une découpe du mythe de la caverne en six étapes : 1) la vision des ombres, 2) le désenchaînement des prisonniers, 3) la remontée hors de la caverne vers le soleil, 4) la vision des êtres au sein de la lumière, 5) la contemplation du soleil, 6) la redescente dans la caverne. Cette découpe ne correspond ni aux quatre stades de la ligne que Platon dégageait en République en 509b[8], ni à la lecture qu’Heidegger propose lui-même dans le Cours de 1931-1932. Ce choix, qui aurait mérité quelques explicitations supplémentaires, n’entrave cependant pas le détail des analyses de l’auteur dans son travail, et lui permet de mettre en place une méthode comparative. Cette méthode comparative consiste à faire mention du texte platonicien, puis à le mettre en relation avec le commentaire que Platon fait lui-même du mythe[9], pour ensuite le confronter avec l’interprétation heideggérienne.
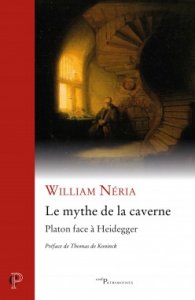
La première partie (« Dans la caverne ») prend en compte les deux premières étapes mentionnées ci-dessus. Elle se consacre à l’examen de la situation des prisonniers qui font initialement face aux ombres sur la paroi de la caverne et qui, en l’absence de toute epistémè, se livrent aux opinions diverses et errent dans des demi-sciences. L’interprétation heideggérienne part de la même situation, celle de l’apaideia, pour montrer que le Dasein est englué dans l’évidence de l’étant, un étant dont l’ombre fait toute la substance. La condition humaine est donc en retrait de l’être, et ne peut se connaître comme telle. W. Néria remarque avec justesse que l’opposition entre Platon et Heidegger tient à ce que le premier se fonde sur l’idée que l’âme est prisonnière de son corps, alors que le Dasein est « prisonnier de sa posture » (66). Cette remarque structure d’ailleurs la suite de l’analyse, qui permet de distinguer la perception platonicienne, dont le corps est l’opérateur, de la perception au sens heideggérien, qui enveloppe une pré-compréhension du monde qui l’environne. Il faut ici noter le « décalage » (80) qui subsiste entre le maintien d’un dualisme ontologique et une appréhension herméneutique de la situation du Dasein, qui ne « transcende pas sa nature corporelle » (79). Le monde des ombres attache les prisonniers tant aux sensations qu’au plaisir, pris pour le bien. Dans cette situation de méconnaissance (doxa platonicienne, oubli de l’être heideggérien), l’âme et le Dasein ignorent leur essence, mais ne souffrent pas. Pour Platon, l’âme, captive du corps, identifie être et sensation, et le Dasein est engoncé dans la quotidienneté de son existence, entre bavardage et préhension de l’étant[10]. Peut-être aurait-il fallu davantage pluraliser les interprétations[11], au sens où la démarche « spirituelle » recouvre quelques peu les enjeux politiques de l’allégorie. Par exemple, les thaumatopoiois auraient mérité un développement plus important. Si l’auteur les assimile aux artistes[12], il aurait fallu questionner la possibilité qu’ils soient non seulement les politiques, mais aussi les sophistes[13] ou les rhéteurs : la situation dans la caverne, ainsi que la libération qui s’ensuit, se comprennent dans une relation dialectique avec ces figures centrales de la philosophie platonicienne, qui vont jusqu’à inquiéter la figure du philosophe lui-même[14].
Le deuxième stade constitue un premier moment de libération : celui du retournement, dans la caverne, vers la lumière. Il s’agit d’un moment intermédiaire, l’âme étant écartelée entre la passivité extrême du théâtre d’ombres et d’échos, et le fait de voir « plus correctement » (515d) les choses. Peut-on en conclure, avec W. Néria, que la « raison peut maintenant faire son apparition » (109) ? Le raisonnement dianoétique ne sera en effet véritablement mobilisé qu’une fois la sortie de la caverne opérée. A ce stade prévaut encore la doxa, et si le fait de contraindre les prisonniers à répondre au « ce que c’est » rappelle la description de Socrate dans le Lachès[15], on peut supposer, avec Monique Dixsaut, qu’il s’agit seulement d’un « noble sophiste[16] » qui pose la question à ce moment. Comment cela pourrait-il en effet être le philosophe, si le retour dans la caverne ne s’est pas encore opéré ? Selon W. Néria, il faut cependant relever qu’en ce lieu ambigu se révèle « une dimension de leur être plus en fond : les Idées pour l’âme, l’être de l’étant pour le Dasein » (118). Pour autant, l’expérience de la lumière dans la caverne est loin d’être un accès total à la vérité, car elle n’est pas même encore comprise comme insuffisante (voir p. 141). W. Néria souligne que l’opposition entre Platon et Heidegger se construit ici sur la question de la science (voir p. 149), le second ne considérant pas que le Dasein en fasse usage dans sa libération. Mais l’on peut se demander si Platon admet à ce stade l’usage de la géométrie ou de l’astronomie comme le soutient l’auteur, ou s’il ne considère pas plutôt que les seules « sciences » qui ont cours sont le calcul, tel que le commerçant l’utilise, ou un genre de savoir empirique propre à la théâtrocratie qu’il évoquera au livre III des Lois[17].
La seconde partie de l’ouvrage débute avec le troisième stade : « La montée dans la lumière ». Il s’agit du second moment de la remontée vers l’être, moment de conversion qui consiste, selon W. Néria, à renverser l’usage habituel des sciences que sont le calcul, la géométrie ou l’astronomie. Ce renversement induit donc, pour l’âme, une véritable conversion, et pour le Dasein une aspiration à l’être (Seinserstrebnis) qui se trouve déclose par l’avènement de la lumière, ou du diaphane. La violence inhérente à la transformation du regard permet néanmoins à l’âme de se rapprocher de son lieu propre, et au Dasein de rentrer « en bataille avec lui-même, c’est-à-dire contre ses conceptions sur le hors-retrait de l’étant » (170). L’on entre alors dans ce qui correspondrait au troisième stade de la ligne, celui qui mobilise la dianoia sous le mode de l’hypothèse. Peut-être aurait-il fallu marquer plus nettement la rupture qui s’opère ici entre Platon et Heidegger : dans le cours de 1931-1932, celui-ci passe sous silence la dimension propédeutique des sciences évoquées par Platon, dont on sait qu’elles ne sont qu’un moment en vue de la purification de l’âme. Selon Heidegger, la science a pour effet de « disloquer la relation à l’étant, de faire passer à l’homme tout instinct pour l’essence de la nature et d’étrangler chez lui l’instinct pour l’essence de l’homme[18] ». W. Néria remarque ainsi que le terme de raisonnement fait l’objet d’un « emploi polysémique » (195) : si l’auteur soutient que le Dasein, à ce stade, se questionne lui-même selon une tonalité existentiale, et pas de manière logique, alors il faut effectivement marquer la franche divergence de l’interprétation heideggérienne du mythe de la caverne d’avec le texte originel. Si le questionnement produit un changement dans la position du Dasein vis-à-vis de l’étant, alors il faut également reconnaître que c’est en dehors de toute pensée orientée scientifiquement. L’ouvert sans retrait n’est pas encore dévoilé à ce stade, l’auteur notant que le Dasein « est donc éclairé, mais n’éclaire encore rien ; tout en se désabritant, il ne désabrite rien. » (207).
Le quatrième stade est intitulé « La lumière ». Partant de ce qu’il y a « deux sortes de troubles dans les yeux » (518a), il s’agit de voir maintenant comment les prisonniers vont réagir face à la lumière du soleil, à quelle condition ce nouvel aveuglement peut contenir les prémices d’une libération. Cet aveuglement ne demeure d’ailleurs pas, car le prisonnier de la caverne peut s’y habituer : la dialectique est le moment d’une confrontation avec les essences des choses. Elle est ce savoir synoptique qui permet d’éviter le morcellement des compétences particulières. De son côté, le Dasein se confronte à ce qui est « le plus hors-retrait », soit les idées. Celles-ci possibilisent l’ouvert sans retrait, en tant qu’il peut se manifester au Dasein. Mais il ne faudrait pas en attendre une révélation absolue, clôturant le cheminement de celui-ci vers l’être : d’une part, c’est le Dasein qui s’ouvre lui-même aux idées en se disposant à les entendre, et, d’autre part, pour celui-ci « la dialectique ne représente pas une science à proprement parler » (223). Heidegger remarque en effet que « la vérité n’est pas une possession tranquille dont nous jouirions en repos[19] ». Sur la question de la dialectique, W. Néria éclaire les divergences entre Platon et Heidegger à partir de textes qui sont extérieurs au cours de 1931-1932, puisque celui-ci ne fait presque pas allusion à la question du logos, quelle qu’en soit la modalité : l’articulation du Dasein et de la vérité comme ouvert sans retrait s’élucide à partir du diaphane plus que du langage. W. Néria met en évidence avec raison un point limite dans l’ascension vers l’être, partagé par Platon comme par Heidegger : l’accès à l’être ne saurait se totaliser sous la forme d’une intuition. Peut-on dire alors que l’âme comme le Dasein « se confrontent aux limites de la technique dialectique » (258) ? L’analyse heideggérienne ne prend pas tant acte des limites du logos en son exercice dialectique que de l’inséparabilité de l’ouvert sans retrait dans son lien nécessaire avec le retrait, ou avec la non-vérité. En outre, Heidegger laisse ici de côté la dimension érotique de l’âme en quête de son être propre, décrite par Platon dans le Phèdre ou le Banquet. Enfin, et plus décisif encore, Heidegger articule à ce stade la critique fondamentale de la constitution de l’essence de la vérité dans la philosophie platonicienne, et donc occidentale : l’identification de la vérité à l’idée, en maintenant une identité de l’eidos et de l’idea. Or, ce point aurait pu donner lieu à des analyses plus serrées en vue de dégager la rupture fondamentale qui s’opère entre Platon et Heidegger, point sur lequel nous reviendrons à la fin du paragraphe suivant.
La troisième partie débute avec le cinquième stade, dont l’accomplissement est donné par la vision du Bien. W. Néria souligne la différence qui existe entre l’idée du Bien et le Bien lui-même, en tant que puissance première et cause de tout être. Ainsi, les « objets ontologiques sont transgressés par le Bien » (p. 272), lui-même au-delà de l’essence[20]. A cette expérience de l’anhypothétique pour l’âme correspond celle du Dasein, qui peut espérer se confronter à l’ouvert sans retrait. Heidegger interprète ce moment comme dévoilant le lien qui existe entre l’alètheia et l’idée du Bien. L’idée est comprise comme le plus étant, puisqu’elle donne à comprendre l’être de l’étant à partir de ses déterminations propres. W. Néria évoque, en de belles pages serrées (voir p. 271 à 279) les difficultés que rencontre l’entreprise heideggérienne : l’idée du Bien est-elle une idée comme les autres ? Ne doit-elle pas être soutenue par le Bien comme condition de son appréhension ? Heidegger semble parfois hésitant dans le Cours de 1931-1932, bien qu’il mette en évidence la dynamis comme seule détermination qu’on puisse entendre pour caractériser l’ouvert sans retrait sous la forme du Bien. Il dégage ainsi la « potentialisation » comme « limite de la philosophie[21] ». Nous citons un passage un peu plus long de la thèse pour commenter ce point, qui nous semble décisif, bien qu’appelant de plus amples développements :
« le commentaire de Heidegger se rapproche celui de Platon [sic], dans la mesure où l’âme et le Dasein cherchent à passer outre les déterminations ontologiques universelles d’un être particulier pour saisir l’Idée du Bien qui les fonde. Il est donc remarquable de constater que Platon et Heidegger se rejoignent quant à la modalité du surpassement des déterminations ontologiques de l’être et de leur caractère universalisant ! »[22]
S’il y a bien un dépassement de l’ontologie (ce qui force toutefois l’anachronisme vis-à-vis de Platon) chez les deux philosophes, au sens d’une science des essences, il faut néanmoins marquer la différence fondamentale des deux projets. D’une part, l’on sait à quel point ce texte a influencé le néoplatonisme par le biais de l’epekeina tes ousias. Le dépassement de l’ontologie par le néoplatonisme[23] a pour contrepartie l’affirmation de l’Un : en ce sens, la potentialisation, « limite » de la philosophie pour Heidegger, en est la réalisation. Le dépassement de l’ontologie par Heidegger, nommé « destruction » dans le § 6 d’Être et temps, est effectué par découverte du temps comme dimension fondamentale du Dasein, et de l’existence comme sa manière propre d’être. Ainsi, une philosophie de l’Un et une philosophie de l’existence : telles sont les deux voies du dépassement de l’ontologie que l’on aurait pu mettre en exergue afin de distinguer les deux projets philosophiques, et donc les deux commentaires du mythe de la caverne. William Néria revient sur cette question, dans les pages de conclusion qui clôturent l’examen du cinquième stade, en soulignant que pour Platon « l’âme vit au-delà des essences eidétiques, tandis que le Dasein se meut dans un libre espace encore contenu dans les essences eidétiques » (p. 307).
La dernière section, intitulée « L’idée illuminatrice dans la Cité », développe le moment de la descente[24] de l’âme dans la caverne. Cette descente, ou ce « retour[25] » selon Heidegger, est à la fois l’effet de la libération du prisonnier devenu philosophe, et la mise en œuvre de la libération au sein de la caverne. Point d’orgue de la pensée devenue philosophique, il ne s’agit pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais bien de porter à la connaissance des prisonniers la thématisation des ombres comme ombres. La portée allégorique du récit met en évidence l’éternelle tâche qui incombe au philosophe : Heidegger écrit ainsi que : « l’ouvert sans retrait n’a lieu qu’au sein de l’histoire d’une constante libération[26] ». Cette dimension historiale de l’exercice philosophique transcende l’histoire même, de la même manière que Socrate est celui qui dit « toujours la même chose[27] », quels que soient ses interlocuteurs. W. Néria souligne que « l’âme est destinée à régner grâce à l’excellence de sa connaissance, sur les autres habitants de la cité, alors que le Dasein n’a pas cette vocation[28] ». Il remarque avec raison ce qui distingue les projets philosophiques de Platon et de Heidegger : si pour le premier, la paideia a pour but le bon gouvernement de la polis, le Dasein a, pour le second, vocation à transmettre la capacité de désabriter l’étant qu’il a acquise grâce au cheminement vers le Bien. Les enjeux politiques et moraux spécifiques font cependant chez Heidegger l’objet d’assez peu de développements, en dépit des pages stimulantes qu’il consacre à la situation de la philosophie à l’heure où il écrit. Ici se trouve le point sur lequel le décrochage est le plus franc : la question du Bien est décorrélée chez Heidegger de ses enjeux éthiques, pour laisser place à une longue réflexion sur l’essence de la vérité et de la non-vérité. Si la philosophie se révèle comme première vis-à-vis des sciences, l’interprétation heideggérienne met également au centre de ses analyses la question de la mort comme destin allégorique du philosophe[29]. W. Néria remarque cette nette rupture à la fin de la section :
« l’âme en tant que philosophe-roi en redescendant dans la souterrain est promise à régner sans partage sur la cité tout entière, alors que le Dasein en tant que libérateur qui redescend parmi ses frères n’a pas de place sociale privilégiée pour assumer un rôle de gouvernant dans la cité »[30].
La « place sociale » du philosophe-roi consistera dans l’exercice du pouvoir en sa position de gouvernant, pouvoir qu’il n’a paradoxalement ni voulu exercer ou cherché à conquérir. Le telos de la paideia réside donc dans un enjeu éthico-politique : le bien est inséparable du vrai. Or, chez Heidegger, il s’agit d’entendre l’essence du Bien en tant qu’elle permettra de révéler le destin de la philosophie occidentale, gouvernée par l’identité du vrai et de l’eidos, soit de la vérité comme « rectitude », thèse responsable de l’oubli de l’être.
III Conclusion et perspectives
La conclusion de cet ouvrage s’ouvre sur un bilan de la méthode et des résultats découvertes par l’auteur, qui affirme avoir mis à jour « le complexe ontologico-gnoséologique du mythe », et avoir ainsi révélé « sa nature et sa visée spirituelle » (356). Ce point mis en évidence, la démarche est résumée en quelques pages, avant d’en venir au moment décisif de l’analyse : une « rupture radicale avec l’a priori métaphysique que Heidegger assigne au mythe » (359). W. Néria veut ainsi « re-venir à la vision originelle de Platon, à cette spiritualité prototypique ayant inspiré nombre de antiques, dont la chrétienne […]. ». Opposant une interprétation « spirituelle » de l’allégorie de la caverne à une interprétation « originaire[31] », il refuse de partager l’approche heideggérienne qui consisterait à voir dans celle-ci le point de départ du destin de la philosophie occidentale, caractérisée par l’oubli de l’être. C’est en effet le sens de la vérité qui distingue les deux philosophes : si l’essence de la vérité « a trait à la connaissance de Dieu, en Dieu et par Dieu » selon Platon (364), elle a, chez Heidegger, « trait au fait de pouvoir donner un visage à l’étant » (364). Faut-il dire pour autant que cette différence « décrédibilise l’entreprise heideggérienne », en sa démarche « originaire » ? Et à cette interprétation originaire, peut-on en substituer « le sens original du mythe, qui est d’ordre spirituel, voire mystique ! » (356) ? L’interprétation « spirituelle » du mythe de la caverne, défendue par l’auteur, aurait également pu être mise en évidence de manière plus nette. L’auteur fait des rapprochements, ponctuellement, avec la mystique, notamment chrétienne (Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d’Avila, par exemple). Or, peut-on considérer qu’il y a une continuité entre le platonisme et le christianisme ? L’essence religieuse de la mystique chrétienne recoupe-t-elle exactement la conversion platonicienne ? Et n’est-ce pas reconduire une conclusion heideggérienne quant à l’essence onto-théo-logique de la métaphysique[32] ? La voie du néoplatonisme[33], ferment initial du projet de W. Néria, aurait ici gagné, nous semble-t-il, à être engagée à grands frais, pour être distinguée du mysticisme chrétien, et afin de renforcer la distinction d’avec le projet heideggérien.
[1] William Néria, Le mythe de la caverne. Platon face à Heidegger, Paris, Cerf, 2019, p. 10. Nous indiquerons maintenant, chaque fois que l’ouvrage est cité, le numéro de la page entre parenthèses.
[2] De l’essence de la vérité. Approche de l’ « allégorie de la caverne » et du Théétète de Platon [1931-1932], trad. Alain Boutot, Paris, Gallimard NRF, 2001.
[3] « La doctrine de Platon sur la vérité » [1940], in Questions I et II, Paris, Gallimard, 1968.
[4] Protagoras, 319d.
[5] Voir par exemple le § 15 d’Être et temps.
[6] Sur cette question, voir par exemple Jules Lagneau, « De la métaphysique », in Célèbres leçons et fragments, Paris, PUF, 1950.
[7] Sur cette question, voir « Le chiasme heideggérien ou la mise à l’écart de la philosophie », in D. Janicaud et J.-F. Mattéi, La métaphysique à la limite, Paris, PUF, 1983.
[8] Nonobstant le fait que les deux images ne peuvent se recouper exactement : voir par exemple Monique Dixsaut, Le naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon, Paris, Vrin, 2016, p. 456-466, ou la première note que G. Leroux consacre à cette question au début du livre VII.
[9] Qui débute après 517c.
[10] Il est d’ailleurs étonnant qu’Heidegger ne s’arrête pas plus sur la question des échos dans la caverne, ou sur la « possibilité de discuter » (515b) des prisonniers. La question du hors-retrait est uniquement posée à partir du lumineux comme condition du dévoilement de l’être.
[11] L’auteur recourt assez peu aux commentateurs plus « classiques » de Platon, et n’inscrit pas toujours ses analyses dans le cadre de débats qui ont pris place autour de l’allégorie de la caverne, comme a pu le faire le texte important de Jacques Brunschwig faisant la distinction entre des images mobiles et des images fixes. Voir « Revisiting Plato’s Cave », in Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy 19, 2003, (éd.) J. J. Cleary & G. M. Gurtler, Brill, Leiden – Boston 2004, pp. 145–177.
[12] A la page 101 de l’ouvrage.
[13] Voir le Sophiste, sur le sophiste comme fabricant d’illusions.
[14] Voir Monique Dixsaut, Le naturel philosophe. Essai sur les dialogues de Platon, op. cit., chap. II.
[15] « Tu m’as l’air de ne pas savoir que celui qui approche Socrate de tout près et qui, s’approchant, se met à discuter avec lui, est forcé, quel que soit le sujet sur lequel il a d’abord commencé à discuter, de se laisser sans répit tourner et retourner par le logos, jusqu’à ce que ce soit finalement de lui-même qu’il vienne à rendre raison, de la manière dont il vit à présent et de celle dont il a vécu par le passé ; ni que, une fois arrivé là, Socrate ne le laissera pas partir avant d’avoir soumis bel et bien tout cela à la question. », Lachès, 187e.
[16] Monique Dixsaut, Platon, Paris, Vrin, 2003, p. 182.
[17] 701a.
[18] De l’essence de la vérité, op. cit., p. 82.
[19] De l’essence de la vérité, op. cit., p. 112.
[20] En suivant le texte fondamental de la République allant de 508c à 509c.
[21] De l’essence de la vérité, op. cit., p. 128.
[22] Le mythe de la caverne. Platon face à Heidegger, op. cit., p. 291.
[23] Voie ouverte par Platon, par le fait que les termes d’eidos et d’idea ne se recouvrent pas exactement. Sur cette question, voir par exemple J.-F. Pradeau, « Les formes et les réalités intelligibles. L’usage platonicien du terme εἶδος. », in Platon. Les formes intelligibles, Paris, PUF, 2001.
[24] Faisant boucle avec le début de la République, Socrate annonçant qu’il « descend » (kateben) au Pirée avec Glaucon. On peut voir ici un écho à de nombreux mythes grecs qui font de ce thème une question centrale.
[25] De l’essence de la vérité, op. cit., p. 108.
[26] Ibid., p. 112.
[27] Gorgias, 490e.
[28] Le mythe de la caverne, op. cit., p. 328.
[29] Qu’il retrace dans le § 10 de son ouvrage, lorsqu’il évoque la modalité sous laquelle aurait lieu l’empoisonnement de Socrate : « Il aurait lieu, cet empoisonnement, en ceci que, dans la caverne, on s’intéresserait au philosophe : on se dirait les uns aux autres qu’il faut avoir lu cette philosophie ; dans la caverne, on décernerait des prix et des honneurs, on procurerait peu à peu au philosophe une célébrité dans les journaux et les revues, on l’admirerait. » (op. cit., p. 105-106).
[30] Le mythe de la caverne, op. cit., p. 352.
[31] Il y a bien ici confrontation entre deux images de la pensée : une ascensionnelle, propre du platonisme, et une qui est horizontale, W. Néria remarquant qu’Heidegger « horizontalise » la caverne. Sur cette question, voir G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, dix-huitième série.
[32] Voir notamment, dans l’appendice du Cours de 1931-1932, l’interprétation de Heidegger : « En effet, la doctrine platonicienne des Idées a permis le déploiement du concept chrétien de Dieu, et, ce faisant, a donné la mesure pour la conception directrice de tout le reste de l’étant (non-divin). », in De l’essence de la vérité, op. cit., p. 361).
[33] D’autant plus que l’auteur mentionne Plotin, Porphyre ou Proclus au début de son ouvrage (p. 32).








