Introduction : Les imposteurs de la philosophie
Il y a, semble-t-il, depuis presque un siècle en France, une forme de tradition qui s’est installée dans le paysage intellectuel. De loin en loin paraissent des ouvrages dont le but principal consiste à dénoncer les fausses valeurs tapageuses de l’époque, à pointer du doigt en particulier les imposteurs qui encombreraient le champ de la réflexion philosophique. C’était par exemple, en un certain sens, dès 1927 la préoccupation de Julien Benda dans La trahison des clercs[1]. Ce fut le sujet des articles mordants de Deleuze sur les « nouveaux philosophes » (est restée dans les mémoires la fameuse formule fustigeant chez eux leurs « gros concepts, aussi gros que des dents creuses »).
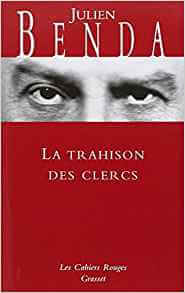
De loin en loin, ces ouvrages nous donnent des nouvelles de la vie intellectuelle de l’époque telle qu’elle va (ou plutôt telle qu’elle ne va pas, telle qu’elle dysfonctionne allègrement). On y lit des noms connus, on y brasse quelques potins sur les milieux éditoriaux ou universitaires, au milieu de considérations plus générales et approfondies. Tout cela est en général d’une facture agréable, bien troussé. L’ouvrage d’aujourd’hui, Les imposteurs de la philo[2], recèle toutes ces qualités, plaisant dans la forme mais acide sur le fond, ne dédaignant pas le jeu de mots et le clin d’œil facile au service d’une entreprise de démolition sans concession de certaines étoiles ou demi-étoiles du moment.
Que nous raconte en effet l’ouvrage de ces deux jeunes agrégés de philosophie, Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau, bien peu respectueux de certains de leurs aînés ou collègues médiatiques ? Tout simplement que la situation ne s’est pas arrangée depuis le moment où Deleuze éreintait les stars intellectuelles de son temps, aux idées bien moins éblouissantes que leurs chemises. Qu’elle se serait même plutôt aggravée. Les « néo-nouveaux philosophes » réussissent l’exploit, pour la plupart d’entre eux, d’être moins intéressants intellectuellement que ne l’étaient leurs aînés, moins articulés, plus superficiels et je m’en-foutistes, écrivant essentiellement leurs ouvrages non pour qu’ils soient lus, mais pour qu’ils connaissent la faveur d’être répercutés médiatiquement à destination d’un public le plus large possible, par le biais d’articles complaisants dans Libération, L’Express ou Philosophie Magazine (qui paraît souvent constituer de nos jours un simple placard publicitaire de luxe au bénéfice des ouvrages des copains et des têtes de gondole).
Qui sont les auteurs visés ici et pour quelles raisons ?
Les reproches adressés à chacun ne sont pas exactement les mêmes, et le lecteur pourra à juste titre avoir à cet égard une certaine impression de disparité. Ce qui est reproché à Raphaël Enthoven et à Charles Pépin, c’est de produire des ouvrages brillants dans la forme mais totalement superficiels sur le fond, de nous vendre du clinquant et du toc, en somme de la verroterie philosophique. A Vincent Cespedes est reproché une certaine incohérence et inconsistance du propos, de produire de la démagogie foutraque mais branchée à destination notamment des entrepreneurs.
A Raphaël Glucksmann est reproché le vide de la pensée, de n’avoir comme seul étendard que la « gloire » héritée de son père et un mince vade-mecum de propos progressifs lénifiants, qui réussissent l’exploit d’être à la fois superficiels et plus ou moins contradictoires entre eux. En somme, on le blâmera de ne savoir faire que de la très mauvaise philosophie avec de bons sentiments.
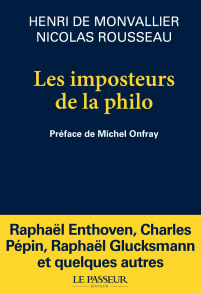
Le cas de Geoffroy de Lagasnerie est quelque peu différent. Ce qui lui est ici reproché, démonstrations à l’appui, réside au moins autant dans la nullité de son propos (sociologie imaginaire, davantage basée sur l’idéologie que sur les faits, sur une vision souvent complotiste et simpliste des choses) que dans l’intolérance du personnage, déniant à quiconque ne pense pas comme lui le droit même de l’exprimer.
Enfin, terminant l’ouvrage, quelques considérations sur les « philosophes » de Youtube (notamment sur le personnage de Cyrus North) invitent à prendre avec des pincettes la réflexion trépidante proposée sur un média qui, soit ne s’y prête guère, soit peut conduire à trahir l’intention pourtant honnête de vulgariser qui préside à son utilisation.
Contexte général
Pour bien comprendre ce que vise à produire l’ouvrage des deux compères, il semble tout d’abord bon de présenter un bref résumé de la situation philosophique du moment, afin de planter en quelque sorte le décor de leur intervention. Ce que l’on pourrait appeler le « champ » philosophique (ou plus exactement le champ de la production éditoriale philosophique, qui recoupe à peu près le champ universitaire) se décompose, pour faire bref, en trois domaines bien distincts : la philosophie traditionnelle française universitaire (qu’on appellera couramment continentale, et qui s’identifie souvent mais pas toujours au mouvement de la phénoménologie), la philosophie universitaire analytique (minoritaire dans l’hexagone mais très productive d’essais, ouvrages collectifs, etc.) et pour finir la philosophie « grand public ». On pourrait évidemment choisir d’autres découpages, mais celui-ci permet de simplifier tout en clarifiant les choses. Les deux premiers types de philosophie produisent une pensée réputée sérieuse, exigeante mais qui n’a aucune chance (sauf miracle éditorial, comme il en arriva un à Vladimir Jankélévitch après son invitation dans l’émission Apostrophes) de toucher quiconque en dehors des cercles universitaires. C’est le cas par exemple des ouvrages aujourd’hui de Jean-Luc Marion aux PUF, pour le courant phénoménologique continental, et de ceux de Frédéric Nef chez Vrin, pour la tradition analytique (les deux pouvant très exceptionnellement toucher le grand public pour un livre à vocation plus généraliste, mais en restant toujours dans des volumes de vente relativement modestes). C’est ce qui nous amène à la troisième catégorie, celle des ouvrages philosophiques destinés en théorie à tout lecteur un brin cultivé, catégorie évidemment la plus recherchée et la plus embouteillée. C’est à cette catégorie d’ouvrages qu’appartiennent, bien entendu, tous les livres dont le grand public a un jour entendu les titres et les noms des auteurs cités dans les journaux, à la radio ou la télévision. C’est évidemment dans cette catégorie que la plupart des philosophes veulent aujourd’hui publier, et on y trouve un peu de tout.
On y trouvera par exemple le grand auteur, considéré comme sérieux et de formation universitaire, mais que l’attrait de se faire connaître d’un public plus vaste aura conduit à écrire des ouvrages plus accessibles. Au risque parfois de déchoir un peu dans les yeux de ses collègues demeurés plus exigeants, plus insensibles aux sirènes de la notoriété (ou plus agacés par cette course à la reconnaissance). C’est ce que l’on a senti notamment il y a peu, lors des salves d’hommages obligés rendus à l’occasion de la disparition récente de Michel Serres. Roger Pol-Droit par exemple, dans son article du Monde, n’a pas oublié de mentionner au passage d’un article pourtant élogieux les réserves que certains ont émises, lorsque le penseur gascon devenu archi-célèbre s’est lancé dans la course aux publications de qualité fort discutable (éperonné en cela par son éditeur Le Pommier, qui vivait en grande partie de la publication de ses best-sellers – comme le survendu Petite Poucette – et tenait à en extraire tout le jus possible) :
« Michel Serres est, pour les éditeurs, une valeur sûre, entretenue par les articles amicaux d’une pléiade d’anciens élèves. Du coup, le philosophe ne sait plus s’arrêter. C’est dommage car, pour rester un genre « noble », l’essai suppose une exigence de rigueur qui, ici, tend à se relâcher au fil des ans. »
On ne saurait être plus clair.
Dans cette catégorie grand public on trouve également, depuis peu, le genre à la mode de la « Pop Philosophie », qui donne à la fois le pire et le meilleur. Le meilleur lorsqu’il s’agit comme le fait Roger Pouivet dans sa Philosophie du rock[3] de fournir une analyse philosophique rigoureuse de cette musique, « grand public » s’il en est. Le pire lorsqu’il s’agit simplement, comme c’est souvent le cas, de plaquer des explications philosophiques ou philosophesques sur des « produits » grand public : le rappeur Eminem n’exprime-t-il pas dans ses textes la vision freudienne de l’Inconscient ?, la série Downton Abbey restitue-t-elle avec plus ou moins d’exactitude la vision tocquevilienne des rapports sociaux entre classes?
Dans cette catégorie de la pop philosophie, on peut épingler également, non mentionnés dans l’ouvrage mais qui mériteraient de l’être, les nombreux livres et articles du philosophe Laurent de Sutter, dont l’inconsistance intellectuelle le dispute à la médiocrité argumentative. Quand on réalise que cet énergumène, incomparable producteur d’âneries au kilomètre, dirige une très active collection d’ouvrages aux (réputées prestigieuses) Presses Universitaire de France, on comprend l’état actuel du monde intellectuel français. Il n’est pas impossible que l’on se retourne dans quelques années sur cette foisonnante production (la sienne et celle de certains de ses camarades, hébergés dans sa collection) et que l’on se prenne à frémir en se demandant comment autant d’idioties, répercutées par des journaux complaisants, auront pu être imaginées en si peu de temps…
On trouve donc enfin, dans cette catégorie, à la suite de leurs glorieux aînés, les fameux et fumeux « nouveaux philosophes », les « nouveaux imposteurs » du moment, dont quelques-uns sont analysés dans cet essai, lui aussi grand public, aux éditions du Passeur.
Le problème du préfacier
Avec cette critique adressée à certains des auteurs les plus en vogue de la philosophie française contemporaine (quelques flèches étant également décochées, au passage, à des philosophes jugés commerciaux, comme Frédéric Lenoir par exemple), vient également la première réserve que certains ne manqueront pas d’émettre à l’endroit de l’ouvrage lui-même : celle d’avoir comme préfacier, justement un des auteurs les plus grands publics du moment, à savoir Michel Onfray. Les auteurs n’ont-ils pas, en choisissant pour présenter leur propos une figure parmi les plus connues et les plus controversées du « monde » philosophique, scié la branche même sur laquelle ils se sont assis ?
Henri de Monvallier, l’un des deux auteurs de l’ouvrage est un défenseur (courageux ?, aveugle ?, lucide ou intéressé ?, chacun en jugera) de Michel Onfray et de sa pensée. Soit. Mais on niera difficilement que cette dilection est loin de faire l’unanimité dans la communauté philosophique, pour user d’un euphémisme. Ce que l’on gagne certainement (et on peut soupçonner que c’est un des buts de la manœuvre) en notoriété et couverture médiatique par un tel choix, ne le perd-on pas en crédibilité concernant la réception de l’ouvrage chez un grand nombre de gens (à tort ou à raison d’ailleurs s’agissant du jugement philosophique aujourd’hui porté sur Onfray par, autant que l’on puisse en juger, une grande partie des professionnels et une partie non négligeable du grand public cultivé) ?
Bref, tout le monde l’aura compris, même s’il peut être défendu, le choix du préfacier, constitue certainement un problème en lui-même et laissera sans aucun doute beaucoup de lecteurs circonspects.
Légèreté des idées, faiblesse de l’argumentation, enfonçage de portes ouvertes… Si c’est à cette aune que l’on estime l’imposture philosophique, quels qualificatifs correspondraient mieux, par exemple, au regrettable Traité d’athéologie de Michel Onfray ?
Certes, on pourra soutenir que d’autres ouvrages, d’autres prises de position du même philosophe sont sans doute davantage dignes d’attention. Mais il est certain que l’ouvrage se disculpera difficilement aux yeux de beaucoup de l’accusation d’avoir choisi un des auteurs faisant le moins consensus dans ce rôle pour attaquer l’imposture philosophique, s’il en est.
Une des critiques, à tout le moins, que l’on ne pourra pas adresser au préfacier serait celle de souffrir de la notoriété de ceux attaqués dans l’ouvrage, d’être jaloux de la couverture médiatique dont bénéficieraient les auteurs incriminés et pas lui. Cette critique du désir frustré de notoriété, n’est-elle pas celle par contre qui viendra facilement à l’esprit concernant les auteurs mêmes de l’ouvrage?
La mauvaise notoriété comme imposture
Il est difficile en effet, lorsque l’on parcourt l’ouvrage de se faire une idée très claire de l’imposture reprochée aux auteurs visés. La notoriété, ou plus exactement la notoriété basée sur de mauvaises raisons, paraît en constituer au moins un élément objectif. Nous vivons, certes, chacun le sait, une époque où beaucoup veulent non pas faire quelque chose de grand pour mériter ensuite la gloire allant avec, mais posséder avant toute chose la gloire (ou disons la célébrité) permettant ensuite, si vraiment il le faut, de faire quelque chose la justifiant quelque peu. Mais, comme chacun le sait également, il se glisse souvent dans ces critiques des succès d’autrui une bonne part de dépit personnel.
S’agissant des auteurs eux-mêmes, ne peut-on pas dire que leur attaque envers quelqu’un comme Raphaël Enthoven vient peut-être du regret de n’avoir pas été invité par lui lors d’une émission de radio ou, mieux, de télévision (ou du regret par anticipation qu’ils ne le seront pas? – Pour cet ouvrage probablement pas, en effet, et sans doute pas pour les suivants désormais…). C’est évidemment une pensée qui vient facilement à l’esprit, la jalousie ou le ressentiment constituant des ressorts bien connus de l’activité humaine. Le désir de gloire personnelle aussi, d’ailleurs, c’est humain. Quel humble professeur n’a pas rêvé un jour des plus insignes honneurs ? Voilà, avec Raphaël Enthoven un bien aimable intervieweur, dont on peut se dire que de nombreux philosophes rêveraient certainement d’être interrogés par lui. Le plus reconnu et le plus admiré dans son champ, mais seulement par une poignée de fidèles, ne troquerait-il pas un instant la vénération confidentielle dont il est l’objet pour un quart d’heure warholien de gloire médiatique auquel il songe sans doute en secret, le matin, en préparant son petit-déjeuner ? « C’est donc ici, sur cette humble chaise, qu’entre deux tartines grillées vous viennent les idées les plus profondes de votre œuvre ? », s’imagine être interrogé, par la voix doucereuse d’Enthoven, le grand penseur confidentiel. « Eh oui, c’est bien ici, en effet ! » s’imagine-t-il répondre, l’air faussement indifférent. C’est en tous les cas très probablement la manière dont les philosophes médiatiques ici visés balaieront d’un revers de la main les reproches qui leur sont adressés : vanités d’obscurs frustrés, haines recuites de petits rien du tout, diront-ils aux rares importuns qui oseraient les interroger sur l’ouvrage. Et la plupart des lecteurs leur donneront sans doute raison, tant le désir de notoriété paraît constituer un ressort essentiel de notre époque, auquel rien ne résiste, même les plus distants en apparence à ces travers, comme l’avait déjà, en quelques planches désopilantes, croqué en son temps le regretté Gotlib.

La corruption éditoriale
On peut bien entendu ne pas en rester là et, s’il est facile de rejeter l’ouvrage en arguant de la supposée frustration de ses auteurs (frustration qui resterait quand même à démontrer), il est également aisé de faire observer que cette critique ne réduit pas à néant les analyses de l’ouvrage. Même si c’était la notoriété frustrée ou la jalousie du succès qui guidaient ici le propos, rien n’empêcherait de penser que cette motivation a aiguillonné les auteurs à produire les observations les plus cinglantes mais souvent aussi les plus justes, les plus désagréables car les plus judicieuses à l’endroit de ceux qu’ils dénoncent. Ce n’est pas parce que l’on serait jaloux que l’on ne peut pas produire des critiques qui visent juste et qui font mouche, au contraire sans doute.
Que retenir alors, finalement, de ces attaques? Le terme d’imposture est certes un terme lourd, dont personne ne souhaite se voir affublé, et dont l’utilisation ne laisse guère de place à la demi-mesure. On peut regretter probablement l’emploi d’un mot stigmatisant qui ne se prête que fort mal à une discussion raisonnable et constitue sans doute, en lui-même, une forme d’usage journalistique que l’on reproche pourtant régulièrement aux philosophes médiatiques.
Les deux auteurs se rendent d’ailleurs souvent compte de l’inutilité de leurs critiques et le répètent : cet ouvrage, disent-ils, ne changera rien, les livres des auteurs critiqués ici, qu’ils soient effectivement jugés de piètre qualité ou non, continueront de se vendre et, probablement, de truster, comme on dit, les premières places des ventes dans la catégorie essai.
Quel intérêt alors d’écrire un tel livre ?
Il peut tout d’abord être intéressant d’entendre, ce qui est fort rare dans les médias, un autre son de cloche que ce dont on a l’habitude concernant ces auteurs, reçus un peu partout dans les journaux ou à la télévision. Celui qui désire fourbir ses armes contre eux et appuyer ses critiques sur des analyses précises et documentées trouvera ici son bonheur (on ne peut que recommander par exemple la critique à la fois cinglante et drôle du philosophe Vincent Cespedes dont il est difficile de nier, à la lecture de ces pages, que la rigueur et la pertinence intellectuelles des idées paraissent aller à rebours exact de la surface médiatique qu’il occupe).
Mais outre les critiques visant tel ou tel, il semble que le principal intérêt de l’ouvrage consiste à pointer du doigt un phénomène hélas déjà bien connu dans le domaine de la littérature et dont on ne mesure pas toujours bien l’importance dans le domaine des idées : à savoir le poids démesuré du « copinage », des réseaux, et l’absence quasi absolue de curiosité intellectuelle de la part des éditeurs français. Bref, ce que l’on pourrait appeler la corruption éditoriale. Dans le domaine de la fiction, elle n’est plus à démontrer, et seul quelqu’un vivant très loin de Saint-Germain des Près peut encore croire à la légende du « manuscrit arrivé par la poste », alors que personne ne lit ces manuscrits et ne se soucie des auteurs inconnus. Faire partie du réseau d’amis d’un éditeur, graviter dans les cercles des médias parisiens ou d’institutions de pouvoir sont des viatiques infiniment plus puissants pour espérer séduire un éditeur que d’être un écrivain de génie inconnu.
C’est ce travers que le livre pointe à de nombreuses reprises avec justesse, notamment lorsqu’il observe :
« Si le manuscrit avait été signé d’un anonyme et non de Enthoven, il y a fort à parier qu’il n’aurait jamais été publié chez Fayard et qu’il aurait probablement pris le seul chemin qui ne soit pas une impasse pour ce genre de production, c’est-à-dire la poubelle. » (p. 33)
Bien entendu ! Si l’on jouait, comme cela a été fait pour des romans célèbres, à envoyer sous un nom d’emprunt, par la poste, les ouvrages de nos gloires du moment ou même des classiques de la philosophie, de réelle valeur cette fois, il y a fort à parier qu’aucun ne trouverait grâce auprès d’un quelconque éditeur, ainsi présentés sans l’attrait d’un nom réputé ou la recommandation d’un ami puissant. Les habitués ne se publient qu’entre eux, en petits cercles fermés, où prévaut infiniment moins la recherche de la qualité que les intrigues du pouvoir, de la connivence et de la notoriété.
La critique est particulièrement amusante lorsqu’elle concerne un auteur faisant pourtant profession de condamner les « possédants » et les gens de pouvoir, portant en bandoulière ses idéaux révolutionnaires, mais profitant au mieux de ses propres privilèges dès qu’il en possède. Ainsi, les auteurs, à propos de Geoffroy de Lagasnerie qui se présente lui-même comme un adversaire résolu du système en place, après avoir rappelé son parcours brillant au sein de l’institution académique, notent-ils cruellement :
« Il a obtenu en 2018, à l’initiative de Sandra Laugier qui a présidé le jury, une habilitation à diriger des recherches de l’université Paris I panthéon Sorbonne, ce qui signifie qu’il peut diriger des thèses de doctorat (il n’a même pas 40 ans !). De plus, il dirige, depuis l’âge de 30 ans (!), la collection « A venir » aux éditions Fayard où il a publié quatre de ses propres livres ainsi que tout récemment les Ecrits sur la psychanalyse de son père spirituel (et par ailleurs mari à la ville) Didier Éribon. Depuis dix ans qu’il dirige cette collection, Lagasnerie oscille donc entre auto-édition et copinage éhonté. » (p. 175)
Le jugement est sans appel. Celui-là même qui critique, dans le sillage de son maître Michel Foucault, les institutions de pouvoir fait habilement fructifier à son propre profit et à celui de ses proches celui qu’il possède incontestablement dans le monde universitaire et éditorial.
L’antithèse du philosophe médiatique
On peut se faire une idée plus claire encore de ce que pointe l’ouvrage, en citant un philosophe totalement à l’écart des cénacles parisiens, et n’ayant eu pour but, autant que l’on puisse en juger, que de produire une ouvre personnelle de qualité, loin des effets de mode. Qu’un philosophe ait eu pour ambition d’abord et avant tout de se construire une vision élaborée et cohérente du monde et de lire ses grands devanciers dans le texte plutôt que de cultiver un réseau menant à sa propre publication est sans aucun doute, de nos jours, une erreur impardonnable.
Au moment d’être confronté à l’étape de la publication, il est toujours intéressant de lire la vision franche et sans fioritures qu’un étranger aux coteries parisiennes peut se faire à son sujet lorsqu’il se retrouve dans ce grand Salon des Verdurin que constitue le monde éditorial français.
Le philosophe Serge Druon, dans son dernier ouvrage (auto-édité) en fait une description qui en quelques lignes, en guise d’introduction, dit à peu près tout de la situation. S’agissant de son expérience avec les meilleures maisons, il est bien obligé de constater :
« Pourquoi ai-je écrit plus haut que les puf « publient, en principe, ce qui se fait de mieux », en mettant « en principe » en italique ? Parce qu’en réalité l’édition de la philosophie ne supporte la pensée neuve éventuelle qu’en provenance du sérail universitaire. Son critère premier – peut-être même unique –, pour décider d’une publication, c’est le CV, c’est la notoriété universitaire. Pour être publié par les puf – ou par n’importe laquelle des grandes maisons d’éditions qui publient de la philosophie –, il est non seulement nécessaire, mais aussi quasiment suffisant, d’appartenir au sérail, c’est la garantie de la qualité, on ne prend pas de risque – du moins, c’est ce qu’on croit dans ce milieu, et c’est la valeur de cette garantie mondaine que je mets ici en question. Dans quelle situation nous place, nous lecteurs, ce monopole de la pensée écrite ? De quels dangers sommes-nous systématiquement protégés ? Cette prétendue garantie ne crée-t-elle pas, au contraire, un danger plus grave ? N’y a-t-il personne, dans l’édition de la philosophie, qui soit capable de juger de la valeur intrinsèque d’un manuscrit ? Ont-ils si peu confiance en eux qu’ils s’en remettent, les yeux fermés, à « l’institution », à l’ordre établi par « l’institution » ? L’édition de la philosophie choisit de tourner en rond, de rester dans l’entre-soi universitaire. Elle se livre à la pratique organisée de l’éloge réciproque. Celui qui a gravi les échelons universitaires, jusqu’à devenir professeur à la faculté ou chercheur au CNRS, celui-là est sûr d’être publié quoi qu’il écrive, il fait partie de la famille, il est adoubé. Celui qui pense sans CV – est-ce possible ?–, peut toujours écrire, l’institution philosophique et éditoriale lui restera fermée quoi qu’il écrive. » (Serge Druon, La grande misère de la philosophie contemporaine, Edilivre, 2019)
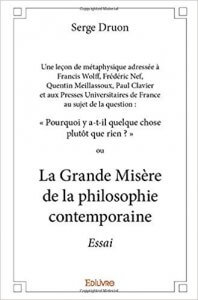
L’issue était hélas inévitable. Si un tel auteur, une fois son œuvre écrite, après de longues années passées à la méditer et à la mettre en forme s’avise de l’envoyer, sans recommandations, à un éditeur de philosophie, que se passera-t-il ?
Il trouvera porte close évidemment !
Il n’y a derrière les portes de ces vénérables maisons que des Geoffroy de Lagasnerie, la bouche pleine de préceptes révolutionnaire mais préoccupés avant tout de se publier eux-mêmes, les amis de leur réseau, et ensuite s’il reste de la place leurs maris, maîtresses et amants.
Les livres d’un penseur solitaire comme Serge Druon n’ont évidemment aucune chance de trouver grâce aux yeux d’un éditeur prestigieux de Saint-Germain des Prés. L’absence de notoriété ou de pouvoir institutionnel y est une pestilence qu’aucune qualité de la réflexion ne peut venir dissiper.
La nature même de la philosophie
On le voit bien, l’ouvrage nous le répète, il y a incontestablement quelque chose de pourri au royaume de la pensée. Qu’un philosophe fin et subtil comme Druon ne puisse trouver sa place aux vénérables puf mais que les âneries branchées quoique sans queue ni tête d’un Laurent de Sutter y soient érigées en collection ne peut qu’interroger sur la qualité de la vie intellectuelle du moment.
L’autre point qui est lié à cette collusion et à cette sélection endogamique du monde intellectuel et que l’ouvrage aborde indirectement, à travers deux des figures principales qu’il attaque, est le phénomène bien connu des « fils de », désignant les individus dont la célébrité repose en partie sur celle du père ou de la mère (ou sur le carnet d’adresses des parents). C’est le cas bien connu dans l’ouvrage de Raphaël Enthoven, fils de Jean-Paul Enthoven (écrivain, éditeur et journaliste français) de même que celui de Raphaël Glucksman (fils d’André Glucksman, déjà épinglé autrefois parmi les fameux « nouveaux philosophes » aux grandes idées creuses). On pourrait évidemment mentionner d’autres noms bien connus du petit monde philosophique correspondant peu ou prou à ce portrait comme par exemple le très présent Gaspard Koenig ou, à l’inverse, le très ésotérique Quentin Meillassoux, et d’autres encore. Bien entendu, cet accès de leurs parents aux réseaux de notoriété peut aussi servir pour certains d’entre eux à faire carrière dans autre chose que la spécialité du père ou de la mère, l’ouvrage mentionnant par exemple Justine Lévy, qui a eu la bonne idée de ne pas devenir philosophe comme son père mais d’être « simplement » romancière, ou le fils de Pierre Bourdieu, qui a préféré la reconnaissance du monde du cinéma à celle de l’université (dont il est pourtant issu). Et l’on pourrait là encore mentionner bien d’autres noms.
De la même manière que dans le cinéma ou dans la chanson, où le phénomène est très présent, être un « fils ou une fille de » ne préjuge évidemment pas du talent de la personne, qui peut être réel, mais favorise simplement l’accès à la lumière. Que la philosophie soit devenue elle aussi le lieu de cette pratique, montre bien à quel point l’exposition médiatique prime souvent aujourd’hui dans ce champ, au détriment des œuvres elles-mêmes.
On pourrait néanmoins voir un peu plus loin, et c’est ce que l’on reprochera sans doute à l’ouvrage de Monvallier et Rousseau de ne pas faire lui-même, bien qu’il nous y invite et nous en montre le chemin : ne faudrait-il pas s’interroger sur la nature même de cette discipline appelée philosophie, s’interroger sur le fait que des « imposteurs » ou de simples « héritiers » apparemment si nombreux et si bien accueillis puissent avec une telle facilité y faire leur nid?
Certes, depuis son origine, la philosophie est la cible de critiques concernant son intérêt, sa pertinence et son sérieux. Mais précisément, la persistance de cette critique, plusieurs milliers d’années après son apparition, n’est-elle pas une (excellente) raison de s’inquiéter ?
L’accusation d’imposture, pour vague et générale qu’elle soit, est en effet on ne peut plus commune en philosophie et, loin d’être réservée à quelques têtes de gondoles ou à la philosophie dite populaire.
Pour revenir à la distinction que nous faisions au début de cette recension, entre le courant dit « continental » et le courant « analytique » : n’est-il pas ahurissant de constater une telle disparité d’opinion au sein d’une même discipline? Imagine-t-on un courant d’idées en physique ou en astronomie traiter les travaux d’un courant différent d’inepties et d’absurdités, en nier vigoureusement la légitimité et l’intérêt ?
C’est pourtant à une telle manière de s’écharper entre gens censés pratiquer la même discipline que l’on a assisté il y a seulement quelques années, en 2014, lorsque la revue Cités consacrée à la Philosophie contemporaine en a profité pour régler ses comptes – on ne peut le dire autrement – avec la philosophie dite analytique, en des termes aussi définitifs et sans concession que ceux utilisés par Monvallier et Rousseau à l’égard des figures beaucoup plus grand public.
Et si c’était donc la philosophie elle-même qui était une imposture ? Remarquable certes, brillante et charmante, comme un aphorisme clinquant d’Enthoven, mais une imposture tout entière ! Un aimable bavardage, dont tout n’est certes pas à jeter, qui peut séduire, mais dont il serait naïf d’espérer une quelconque dimension d’universalité et de sérieux, chacun venant simplement y puiser ce qui lui parle le plus, au gré de ses motivations profondes ou de ses lubies irrationnelles.
C’est sans doute finalement à cela – et ce n’est pas l’un de ses moindres paradoxes – que nous invite l’ouvrage intransigeant de Monvallier et Rousseau, c’est-à-dire à relire les œuvres plus radicales encore de Jean-François Revel ou de Maurice T. Maschino. Œuvres terribles pour la philosophie (et pas seulement pour ses imposteurs) qui prétendaient – il y a plusieurs décennies déjà – que Descartes lui-même serait « inutile et incertain », qu’il ne faut peut-être voir dans l’agitation des esprits philosophiques qu’une vaine frénésie et qu’il vaut mieux en définitive suivre la recommandation de Maschino, dont il faisait le titre de son ouvrage : Oubliez les philosophes ![4]
[1] Cf. Julien Benda, La trahison des clercs, Paris, Grasset, coll. « Cahiers rouges », 2003.
[2] Henri de Monvallier, Nicolas Rousseau, Les imposteurs de la philo, Paris, Le Passeur, 2019
[3] Roger Pouivet, Philosophie du rock, Paris, PUF, 2010
[4] Dans cet ouvrage justement, Maschino prend néanmoins comme exemple, parmi le très petit nombre de philosophes contemporains qu’il trouve dignes d’intérêt, le déjà célèbre à l’époque Michel Onfray. Le même Michel Onfray, que beaucoup jugeront aujourd’hui beaucoup plus sévèrement, mais qui néanmoins fait aujourd’hui oeuvre de préfacier pour un nouvel ouvrage, 18 ans après celui de Maschino, dénonçant encore une fois l’imposture philosophique… La boucle est bouclée.








