Introduction
Cet ouvrage de musicologie[1] – traduit par Théo Bélaud aux éditions Contrechamps – nous introduit à deux problèmes philosophiques combinés d’une part à travers la musique et le sentiment, et d’autre part, la musique et le langage : si la musique semble exprimer un sentiment, en réalité son système de notation et d’interprétation sonore ne peut s’identifier à aucun sentiment déterminé. Tout au plus, la musique peut provoquer, suggérer, ou susciter une émotion. L’auditeur va alors plus ou moins ressentir et reprendre ce qu’il perçoit selon ce que l’on pourrait grossièrement appeler une « représentation » sentimentale liée à l’œuvre écoutée ; mais en tant que telle, l’œuvre musicale ne peut pas signifier, c’est-à-dire désigner, lier et fixer de façon nécessaire son expression avec un état sentimental déterminé, et cela, même si dans certaines œuvres, les compositeurs avaient des intentions précises là-dessus, ou voyaient leurs compositions comme un mode opératoire : malgré cela, on ne peut donner aucune règle évidente concrétisant ces intentions à partir de la partition ou de l’exécution instrumentale d’une composition. Alors, le problème du sentiment musical se distribue ainsi : s’il n’est pas lié à un état sentimental particulier, de quoi parle-t-on réellement lorsqu’il est question d’un « sentiment musical » authentique si celui-ci ne peut être identifié par aucun état émotionnel déterminé à partir d’une partition ou du son d’un instrument de musique ? Ce que Charles Rosen veut faire comprendre, c’est que cette question du sentiment en musique ne se pose de façon pertinente qu’à même la relation au système de notation, dans sa compréhension et son appréciation lors de l’interprétation instrumentale de cette même partition. Dans le processus originel de ce sentiment musical authentique, c’est donc le geste interprétatif incarnant l’œuvre qui révèle d’emblée un type de sentiment. Et originairement, la seule lecture de la partition pourrait donc rendre raison de la logique de ce sentiment musical si on le considère comme un langage.
Le problème est que ce « langage musical » de la partition ne peut à lui seul tout noter à travers son code ; l’expression plastique de l’œuvre musicale est tributaire d’une exécution instrumentale, et donc aussi de conditions sonores et acoustiques radicalement contingentes : la relation à la partition lors d’un concert peut tout au plus corriger psychologiquement ces aspects contingents pour les faire ressentir selon une écoute cultivée, « sensible » à l’essentielle origine codée de l’œuvre malgré son incarnation expressive en-deçà de son idée notée. Le sentiment musical se jouerait donc non pas dans une liaison entre un son et un état psychique d’auditeur affecté, mais bien plutôt la compréhension d’une notation faisant corps avec son rendu sonore, lequel, par analogie avec l’état affectif, participe de l’œuvre dans sa compréhension critique du geste interprétatif. Nous disons ici « critique » parce qu’alors cette audition active sait faire la part et la relation entre la partition et le geste interprétatif, et en ce sens, elle peut s’identifier à certains modes et exigences interprétatifs. Ce dont certains jouissent particulièrement – et qui fait donc la teneur active de leur sentiment lors d’une écoute musicale -, c’est donc de ce point de vue l’évaluation du degré d’obéissance ou de respect de l’interprète à la partition qu’il sert et qui s’exprime.
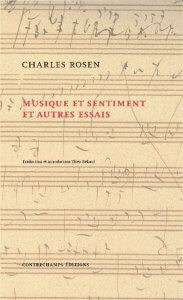
Philippe Albèra indique dans l’avant-propos cette tension :
« ce que Rosen tend à démontrer, c’est que les structures musicales ne se justifient pas en renvoyant à des significations préétablies, qu’elles soient internes ou externes, fondées en nature ou légitimées par une tradition, mais qu’elles produisent un discours propre, ouvert à des interprétations qui s’enrichissent à mesure que la musique elle-même évolue et se transforme (d’où sa méfiance pour des approches théoriques qui figent le rapport aux œuvres et son attention aux développements les plus récents de la création) » (p. 13).
Là-dessus, la solution que semblent donner à ce problème le traducteur Théo Bélaud et en partie Charles Rosen, se présente sous les auspices de ce qu’ils appellent « la familiarité » : s’il y a une fidélité historique qui se constitue dans la relation à l’œuvre, c’est en tant qu’habitus qui concrétise, transmet et développe une forme de tradition interprétative, donc une forme supérieure de sensibilité éduquée, et non plus une réception abrutie, passivement consommatrice. Il y a alors une certaine continuité avec l’origine perpétuée qui lui donne ses accents d’autorité au présent ; s’opère ainsi une vivante participation à l’esprit de l’œuvre, esprit obéissant lui-même aux normes formelles de la notation musicale « classique ». Cela reste tout de même une médiation, avec ses caractères fluctuants et relatifs, mais qui font par ailleurs ce que les auteurs du commentaire appellent le « charme » musical ; cela a le mérite d’ouvrir sur ce qui forme les modes même de cette familiarité liant musique, langage, forme et sentiment : celui de l’enseignement ; et cela, en contrepoint du propos, puisque ces pages de Rosen comprennent bien déjà celui-ci à travers les analyses professées ici. L’ambiguïté est cependant que cet enseignement est de l’ordre artistique, et qu’ainsi sa grandeur ne peut pas être respectée réellement selon une simple copie comportementale reproductrice ou un héritage cumulatif pour être réellement vivant. Là-dessus, l’article sur l’avenir de la musique expose froidement la situation et la disposition dans laquelle notre époque se situe :
« les enregistrements privilégient l’exécution par rapport à la partition. La composition est tenue à distance ; l’interprétation est mise en avant. (…) Les enregistrements effacent presque complètement l’un des aspects le plus profond de l’expérience de la musique savante : la résistance que l’œuvre impose à l’interprétation. » (p. 201).
C’est bien ce souci qui transi les pages de ce recueil, cette inquiétude qui exhorte à tenter de retrouver cette exigence à tous les niveaux dans l’expérience musicale, pour qu’au-delà de la simple passion de collectionneur de disques ou de mondanités aux concerts, nous retrouvions aussi, par la lecture de la partition, la mesure de cette « résistance » qui forme toute interprétation, toute écoute, et donc toute sensibilité musicale authentique.
Ce recueil réunit sur ces sujets cinq textes de Charles Rosen (1927-2012), pianiste américain émérite qui fut cependant surtout connu grâce au grand succès de son livre, Le Style Classique publié en 1971. Music and sentiments est le donc dernier ouvrage de Rosen publié deux ans avant sa mort. Le présent recueil comprend ce texte, puis « Tradition sans convention », « L’avenir de la musique » (traduit cette fois-ci par Jean-François Sené), et enfin, l’ouvrage se termine par deux articles consacrés au compositeur Elliott Carter et la manière d’aborder ses œuvres dont Rosen fut souvent le premier interprète et ambassadeur. Comme nous l’avions mentionné plus haut, ces textes sont encadrés par un avant-propos de Philippe Albèra, que suit une longue présentation du traducteur Théo Bélaud sur laquelle nous reviendrons après les différents essais de Rosen – avant que l’ouvrage ne s’achève par un index concluant une bibliographie des textes de Rosen ainsi que sa discographie.
 I. Musique et sentiment
I. Musique et sentiment
Ce texte publié en 2010 se distribue en huit chapitres dont les premiers s’appesantissent sur des considérations théoriques sur le langage et la manière de problématiser le sentiment musique ; et les cinq autres illustrent ensuite ces propos à l’aide de riches analyse d’œuvres et de styles classés par périodes. Que signifie donc ce sentiment spécifique que produit la musique ? Rosen le reconnaît, une musique peut être qualifiée de triste ou joyeuse ; mais pour déterminer comment certaines tonalités produisent ou non cet effet affectif ou émotionnel, à ce moment-là toutes les théories s’effondrent. On peut identifier tel ou tel procédé d’une musique avec tel effet, pour voir le même procédé utilisé dans une autre œuvre produire des effets affectifs inverses ou opposés. Rosen nous prévient donc :
Je ne cherche pas à mettre des mots sur le sentiment : les lecteurs qui espèrent trouver ce qu’ils sont supposés ressentir en écoutant une œuvre donnée seront immanquablement déçus. La communication d’informations est l’une des plus importantes des nombreux et diverses fonctions du langage, mais n’appartient pas à celles de la musique (…) le langage s’efforce cependant d’approcher poétiquement le même impact émotionnel de la musique. Identifier l’affect ou le sentiment représenté musicalement n’est pas la question, mais c’est la nature de la représentation elle-même et ses modes qui se développent conjointement avec le matériel musical qui est en question. (p. 40)
Il y a donc une limite à déterminer dans le langage même pour parvenir à signifier ce que la musique représente pour le sentiment – ici Théo Bélaud nous signale d’ailleurs en introduction que dans sa traduction, « Représentation s’entend comme expressivité, mise en forme de l’expression » (p. 32) – alors que pour autant, la musique ne signifie pas de la même manière que le langage de la communication. Même si la musique n’est pas une codification ésotérique, sa « représentation » ne s’identifie pas à un sentiment déterminé, et l’on ne peut assigner des « significations stables aux éléments musicaux isolés » (p. 57). A de rares exceptions, la musique n’est pas imitative comme en peinture, et elle ne peut pas être totalement assimilée au langage ; ici Rosen critique la fameuse « Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient » de Diderot :
Diderot pèche par naïveté : on entend plus que des sons, on entend des relations,une pulsation…et c’est ce qui aboutit à nous offrir un accès au sens. Ce que nous percevons consciemment au non est un certain système d’organisation régulier des sons ; et c’est pour cette raison que les contemporains de Diderot pouvaient considérer la musique comme un langage, le désir de produire de l’ordre étant la condition pour que puisse se former le langage, la culture et la société. La plupart des études sur le sentiment en musique exagèrent sa précision et sous-estiment son ambiguïté (p. 45)
La musique présente donc cette difficulté d’avoir un vocabulaire pauvre et imprécis, alors que sa syntaxe et sa grammaire sont riches et puissantes. La musique peut donc avoir la forme d’un langage tout en n’ayant pas la possibilité de désigner un contenu : elle peut tenter de l’évoquer comme dans les opéras de Mozart, Wagner ou Strauss avec un arrière-fond plus ou moins érotique, mais cette « représentation du sentimental » par la musique n’est pas imitative, ne reproduit pas un contenu à reconnaître (p. 49). De quel sentiment s’agit-il alors dans les évocations musicales ? Rosen déplace alors le problème : il s’agit moins de réfléchir sur l’état sentimental provoqué par la musique (lequel est toujours plus ou moins contingent et accidentel, et sans contenu stable fixé) que de réfléchir sur la relation stylistique de la composition dans son évolution pour représenter le sentimental (p. 55), car encore une fois,
« nous n’apprendrons rien du caractère affectif d’une œuvre en nous référant à sa tonalité : se contenter de l’écouter pourrait bien être suffisant. (…) L’utilité principale de spéculer sur le caractère des tonalités n’est jamais reliée de façon convaincante à la tradition musicale en général, ou même à la musique d’une certaine période, mais réside dans la manière personnelle dont certains compositeurs traitent certaines tonalité. » (p. 60).
Le sentiment musical dérive ou témoigne donc d’une intégration socio-historique qui le sédimente, sans être réellement compris et su : « on est affecté par les procédés musicaux sans pour autant les connaître (…) toute tentative d’explication du sentiment éprouvé par l’auditeur via sa compréhension préalable d’un code est un échec. » (p. 44). Ce n’est pas un savoir puisque c’est un sentiment, c’est l’effet d’une disposition d’appréciation issue d’une familiarité régulière avec la pratique musicale, mais non analysée. Comment Rosen peut-il donc à partir du texte musical même déterminer une approche de sa relation avec le sentiment ? Réponse de Rosen :
« chaque phrase est consonante ou dissonante relativement à n’importe quel centre tonal subsidiaire impliqué par chacune des sections de l’œuvre dans laquelle elle apparaît. Chaque mélodie tonale bien formée établit sa propre structure harmonique sous-jacente. Les différents degrés de tension sont à la base de l’expression de n’importe quelle sorte de sentiment. » (p. 42)
Et ainsi, l’essentiel du propos va être de décrire la manière dont, à chaque période de l’histoire de la musique classique, on s’est accoutumé à un certain style musical, et ainsi, à la manière dont cet habitus musical, cette « familiarité » avec le style, a ouvert à un type de contenu émotionnel sensible à ces mêmes formes expressives (p. 50). Rosen fait donc l’histoire de la sensibilisation d’une époque à telle ou telle forme musicale, tel style, et la manière dont une forme rompt avec une époque ou bien encore, dont un compositeur réintroduit certains procédés musicaux délaissés dans les formes acceptées par son époque.
Tout d’abord, c’est « l’esthétique de l’unité de sentiment » qui dominait la musique du premier XVIIIème siècle (p. 62) selon Rosen. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule tonalité affective développée ; elle peut être infléchie, et là-dessus, Rosen propose l’exemple d’une « allemande » dans la première partita de Bach, qui met en lumière la gamme expressive alors disponible, et la variété subtile d’inflexions du sentiment à l’intérieur d’un cadre bien défini ; l’unité du sentiment se trouve ici renforcée par l’unité de mouvement, tout en étant constamment infléchie par de légères variations d’intensité dans l’harmonie et la texture, et par de délicates augmentations du contenu dissonant des arabesques mélodiques (p. 67 et p. 69). Bach conserve cette unité tout en combinant également des affects en opposition ou en synergie, sans pour autant que la structure générale se dissolve : dans la Passion selon saint Mathieu, Rosen note que « les mêmes oscillations d’intensité au sein d’un flux rythmique continu sont présentes, de même que la force conduisant sans monotonie un mouvement continu jusqu’à la cadence finale. Unité dans la combinaison de deux motifs (un choral superposé dans le matériel principal du chœur). » (p. 70).
Début XVIIIème, au milieu de la première moitié d’un mouvement, l’arrivée sur la dominante devint un événement : une demi-cadence sur la dominante de la dominante pouvait l’introduire et le rythme était souvent perturbé ; mais un nouveau thème pouvait alors apparaître (p. 71). Ce qui est donc surtout « sensible », c’est l’intégration même du contraste dans la « forme-sonate », des thèmes ou des motifs dans la structure, car à eux seuls, c’est eux qui « représentent des sentiments opposés » selon Rosen. Ce dernier illustre son propos avec la fameuse Symphonie « Jupiter » de Mozart (p. 73) : deux moitiés du motif sont là, mais l’opposition entre elles a disparu, ayant été réunie par l’intervention de la flûte – un procédé aussi important que le contraste d’origine. Nous notons ici, non sans une certaine réprobation contenue, que Rosen a voulu donner consistance à sa description en se forçant à la rehausser avec un gros cliché, en « proposant ici une analogie avec Hegel avec son enchaînement thèse antithèse synthèse » ; Mozart utilise le même procédé que sa Jupiter dans sa sonate K576 avec un thème ayant deux motifs opposés.
Rosen emploie assez indistinctement les termes « sentiments » et « affects » ; il passe de l’un à l’autre indifféremment, sinon que le terme « affect » est souvent employé quand il est question de « rythme » général ou de déroulement d’un thème musical, et le « sentiment » quand il est question de ce qu’un thème peut combiner comme motifs. Un changement de rythme produit un affect nouveau, un changement d’agencement dans un thème produit des sentiments nouveaux : il peut donc y avoir un affect nouveau sans pour autant y avoir de sentiment général nouveau, seulement, celui-ci sera intensifié ou atténué, se développant avec le thème selon les modulations rythmiques des différents affects, le sentiment changeant alors en degré, pas en nature. Et à l’inverse, un changement de sentiment dans les motifs du thème ne produira pas nécessairement d’affects nouveaux si le rythme reste stable ou sans rupture notable dans le déroulement des différents motifs : « le changement affectif ne contraste pas avec l’état initial, la relation n’est pas antithétique – le nouvel affect, quoique frappant par son changement de nature, naît directement du motif initial. L’accroissement soudain d’énergie vient en réponse à une série de dissonances accentuées, quatre septièmes de dominante. » (p. 78).
Si l’on veut approfondir la distinction, en parallèle de Mozart, Haydn utilise un seul thème selon une double présentation sous la forme de deux réalisations différentes ayant des « significations affectives opposées ». Un thème peut alors être le même, mais avec un changement « d’atmosphère », nous dit Rosen, « proprement inouï » (p. 80). Haydn présente des thèmes sans changement de tonalité, mais avec des contrastes affectifs évidents : l’affect détermine donc le sentiment ; un même affect peut être creusé par un compositeur, comme en témoigne la richesse des sentiments issus de la multiplicités des thèmes et motifs. Un même sentiment peut être creusé par la multiplicité d’affects qui farciront son thème selon différentes nuances, et produiront différents « climats ». C’est ce que Rosen appelle la « transformation expressive » (p. 81).
Dans l’ordre du traitement du sentiment, nous avons avec Beethoven une sorte de synthèse de Haydn et Mozart, en ce sens que, selon Rosen,
« Beethoven utilise un matériau de base construit sur une variété d’affects, voire une opposition articulée – et nous voyons que Beethoven revient à la technique du contraste dramatique suivi d’une réduction du caractère antagoniste, jetant un pont entre les forces opposées, comme si elles formaient une dissonance structurelle nécessitant une résolution. » (p. 102). Rosen donne alors une longue série d’exemples très richement analysés, notamment avec la sonate op. 10 n°2 qui s’ouvre par une multiplicité de motifs et deux phrases opposées, montante et descendante, puis combine des registres aigus et graves, ce qui fait qu’en terme d’expression, se produit alors l’effet d’une forme narrative : une intrigue s’y joue (p. 109).
Après la mort de Beethoven, Rosen constate en historien que l’on assiste à un retour de l’unité du sentiment ; et les thèmes dotés d’une opposition de sentiments intérieurs cessent quasiment d’exister (p. 114). Au cours de la seconde moitié du XVIIIè siècle, les augmentations d’intensité à grande échelle étaient généralement réservées aux sections ultérieures de l’œuvre, où le matériau pouvait être plus librement développé, fragmenté et retravaillé : en particulier, la préparation d’une vaste récapitulation pouvait être l’occasion de susciter un sentiment d’excitation (p. 115). Mais précisément, le romantisme naissant fait débuter ses œuvres à ce moment-là. Par exemple, avec son opus 17, Schumann débute à un niveau de tension qui ne laisse comme seule possibilité que sa diminution jusqu’à l’épuisement complet, procédé répété encore et encore sur toute la durée du mouvement, et qui, selon Rosen, justifie le titre donné originellement : « Ruines » (p. 125).
Avec Brahms, Rosen note le quasi paroxysme classique : la Sonate en fa majeur pour violoncelle et piano marque le retour du thème à la fin du développement : il s’agit d’une démonstration éloquente de la manière dont un même motif mélodique de base peut être employé pour produire des sentiments spectaculairement dissemblables par des changements de rythme et de texture (p. 131).
C’est après Brahms que selon Rosen, le temps de la crise de la tonalité arrive à son comble et avec elle, celle du repère sentimental :
Dans la musique du XVIIIè chaque note et chaque accord est à une distance harmonique mesurable vis-à-vis de la tonique sur le cercle des quintes, et fonctionne comme s’il se déplaçait en se rapprochant ou en s’éloignant de la résolution. Cela donne à chaque phrase d’une œuvre une signification tonale précise, permettant à l’auditeur d’éprouver le degré exact de tension harmonique, de sorte en général à pouvoir dire si un passage s’est éloigné de la tonique en direction des dièses (c’est-à-dire vers la dominante) ou des bémols (vers la sous-dominante), ce qui modifie sa signification affective. Les relations de médiantes, plus riches, qui dominent le XIXè, rendirent possible une nouvelle gamme d’affects, mais compromirent la simplicité harmonique que percevait aisément les auditeurs précédents. La proposition de se débarrasser de la tonalité fut avancée par Debussy, lequel ne s’aventura certes pas si loin, mais l’insatisfaction à l’égard du vieux système harmonique était déjà tangible dans sa musique : il trouva une nouvelle voie visant à remplacer le rôle des hauteurs par celui du timbre (p. 132).
Le sentiment selon Rosen est donc directement indexé aux procédés de la composition ; on peut même dire qu’il emploie le terme de sentiment et d’affect pour qualifier une certaine situation dans les différents moments de la construction indiqués sur la partition – que l’auditeur est censé percevoir. Cette perception nette des « sentiments » est identifiée à la « signification tonale » harmonique : mais lorsque les compositions favorisent le « chromatisme » sur la « tonalité », c’est à ce moment historique que le sentiment musical n’est plus clairement déterminé, ou qu’il est produit par « provocation », ou suggestion chez l’auditeur. Rosen donne là-dessus l’exemple de l’opéra de Strauss, « Salomé » : Strauss prétend « représenter » un sentiment alors qu’en fait, il « vient provoquer un sentiment d’impatience par son effet irritant – en d’autres termes, il produit l’impatience en manipulant la sensibilité de l’auditeur. » (p. 133). Entrent en scène dans les compositions des procédés de « stimulation », et non plus de signification précise classique au sens employé précédemment : quand le sentiment s’éteint, s’éveille la sensibilité.
C’est ce jeu qui caractérise selon Rosen une bonne partie de la musique du XXème siècle, avec par exemple Stravinsky, dans le « Sacre » ou dans « les Noces », où « la rupture avec les attentes physiques à l’égard du rythme et de l’accentuation constitue une part essentielle de l’expression du sentiment » (p. 138). Le sentiment et l’affect sont donc brouillés par le mode de composition lui-même dont les repères harmoniques sont mis petit à petit à distance : « la prolifération du chromatisme et l’usage banalisé de la dissonance augmentèrent la difficulté pour les compositeurs de parvenir à un contraste affectif véritable par la simple opposition des modes majeur et mineur ou par l’opposition entre harmonies diatoniques et chromatiques. Ils eurent souvent recours au procédé d’utilisation obsessionnelle d’un type d’accord pour un long passage, voire une section ou une pièce entière. » (p. 139)
Ainsi, au fil du temps et de l’histoire de la musique classique, Rosen note une pure et simple dégénérescence de la « représentation du sentiment » dans les compositions : « le fondement de la tonalité classique est la relation entre la tonique et la dominante. Celle-ci avait été considérablement affaiblie dans les années 1830, les compositeurs s’intéressant alors davantage aux relations fondées sur la médiante (III) que sur la polarité I-V classique (…) mais ce qui était essentiel pour la tonalité classique était la dominante majeure » (p. 169). En s’écartant de ces standards, le travail des interprètes et des compositeurs est donc complexifié pour obtenir un rendu « significatif », même s’il n’est pas exclu de les voir ressurgir un jour.
II.Tradition sans convention
Dans la suite de ses analyses sur la représentation des sentiments signifiés par la structure musicale, Rosen propose de montrer en quoi ces structures, ces formules du répertoire et du style, étaient des « formes conventionnelles », c’est-à-dire des manières typiques constitutives d’une œuvre musicale, donc de l’audition et de la composition de celle-ci, notamment à la fin du XVIIIème siècle. Ce sont ces formules conventionnelles – par exemple les arpèges, traits virtuoses, fanfares (p. 157) – qui cimentent l’œuvre, et qui, par effet de contraste, produisent et mettent en lumière les traits les plus originaux et novateurs d’une composition classique comme la forme-sonate ; Rosen donne en exemple le concerto en si K 595 de Mozart qui
« commence avec une modulation exceptionnellement frappante – de fa majeur à si mineur, soit l’intervalle de quarte augmentée (le triton, ou intervalle diabolique), le plus destructeur du sentiment de stabilité tonale – et se poursuit avec une série de surprises (…) Dans cette œuvre extraordinaire, les éléments conventionnels de structures, les figurations banales et les arpèges, aident Mozart à résoudre le problème d’une forme de grande étendue. Ils lui permettent à la suite de changements d’une rapidité déconcertante, de retenir l’élan au moment où le développement touche à son terme, et de soutenir le retour du thème initial en recréant l’espace nécessaire à son épanouissement. Ils annoncent la résolution en retenant le mouvement harmonique. » (p. 153 sq)
C’est donc le conventionnel, au sens d’habitude familière et de lieu commun imposé dans la composition, qui à la fois rassure et surprend, structure la limite et la consistance d’une œuvre tout en laissant jaillir par contraste les motifs les plus originaux.
Ici, Rosen pose la question suivante : comment se forme une convention ? il reprend alors son analogie et sa discussion sur le langage avec Diderot et Lessing. L’autre problème de la convention en art, vient du fait que le compositeur de génie en sait la nécessité mais l’épure pour ne pas la répéter comme un lieu commun fastidieux, attendu et vulgaire, comme un cliché. L’artiste ne dépasse la convention que pour autant qu’il l’approfondit plus intensément : il remonte à sa « raison d’être logique » selon Rosen, et ainsi, évite sa banalité commune comme l’indique l’exemple d’élaboration géniale par Mozart. En ce sens, Beethoven est une figure créatrice « ambiguë » :
« un tel matériau ne disparaît pas dans son œuvre : au contraire, celle-ci en est peut-être plus remplie que celle de Mozart. Mais il est dépouillé d’une partie, voire de l’essentiel de son aspect conventionnel. L’usage traditionnel et convenu des arpèges dans le second solo d’un concerto est encore un bon exemple : il est présent dans chacun des concertos de Beethoven. (…) les arpèges de l’Empereur ont cessés de paraître conventionnels : ils sont devenus thématiques, le motif principal porteur de la signification musicale qui concentre notre attention. En somme, le « conventionnel » (arbitrary) a été « naturalisé » – et comme tel, devient porteur d’une immédiateté de signification insoupçonnée par la tradition, et indépendante d’elle. Les arpèges sonnent ici comme si Beethoven en avait spécifiquement inventé le procédé pour ce concerto : de sorte que la référence à une tradition apparaisse sans objet. Beethoven ne se contente pas d’user avec la maestria mozartienne du remplissage traditionnel : il le réinvente. Dans le développement d’un concerto de Mozart, les arpèges standardisés doivent être exécutés avec un caractère improvisé – par exemple, au début du développement du Concerto en sol majeur, K 453. Mozart nous rappelle l’origine de la convention. Dans le développement de « l’Empereur » en revanche, tout sens de l’improvisation est abandonné. Les arpèges ne sont plus improvisés mais composés. Ils doivent être strictement intégrés à la texture symphonique. » (p. 166)
Ces procédés sont d’ailleurs là encore repris et radicalisés par Brahms dans tous les sens du terme, ce qui, paradoxalement, classe son attitude comme fondamentalement liée à l’aliénation romantique, dans la mesure où Brahms fait paraître le conventionnel comme novateur et les motifs novateurs comme conventionnels – ceci dans la suite de la formule célèbre de Novalis : « rendre le familier étrange et l’étrange familier » (p. 182).
Enfin, si la convention en musique se créé selon Rosen par la « répétition », alors on peut dire que même la musique contemporaine est à sa recherche malgré elle : chez Carter ou Boulez par exemple, on ne trouve pas de retour thématique dans leurs compositions ou de récurrence d’un motif ; mais ils restent en miroir du conventionnel dans cette attitude compositionnelle, car en niant la répétition, ils la présupposent et par là même ils la conservent : le conventionnel absent hante ces œuvres apparemment sans retour, et c’est pourquoi les œuvres de Boulez et Carter joue encore avec ces standards conventionnels et les présupposent dans leurs compositions.
III. L’avenir de la musique
Si ce que Rosen appelle le conventionnel est constitutif de la musique classique, alors son système de composition comme de transmission est homogène en cela qu’il est essentiellement une répétition, une reprise active de certaines formes et modèles. « Un art peut survivre simplement parce que ses traditions et ses pratiques se perpétuent. Cette sorte de survivance rituelle s’accomplit au mieux dans une société qui évolue peu et reste homogène sur le plan culturel » (p. 186), c’est-à-dire que ses exigences significatives restent stables parce qu’elles comprennent et approfondissent continuellement l’origine d’une « convention » et la vivent pleinement.
Comment transmettre aujourd’hui cette exigence dans l’art musical, alors qu’il était auparavant confié au système de notation, lequel est pratiquement abandonné par la musique populaire actuelle ou le jazz ? Là-dessus, Rosen ré-expose le paradoxe de la musique classique :
« pour des raisons pratiques, on ne peut noter tous les aspects de la musique. La notation est sélective ; seuls sont choisis certains éléments musicaux, ou « paramètres ». Pour cette raison, nous pourrions considérer qu’un art aussi fortement dépendant de la notation que l’est la musique savante occidentale est par essence inférieur aux musiques des autres cultures, transmises oralement par imitation… différentes écoles de pédagogie cherchent à fonder la supériorité dont elles se targuent presque entièrement sur ce qui n’est pas écrit. Cependant, c’est avant tout la nature fondamentalement non satisfaisante de la notation qui a permis aux monuments de la musique occidentale de survivre et d’échapper à l’érosion destructrice du temps. En fait, c’est cet antagonisme fondamental entre la partition et l’interprétation, le concept et la mise en œuvre, qui fait la gloire de la musique occidentale. (…) ce que nous entendons, l’exécution sonore de la partition, ne peut jamais être assimilé à l’œuvre elle-même, car il existe de multiples façons de jouer la partition, mais toutes sont des exécutions de la même œuvre qui, en fait, demeure inchangée – visible, pourrions-nous dire, mais inaudible derrière toutes ces exécutions. La partition écrite définit les limites à l’intérieur desquelles de nombreuses possibilités peuvent venir se loger. Le problème des chercheurs demeure essentiellement celle de savoir comment décider laquelle des interprétations rend justice à l’œuvre et laquelle la trahit. » (p. 189sq)
Le problème de la transmission n’est pas selon Rosen que le système de notation de la musique n’est pas autosuffisant ; au contraire, comme encore une fois on ne peut pas tout noter, c’est le « charme » même de la musique qui fait que l’on doit nécessairement l’interpréter. Mais ce qui n’est plus transmis, c’est cette exigence de lecture de la partition préalable à la compréhension d’une interprétation que le public contemporain perd de plus en plus : une œuvre est belle selon Rosen indépendamment de toute exécution (p. 197), et malheureusement, les disques et les concerts forment à une expérience qui peut se passer de cette visualisation et de cette lecture. L’amour de la musique classique, pour être réel, doit être fondamentalement éduqué pour aimer réellement – aussi Rosen considère cet amour comme « pervers » (p. 199) étant donné la somme de conditions qu’il lui faut pour seulement accéder à son éventualité. Hélas, « l’apprentissage du chant et du piano a été remplacé aujourd’hui par l’acquisition de disques. C’est là une évolution inquiétante qui pèse déjà sur l’avenir. Le public de la musique sérieuse est de plus en plus passif, et on ne trouve plus en grand nombre des auditeurs instruits qui aient une expérience active de la musique et qui soient capables de créer un lien entre le grand public et les professionnels. » (p. 200). Et nous retrouvons ce que nous avions cité en introduction : le public n’est plus éduqué à la « résistance que l’œuvre impose à l’interprétation », là-dessus, les multiples disques ou versions ne nous apprennent rien du processus qui fait passer de la partition au son (p. 201).
Rosen conclut ainsi : peut-être que le système de notation de la musique classique la sauve des affres du temps, mais l’essentiel est la tradition de sa lecture liée à son indispensable interprétation : et c’est ce lien que nous perdons actuellement. Nous pouvons maintenir cette tradition ou espérer la retrouver, mais alors, sur cette dernière « option », notre époque prend de grands risques car « il existe une différence entre une tradition continûment réactivée et une autre qu’il faut ramener à la vie, il y a là une différence d’authenticité » (p. 203).
IV. Les langages musicaux d’Elliott Carter ; « Une pièce facile »
Ces deux articles consacrés à la musique de Elliott Carter (1908-2012) dont Rosen fut le premier défenseur et interprète, reprennent et illustrent le propos général sur l’avenir de la musique. A travers la sonate de Carter, Rosen va montrer toute la filiation classique de sa composition avec la Sonate de Liszt. La différence cependant, c’est que celle de Carter « s’ouvre non pas sur un thème, mais avec la sonorité des si en octaves dont découlent tous les thèmes » (p. 217). Qu’y a-t-il donc à entendre dans ce matériel thématique sans thème ? Si Carter renonce à la relation tonique-dominante, il maintient cependant une strict discipline avec la barre de mesure (p. 214) : et l’on peut parler ici d’un renversement dialectique spectaculaire, car en maintenant cette pulsation dans sa sonate, il s’émancipe cependant de la stricte régularité du métronome, se « dégageant alors du temps mesuré » (p. 218) par la mobilité constante de la barre de mesure : ce que l’on n’était pas censé entendre, on le perçoit alors comme « sensation d’un temps non mesuré » (p. 223) ; et le génie de la sonate de Carter – donc sa difficulté – c’est que l’on ne peut anticiper quoique ce soit dans cette perception : la pulsation est rigide et ainsi, par le conflit temporel simultané, le temps se condense en myriades de séries libérées, pollinisées.
Cette difficulté procède là encore d’un jeu avec le conventionnel que le compositeur contemporain suggère tout en s’en abstrayant : « Toute œuvre originale présente une omission, et même un effacement délibéré de ce qui était auparavant indispensable, en même temps qu’elle offre un ordre et des éléments neufs. La cause réelle d’irritation pour un auditeur est que ce qu’il avait jusqu’ici perçu comme essentiel dans une œuvre musicale ne lui est plus disponible. Le compositeur le lui a enlevé. Apprécier un style nouveau requiert autant une renonciation qu’une acceptation. » (p. 229)
V. Retour sur l’introduction du traducteur Théo Bélaud, « Un thème et variations sur le sens musical »
Après cette lecture directe de Charles Rosen, nous pouvons à présent faire un retour sur la présentation de son traducteur Théo Bélaud. Ce dernier considère que Rosen effectue des observations « in vivo », directement décrites à partir et selon le matériel musical, et non une réelle conceptualisation. C’est là une considération sur la nature même de la description qui nous semble illusoire quelque soit la caractérisation ou les fonctions que l’on attend du concept en le distinguant de la description ; le concept étant une saisie systématique, le simple examen qu’il rapporte, même avec des prétentions limitées à la simple « observation », est d’emblée dans une situation équivoque par rapport à son objet : la description in vivo est alors aussi une tentative de produire une vue d’ensemble ou une mise en perspective, et c’est donc selon le concept qu’elle produit un type de relation et une distance signifiante élaborés de façon plus ou moins authentique ; mais le concept réel atteint son authenticité supérieure parce qu’il affronte cette relation même, c’est-à-dire qu’il la pense dans son développement systématique – c’est l’activité philosophique. Malgré tout, Théo Bélaud, plus que Rosen – qui à notre avis reste vague – considère cette description de la situation musicale comme portant directement sur « la vie du langage musical » (p. 17) ; ainsi, elle manifeste de façon « immanente » l’histoire des différents types de sensibilités selon les styles.
Mais alors, de quelle « vie » s’agit-il encore ? Est-ce celle des œuvres telles que les voyaient Wittgenstein [2]? Comment la tradition fait-elle encore vivre ces formes expressives classiques ? Théo Bélaud interprète la tradition comme une sorte de superstructure instituée superposée à des phénomènes de reconnaissance qui se jouent au présent. Comment ? Selon lui, Rosen considère que le style est déjà une interprétation du langage, l’histoire de la musique et l’interprétation musicale étant des interprétations au deuxième degré, on peut considérer que l’acte de composition est déjà interprétatif, parce qu’il réalise un programme de « naturalisation de la convention langagière » (comme l’herméneutique accomplit la naturalisation du mythe dans le langage). A partir de là, Théo Bélaud indique que le discours même de Rosen
« présuppose indirectement trois thèses fondamentales : Primo, que la destinée historique des œuvres canoniques, suivant le principe romantique schlégélien, est inscrite dans leur texte même, parce que leur relation au style modifie et précise celle-ci, éventuellement en réinterprétant le langage lui-même, et qu’elles acquièrent ainsi une fois pour toutes le statut de canon : c’est une raison logique pour laquelle la signification de ces œuvres ne peut se trouver en-dehors d’elle, et ne peut donc s’exprimer dans le langage verbal.
Secundo, que le sens musical ne pouvant être fixé verbalement, il ne peut donc pas vraiment être fixé tout court : et c’est heureux, car sa disponibilité à l’interprétation par le geste musical doit demeurer inentamée. Ce simple raisonnement déplace le lieu et l’enjeu de la signification de la musique. Ce qui est juste ou correct n’est pas le sens que l’on peut énoncer quant à une phrase musicale, mais le geste interprétatif, comme tel, peut l’être plus ou moins – et c’est la familiarité avec le style qui autorise d’en juger.
Tertio, que le sens musical est si fragile (à cause de l’extrême sensibilité du langage à la perturbation, et par sa nécessaire disponibilité interprétative) qu’il se tient toujours à la frontière du non-sens – et qu’une forme de connivence linguistique entre le compositeur et l’interprète ou l’auditeur consiste éventuellement à en jouer ; cependant, il doit rester possible, dans l’expérience pratique, de distinguer entre le sens et le non-sens, sans que pour autant leurs contenus soient descriptibles. » (p. 19-20)
Nous n’avons lu de Rosen que cette série d’essais, il nous sera donc difficile de prendre justement toute la mesure de ces présupposés indiqués par Théo Bélaud. Cependant, nous avouons concernant le premier point, ne pas vraiment comprendre cette référence à Schlegel et aux romantiques, ni voir dans les textes de Rosen ce qui aurait pu indiquer une destinée canonique des œuvres musicales à la manière de Schlegel. Nous avons vu deux références à Novalis concernant une période déterminée de l’histoire de la musique, mais quand l’un des Schlegel s’inspire directement de Condorcet sur l’évolution poétique sans fin d’un progrès de l’esprit humain infiniment perfectible[3], nous restons assez sceptique avec cette comparaison dans ce que nous avons pu lire, puisque Rosen propose surtout, à travers ces essais, une vision du modèle classique en désagrégation au fil des époques, et même s’il veut croire au maintient et au retour prochain de ce modèle, cette attente cyclique se rattacherait alors à un mouvement de type naturel, donc en contradiction avec les conceptions des romantiques allemands. Certes, on peut lire ce qu’expose Rosen comme un cours historique en approfondissement jusqu’à épuisement des formes classiques, puisqu’il considère aussi que c’est la compréhension des styles postérieurs à un style donné qui éclaire mieux la compréhension du plus ancien ; cela peut donc se lire symétriquement au progrès romantique, comme son inverse. Cependant, dans la mesure où Rosen salue, interprète et valorise la création de Carter ou Boulez, nous devons bien noter que la déliquescence historique concerne principalement l’auditeur plus que le créateur, ce dernier restant seul capable de ressusciter des formes et des procédés de compositions passés (mais on l’a vu, ce n’est pas sans risque pour Rosen). Rosen mobilise donc dans ces articles des visions temporelles de nature différente.
Est-ce que Schlegel est utilisé par Rosen comme principe de lecture ? Schlegel écrit que « beaucoup de compositions musicales ne sont que des traductions de poèmes dans la langue de la musique » (Cf. L’Absolu littéraire § 392). En effet, si l’on veut suivre le commentaire de Théo Bélaud dans cette voie, le travail stylistique interprète le langage, c’est-à-dire élève le signe à la symbolisation, et met celle-ci à disposition du travail d’interprétation « vivant » ; mais celui-ci en reste aux simples conditions de possibilités à conserver quand les romantiques Schlegel et Novalis cherchaient à les réfléchir à l’infini pour les dépasser.
Sur le deuxième présupposé évoqué, on voit ici la marge, la porte étroite qui devient même infime : le style est un phénomène historique dont la compréhension se joue « à la surface du texte » : et comme ce n’est pas une « construction intellectuelle du commentateur », on s’interroge donc sur le statut de cette « raison logique » du canon qui n’est compréhensible que par une simple « familiarité », une fréquence de fréquentation qui a immédiatement force d’argument sans argument, sans réplique puisqu’elle annule d’elle-même toute explication par le signe dans son ressenti de l’instance normative instituée. Cela a le grand mérite de paraître fidèle à un principe de « simplicité », c’est-à-dire de refuser toute « inflation » du commentaire musical, cette mince pellicule de poussière que l’on verrait comme en filigrane du texte de la partition. Mais étrangement, ce n’est surtout qu’une force d’appréciation qui reconnaît la raison logique sans en avoir la compréhension intelligente : cette reconnaissance n’est plus au fond qu’un hommage plus ou moins cultivé du passé.
Mais une sorte d’amphibologie apparaît avec le troisième point, lorsqu’en jouant avec Rosen sur un double sens du sentiment musical, ce sens ainsi thématisé va se bloquer dans son antinomie et déboucher sur le hors-sens. Le contenu du sentiment musical est indescriptible parce que la familiarité à revivifier par la réflexion historique est pourtant vécue comme inexplicable. Et Théo Bélaud tire ensuite les dernières conséquences de cette neutralisation apparente du conceptuel dans sa renonciation à la signification : « Lorsqu’on accède à la familiarité musicale, on cesse en principe de se demander ce que la musique signifie : c’est là une contribution décisive de Rosen, la plus personnelle en tout cas, à la tradition de pensée de l’autonomie du musical. » (p. 20). Alors, la mauvaise interprétation est vécue comme un « non-sens » et non plus comme un « contre-sens », puisque de toute façon, l’inévitable familiarité se joue sur un mode hors-sens, c’est-à-dire qu’elle est « naturelle » (p. 24).
Naturelle, puisqu’on le sait, selon Wittgenstein, « la tradition n’est rien que l’on puisse apprendre, ce n’est pas un fil que l’on puisse ressaisir quand bon nous semble. Tout aussi peu qu’il nous est loisible de choisir nos propres ancêtres. » (Cf. Remarques mêlées, Éditions TER, 1984, p. 76). Ainsi, ne reste plus que la « familiarité » issue de cette tradition dont les modes biologico-historiques se maintiennent comme et en tant que savoir tacite à régulièrement nourrir pour être préservé. Dans la mesure où l’enjeu de la familiarité se situe dans le rapport du langage musical à la convention, la question philosophique de l’origine naturelle ou conventionnelle du langage musical est donc « un motif ancestral » (p. 22). On retrouve là encore Wittgenstein et ses funestes conséquences interprétatives platement bourdieusiennes, où l’acquisition des capacités passent par le corps – tout comme le geste interprétatif – et se résument à du social incorporé, reproduit dans l’ordonnance d’une aspiration culturelle collective où, selon Wittgenstein, chacun se reconnaît dans les normes extraites par les créateurs et que chacun aspire à comprendre et réaliser donc reproduire, pour former « du style » ; d’où l’importance de la formation de cette « sensibilité générale » et de son « institution » (p. 28). Ainsi, malgré le premier présupposé, Théo Bélaud va par ailleurs tenter de nuancer l’historicisme du texte de Rosen de cette manière :
« la musique en se signifiant elle-même, nous met en présence d’affects, et de l’évolution historique. Non pas ce que la musique signifie, ni vraiment pourquoi, mais comment : l’analyse, portant à la fois sur le vécu sensible du phénomène musical et sur son historicité, se joue de la ligne de partage habituelle entre ontologie et philologie. On pourrait dire que l’histoire du sentiment musical ici esquissée est l’histoire des styles d’expressivité.
Ce ne sont pas les contenus affectifs, mais les formes expressives dans le matériel de base. La forme-sonate relève donc moins de la forme que du style, c’est-à-dire directement de l’interprétation du langage, de l’expression d’une sensibilité générale voire d’une civilisation : n’inventant pas de nouveau langage, le classicisme se contente d’être un style de réinterprétation. Rosen transcende l’alternative par l’aptitude à manier et comprendre le conventionnel, avant qu’il ne se dégrade en lieu commun et arbitraire. Le propre des langages poétiques étant de créer l’illusion que le signe conventionnel surgirait de la nature, la véritable convention fonctionne tant que le charme opère (et que nous sommes capables de le retrouver par la familiarité avec les styles du passé, ce qui au passage explique de façon imparable l’impossibilité de ressusciter un style ancien sans le parodier, volontairement ou non). » (p. 28)
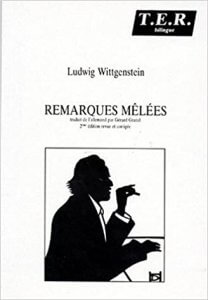
La musique est donc apparemment « autonome » à tous les niveaux selon ce circuit fermé de la naturalisation conservatrice de son « expression », laquelle provient de conditions stylisées : ainsi, « le sentiment en musique est toujours explicite, dont la dimension accessible à la formulation verbale ne l’est que par un ensemble de conventions et d’habitudes, de sortes que sur ces traits généraux, il est à peu près impossible de jamais se tromper. » (p. 25). L’auto-expression du langage musical, comme expression à l’intérieur de soi procède par la symbolisation des propriétés contenues par le langage, ce qui signifie non seulement qu’il s’exprime lui-même, mais que son but n’est autre que lui-même. Que peut donc encore signifier la désignation d’un but au sein de l’autonomie ? Peut-être est-ce comme un moment d’ultime clôture avant l’autophagie. Là-dessus, l’interprétation de Rosen par Théo Bélaud propose un cercle conditionné et n’explique le surgissement d’une stylisation qu’à partir du point de vue de l’auditeur : la perception de cette expression musicale vient alors échouer dans la consignation symbolique d’un texte ; ensuite, pour donner part au compositeur par réversibilité, il ne reste plus qu’à faire jouer en miroir ces mêmes conditions dont le compositeur est à coup sûr transi, et voilà l’illustration de l’autonomie du musical, qui n’est que l’histoire même de ce schéma de symbolisation, c’est-à-dire de la description des moyens par lesquels certaines procédures et ensemble de règles produisent de la symbolisation en vue de l’expressivité et cherchent à la protéger. L’œuvre d’art serait ainsi ce miroir des conventions d’une époque alors cristallisée en formes symboliques que reconnaît émotionnellement le public. Le problème, c’est qu’il y a selon Rosen un divorce structurel entre le public et le compositeur, ce dernier venant d’ailleurs souvent toujours trop tôt face à une époque qui ne s’est pas encore assez habituée à apprécier le fond conventionnel naturalisé de ses propres habitudes. Il faut donc éduquer l’habitude du public à ce qu’il connaît déjà dans une œuvre d’art (apparemment) nouvelle.
Conclusion et perspectives critiques
Les textes de Rosen traduits et introduits par Théo Bélaud ont, en plus de leurs analyses techniques précises et extrêmement érudites – « intimidantes » de l’aveu même de Boulez -, ont disons-nous, l’immense mérite de recentrer l’écoute musicale pour une esthétique sur des fondamentaux sains : la pensée d’un sentiment musical est à déterminer à partir de la partition et de l’exécution de celle-ci, et donc pas nécessairement à partir des intentions extérieures du compositeur dans une perspective de provocation du sentiment, mais bien plutôt selon un procédé propre à la composition elle-même. Ainsi nous sommes dans un premier temps apparemment débarrassés des spéculations étrangères à la musique même qui, dans leur psycho-sociologisme, manquent l’élaboration musicale même, et ainsi toute forme d’évaluation artistique. Cela ouvre une porte pour l’évaluation critique de l’interprétation systématiquement comparée avec le texte musical.
Ce que nous pensons devoir discuter cependant, c’est la croyance en une autonomie de l’art musical et à l’univocité de son commentaire avec le langage. Même si l’enjeu est limité à la préservation de l’intégrité expressive de l’art musical, non seulement ces deux perspectives nous semblent structurellement et logiquement incompatibles, mais également négatrices d’un système fécond pouvant réellement connaître la musique à travers ces analyses techniques : si l’inflation herméneutique est effectivement châtrée par la première attitude, on risque cependant de manquer le savoir même, parce qu’en embrassant au départ une excessive apophantique, cette attitude n’a ensuite plus d’autre choix que d’expliquer sa posture malgré elle par la voix de la « familiarité », la cynique référence au bien connu qui ne peut que verser dans un format historiciste de plate reproduction : car par exemple, si l’on considère que la vérité des œuvres et leur écoute sont toujours mieux entendues plus tard, ou bien encore, si elles sont conditionnées par un maintient culturel de transmission dans le cours de l’histoire, alors on reconnaît par-là que le type classique – dont les normes authentiques devraient être pourtant définitives – est en fait d’emblée caduc et daté, non seulement pour les auditeurs, mais également dans son texte même puisqu’il n’est, selon ce schéma, que la consignation symbolique d’une époque : ne reste plus par conséquent qu’à l’examiner comme un objet sédimenté dans l’histoire.
Les éléments d’analyses de Rosen justifiés par Théo Bélaud via l’évocation ponctuelle de Wittgenstein rendent ainsi certains de ses propos moins crédibles à notre avis, alors même que Rosen tente souvent de réinscrire ses savantes descriptions dans un système des arts ; certes, il le fait par analogie et mélange des genres, avec certaines confrontations comme avec Diderot ; de même qu’avec le langage qui, en fait, est reposé dans ces articles comme simple point de départ, métaphore d’un processus de « naturalisation ». Les intentions propres à Théo Bélaud sont développées plus spontanément par ailleurs :
« Le piège consiste en ce que la volonté d’explication est tentatrice de fixer les mots une fois pour toutes. C’est exactement ce contre quoi Rosen mettait en garde : si la musique se tient au bord du non-sens, ce n’est pas une raison pour y basculer. « La proximité du non-sens, le refus de toute signification fixée par avance, est une condition essentielle pour la musique. » Cette formulation qui borne idéalement la spécificité des conditions de possibilités du sens musical par rapport au langage en général. Simplement, en musique ces conditions doivent avoir un caractère absolu. (…) Je ne crois pas du tout que la musique soit universelle au sens absolu (qui réclame une approche sentimentale) ou restreint qui consiste à dire qu’on peut lui faire faire ou lui faire «dire» n’importe quoi, au prétexte de son ouverture à toute réponse émotionnelle possible. La «condition du non-sens a priori » est indispensable, mais faute de s’effacer derrière la « bonne » culture ou compréhension d’un moment historique, elle semble pour ce siècle devoir libérer un autre potentiel, d’arbitraire et d’autodestruction (je pourrais vous donner et commenter des dizaines d’exemples dans l’industrie actuelle du concert et du disque « classique »). La question raisonnable, je crois, est d’éprouver les limites de notre résistance à cette force, sans compromettre la clause initiale du non-sens. Si on sait poser ce défi, on se donne une chance de vivre et de mourir moins ignorant (de l’effet proprement musical que peut produire la musique sur nous).[4] »
Avec cette culture de « l’effet » et de la conservation du non savoir, ne reste à notre avis que la jouissance de la différence entre une écoute cultivée et une écoute culturelle, une écoute particulière qui sent se composer un conditionnement vis-à-vis d’une écoute de conformité laquelle, par contraste, se perd dans l’intuition faussement créative. Mais les deux se situent en fait sur le même plan, et présupposent également le savoir sans l’élucider : il n’y a au final pour les différencier que l’érudition et la collection.
L’intégration d’un tel mécanisme de formes empaillées face aux évaluations concurrentes devient alors exclusive, et croit en cela atteindre et participer de l’intégrité même de l’œuvre, parce qu’en s’étant aveuglé sur ses propres principes et critères – disons mieux, en considérant les principes comme aveugles -, le critico-interprète croit voir la nudité de l’œuvre dans l’éclair d’une écoute lézardant ses habitus : ni historique, ni originaire, elle n’est pas non plus prise dans un retour originel rêvé, ni dans une lecture purement technologique : l’œuvre n’apparaît alors que parce qu’elle devient simultanément témoin de son propre médium qui revient à l’œuvre dans l’encens du « savoir tacite » et son jeu d’auto-reflet incessant, réitéré dans ce qui n’est plus qu’un rituel de momification par les concerts et les enregistrements. Inutile donc de demander à une telle disposition la démonstration de ses principes ou de ses évaluations : ceux-ci sont ravalés au processus historique que l’on ne peut reconstituer sans le surcharger de modalités toujours trop « culturelles » – en laissant donc de côté la question de savoir ce qu’il y a à réellement cultiver spirituellement -, et qui seraient in fine d’ailleurs dénoncées comme tentation « herméneutique inflationniste» que l’on a par avance dénoncé et nettoyé. A l’écoute des « mise en forme de l’expression », ne reste plus alors qu’à veiller devant les « sépulcres blanchis à la chaux » du non-sens. Mais au fond, il n’y a là rien de choquant dans cette attitude critique des œuvres d’art, puisque depuis longtemps
ce que nous faisons en jouissant d’elles n’est pas une activité de service divin par laquelle adviendrait à notre conscience la vérité parfaite qui est la sienne et qui la comblerait, mais c’est une activité extérieure, celle qui, par exemple, essuie les gouttes de pluie ou la fine poussière déposées sur ces fruits, et qui à la place des éléments intérieurs de l’effectivité environnante, productrice et spiritualisante du souci des bonnes mœurs, dresse le vaste échafaudage des éléments morts de leur existence extérieure, du langage, de l’historique, etc., non pour y engager sa vie, mais uniquement pour se les représenter en soi-même.[5]
[1] Charles Rosen, Musique et sentiment, et autres essais, Traduction Théo Bélaud, Contrechamp Editions, 2020.
[2] « Wittgenstein a eu à l’égard de la musique germanique objectivement « de tradition » de son époque, comme celle de Schönberg, en regard de sa déférence pour la tradition elle-même, une attitude analogue à celle que pourrait avoir un naturaliste dans un zoo. Peut-être qu’un animal peut vivre heureux selon sa propre norme dans un zoo : mais ceux qui l’y observent pour se distraire, même s’ils éprouvent un amour et un respect authentiques des animaux, ne vivent certainement pas en harmonie avec la nature d’où on les a extraits. Selon Wittgenstein, il fut un temps, certes bref, à la charnière des moments classique et romantique, où l’animalité « sauvage, domestiquée . » qui signe les réalisations d’une grande culture, a composé le cœur du vivant dans la société occidentale, autour duquel elle organisait ses valeurs, ses croyances, et s’organisait elle-même. Ce temps étant révolu, tout prolongement de cette vie animale intervient en marge d’une société qui se soucie d’autres formes de domestication, induites par la foi dans le progrès et la technique, et dont, peut-être, la composante sauvage est passée du seul côté de la violence physique et politique déchaînée. Les œuvres se frayant un chemin dans cette culture sont peut-être grandes mais elles ne sont pas vécues comme grandes par la société » Cf. Entretien Théo Bélaud et Christianne Chauviré, https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2016-4-page-519.htm?fbclid=IwAR27sA_DSc5cRRDhZmWDVuCFaiunVAscWqjHk5wxHjLGvtqzasbCnVaQQvQ
[3] https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2011-2-page-265.htm
[4] Entretien Christiane Chauviré et Théo Bélaud, « L’esthétique » de Wittgenstein, le classicisme, la modernité et la constellation éclatée : Hanslick, Schönberg, Mann, Rosen », dans la « Revue de métaphysique et de morale » 2016/4 (N° 92), pages 519 à 546. https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2016-4-page-519.htm?fbclid=IwAR27sA_DSc5cRRDhZmWDVuCFaiunVAscWqjHk5wxHjLGvtqzasbCnVaQQvQ
[5] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Paris, Aubier, Bibliothèque philosophique, trad. J.P. Lefebvre, 1991, pp. 489-490








