I. « L’autonomie brisée » : quand les techniques créent des situations inédites qui travaillent nos catégories de pensée
Le constat est simple et banal pour qui est un peu attentif à ce qui se passe dans le monde qui l’entoure : les conséquences des avancées de la recherche médicale brouillent les cartes du jeu social, confrontent les démocraties à des problèmes nouveaux et conduisent souvent à des situations plus qu’embarrassantes, à des conflits que les législations en vigueur dans nos démocraties peinent à résoudre faute d’outils conceptuels adaptés. C’est un tel constat qui fonde le projet de l’ouvrage. Ou plutôt, c’est ce constat, banal s’il en est au premier abord, qui s’affine au point de nous permettre de repenser de fond en comble le politique sur la base d’une nouvelle éthique, un approfondissement qui conduit de la surface des actualités et de l’événementiel à l’élaboration d’une véritable réflexion de philosophie politique, l’auteur retrouvant en cela des thématiques dont elle est spécialiste1.
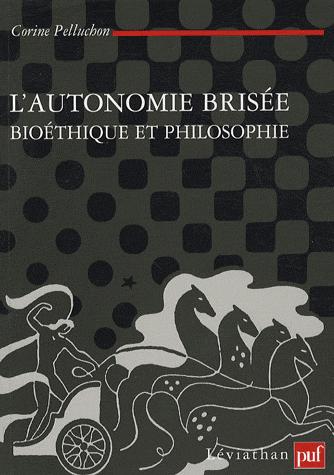
L’inscription du bioéthique dans le champ politique est la matrice de l’ouvrage. Mieux, la prise en compte du caractère éminemment politique du bioéthique, répond à l’aporie de la situation actuelle caractérisée au contraire par une régionalisation et une spécification toujours plus importante qui marginalise le bioéthique et la recherche – médicale et biomédicale notamment – dans un champ « à part » où le politique lui-même se dissout en devenant l’un des « champs » de la réflexion…seulement. Or, la régionalisation du bioéthique et de la recherche médicale prive par avance les conflits de résolutions satisfaisantes dans la mesure où les problèmes qui se posent engagent des choix de société. Comme le rappelle l’auteur en s’appuyant sur Habermas, il n’est pas question de porter un jugement sur telle ou telle pratique mais de mettre au jour le sens de cette pratique en la rapportant aux choix qui déterminent la communauté politique. Des cas de comas ou de fins de vies difficiles, sur-médiatisés, peuvent plaider en faveur de l’euthanasie. Pourtant, dans la perspective que défend C. Pelluchon, il importe de se demander si la légalisation de ce qui est très concrètement un meurtre par exemple, est compatible avec les valeurs que l’on entend promouvoir.
En outre, les avancées de la recherche en médecine comme en biologie créent des situations inédites qui viennent remettre en cause les catégories avec lesquelles nous pensons l’humain : nous vivons plus longtemps, ce qui donne lieu à des configurations de vies différentes de celles auxquelles nous sommes habitués et qui nous placent en face d’expériences du monde différentes où l’autonomie des sujets, fondement des Droits de l’Homme semble ne plus rendre compte de façon satisfaisante de ces expériences du monde pourtant bien humaines. C’est ce à quoi l’auteur fait référence en parlant d’ « autonomie brisée ». On comprend dès lors que les politiques libérales, favorables à une régionalisation du bioéthique, sur la base d’une anthropologie dépassée soit l’objet des critiques pertinentes et fondées de la première partie de l’ouvrage de C. Pelluchon. Non seulement la régionalisation du bioéthique est une position intenable puisque les situations qu’elle fait naître appellent des réponses en termes de choix de société, mais le politique, dans la mesure où il prend la forme libérale caractéristique de la réflexion de ces dernières décennies – notamment avec J. Rawls, E. Engelhardt, R. Ogien – est incapable de répondre aux nouveaux défis lancés par les avancées de la recherche médicale et biotechnologique pour la bonne et simple raison que les fondements sur lesquels s’appuient ces choix sont hétérogènes aux situations qui surgissent puisqu’ils excèdent précisément les catégories de pensée existantes. La pensée de l’humain impliquée dans ces choix, fondée sur l’autonomie du sujet, privilégiant le juste sur le bien, favorisant la revendication de droits ne sont plus en mesure de comprendre le monde et l’homme qui se font jour et que les avancées de la recherche contribuent à produire et à mettre en lumière de façon particulièrement saillante. Si une pensée politique neuve doit se faire jour, il convient de comprendre cette exigence comme une critique de l’anthropologie héritée des Lumières et caractérisée par une « autonomie » que les avancées de la recherche médicale ont largement contribué à briser. Comment définir aujourd’hui l’humain pour pouvoir réaffirmer des choix et des valeurs susceptibles de dessiner un système véritablement démocratique, et par suite, pour que les choix politiques soient à la hauteur de l’évolution des défis posés par l’évolution et les avancées de la recherche notamment dans le champ de la médecine et de la biologie – des défis fondamentaux puisque les situations inédites qu’elles contribuent à créer affectent l’humain dans ce qui le caractérise intimement et nous conduisent à adopter une perspective critique sur les catégories de pensée qui nous servaient à appréhender le réel et à l’ordonner dans une perspective sociale ? La pérennité de la démocratie exige que cette critique soit menée et qu’une autre anthropologie soit envisagée. On comprend dès lors le lien entre les deux parties de l’ouvrage et la place centrale qu’y joue une compréhension politique du bioéthique en même temps que le refus de son autonomie : une compréhension politique du bioéthique, nécessaire si le politique et la démocratie prétendent à quelque pertinence, conduit en outre à prendre en compte l’incapacité de la notion d’ « autonomie » à rendre compte de l’humain aujourd’hui, ce qui fonde et étaye une critique des éthiques minimalistes dont elle est le critère fondamental – première partie – et appelle une refondation anthropologique sous la forme d’une nouvelle éthique que l’auteur appelle « éthique de la vulnérabilité » en s’appuyant sur les réflexions de Lévinas qu’elle prolonge de façon fine et personnelle dans la deuxième partie de l’ouvrage. Les résultats de la recherche bioéthique et médicale réinscrites dans le champ du politique fondent la démarche critique aussi bien que thétique de l’auteur, et doublement : c’est non seulement l’exigence d’une éthique qui s’y fait jour mais également sa forme puisque cette « éthique de la vulnérabilité » se fonde sur une « phénoménologie de la passivité » construite au contact de malades et de cas cliniques dont l’auteur rend compte de façon originale et précise.
Cette double fonction du thème médical appelle cependant quelques remarques : si les situations inédites contribuent à mettre nos catégories de pensée à la question, s’ensuit-il que le rapport du malade au médecin et la douleur effectivement vécue soient les paradigmes les plus pertinents pour refonder une anthropologie ? Qu’est-ce qui se joue dans cette continuité et quels sont les enjeux de cette solution ?
Que les avancées de la recherche médicale posent de nouveaux défis, des défis qui ont la radicalité que leur prête C. Pelluchon, nous en sommes convaincus. Que cela invalide des politiques actuelles et nombre de leurs principes, nous en sommes également d’accord ; que cela exige, dans une démarche résolument politique, de repenser ces principes et ces catégories, voilà qui est admis. Dans la mesure où ce texte se donne comme un essai, il nous semble plus intéressant, pour rendre justice à cette démarche féconde s’il en est, de s’attacher au projet lui-même plus qu’à tel ou tel aspect du développement. Nous avons en effet affaire à un projet fondé et fort bien étayé qui, plus qu’une lecture myope qui s’en tiendrait à détailler les arguments, appelle une réflexion politique sur la thèse effectivement défendue et, reprenant la démarche politique prônée par l’auteur, à évaluer les conséquences de ce choix. L’éthique de la vulnérabilité fondée sur une phénoménologie de la passivité à partir du paradigme malade-médecin, exposée de façon si claire et, il faut l’avouer, assez convaincante, exige cependant de résister un peu à l’adhésion immédiate et à nous demander si la prise en compte d’une « autonomie brisée » qui appelle nécessairement une autre pensée anthropologique et une autre pensée politique débouche nécessairement sur les formes de société et de socialité envisagées dans cet essai. Le paradigme médecin-malade est-il la seule ou la meilleure forme que peut prendre l’éthique de la vulnérabilité ? Peut-on passer sans heurts du caractère révélateur et heuristique du champ médical à sa dimension fondatrice d’une nouvelle anthropologie ? Plus encore, l’actualité de cette réflexion qui prend en compte la dimension critique de la situation, n’est-elle pas en reste précisément dans le champ politique, mobilisant une certaine pensée de la valeur caractéristique de l’anthropologie que l’auteur juge précisément dépassée ?
2. l’éthique de la vulnérabilité fondée sur le paradigme de la souffrance est un choix, assumé, mais il n’est pas le seul et peut-être pas le plus pertinent.
Pour répondre à ces questions, il me semble intéressant de rapprocher cet essai de deux articles de J. Butler repris dans Défaire le genre, « Hors de soi, les limites de l’autonomie sexuelle »2 et « la question de la transformation sociale »3. Les deux philosophes se fondent toutes deux sur une critique de la notion d’ « autonomie » et donnent une place centrale à la vulnérabilité, à partir de la prise en compte du statut des minorités sexuelles pour l’une et de la situation des malades pour l’autre. L’expérience de la vulnérabilité est le fondement qui leur permet de repenser une anthropologie qui ne saurait reposer sur l’autonomie de sujets de droits souverains sans exclure d’emblée un nombre important d’individus. Ces réflexions relèvent pour l’une comme pour l’autre du politique et se rattachent explicitement aux travaux d’Habermas. Pourtant, comme en témoigne la divergence de traitement de la pensée habermassienne, nous avons affaire de part et d’autre à des solutions assez différentes, ce qui implique que la relation malade-médecin n’est pas le paradigme d’une éthique de la vulnérabilité mais un choix, une certaine manière de comprendre les enjeux d’une certaine vulnérabilité. Nous avons donc affaire à deux thèses assez différentes fondées pourtant sur des principes similaires, du moins à ce qu’il semble au premier abord. Il peut alors être intéressant de s’interroger sur le sens et sur les enjeux de cette divergence. Le choix du cadre médical pour fonder une nouvelle éthique est lourd d’implications et distingue radicalement cette conception de la vulnérabilité de celle défendue par J. Butler. Sous des termes semblables, des situations apparemment proches et des enjeux similaires – une réflexion politique qui assure le meilleur fonctionnement démocratique des institutions et de la société – nous avons affaire à des objets différents, ce qui a des enjeux très importants que nous allons essayer d’évaluer.
Tout d’abord, le paradigme patient-médecin conduit d’emblée à penser un certain type de vulnérabilité : non seulement elle est immédiatement négative et comprise comme passivité et non comme ouverture à la douleur aussi bien qu’au plaisir, cette vulnérabilité étant en outre exclusivement d’ordre et de source physique même si les implications psychiques lui sont inhérentes. La vulnérabilité est ici de l’ordre du fait, du donné. Seul un traitement de cette vulnérabilité et non cette vulnérabilité elle-même est politique. La question des normes et des « choix de société » impliqués dans la compréhension politique des avancées de la recherche n’intervient qu’à ce niveau-là et seulement pour prendre en compte un état de fragilité physique de l’individu. Le politique est condamné à aménager et à gérer une souffrance effective plus qu’à traiter la vulnérabilité caractéristique de l’humain – comment le pourrait-il ! – en tentant de minimiser sa réalisation négative. Le caractère intrinsèquement et avant tout politique de la vulnérabilité, qui engage d’emblée une réflexion sur l’ambivalence du fonctionnement même des normes, n’est pas pris en compte. Alors que le politique semblait au cœur de la réflexion de C. Pelluchon, l’anthropologie qu’elle redessine est extra-politique et s’enracine dans une expérience vécue à partir de laquelle seulement la question politique se pose pour traiter un tel fait. Le travail politique construit, à partir de là, ses « évaluations fortes »4. Le rapport de l’individu à la norme n’est pas compris ici dans sa dimension constitutif/assujettissante ; il extérieur. Le travail politique consiste donc à refonder des valeurs, sur la base de cette anthropologie mais jamais à interroger le fonctionnement de la valeur qui apparaît d’emblée de façon très positive comme la réaffirmation critique de principes qui peuvent être communément admis et qui viennent ainsi fonder la démocratie, ce qui invite à interroger le « nous » qui parcourt tout l’ouvrage sans que l’on puisse jamais savoir s’il s’agit d’un nous de majesté, de la communauté des intellectuels, des gens de bon sens, de l’ensemble des citoyens des lecteurs… Il semble que l’on assiste en outre à un ajustement assez peu heureux de l’universel au particulier. En donnant le primat aux « évaluations fortes », quand bien même seraient-elles refondées en prenant en compte la vulnérabilité intrinsèque de l’humain, toute revendication de droit qui prendrait une forme inédite s’expose à être contrariée. Le statut de la vulnérabilité et par suite de l’anthropologie mobilisée par C. Pelluchon contraignait déjà le politique à une action de réparation ou du moins à une gestion et à une administration de la vulnérabilité négativement réalisée, nous comprenons à présent que le statut des minorités en démocratie ne peut pas, par principe, être pris en compte. L’individu, quand il excède la norme, sous prétexte que sa revendication contredit des principes admis, se trouve débouté. Ce sont les principes et le commun qui sont protégés au détriment des singularités. Mais le commun concerne-t-il encore quelqu’un ou n’est-il que la satisfaction d’un fantasme démocratique dont les paradoxes sont on ne peut plus manifestes ? La question démocratique actuelle n’est-elle pourtant pas celle de la gestion de singularités ? La refondation des principes communs ne semble pas satisfaisante à cet égard. Dépasser de telles apories implique peut-être un double déplacement de perspective d’une part et d’objet de l’autre : adopter le point de vue des minorités d’une part, et traiter d’autre part une vulnérabilité intrinsèquement socio-politique qui lui donne un caractère résistible et permet de prendre en compte le rapport à la norme dans la caractéristique de l’humain, détachant ainsi toute « anthropologie » d’une forme fixée à l’avance et la rend libre pour les innovations. Seul un travail sur la norme et sur son fonctionnement permet aujourd’hui d’articuler de façon heureuse le commun et le singulier. Par ailleurs, n’est-ce pas cette fixité, fût-elle fondée sur une nouvelle anthropologie et mobilisât-elle des principes difficilement contestables, qui a conduit le politique à être débordé par les techniques, ou en d’autres termes à exclure de l’humain nombre d’individus ? Jamais la norme n’est en effet envisagée dans sa dimension violente et contraignante.
Le travail de J. Butler se fonde au contraire sur le caractère d’emblée politique de la vulnérabilité comme exposition permanente à autrui où la vulnérabilité relève essentiellement du rapport de l’individu à la norme dans la mesure où l’on prend en compte le caractère ambivalent des normes. Nous avons affaire à un problème d’emblée politique qui propose une réflexion sur la nature des normes et de leur fonctionnement et non pas sur leur contenu. Bien plus, c’est précisément une critique et un refus de la fixité des normes qui sont impliqués dans la refondation anthropologique telle que J. Butler l’entend. La vulnérabilité comprise comme exposition à autrui dans un cadre normatif n’implique aucune forme définie du soi, aucune forme de vie particulière. La vulnérabilité comprise dans sa dimension essentiellement politique appelle une réflexion politique sur la norme qui, dès lors, ne peut plus porter sur le contenu de telle ou telle norme en fonction de telle anthropologie. Il s’agit au contraire de rendre possible et vivable ce qui n’existe précisément pas encore et de rendre possible des vies qu’une norme substantielle rend nécessairement impossibles.
On voit que dans cette différence de point de départ, se joue une pensée du politique et une réflexion sur les normes. Reste à comprendre les conséquences de ces deux perspectives.
Une compréhension politique de la vulnérabilité me semble plus englobante, alors que la phénoménologie de la passivité, dans la mesure où elle donne lieu à une refondation des principes sans penser le rapport fondamental et ambivalent de l’individu à la norme, prend difficilement en compte des vulnérabilités qui ne relèvent pas de la douleur et de la souffrance physique.
La promotion de normes « communes » est par elle-même une opération qui détermine par avance la frontière du réel et du possible, excluant d’emblée et par avance, toute forme de vie qui excèderait ces normes et, comme cela était le cas avec l’autonomie contraindrait encore à refonder une nouvelle fois l’humain, en déplaçant certaines frontières, mais toujours dans une perspective définitionnelle qui est par principe exclusive et conduit le politique à être toujours et d’emblée débordé par des situations neuves et inédites qu’il se trouve incapable de prendre en compte, qu’il exclut et violente.
Le traitement des cas singuliers de souffrance fondé sur une évaluation des conséquences d’un droit à l’aune des principes d’une démocratie conduit simplement à aménager la douleur et la souffrance pour inclure des vies sans prendre en compte leur choix sous prétexte qu’ils seraient contraire aux principes de la démocratie.
3. Pouvait-il en être autrement ? De la divergence des éthiques – fondée sur un traitement différent de la norme – à une divergence de perspectives
Le paradigme nécessairement partial et partiel du médecin-malade, la vulnérabilité politiquement irrésistible, l’absence de réflexion sur les normes ne sont pas des carences dans la réflexion et l’argumentation, ou des choix arbitraires, mais les conséquences d’une certaine vision du monde qui s’exprime dans le choix de l’objet lui-même : les biotechnologies dans la mesure où elles sont au fondement d’une critique des choix libéraux, comme l’élément qui fait apparaître la nécessité d’une refondation de l’anthropologie et lui donne une certaine forme, et comme l’élément qui confère un certain statut au politique lui-même et à l’action politique. A moins que les choses soient plus subtiles et que ce rapport de cause à conséquences ne soit que la face visible d’un processus qui fonctionne souterrainement en sens inverse.
Choisir de faire des biotechnologies, de l’avancée des recherches médicales et des situations inédites qu’elles créent le lieu pertinent et fondamental pour interroger notre actualité constitue la thèse la plus forte de l’auteur, mais également la plus contestable car en elle réside le plus grand danger si l’on évalue les conséquences qui en découlent, si l’on prend en compte également de l’illusion critique à laquelle elle donne lieu. Faire des biotechnologies le lieu pertinent d’une interrogation de notre actualité s’enracine en effet dans une certaine pensée du politique que cette perspective entretient. Le caractère intrinsèquement politique du bioéthique renvoie au fait que les situations inédites auxquelles il donne lieu et les réponses que les conflits qu’il fait naître exigent, impliquent des « choix de société ». Mais cette question des « choix de société » donne la priorité au « commun » et à la recherche des « évaluations fortes » substantielles capables d’être communément admises. Le bioéthique n’a une telle portée qu’en fonction d’une certaine perspective politique qui n’est précisément pas mise en question et dont rend compte le problème paradigmatique du fonctionnement démocratique pour C. Pelluchon, à savoir l’élaboration, la réaffirmation critique des évaluations fortes communes qui joueront un rôle discriminant pour traiter les cas singuliers, permettant de dépasser les émotions de surface et les pièges de la médiatisation. Nous avons affaire à un cercle : le bioéthique met le politique à la question, mais dans la mesure seulement où l’on présuppose une certaine conception du politique et de la démocratie. Seules les « évaluations fortes » elles même sont mises en question, mais non pas leur statut ni celui du commun qui fonctionne au contraire comme une évidence.
De même, les biotechnologies affectent nos catégories de pensée relatives à l’humain en précisant que ce sont certaines expériences bien particulières – la souffrance physique de la maladie et de la vieillesse, l’ignorance de la complexité des débats – que réside la mise en question critique de l’autonomie, jamais dans les expériences de rejet et de discrimination. La circularité de l’argumentation se redouble : le bioéthique apparaît comme le lieu pertinent pour questionner notre actualité dans la mesure seulement où une certaine vision du politique et de l’humain est posée. D’où ce que l’on appelait plus haut une « illusion critique ». La critique ne porte que sur un aspect, mineur, de la situation politique : les termes du débat sont admis au lieu d’être précisément remis en question ; les biotechnologies, la recherche, leurs avancées, les situations qu’elles créent sont toujours comprises comme relevant des « faits », jamais dans leur dimension stratégique pourtant indéniable. Nous n’avons pas affaire à une réelle mise en question dans la mesure où ce qui est pris comme lieu pertinent pour l’interrogation, ce que l’auteur appelle le « laboratoire », se fonde précisément déjà sur une certaine acception du politique et de l’anthropologique.
Ce sont les conséquences d’une telle perspective qui doivent être mises au jour. Certes, on ne saurait nier le caractère inédit des situations et les problèmes, conflits et apories qui se font jour. Il n’en découle pas pour autant que ce lieu permette de poser les questions de façon adéquate. Mieux, la manière dont il permet de formuler les débats nous semble assez contestable. Le niveau d’analyse choisi, qui découle de la perspective adoptée ou encore du thème traité comme lieu pertinent, conduit à formuler un problème que le politique ne peut traiter, mais seulement aménager. Nous retrouvons les quelques objections faites plus haut et qui se trouvent bel et bien découler de ce choix liminaire qui consiste à faire des biotechnologies le lieu pertinent d’une interrogation philosophique et politique de notre actualité. Cela conduit en outre à négliger une vulnérabilité de type politique qui, elle, peut faire l’objet de luttes et de pratiques de résistance. Faire des biotechnologies et des avancées de la recherche médicale le lieu pertinent d’une analyse critique de notre démocratie, un « laboratoire pour le philosophe », cela ne conduit-il pas à déplacer les problèmes de telle sorte que les luttes politiques concrètes, les pratiques de résistance locales se trouvent frappée d’invisibilité ou simplement destituées de leur pertinence ? De même, le statut des minorités qui fonde ces revendications perd de son sens et n’est pas pris en compte, à l’aune d’un problème qui concerne précisément « l’humanité », en fonction de critère que « tous » « nous » ( ?) pouvons accepter. Dans ce choix d’objet, dans cette divergence des éthiques de la vulnérabilité, un enjeu politique très fort se dessine, et se joue une pensée radicale de la démocratie. La question est dès lors de savoir si la question du commun est la question pertinente de la démocratie, ou si, dans cette recherche du commun, une forclusion n’est pas d’emblée impliquée ? La thématique des biotechnologies, comprise comme relevant intrinsèquement du politique et capable d’initier une réflexion critique relève, nous semble-t-il, d’une illusion critique d’une part, et contribue d’autre part à l’assujettissement de fait de toute minorité potentielle dans la mesure où elle fonctionne sur la base de normes « communes » et par définition exclusives, faute d’une interrogation critique sur les normes mêmes, ce qui aurait à son tour supposé une autre perspective sur l’humain et le caractère « vivable » d’une vie, autrement dit la prise en compte du possible en politique ou plutôt le souci de cette prise en compte dans la transformation politique.
Il n’en demeure pas moins qu’une critique de l’ouvrage n’est possible que parce que sa richesse, sa pertinence et la force de son hypothèse de départ le permettent. Ne serait-ce que cela, l’ouvrage mérite lecture. Quant à la thèse elle-même, sans doute pourrait-on rétorquer que ma critique elle-même se fonde sur une perspective partiale et partielle… ce que j’admets.
- C. Pelluchon a publié chez Vrin en 2005 Leo Strauss : une autre raison, d’autres Lumières. Essai sur la crise de la rationalité contemporaine qui est l’aboutissement de son travail de thèse.
- J. Butler, Défaire le genre, chapitre 1, pp. 31-55.
- J. Butler, Défaire le genre, chapitre 10, notamment, pp. 249-256.
- C. Pelluchon, p. 14. qui reprend l’expression de utilisée par C. Taylor dans La liberté des modernes, Paris, P.U.F. pour l’édition française, pp. 2-4 entre autres occurrences.








