Écrire sur l’alchimie n’est guère chose aisée ; la prendre pour objet d’étude afin d’en comprendre l’histoire de manière scientifique ne met pas à l’abri d’un grand nombre d’écueils qui tiennent à la nature même de ce que prétend être l’alchimie. Inversement, mépriser la rigueur scientifique dans le traitement de celle-ci, et ricaner devant les tentatives de son objectivation épistémologique ouvre la porte à toutes les errances et toutes les dérives que commettent nombre de gourous prétendant maîtriser le Grand Œuvre.
C’est pourquoi, lorsque Didier Kahn, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l’histoire de l’alchimie en général et de Paracelse en particulier1 a publié une étude sur les liens entre l’alchimie et la naissance de la chimie moderne2, nous avons à la fois été fort intéressé par la scientificité annoncée de l’ouvrage et en même temps réservé devant la limitation intrinsèque du propos qui ne pouvait être fonctionnel qu’à la condition de considérer que l’alchimie n’était accessible que par ses textes et que, partant, la tradition orale devait être exclue de toute approche scientifique du problème.
Nonobstant cette difficulté inaugurale, et grâce à l’immense qualité de ses travaux que les lecteurs d’Actu-Philosophia ont pu découvrir ici, il est rapidement apparu que l’ouvrage proposait une approche historique séduisante, permettant d’accroître l’intelligibilité de cette étrange discipline qu’est l’alchimie et qui, au moins pour une part, se laisse objectiver dans des textes. Il est donc possible de se lancer dans cette analyse du fixe (le corps) et du volatil (l’esprit) que charrie le titre et qu’affectionne l’alchimie.
A : L’objectif de l’ouvrage
L’objectif de l’ouvrage est annoncé dès les premières lignes : il s’agit d’analyser la manière dont la chimie moderne, à partir de Lavoisier, peut être dite héritière d’un certain nombre de procédures et d’idées alchimiques, ce qui ouvre d’emblée trois possibilités :
– soit la chimie est scientifiquement satisfaisante, et l’on peut envisager de réévaluer à la hausse l’alchimie qui en serait la racine plus ou moins secrète.
– soit l’on maintient la dimension insatisfaisante de la scientificité de l’alchimie, et celle-ci rejaillit sur la chimie elle-même qui doit donc être réévaluée à la baisse.
– soit l’on conserve un écart épistémologique entre alchimie et chimie tout en reconnaissant l’influence de celle-là sur celle-ci, ce qui revient à interroger les différences de méthode et de croyance installées au cœur de leur ressemblance.
Dans un premier temps, l’auteur ne tranche pas, et préfère évoquer une histoire « centrée sur les liens complexes qui unirent l’alchimie et la pratique de la « chimie » (terme éminemment problématique) jusqu’à l’émergence tardive de cette dernière en tant que science pleine et entière. »3. Deux figures sont également annoncées comme majeures : Paracelse (1493-1541), dont l’auteur est un spécialiste reconnu, et Lavoisier (1743-1794). Le premier est évidemment un des noms cruciaux de l’alchimie, le second le fondateur de la chimie moderne.
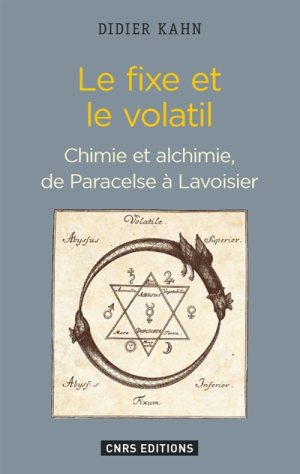
L’ouvrage précise néanmoins le sens de sa démarche : définissant l’alchimie comme une pratique transmutatoire – nous reviendrons sur les problèmes que soulève une telle définition –, il suit à la trace l’évolution de cette dernière et analyse avec précision le moment où émerge, à partir de l’alchimie, une science nouvelle, la chimie, qui se constitue comme discipline autonome, cherchant à s’affranchir du terreau qui lui a donné naissance. L’immense mérite de l’ouvrage revient alors à montrer combien il serait vain et illusoire d’affirmer que la chimie sort de nulle part ; à l’inverse, tout concourt à prouver que sa gestation fut d’ordre alchimique et que la séparation – c’est-à-dire la constitution de la chimie comme discipline autonome – fut longue et non évidente, bien que l’on ne puisse faire de la chimie la fille « directe » de l’alchimie.
« Le processus de séparation entre chimie et alchimie va prendre près d’un siècle. Ce n’est qu’à partir des années 1620 qu’on voit apparaître l’idée d’une « chimie » entièrement vouée à l’analyse chimique au laboratoire, et ce n’est pas avant 1660 qu’on verra cette idée se répandre suffisamment pour que la « chimie » se sépare graduellement de l’alchimie transmutatoire, processus qui nécessitera encore plus d’un demi-siècle : il faut attendre les années 1720 pour ne plus rencontrer de personnages du calibre de Leibniz, Newton, Boerhaave, Stahl ou Homberg « impliqués de façon manifeste dans des recherches transmutatoires ». »4
En d’autres termes, jusqu’au XVIIIè siècle, Didier Kahn montre très clairement que les plus grands noms de la science – à commencer par ceux de Newton et de Leibniz – sont étroitement liés à une activité alchimique qui peut même être de temps à autre la matrice de leurs plus grandes découvertes. Nous avions d’ailleurs ici même recensé l’ouvrage de Jean-Paul Auffray, Newton ou le triomphe de l’alchimie qui, dans la lignée de Keynes et Westfall, indiquait comment les principales lois de Newton étaient issues de méditations et de principes alchimiques. « La physique de Newton, écrit Pierre Laszlo, repose sur des forces d’attraction et de répulsion dont l’alchimie lui a fourni le modèle. »5 Lorsque s’imposent les Lumières, les alchimistes ne disparaissent pas, mais ils ne sont plus confondus avec les grands noms de la science, qu’elle soit physique ou chimique, sans que cela n’exclue la possibilité que des érudits continuent à s’y intéresser.
« L’exemple d’Antelmy montre bien le danger de se faire une idée trop schématique des amateurs d’alchimie au XVIIIè siècle : comme au siècle précédent, ceux-ci pouvaient être aussi bien des charlatans madrés que des savants, des érudits, et même des partisans déclarés des Lumières ou de la Révolution, comme l’avocat Colliette de Froqueville, qui recopia des manuscrits d’alchimie et de médecine entre 1789 et 1792, datant l’un d’entre eux, sans ambiguïté, de « l’an 1792 ». »6
Même un auteur aussi matérialiste que Diderot se refuse à condamner entièrement l’alchimie ; il manifeste ainsi une indulgence explicite envers Rouelle qui est alchimiste, entretenant à son endroit une « sympathie distante »7
Toutefois, l’auteur ambitionne de montrer que si des érudits respectables continuent, à côté de charlatans, de s’intéresser à l’Art Royal jusqu’au siècle des Lumières, les découvertes de Lavoisier transforment toute dilection à son endroit en pur intérêt historique et ôtent tout crédit scientifique à sa pratique. « On attribue à juste titre la fin, ou la ruine, ou le discrédit total de l’alchimie à l’avènement de la chimie de Lavoisier. »8 Bien que Lavoisier ne parle pas directement de l’alchimie, le fait même qu’il refuse la séparation des éléments revient à mettre fin à la quadripartition des éléments qui est en effet au cœur de la pratique alchimique : l’air, la terre, le feu et l’eau constituent les composantes élémentaires de la matière, et sont symbolisées par la croix du Mercure, surmontée du cercle solaire et du croissant lunaire. D’où la conclusion de Didier Kahn : « l’alchimie ne s’est jamais relevée de la chimie de Lavoisier. »9
B : Dimension philosophique de l’alchimie opérative
Le lecteur pourrait toutefois se demander pourquoi un livre sur l’alchimie, fût-il écrit par un chercheur au CNRS, se retrouve chroniqué sur un site de philosophie. Dans le cadre opératif où la nature des métaux est en jeu, l’alchimie est inséparable d’une certaine philosophie, puisque c’est Empédocle qui mit au point l’idée fondamentale selon laquelle tous les matériaux composant le monde seraient structurés selon les quatre éléments, à savoir la terre, l’eau, le feu et l’air. La présence en quantité variable de ces quatre éléments expliquerait ainsi le caractère plus ou moins volatil, plus ou moins chaud, plus ou moins humide de chaque matière.
Aristote poussa cette logique à son maximum, notamment dans De la génération et de la corruption :
« Puisque les qualités élémentaires sont au nombre de quatre, et que ces quatre termes peuvent être combinés en six couples, mais que, par contre, les contraires ne peuvent, en vertu de leur nature, être couplés (car la même chose ne peut être chaude et froide, ou encore sèche et humide), il est évident que seront au nombre de quatre les couples de qualités élémentaires chaud-sec, chaud-humide, et, inversement, froid-humide, froid-sec. Et ces quatre couples sont attribués, comme une conséquence logique de notre théorie, aux corps qui nous apparaissent simples, le feu, l’air, l’eau et la terre. »10
On trouve chez Aristote l’idée que les métaux se composent, en dernière analyse, de terre et d’eau, ce qui explique leur fusibilité ; Didier Kahn restitue de manière très claire la manière dont Aristote a constitué le fondement théorique de l’alchimie opérative, et comment cette théorie a résisté jusqu’à la Renaissance pour lutter contre la théorie du soufre et du mercure, nouvellement apparue. Il en analyse également les variations, notamment dans l’alchimie arabophone qui compte de nombreux alchimistes dans ses rangs comme Avicenne. Pour ce dernier, les métaux quoiqu’appartenant à un seul et même genre, représentaient différentes espèces, plomb, fer, cuivre, etc. Chacune des espèces avait donc sa forme spécifique et on ne pouvait pas les transformer l’un en l’autre ; le changement de forme spécifique relevait de la seule volonté divine, et était hors de portée des possibilités humaines. Les alchimistes contournaient ce problème ainsi : l’espèce n’est pas le plomb, le cuivre ou le fer, mais le métal. Les différents métaux n’étaient alors conçus que comme des degrés différenciés de maturation de cette espèce. En d’autres termes, on ne peut pas selon Avicenne transformer les espèces, à moins de les ramener à la matière première.
Didier Kahn fait également remarquer que l’éther incorruptible qui est le cinquième élément chez Aristote devient le cinquième être en alchimie. C’est la matière céleste échappant au cycle de la génération et de la corruption, c’est-à-dire la quintessence. L’auteur n’hésite pas à proposer une analyse historique précise, dont nous ne pouvons pas ici rendre compte dans tous les méandres, notamment chez Jean de Roquetaillade (1310-1370), parfois appelé Rupescissa en latin, qui décrit une contrepartie terrestre de la matière céleste permettant d’opérer certaines transformations.
Un autre élément intéressant, du point de vue philosophique, est la transformation aristotélicienne de forme à travers l’introduction des semina, notamment dans les écrits de Jean-Baptiste van Helmont (1579-1644) en général, et dans l’Ortus Medicinae en particulier. Il donne un second souffle au paracelsisme, qu’il réinterprète de manière critique tout en réactivant sur de nouvelles bases la virulente opposition paracelsienne à l’aristotélisme et à la médecine galénique et en donnant une nouvelle vigueur au rôle-clef de l’illumination divine dans l’acquisition de la connaissance et à l’importance de l’imagination dans les processus de transformation de la matière. Aux yeux de Van Helmont, il n’y a que deux véritables principes de toutes choses : l’eau et les semina, qui sont des semences invisibles, de nature spirituelle et douées de scientia contenant la force vitale et organisatrice de chaque substance. Ces semina, Van Helmont en emprunte l’idée à Petrus Severinus et en retrouve la confirmation chez Sendivogius ; elles se substituent au concept aristotélicien de « forme », Van Helmont invoquant contre la tradition scolastique, les rationes seminales d’Augustin (les « raisons séminales »). On voit que, en parallèle de la tradition philosophique classique, se développe toute une série de débats qui, d’une certaine manière, prolongent dans le cadre alchimique les disputes théoriques que connaît la scolastique, quitte parfois à se confondre comme c’est le cas chez Albert le Grand. A cet égard, un livre sur l’alchimie opérative trouve toute sa place dans le cadre d’une réflexion philosophique, tant la porosité se révèle importante.
C : Un présupposé problématique
L’ouvrage de Didier Kahn est assurément très intéressant du point de vue historique et témoigne souvent d’une impressionnante érudition concernant les textes eux-mêmes. La longue pratique de l’auteur avec les manuscrits d’alchimistes célèbres11 a créé une évidente familiarité avec le lexique ainsi qu’avec une certaine mentalité alchimique. A cet égard, sa compétence est indiscutable, et le livre est assurément instructif quant à l’évolution historique de la perception de l’alchimie.
En revanche, plus discutable est le résultat ultime de l’ouvrage : dire que Lavoisier a définitivement mis fin à l’alchimie est étrange et contredit de nombreuses déclarations de physiciens ou de chimistes de renom. Nous en citerons trois par ordre croissant d’importance, non pas pour défendre la validité contemporaine de l’alchimie, ce qui serait tout aussi absurde que d’en affirmer la définitive obsolescence, mais pour montrer qu’il y a justement là matière à discussion et que de grands physiciens ainsi que de grands chimistes ont maintenu l’hypothèse ouverte à partir d’une réflexion sur les principes contemporains de la physique et de la chimie.
Parmi eux se trouve tout d’abord Alexandre-Edouard Baudrimont (1806-1880), chimiste français célèbre pour avoir été le premier à préparer Na3P, et pour avoir écrit des traités de référence en chimie, dont le Traité de chimie générale et expérimentale où l’on trouve écrit ceci :
« Par suite de l’admission trop exclusive des théories de la chimie moderne et par l’abandon dans lequel certains auteurs ont laissé les écrits alchimiques, on se contente généralement de parler des alchimistes avec dédain, mais je puis affirmer qu’ils étaient guidés par une saine philosophie, et que tout leur art reposait sur une théorie générale de la nature. Aucun fait de l’époque actuelle n’est en contradiction avec leurs travaux. Au contraire, à mesure que la chimie grandit, elle semble apporter de nouveaux faits de l’ordre de ceux qui faisaient la base des théories alchimiques. Pour le prouver, il suffit de citer l’isomérie et la catalyse. Il est vrai qu’aujourd’hui la sanction expérimentale manque à l’alchimie. »12

Cette longue citation permet d’apporter deux objections à la thèse de Didier Kahn. Premièrement, il n’est pas vrai qu’après Lavoisier tous les auteurs institutionnellement reconnus aient condamné l’alchimie ; un homme aussi considérable que Baudrimont, au milieu du XIXè siècle, continue à trouver des vertus principielles à celle-ci, et n’hésite pas à l’affirmer dans un traité qui fut une référence dans la formation des étudiants. Deuxièmement, on peut déplorer que Didier Kahn ne distingue pas suffisamment critique de la méthode et critique des principes : il est clair que si Baudrimont admet volontiers l’insuffisante scientificité de l’alchimie, il n’en conclut pas pour autant que cette dernière est erronée en ses principes ni et encore moins en sa philosophie.
Un autre élément à objecter à Didier Kahn réside dans les travaux de Frederick Soddy (1877-1956), prix Nobel de chimie en 1921. Avec Ernest Rutherford, il étudie les propriétés radioactives de l’uranium, du thorium et du radium : ils proposent une théorie de la désintégration atomique en suggérant que chaque atome radioactif se brise en formant un autre élément et en émettant une particule intra-atomique, ce que Soddy appelle fort explicitement une « transmutation », en hommage à l’alchimie dont il juge les principes plus valides que jamais. Cela l’amena à justifier, au grand dam de Rutherford, sa proposition d’identifier la désintégration à la transmutation alchimique en ces termes :
« Il est curieux de réfléchir, par exemple, à la remarquable légende de la pierre philosophale, qui est une des croyances les plus anciennes et les plus universelles, et dont l’origine, si loin que nous puissions remonter dans les traces du passé, ne saurait être, avec certitudes, rapportée à sa vraie source. On attribuait à la pierre philosophale le pouvoir non seulement d’effectuer la transmutation des métaux, mais aussi d’agir comme élixir de vie. Or, quelle qu’aie été l’origine de cette association d’idées, apparemment dénuée de sens, elle se montre, en réalité, comme l’expression très correcte et à peine allégorique de notre actuelle manière de voir. Il ne faut pas un grand effort d’imagination pour arriver à voir dans l’énergie la vie même de l’univers physique : et on sait, aujourd’hui, que c’est grâce à la transmutation que jaillissent les sources premières de la vie physique de l’univers. Cet antique rapprochement du pouvoir de transmutation et de l’élixir de vie n’est-il donc qu’une simple coïncidence ? »
Enfin, et c’est peut-être là le plus impressionnant, Max Planck lui-même, en 1946, s’interrogea sur l’actualité de la perception alchimique du monde. Dans une conférence donnée à Goettingue, le prix Nobel de Physique tint en effet le langage suivant :
« Actuellement, depuis la découverte de la radioactivité artificielle, les choses ont encore changé et il ne nous semble plus absolument impossible d’inventer un procédé qui éloignerait un proton du noyau de l’atome de mercure et un électron de sa ceinture, ce qui transmuterait l’atome de mercure en atome d’or ; dans l’état actuel de la science, le problème des alchimistes cesse donc d’être un faux problème. »13
Il ne s’agit pas pour nous d’aligner d’interminables citations fonctionnant comme autant d’arguments d’autorité destinés à légitimer les principes alchimiques. Il s’agit bien plutôt de pointer deux limites du livre de Didier Kahn : d’une part, il ne nous semble pas tout à fait exact que, après Lavoisier, plus aucun scientifique de renom n’ait accordé à l’alchimie quelque crédit que ce soit ni n’en ait épousé partiellement la vision du monde. C’est donc là un problème d’ordre historique. D’autre part, il n’est peut-être – pure hypothèse – pas tout à fait sûr qu’un jour ou l’autre, ainsi que l’affirment Soddy ou Planck, la science physique et la science chimique ne reviennent pas chercher dans l’alchimie un certain nombre d’idées ou de principes qui pourraient sembler pertinents. Épistémologiquement parlant, donc, on peut envisager avec Planck que le problème des alchimistes ne soit plus « un faux problème ».

Il n’est qu’à penser, par exemple, à la célèbre formule de la transformation du plomb en or : cela présente un sens scientifique clair, au moins au plan théorique : en bombardant le plomb qui contient 82 protons et 126 neutrons, on pourrait lui arracher 11 nucléons (trois protons et huit neutrons), ce qui permettrait d’obtenir de l’or qui contient 79 protons et 118 neutrons. Cela demeure purement théorique et n’est pas réalisable expérimentalement, tant en raison de la durée de l’opération que de son coût ; mais il ne semble pas interdit de penser qu’une telle opération, parfois évoquée par les journaux scientifiques, soit possible un jour.
D : Une difficulté méthodologique : se limiter à l’alchimie opérative et se priver du fondement intellectuel de l’alchimie spéculative
Nous l’avions signalé en introduction, il est extrêmement difficile d’écrire sur l’alchimie. Pour un universitaire, notamment français, c’est déjà trop accorder à l’ « irrationnel » que de prendre l’alchimie pour objet d’étude, et il faut ici saluer le courage de Didier Kahn d’aborder un tel sujet dans un registre scientifique et institutionnel. Inversement, et cela redouble la difficulté, pour un « initié » ou un « pèlerin », il est absurde de vouloir comprendre l’histoire de l’alchimie à partir de textes écrits, d’archives ou de manuscrits qui ne peuvent contenir, par essence, que ce que l’alchimie comporte de plus inessentiel.
Il y a donc là un paradoxe : par sa méthode rigoureuse et épistémologiquement éprouvée, Didier Kahn se condamne à manquer ce qui fait, du point de vue de l’alchimie, le cœur de son fonctionnement, l’essence de sa pratique. Pire encore, seule l’alchimie dite « opérative » a laissé des textes ; c’est pourquoi Didier Kahn restreint son objet d’analyse à « l’alchimie transmutatoire, qui a pour objectif la transformation des métaux vils en argent et en or, [et qui] est le courant majeur de l’alchimie médiévale – et le premier à être apparu dans l’Occident latin. L’alchimie médicale a pour but la prolongation de la vie : elle s’ajoute, dès le XIIIè siècle, au projet de la transmutation des métaux. »14 Cela, encore une fois, se comprend, voire s’impose, pour des raisons méthodologiques.
Néanmoins, c’est un choix qui revient à laisser de côté tout le fondement intellectuel de l’alchimie qui est spéculatif, et qui est largement antérieur au monde médiéval : on en trouve des traces dans la Chine du 4ème siècle avant Jésus-Christ et dans l’Inde du 6ème siècle avant Jésus-Christ. Elle se transmet à l’Égypte puis au monde gréco-romain, et enfin au monde arabo-musulman, donnant sa structure et sa signification véritable aux développements opératifs que proposera le monde médiéval. Visant non pas la transmutation des métaux mais la transformation de soi, elle donne à l’alchimie sa cohérence intellectuelle et le sens général de sa pratique. Transmise oralement par initiation, elle ne peut être comprise ni même connue à travers le savoir livresque ; qu’elle soit une chimère ou non importe ici bien peu : en ne pouvant étudier que l’alchimie opérative, « transmutatoire », Didier Kahn éradique l’alchimie de son soubassement logique et intellectuel, et présente donc une histoire tronquée de son développement qui, du point de vue de l’essence même de l’alchimie, ne peut être que dénuée de sens.
Dans son ouvrage fondateur, Mircéa Eliade explique fort bien cette relation : l’on peut dire que « la chimie est née de l’alchimie ; plus exactement : elle est née de la décomposition de l’idéologie alchimique. Mais dans le champ de vision d’une histoire de l’esprit, le processus se présente autrement : l’alchimie se posait en science sacrée, tandis que la chimie s’est constituée après avoir vidé les Substances de leur sacralité. Or il existe nécessairement une solution de continuité entre le plan du sacré et le plan de l’expérience profane. »15 On peut naturellement considérer que l’alchimie spéculative conçue comme « science sacrée » est un tissu d’aberrations ou de superstitions : il n’en demeure pas moins que c’est elle qui donne sens, que l’on y accorde crédit ou non, à la pratique alchimique au sens d’une pratique opérative. Penser celle-ci sans celle-là, c’est s’interdire d’en comprendre aussi bien son fonctionnement que ses principes fondamentaux.
Le titre porte trace de cette réduction drastique à la dimension opérative. Didier Kahn n’envisage le fixe et le volatil que du point de vue de la transformation ; il cite ainsi la Summa perfectionis magisterii (1270-1300), classique de l’alchimie, qui aborde toutes les questions de la transmutation. L’or s’y compose d’une grande quantité de mercure, fait de petites particules fixes (non volatiles) et pures et d’une petite quantité de soufre fixe et pur, capable de teindre le mercure en jaune. Le fixe et le volatil y ont un sens purement matériel, celui de caractéristiques d’entités matérielles. Idem lorsqu’il aborde le rapport entre le mercure et l’or qu’il synthétise en ces termes: « En somme, l’or est presque du pur mercure fixe. »16 La signification spirituelle du volatil comme symbole de l’esprit affranchi de la pesanteur matérielle ou du fixe associé au corps se trouve ici complètement occultée alors même que la lutte entre le fixe et le volatil entendus comme qualités métaphysiques se trouve au coeur de l’alchimie qui la cristallise dans la figure du griffon ou de l’autruche. Tout un pan de l’alchimie est ainsi passé sous silence, ce qui ne serait rien si ce n’était celui qui donnait sens à la pratique de transformation des métaux.
E : L’alchimie au sein de l’hermétisme
De là l’étonnement qui ne peut que saisir le lecteur – qu’il adhère ou non aux principes de l’alchimie spéculative – lorsqu’il découvre les premières lignes de l’ouvrage. Après de sévères critiques – d’ailleurs non étayées – de Jung et Eliade, Didier Kahn justifie sa méthode en affirmant que, de toutes les procédures possibles, « la seule qui se soit avérée réellement fructueuse pour notre connaissance de l’histoire de l’alchimie, c’est en effet l’histoire des sciences et des idées. Cette perspective amène à rejeter comme faux bien des lieux communs, à commencer par la prétendue solidarité qui unirait l’alchimie à l’astrologie et à la magie au sein d’un vaste corps de doctrines appelées « sciences occultes », « occultisme », « hermétisme » ou tout autre terme apparenté. A de rares exceptions près, les alchimistes ne furent pas astrologues, ni les astrologues alchimistes, et l’alchimie se développa indépendamment de la magie, dont elle ne partageait ni les buts, ni les techniques, ni les concepts, ni les maîtres légendaires. »17
On peut comprendre que, pour des raisons tactiques, Didier Kahn cherche à assurer la dignité de son objet d’étude en le coupant de disciplines pittoresques ou farfelues comme l’astrologie ou la magie. Il n’en demeure pas moins qu’une telle séparation ne peut que laisser songeur, et ce pour trois raisons.
1) Une raison principielle d’abord. L’alchimie est une discipline fondée sur l’organicité du cosmos, sur l’idée que chaque élément est en relation avec tous les autres, idée qui refuse toute forme de localisme ou de localité. A ce titre, elle est intimement liée à l’astrologie qui considère précisément que le cours et la marche des astres déterminent le devenir des événements cosmiques en leur entier. C’est le même principe fondamental qui régit la cosmologie alchimique et astrologique et il apparaît de ce fait bien artificiel d’en affirmer la séparation. C’est pourquoi Didier Foucault, professeur d’Histoire moderne à l’Université de Toulouse, nous semble avoir raison d’indiquer, dans un remarquable article, que la constitution de l’alchimie, de l’astrologie et de la magie en sciences « respectables » s’opéra de manière simultanée au XIIè siècle : « Ce n’est donc pas avant le XIIe siècle que la médecine, l’astrologie et l’alchimie, prenant alors quasi simultanément le statut de disciplines savantes, commencent à entretenir des relations étroites et complexes qui se prolongeront jusqu’à la Renaissance. »[L’article est consultable à [cette adresse. [/efn_note]. C’était là prendre acte de leur naissance commune.
2) Une raison tenant à l’auto-compréhension de l’alchimie. Tous les alchimistes ou presque, contrairement à ce que peut écrire Didier Kahn, ont élaboré de manière explicite ou implicite des correspondances entre les étapes du Grand Œuvre et la logique zodiacale. Lorsque Pernety conçoit son célèbre Dictionnaire mytho-hermétique, il propose, comme énormément d’auteurs avant et après lui, une correspondance parfaite entre les douze constellations zodiacales et les étapes du Grand Œuvre. C’est là un topos hermétique qu’il paraît invraisemblable de contester : même l’alchimie opérative est attentive aux correspondances cosmiques dont l’astrologie prétend rendre compte, et rien ne vient donc justifier pareille séparation. Mieux encore, la totalité de la symbolique alchimique correspond exactement à la symbolique astrologique, les sept planètes dans le ciel représentant les sept métaux dans la terre. Le soleil, Vénus reçoivent en outre les mêmes écritures symboliques en alchimie et en astrologie.

3) Cette intimité se retrouve dans l’iconographie : il existe d’innombrables zodiaques alchimiques, sans compter les horoscopes alchimiques qui illustrent nombre d’ouvrages ; songeons ainsi au Livre du destin tiré du manuscrit de Heidelberg qui figure une parfaite porosité entre l’alchimie et l’astrologie, ou encore aux illustrations des textes de Jacob Böhme destinées à indiquer les qualités des sept planètes.
C’est pourquoi, l’hypothèse de Mircéa Eliade, malgré ce qu’en dit Didier Kahn, nous semble tout simplement bien plus conforme aux faits historiques et intellectuels que la thèse de ce dernier : « on pourrait expliquer la brusque apparition des textes alchimiques autour de l’ère chrétienne comme le résultat de la rencontre entre le courant ésotérique représenté par les Mystères, le néo-pythagorisme et le néo-orphisme, l’astrologie, les « sagesses orientales révélées », le gnosticisme, etc., courant ésotérique qui était surtout le fait des gens cultivés, de l’intelligentsia – et les traditions « populaires », gardiennes des secrets de métier et des magies et techniques d’une très grande antiquité. »18 L’astrologie est co-native de l’alchimie et lui est intimement liée par ses principes cosmologiques, ce que confirme René Alleau. Ce dernier explique fort bien que le monde vu par l’alchimie autant que par l’astrologie est un vaste organisme animé, assez proche de l’idée des stoïciens avec la notion de sympathie et d’antipathie des êtres. Cadre mystique et spirituel, il rappelle que l’alchimie est une manière générale de percevoir le monde sous une forme spéculative, qui s’accompagne ensuite d’une tentative opérative de transformation de ce dernier.
Quant à la « magie », elle ne peut non plus en être dissociée, notamment grâce à la transmission orale. « On peut la nommer « magique », note toujours Alleau, à condition d’admettre qu’il existe une magie « naturelle » et qu’elle ne présente pas de rapports avec la sorcellerie. »19
Conclusion
Malgré l’ensemble de nos réserves, nous reconnaissons à ce livre de grandes vertus. Celle du courage, d’abord, qui consiste à aborder au sein de l’institution la question alchimique de manière rigoureuse et scientifique. Cela est rare et mérite d’être salué. Celle de la clarté ensuite, en ceci que l’histoire menant de l’alchimie à la chimie est vigoureusement retracée, avec une érudition et une précision sans failles. Enfin, les nombreux rappels sur la porosité des savants classiques (Newton, Leibniz, etc.) et des philosophes avec cette discipline sont à la fois bienvenus et intelligemment exploités.
Néanmoins, nous devons émettre plusieurs réserves sous une forme synthétique. D’abord, l’auteur ne traite pas tant de l’alchimie que des textes alchimiques ce qui, pour une discipline où l’essentiel se transmet oralement, constitue une différence cardinale. Ce n’est là pas une réserve à l’encontre du livre mais une réflexion sur l’impossibilité épistémologique de ce type d’entreprises en général. D’un côté, il n’y a aucune raison que le corpus alchimique échappe à l’objectivation et se refuse à l’étude au moins historique de sa constitution et de ses influences – aussi bien en amont qu’en aval. Mais de l’autre, parce que l’alchimie n’écrit que ce qu’elle considère comme secondaire, banal ou même faux, et parce qu’elle s’inscrit dans cette antique tradition du mépris envers la chose écrite au profit d’une valorisation de la transmission orale, alors l’idée même d’un corpus comme ensemble de textes devient contradictoire avec la volonté explicite de comprendre ce dont il est question : étudier ce corpus, c’est certes l’objectiver d’une certaine manière qui peut être épistémologiquement satisfaisante, mais ce n’est en même temps étudier que l’écume de l’alchimie, et se priver de ce qu’elle considère elle-même, dans son auto-compréhension, comme l’essentiel qui n’est pas comme tel communicable par des écrits.
Notre véritable première réserve à l’encontre de l’ouvrage réside plutôt dans le problème suivant : à aucun moment l’auteur, en dépit des textes étudiés, ne se situe du point de vue de la logique alchimique, du côté de son auto-compréhension. Par exemple, le livre est tout entier conçu de manière téléologique comme la longue marche « indirecte » de l’alchimie vers la chimie, donc de pratiques multiples et non scientifiques vers la rigueur de Lavoisier qui mettrait fin à toute légitimité et toute pertinence de l’alchimie. Or, non seulement, cela nous semble discutable historiquement autant que scientifiquement, mais de surcroît cela revient à ne jamais envisager le point de vue de l’alchimie sur la chimie, ce qui crée une analyse tout à fait unilatérale du problème. Très vite en effet, et l’on dispose de textes sur ce sujet, est apparue dans la littérature alchimique, une dichotomie entre la substance naturelle, jugée a priori admirable, et le produit chimique, produit de l’art, perçu comme un daidalon, un artifice, voire une tromperie. « Dès ses origines, la chimie est donc objet de suspicion. C’est une méthode de contrefaçon, un ensemble de procédés plus ou moins honnêtes pour masquer la véritable nature d’un objet métallique et donner le change. »20 Du point de vue de l’alchimie, c’est la chimie qui s’égare, quels que soient ses résultats.
Il ne s’agit donc pas pour nous de prétendre que l’alchimie serait une science – elle ne l’est assurément pas – mais de nous interroger sur la possibilité de véritablement retracer l’histoire de l’alchimie et de ses rapports avec la chimie à partir des seuls textes, tout en ayant conscience qu’il est difficile de procéder autrement d’un point de vue scientifique. Il s’agit également de nuancer certaines affirmations sur l’obsolescence de l’alchimie, non pas quant à sa scientificité mais quant aux principes philosophiques qui la structurent, et de prendre au sérieux les réflexions de Max Planck. Enfin, et cela est corrélatif des remarques précédentes, il est sans doute très délicat de considérer l’alchimie comme un corpus de textes en devenir, car cela revient à rendre des principes qui se veulent immuables relatifs à l’historicité ; encore une fois, il ne s’agit pas d’affirmer que les principes alchimiques sont vrais ou pertinents, mais il s’agit de pointer la difficulté méthodologique consistant à refuser absolument d’analyser une discipline en fonction de ce qu’elle dit d’elle-même. En d’autres termes, l’alchimie ne se pense pas comme quelque chose qui pourrait être compris à partir de principes universels et objectifs, exprimés de manière claire dans des livres ouverts à tous, mais bien au contraire comme quelque chose qui devrait être expérimenté dans un processus de transformation intérieure à l’issue d’une initiation singulière. Ce qui condamne l’historien des idées, à son corps défendant, à rester irrémédiablement et tragiquement extérieur à son objet d’étude.
- Il a publié une très importante monographie consacrée à la réception du paracelsisme : Didier Kahn, Alchimie et paracelsisme à la fin de la Renaissance en France (1567-1625), Genève, Droz, 2007
- Didier Kahn, Le fixe et le volatil. Chimie et alchimie de Paracelse à Lavoisier, Paris, CNRS-Editions, 2016
- Le fixe et le volatil., op. cit., p. 5
- Ibid., p. 138
- Pierre Laszlo, L’alchimie, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 2003, p. 103
- Ibid., p. 159
- Ibid., p. 165
- Ibid., p. 167
- Ibid., p. 185
- Aristote, De la génération et de la corruption, II, 3, traduction Tricot, Paris, Vrin, 2005, p. 126
- Il a édité de Thomas Vaughan, L’Art hermétique à découvert (1787), Paris, J.-C. Bailly, 1989, de Jean d’Espagnet, La Philosophie naturelle rétablie en sa pureté, ainsi que L’Ouvrage secret de la philosophie d’Hermès, version française de 1651, Grez-Doiceau (Belgique), Beya, 2007, et de Henry de Montfaucon de Villars, Le Comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes. Avec l’adaptation du Liber de nymphis de Paracelse par Blaise de Vigenère, Paris, Champion, 2010
- Alexandre-Edouard, Baudrimont, Traité de chimie générale et expérimentale, Tome I, Paris, Baillière, 1844, note 1, p. 69
- Max Planck, L’image du monde dans la physique moderne, chap. VIII, « Faux problèmes de la science », Paris, Gonthier, 1963, p. 142
- Le fixe et le volatil., op. cit., p. 27
- Mircéa Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, Flammarion, coll. Champs, p. 8
- Le fixe et le volatil, op. cit., p. 33
- Le fixe et le volatil, op. cit., p. 7
- Eliade, op. cit., p. 123
- René Alleau, Alchimie, Paris, Allia, p. 55
- Pierre Laszlo, op. cit., p. 22-23








