A : Proposer une philosophie populaire
Actu-Philosophia : Denis Moreau, vous êtes un spécialiste reconnu de la philosophie du XVIIe siècle, vous êtes professeur de philosophie moderne à l’Université de Nantes, vous avez consacré de nombreux ouvrages à Descartes mais aussi aux héritiers de Descartes et avez édité des textes précieux de ces derniers, notamment les Textes philosophiques d’Antoine Arnauld[1], ou encore les Vraies et fausses idées du même Arnauld[2]. Or, depuis quelques années, à côté de votre travail proprement scientifique d’édition et de commentaire des grands textes, vous proposez une œuvre ciblant davantage le grand public, œuvre qui semble destinée à montrer que les grandes questions de la philosophie ne doivent pas rester confinées à un cénacle de spécialistes mais, bien au contraire, s’adresser à tout homme interrogeant le sens même de l’existence.
Ainsi, dans un ouvrage très récent, Y a-t-il une philosophie chrétienne ?[3], vous affirmez dans l’avant-propos que les textes qui composent le volume veulent appartenir à « la philosophie populaire et la philosophie de la religion. »[4] Et une page plus loin, vous réitérez le propos en réaffirmant ceci : « j’ai tenté de faire de la philosophie populaire.[5] Naturellement, cela fait résonner la célèbre formule de Diderot, « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », mais il me semble qu’il y avait chez lui une visée politique à travers laquelle le fait de s’adresser au peuple était une des conditions favorables à une profonde transformation du cadre politique. Alors, pardonnez la naïveté de ma question, mais dans votre optique qui me semble différente de celle de Diderot, pour quelle raison souhaitez-vous proposer une « philosophie populaire » ?
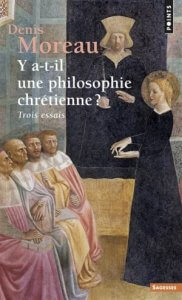
Denis Moreau : La principale raison n’est effectivement pas vraiment d’ordre politique, ou alors c’est en donnant un sens large au terme. C’est que j’ai le sentiment qu’il y a, depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années, une forte demande pour ce genre d’écrits et que je me sens en quelque façon tenu d’y répondre. En France, cet intérêt « populaire » pour la philosophie a, je crois, commencé au début des années 1990, avec les « cafés philosophiques » lancés par Marc Sautet. A l’époque, je n’y ai pas vraiment prêté attention, je me suis dit « c’est une mode, cela va vite passer ». Mais sont ensuite venus les universités populaires, les « festivals » de philosophie (Citéphilo à Lille, Rencontres de Sophie à Nantes, etc.), des romans (Le Monde de Sophie), des revues (Philosophie magazine), des sites internet (« La Vie des idées », le vôtre) et des ouvrages (ceux d’André Comte-Sponville puis de Michel Onfray, Luc Ferry, etc. ; La Philosophie pour les Nuls, etc.). Bref, c’est à l’évidence plus qu’une mode ou un phénomène éphémère : il existe sous nos cieux, de la part d’un public assez large qui dépasse de beaucoup les seuls « professionnels de la philosophie » une véritable et importante demande de philosophie.
Du point de vue du philosophe de profession, c’est-à-dire dans la majorité des cas celui qui a la chance de pouvoir se consacrer à ce beau métier qu’est l’étude et l’enseignement de la philosophie, cette demande n’est certes pas exempte d’ambiguïtés ou de malentendus : il est loin d’aller de soi que, même sous sa forme vulgarisée, la philosophie que pratiquent les philosophes de profession soit celle que le public attend ou réclame ; il n’est pas exclu que le grand public se trompe en escomptant de ce qu’il appelle philosophie des « réponses à ses questions », à toutes ses attentes de sens. Mais les philosophes de profession peuvent-ils d’entrée de jeu, sans même avoir essayé d’y répondre, choisir d’ignorer purement et simplement cette demande ? Pour des gens qui ont appris en lisant Aristote à quel point il est important de savoir saisir le kaïros, le « moment favorable», ne serait-il pas curieux de laisser passer cette occasion sans réel équivalent ou précédent : de très nombreuses personnes — et sûrement plus qu’au moment où Diderot écrivait — ont envie de réfléchir, font a priori confiance aux philosophes de profession pour les y aider, et attendent d’eux qu’ils leur apportent cette aide ? Pour ma part, dans une telle situation, il me semblerait incorrect de garder pour moi et pour mes seuls pairs universitaires les trésors intellectuels auxquels mon métier me donne la chance de m’intéresser chaque jour : « Écrire [seulement] des textes [philosophiques] que seuls pourraient lire et comprendre des collègues universitaires [serait] dénué de sens, […] voire immoral. Aussi dénué de sens que si un boulanger ne faisait ses petits pains que pour d’autres boulangers. » (Gunther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?, trad. fr., Paris, Allia, 2001, p. 33). Ou encore, dans les termes de Michel Foucault (Dits et écrits, t. 4, Paris, Gallimard, 1994, p. 537-538) :
« Nous [philosophes dans l’enseignement public] sommes payés par la société, par les contribuables, pour travailler. […] Je considère qu’il est normal, dans la mesure du possible, de présenter et de rendre accessible ce travail à tout le monde. Naturellement, une partie de ce travail ne peut pas être accessible à tout le monde, parce qu’il est trop difficile. […] Nous sommes à la fois des chercheurs et des gens qui devons exposer publiquement nos recherches. »
AP : J’aimerais rester sur le statut de ces ouvrages ; dans un précédent livre intitulé Comment peut-on être catholique ?[6], vous menez une réflexion sur ce que signifie concrètement être catholique tout en remarquant que l’on ne peut convaincre personne à l’aide d’arguments en matière de foi. J’aurais alors deux questions : pour quelle raison faudrait-il déployer des efforts philosophiques – c’est-à-dire des efforts d’argumentation – en matière religieuse dès lors que de tels efforts seraient vains du point de vue de la capacité à convaincre son interlocuteur ? Et, de manière plus générale, proposer une philosophie populaire ne présuppose-t-il pas une certaine foi dans la dimension rationnelle de l’humanité, qui serait pourtant malmenée par ce que vous relevez dans l’avant-propos de Y a-t-il une philosophie chrétienne ?, à savoir que la raison est de plus en plus oubliée au profit d’un subjectivisme du « ressenti » qui clôt instantanément toute discussion argumentée ?
DM : Je ne crois pas avoir écrit ou dit qu’on ne peut « convaincre » personne à l’aide d’arguments. Dans le contexte religieux qui est celui de l’ouvrage que vous évoquez, j’ai dit qu’on ne « convertissait » pas par des arguments. Ce n’est pas tout à fait la même chose : on est « convaincu » de la vérité ou de l’intérêt d’une proposition (« fumer est mauvais pour la santé »), la « conversion » suppose en plus un engagement existentiel (il y a des tas de gens qui continuent à fumer alors qu’ils sont convaincus que c’est mauvais pour eux). Sur le fond, votre question renvoie à la nature de mon projet dans ce genre de texte. Je ne suis pas dans une optique prosélyte, mon désir n’est pas de convertir mes contemporains, ni même de les propagander pour les convaincre que j’ai raison. Mon projet est, si l’on me permet d’user d’un gros mot obsolète auquel je redonnerais volontiers quelque lustre, de nature apologétique : il s’agit de proposer une défense, une justification et un éloge argumentés du catholicisme, avec l’ambition de faire apparaître, à des lecteurs pour qui c’est probablement loin d’aller de soi, qu’il s’agit d’une affaire sérieuse qui, comme d’autres courants de pensée marquants dans l’histoire de l’humanité, mérite l’intérêt (ce qui ne signifie pas nécessairement : « l’adhésion ») et qu’il existe donc un certain nombre de raisons dignes de considération d’être catholique (tout comme il existe, du moins je l’espère pour les adhérents à ces visions du monde, de dignes raisons d’être athée, marxiste, libéral, etc.). Si l’on veut préciser un peu les choses, on peut dire, dans les termes des rhéteurs de l’Antiquité, que cette tentative apologétique a trois dimensions, et vise trois catégories de personnes : une dimension polémique — c’est une défense face aux accusations lancées contre ma religion par les gens qui pensent qu’un chrétien ajoute foi à des choses déraisonnables ; une dimension protreptique — je m’adresse en partie à un public de « non-croyants » que je voudrais convaincre de l’intérêt de mes arguments ; une dimension parénétique — il s’agit aussi de (ré)conforter dans leur foi mes coreligionnaires. Mais enfin, pour synthétiser, je ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Je veux juste expliquer qu’en tant que catholique, je ne suis pas nécessairement un imbécile !
Quant à la « foi dans la dimension rationnelle de l’humanité », oui, c’est la mienne. Ce n’est plus très à la mode, mais je reste attaché à la définition de l’être humain comme « animal rationnel ». En tant que chrétien, qui lit dans le prologue de l’Évangile de Jean qu’un des noms de Dieu est Logos, Raison, je pense même que c’est avant tout par sa raison que l’homme est « à l’image de Dieu », ou si vous préférez que la raison est une part de divin en nous, dont tout être humain, comme le disent Descartes au commencement du Discours de la méthode ou Malebranche avec le thème de la «vision en Dieu », est doté. C’est pourquoi je tiens à ce que mes travaux demeurent philosophiques, y compris lorsqu’ils portent sur des questions qui ont du rapport avec Dieu ou la religion : le philosophe s’adresse, de droit, à tous, là où les propositions du théologien sont recevables seulement lorsqu’on admet la validité de la révélation sur laquelle il s’appuie pour réfléchir. De ce point de vue et pour en revenir à votre remarque sur la subjectivité, je souhaite entrer en discussion non seulement avec ceux qui critiquent le catholicisme, mais aussi, et peut-être surtout avec les « croyants » qui, alors que la vie leur a donné la chance de faire des études et de savoir réfléchir, font pourtant profession de se contenter d’une foi obscure, voire aveugle, qui se réduit à un sentiment et se replie sur la seule « intériorité », se crispe en se contentant d’être personnellement « vécue » ou « authentiquement » « ressentie » — ce qui, certes, n’est pas rien— sans jamais être réfléchie, et qui se dérobe ainsi à tout débat argumenté. Une telle attitude est ruineuse : si, face à ceux qui s’interrogent ou les interrogent sur leur foi, les chrétiens ne savent répondre que « je ne sais pas », « je le ressens mais je n’ai rien à en dire », il n’est pas étonnant qu’on les considère comme les membres d’une secte farfelue. Je m’inquiète donc de l’anti-intellectualisme parfois virulent observable chez bon nombre de croyants, notamment chez les catholiques et y compris chez les intellectuels, lorsqu’ils envisagent leur foi ; de leur refus intransigeant de la rationalité en matière religieuse ; bref, de cette tentation fidéiste du christianisme contemporain qui va de pair avec un renoncement à comprendre ou expliquer ce qu’on croit, et qui trouve sa traduction sociale dans une tendance identitaire au communautarisme, un recroquevillement sur soi, l’installation consanguine dans une mentalité de forteresse assiégée. Toutes ces formes de repli sont par essence incompatibles avec la visée universelle, c’est-à-dire catholique, au sens étymologique, du message chrétien. Contre ce fidéisme, je voudrais être ouvert au débat, réfléchir et promouvoir une conception du christianisme comme doctrine sans doute pas intégralement rationnelle (quelle idéologie ou vision du monde peut se prévaloir d’une telle qualité ?), mais de part en part raisonnable. Je le fais avec la conviction que seule la raison, l’universalité qu’elle autorise et le dialogue qu’elle instaure, permettent de communiquer (au sens fort : partager, mettre en commun), échanger, s’expliquer, et d’échapper par là au prosélytisme à sens unique, au fanatisme et à l’obscurantisme qui menacent toute confession religieuse de type dogmatique ou tout discours de foi fondé sur la seule intériorité incommunicable d’une expérience religieuse. On cite souvent la formule (apocryphe ?) d’André Malraux : « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». J’espère que notre siècle, s’il est religieux, sera également rationnel. Ou bien nous irons au devant de sérieux problèmes. « Rappelez-vous, écrit Paul Valéry dans Monsieur Teste, qu’entre les hommes il n’existe que deux relations : la logique ou la guerre. Demandez toujours des [arguments], l’argument est la politesse élémentaire qu’on se doit ».
A toutes fin utiles et pour éviter les malentendus, je précise qu’en disant tout cela, je ne veux en aucun cas critiquer ce qu’on appelle la « foi du charbonnier », la foi des gens simples. J’ai beaucoup de respect pour la foi du charbonnier… quand c’est celle d’un charbonnier ! Après, quand on a fait un peu de philosophie en terminale, voire des études supérieures, on n’est plus un charbonnier. Et dans la France des années 2010, il y a beaucoup de monde dans ce cas, notamment chez les chrétiens parmi lesquels on sait très bien que, sociologiquement parlant, les classes moyennes et supérieures sont désormais surreprésentées, notamment dans les grandes villes.
AP : Cette question m’est venue lorsque j’ai lu la partie consacrée à la théodicée. Alors que vous entamez une réflexion sur le mal, vous relativisez aussitôt la portée de celle-ci comme si vous jugiez indécente de penser le mal face à la réalité de la souffrance. Je vous cite :
« Quelles que soient la nécessité et l’urgence reconnues à une réflexion philosophique sur le mal, elle reste ainsi le privilège de personnes qui ne sont pas présentement broyées par la souffrance rencontrée ou subie, et il existe des situations de confrontation directe avec le mal où il y a indéniablement autre chose à faire que de se lancer dans des opérations de conceptualisation ou de lire celui qui les accomplit. »[7]
Et vous ajoutez à la page suivante :
« Et en ce qui me concerne en tant qu’auteur et émetteur du présent texte, qu’il soit clair que je ne dirais pas ce que j’écris dans les pages qui suivent, ou que je ne le dirais pas de la même façon, en allant visiter une personne qui souffre actuellement, et que je ne le penserais peut-être pas identiquement en faisant moi-même l’expérience du mal sous ses formes les plus accablantes. »[8]
Il y a là quelque chose d’étrange si je puis me permettre : soit la réflexion sur le mal a un sens, et même une efficace, auquel cas elle devrait s’adresser en priorité à ceux qui souffrent et qui sont accablés par le mal dont s’empare la réflexion, soit elle apparaît comme indécente face à la souffrance réelle, mais alors elle ne peut être pensée que comme vaine et l’idée même d’une théodicée doit être abandonnée. Autrement dit, que peut bien être le sens d’une réflexion sur le mal si elle ne peut être déployée prioritairement devant ceux qui sont accablés par ce dernier ? Reculer devant cela, n’est-ce pas avouer justement que le « ressenti » a le dernier mot face au mal ?
DM : Oui, vous avez raison, il y a une tension dans ce que j’ai écrit. Je ne suis pas sûr de souhaiter la résorber complètement, tout comme je ne suis pas sûr qu’on puisse arriver à clôturer de façon rationnellement et parfaitement satisfaisante une réflexion sur cet insondable et douloureux mystère qu’est le mal en contexte chrétien. De façon triviale, il me semble d’abord que lorsqu’on a vraiment très mal, au physique ou au moral, on n’est pas en situation de philosopher. La douleur accable et sature l’esprit : c’est pourquoi j’ai écrit « quelles que soient la nécessité et l’urgence reconnues à une réflexion philosophique sur le mal, elle reste ainsi le privilège de personnes qui ne sont pas présentement broyées par la souffrance rencontrée ou subie ». Un jour, un dentiste m’a touché le nerf d’une dent sans l’avoir préalablement anesthésiée, je vous assure que, dans les minutes qui ont suivi, je n’étais absolument pas en état de faire de la philosophie ! Et de façon plus dramatique et sans rentrer sans des détails personnels, j’en dirais de même de l’état de déréliction où je me trouvais dans les heures ou les jours qui ont suivi les quelques grands désastres existentiels que j’ai connus dans ma vie. Quand on est face à quelqu’un qui souffre beaucoup, il y a peut-être plus urgent à faire que de lui proposer des opérations de conceptualisation et de lui exposer une théodicée bien propre sur elle : secourir, soigner, nourrir, consoler, se révolter et entreprendre d’améliorer un peu le monde. Dans le même ordre d’idée, certains des arguments classiquement développés par les théodicées pour justifier la présence du mal dans le grand ordre du monde sont comme coupés de la réalité tragiquement vécue de l’expérience du mal : je sais bien que c’est une remarque un peu facile et qui verse dans un certain pathos, mais je me vois mal débarquer dans un service d’oncologie pédiatrique pour expliquer à une mère dont le jeune enfant est atteint d’un cancer en phase terminale que tout cela est une, ou n’est qu’une, petite ombre nécessaire à la beauté du grand tout et que la souffrance qui la bouleverse n’est, au fond, qu’un non être.
J’ai parfois l’impression, à lire les théodicées, d’être face à une sorte de délire de rationalisation justificative, de voir la raison pure développer de beaux principes en roue libre, en finissant par se couper complètement de ce qu’est l’expérience concrète de la souffrance dont elle prétend pourtant rendre compte.
Cela dit, j’entends votre objection. A trop aller dans cette direction, on donne le dernier et seul mot au « ressenti », et ce n’est pas ce que je souhaite. Je pense effectivement que le dernier mot doit revenir à la raison. Mais le « dernier mot », justement, n’est pas le premier. Permettez-moi de prendre un exemple pour essayer de clarifier cette question compliquée de l’articulation du ressenti et du rationnel dans des situations tragiques. Je suis opposé à la peine de mort, et j’ai pour cela de bons arguments. Mais si demain un détraqué viole et tue un de mes enfants, il n’est pas impossible que, fou de douleur, je réclame, au moins dans un premier temps, le rétablissement de la peine de mort. Ce « ressenti » constituera-t-il une raison valable de la rétablir ? Non, il est bon qu’on s’en tienne aux arguments rationnels plutôt qu’à l’immédiateté de ce désir de vengeance. Mais est-ce à dire que ce ressenti n’a aucune valeur, que mes amis philosophes venant à mon chevet dans cette situation terrible devraient le balayer en se contentant de me rappeler doctement les arguments contre la peine de mort ? Je ne crois pas. Il faut aussi, dans un premier temps, savoir accueillir et entendre la souffrance brute dans ce qu’elle a, justement, de brutal et de catégorique, d’indépassable, de rétif à toute justification. J’aime bien en ce sens le personnage de Rachel dont la Bible (Matthieu, 2, 18) dit qu’après la mort de ses enfants, « elle pleurait et ne voulait pas être consolée ». Il y a aussi de cela dans le personnage de Job : il endure mille maux sur son tas de fumier, ses amis viennent lui servir des arguments de style « théodicée » un peu faciles et bien pensants, et il y a en lui une sorte d’obstination, une façon de dire « non, désolé les amis, ça ne va pas, c’est trop commode, ma souffrance présente excède vos belles paroles, elle m’accable et il y a là un noyau de douleur et de révolte dont vous ne rendez pas compte ».
Donc oui, le dernier mot doit revenir à la raison. Mais je tiens à ce qu’on entende bien ce « dernier » en un sens chronologique, c’est-à-dire que, face au mal, la raison ait la pudeur de ne pas vouloir tout rationaliser trop vite et tout de suite. Les théodicées permettent de réfléchir après-coup à l’expérience du mal, d’essayer de donner, patiemment (parce que tout cela prend du temps) un sens à ce qui nous a un jour accablés, abattus, mis à terre. Disons qu’en ces matières compliquées, la chouette de Minerve doit avoir la pudeur, la délicatesse, la sagesse peut-être de ne pas vouloir prendre trop vite son envol.
AP : Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais vous soumettre une hypothèse ; en lisant vos derniers ouvrages, je me suis demandé ce qui pouvait les relier avec votre œuvre scientifique ; à cet égard j’aimerais vous soumettre l’hypothèse suivante, à savoir que la question du subjectivisme est peut-être le fil directeur de nombre de vos écrits. L’analyse que vous menez du débat entre Malebranche et Arnauld tourne autour du risque de psychologisme inhérent à l’ « évidence » cartésienne, et au risque que l’amour-propre corrompe un tel critère, faisant perdre l’objectivité de celui-ci. Or vingt ans plus tard, ce qui vous inquiète, demeure cette difficulté d’atteindre l’objectivité ou, à tout le moins, de sortir du pré-carré du particulier dans une époque où l’individu se glorifie presque de rester enfermé en lui-même et de faire de son propre « vécu » l’alpha et l’oméga de ce qu’il peut atteindre. Là-contre, tous vos écrits me semblent rechercher le passage de l’ordre de la subjectivité à celui d’un terrain commun ou, plus précisément, à la possibilité d’un terrain commun. C’est ce dont vous m’avez parlé plus haut, quand vous vous dites inquiet de « l’anti-intellectualisme plus ou moins virulent qu’on observe par les temps qui courent chez bon nombre de croyants (…) de leur insistance sur le seul ordre subjectif du « personnel », du « ressenti », de l’émotion, de l’expérience, de leur repli sur une religion de l’ « intériorité », de leur crispation sur une foi de type avant tout affectif qui se contente d’être personnellement « vécue » ou « authentiquement » « ressentie »
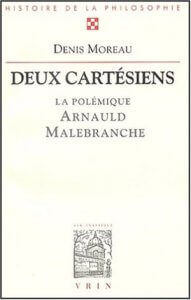
DM : Je n’avais jamais pensé à relier de cette façon mes premiers travaux « savants » en histoire de la philosophie et ce que j’ai écrit plus récemment. Mais oui, vous avez raison, cette question du poids de la subjectivité, de la distorsion subjectiviste y tisse une certaine continuité. J’avais été frappé par tout ce que Leibniz, Spinoza, Arnauld, ont écrit contre les risques de dérive subjectiviste du critère cartésien de l’évidence. On en a des échos aujourd’hui, quand les gens considèrent qu’on ne peut rien reprocher à ce qu’ils ont dit parce qu’ils l’ont dit « authentiquement » ou de façon sincère. Mais une ânerie authentiquement proférée reste une ânerie, et un imbécile sincère demeure un imbécile ! A un moment ou à une autre, il faut bien prendre en compte, aussi, la solidité objective, la cohérence de nos affirmations. Mutatis mutandis, j’ai les mêmes réticences quand on réduit la foi à un ressenti : à un moment ou à un autre, il faut bien prendre en compte, et s’expliquer sur, les contenus de la foi, les raisons qui justifient qu’on les adopte, et tout cela implique qu’on sorte de l’ordre du pur « ressenti », qui n’est ni objectivable ni susceptible d’être partagé. Je ne veux néanmoins pas donner l’impression de mépriser cette dimension subjective, personnelle, de l’expérience religieuse, et je reconnais qu’il y a quelque chose de très (trop ?) cérébral dans ma propre foi : en tout cas, beaucoup d’expressions par lesquelles mes coreligionnaires évoquent leur vie de foi (« coeur-à-coeur avec Dieu », « douceur qui envahit ») me restent assez étrangères. Mais je ne veux pas pour autant contester leur légitimité. Je veux bien admettre que je rate quelque chose, que ma foi est très froide et pèche par excès d’aridité spirituelle. Mais c’est en demandant à ceux qui se contentent du constat d’un « coeur-à-coeur avec Dieu » s’ils ne fautent pas, eux, par débordement de la subjectivité et manque d’argumentation.
AP : Diriez-vous que la substitution du mot « croyant » à celui de « fidèle » est un symptôme de cet enfermement dans la subjectivité ? Dire qu’il y a des croyants, c’est définir le rapport à la religion via une attitude de la conscience subjective ; dire que l’on est fidèle, c’est définir ce rapport via la possession d’une foi qui se veut savoir objectif. En ce sens, lorsque les chrétiens se disent « croyants » et non plus « fidèles », n’ont-ils pas déjà abandonné la possibilité de sortir de leur subjectivité, et n’ont-ils pas toujours déjà rendu impossible la discussion conceptuelle ?
DM : Je suis toujours étonné, voire amusé, quand m’est posée l’inévitable question : « es-tu croyant ? ». Si on prend cette interrogation au sens littéral, sans préciser de quel objet de croyance on parle, la réponse qui s’impose est, quel que soit celui qui a posé la question : évidemment je le suis, et toi aussi, nous le sommes tous. La croyance est une attitude spontanée de l’esprit humain, aucun d’entre nous ne vit ni ne pourrait vivre sans croire en certaines autorités dont nous avons de bonnes raisons de penser qu’elles en savent plus que nous sur certains sujets (l’État, la famille, L’Église, tel site web), aucune société humaine ne subsisterait si ses membres n’acceptaient d’admettre des choses qu’ils ne saisissent pas en toute évidence. À la question « es-tu croyant ? » il convient donc de substituer l’interrogation « que crois-tu ? » ou bien « à quoi ajoutes-tu foi ? » (fides, en latin, qui a aussi donné « fidèle »). Mais je ne suis pas complètement convaincu par ce que vous me dites sur « la substitution du mot « croyant » à celui de « fidèle » et le fait que, « dire que l’on est fidèle, c’est définir ce rapport via la possession d’une foi qui se veut savoir objectif ». D’abord, historiquement parlant, je ne sais pas très bien si et quand la substitution dont vous me parlez a eu lieu, si c’est un problème purement francophone, etc. Et il me semble que la fidélité, comme la croyance, peut se vivre de façon très subjective. Je n’opposerai donc pas d’une part « croyance subjective » et d’autre part « fidélité objective ». Je dirais plutôt qu’on peut être croyant, ou fidèle, pour des raisons plus ou moins objectives. En revanche, il me semble que l’idée de « fidèles » véhicule plus immédiatement l’idée de communauté que celle de « croyant ». C’est là que je vois une évolution, en phase avec la montée de l’individualisme qui caractérise notre modernité (et qui n’a pas, il faut le noter, que des mauvais côtés). Réduire la croyance à une affaire purement individuelle me paraît constituer le point aveugle d’une partie de la réflexion philosophique contemporaine sur la foi ou la croyance. Je reconnais avoir moi-même donné dans cet écueil, notamment lorsque j’ai écrit sur la question du salut : je n’ai pas assez, philosophiquement, mis en avant ce qu’il y a d’indispensable dans la notion d’ « Église », déterminée ici comme la structure sociale qui propose et permet mieux qu’une autre l’orientation communautaire des croyances et pratiques des individus dans une direction qui contribue à leur salut
AP : Une dernière question peut-être, en lien avec la dimension populaire de la philosophie mais aussi avec le problème du « terrain commun ». Votre tout dernier ouvrage, Nul n’est prophète en son pays[9] vise à restituer la provenance de nombreux proverbes et expressions familières en en rappelant l’origine néotestamentaire. D’une certaine manière, vous redonnez au langage comme terrain commun l’intelligence de sa source tout en soulevant dès l’introduction le paradoxe de l’entreprise :
« une très forte majorité de Français contemporains n’a jamais lu et ne lira jamais ces quatre tout petits livrets de quelques dizaines de pages appelées « Évangiles », qui racontent la vie et rapportent les paroles de Jésus. Mais, en presque deux mille ans d’histoire du christianisme, ces textes constamment copiés, puis imprimés, puis numérisés, lus, médités, cités, commentés, glosés, détournés ont si profondément informé (au sens fort de « donner forme ») notre culture, nos pensées, et (…) nos façons de parler, que chacun conserve avec eux une forme de familiarité, de connivence implicite. »[10]
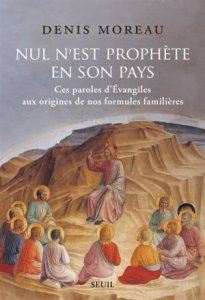
J’aimerais vous poser la même question que précédemment, quant au sens de cette nouvelle entreprise ; vous critiquez assez vertement la vitupération d’un Léon Bloy fustigeant le Bourgeois transformant les paroles d’Évangile en formules asséchées, mais dans votre propre optique, quel est le but précis de déterminer la source de formules devenues proverbiales ? La question se pose car il me semble qu’un dilemme délicat se pose : soit l’origine chrétienne de nombre de nos expressions va de soi, ce que d’ailleurs vous reconnaissez en notant que « l’influence massive sur notre culture du christianisme en général et des Évangiles en particulier n’est pas, en soi, un sujet de discussion ou de débat »[11], auquel cas rappeler l’origine néotestamentaire de bien des proverbes relève de l’évidence ; soit une sorte de voile d’oubli a recouvert cette origine, mais alors l’influence massive du christianisme ne va plus de soi en raison même de cet oubli, et la volonté de désocculter si je puis dire l’origine s’apparente à un projet précis qu’il faudrait préciser.
DM : Pas de problème, je veux bien préciser ce qu’a été mon projet avec ce livre. Mais, cette fois, je trouve que le dilemme que vous me proposez n’est pas très bon. En fait, c’est assez simple, et tout cela renvoie derechef à mon projet « apologétique » dont nous avons déjà parlé tout à l’heure. Je suis depuis longtemps travaillé par l’exclamation de saint Paul « malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile ! » (Première lettre aux Corinthiens, 9, 16 ; je ne prends pas cette exclamation comme lestée d’une menace, je me dis plutôt qu’elle signifie que, si je ne parle pas de l’Évangile, je me priverai de faire quelque chose de bien). Cela fait vingt ans que je cherche des points de contacts entre christianisme et modernité, ou si vous préférez des « prises » (au sens que le terme a en escalade) où m’accrocher pour parler de ma foi catholique à ceux qui ne la partagent pas. J’ai tenté de le faire, avec plus ou moins de succès, en écrivant sur le salut, le mariage, etc. Là, il m’a semblé que j’avais trouvé une de ces prises, peut-être meilleure que les précédentes : les gens citent fréquemment les Évangiles, mais le plus souvent sans le savoir. On peut le leur expliquer, et en profiter pour leur faire (re)découvrir les Évangiles sous un jour inattendu, et dans la bonne humeur, en évitant le prêchi-prêcha ou une approche trop immédiatement pieuse, qui rebute la plupart des lecteurs d’aujourd’hui.
Dans les faits, bien sûr, vous avez raison, et, par exemple, en tant qu’enseignant dans le supérieur, je rejoins votre constat : nous sommes face aux premières générations entièrement et massivement déchristianisées. Une forte majorité de mes étudiants, y compris les plus doués, ne connaît absolument rien au christianisme. Mais une fois ce constat opéré, que fait-on ? On peut, à la façon de Léon Bloy, grogner, déplorer, regretter un passé plus ou moins idéalisé, enguirlander les étudiants parce qu’ils ne ressemblent pas à ce qu’on voudrait qu’ils soient. Les catholiques français, souvent ronchons, sont assez doués pour tout cela. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, c’est même plutôt, comme on dit à présent, « contre-productif » : les gens, voyez-vous, n’aiment pas se faire enguirlander en permanence ! Je préfère partir du monde tel qu’il est : il y reste des formes, certes ténues et peu abouties, d’imprégnation chrétienne, comme ces formules issues des Évangiles que je repère et explique, en restituant aussi leur sens théologique. Ce sont comme de petites braises, j’essaie de souffler dessus, peut-être quelque chose, un certain intérêt pour les Évangiles, se rallumera-t-il. Mais bien sûr, c’est très modeste. A l’âge où j’arrive, on commence à penser un peu plus à la mort. Disons que sur ma tombe et en souvenir de ce que j’ai pu écrire comme défense et illustration du christianisme, j’aimerais bien que figure en guise d’épitaphe cette phrase de l’Évangile de Marc, 14, 8 : « il a fait ce qu’il a pu ».
B : Foi en Dieu et raison
AP : Si vous le voulez bien, j’aimerais aborder à présent les trois textes qui constituent Y a-t-il une philosophie chrétienne ?, et commencer par un éloge. J’ai rarement lu quelque chose d’aussi clair et d’aussi synthétique concernant les preuves de l’existence de Dieu mais aussi concernant les problèmes inhérents à la théodicée. Ce sont là des textes remarquables de concision, de clarté et de pédagogie qui, jamais, ne se paient de mots, fait suffisamment rare pour être souligné. Je vous dis donc le grand plaisir pris à la lecture de cet ouvrage, de surcroît parcouru de traits d’humour sur lesquels nous reviendrons peut-être.
Avant toutes choses, je voudrais vous interroger sur une affirmation qui m’a quelque peu étonné et que je vous soumets :
« Lorsqu’on aborde philosophiquement la question de Dieu, il n’y a pas de prime abord de raison de lui réserver un traitement théorique particulier, de considérer qu’il est fondamentalement différent de n’importe quel autre objet auquel on est amené à réfléchir. »[12]
Un tel énoncé me paraît justement discutable, au moins du point de vue historique ; d’une part, si l’on se réfère à la période moderne, Dieu fait justement l’objet d’un traitement philosophique spécial puisqu’il est traité par la métaphysique spéciale et non par la métaphysique générale, ce qui signifie qu’il existe, au moins historiquement parlant, un type d’objets spécifiques, qui ne peuvent être traités de la même manière générale que ceux relevant du régime général de l’être. D’autre part, il me semble que son statut est tellement différent selon que l’on se réfère à une philosophie grecque comme celle de Platon ou d’Aristote où le divin n’est jamais que la principe impersonnel de l’Ordre ou de l’Intellect, ou à une philosophie contemporaine du christianisme où il devient l’origine, le fondement et le sens de toutes choses, et où, surtout, il devient une Personne, qu’il est peut-être hardi d’affirmer qu’aucun traitement théorique particulier ne saurait lui être réservé.
DM : Ce que j’ai voulu dire dans ces lignes est plus banal que ce que vous y avez entendu. Je suggère simplement que si on veut philosopher sur Dieu, ce n’est pas une très bonne idée de décider d’emblée de s’exempter des principes généraux de la saine rationalité. J’ai souvent l’impression que les gens disent : « ah, tiens, puisqu’on va parler de Dieu, on le droit de penser n’importe comment ». Et alors, c’est parti pour les rafales d’oxymores (« obscure clarté » « immense petitesse », etc.), les paradoxes à foison, les thèses invraisemblables. Je prends souvent pour exemple cette phrase qu’on prête à Maxime Gorki (j’ignore s’il l’a vraiment écrite) : « Dieu, si tu penses à lui, il existe, si tu n’y penses pas, il n’existe pas ». Sauf à professer un idéalisme absolu, c’est quand même très bizarre de considérer que l’existence d’une chose est coordonnée au fait que je la pense ! Mais, parce que c’est de Dieu qu’il s’agit — un objet, donc, un peu spécial, intimidant, qu’on pressent ou se figure pas comme les autres — on se donne le droit de dire à son propos des choses parfaitement absurdes quand on les applique à n’importe quel autre objet du monde : par exemple, je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de personnes pour estimer que l’existence d’Emmanuel Macron dépend de ma pensée et qu’il faut donc dire « Emmanuel Macron, si tu penses à lui il existe, si tu n’y penses pas, il n’existe pas » ! Quand j’écris « Lorsqu’on aborde philosophiquement la question de Dieu, il n’y a pas de prime abord de raison de lui réserver un traitement théorique particulier », c’est, ici aussi, le « de prime abord » qui est important : quand on commence à philosopher à propos de Dieu, je recommande de garder son calme spéculatif, d’éviter le délire intellectuel, de s’en tenir aux exigences standards de la philosophie. Ensuite, comme vous le remarquez, il n’est effectivement pas exclu qu’en cours de route, au fur et à mesure que la réflexion sur Dieu se constitue, on découvre que cet objet a des caractéristiques particulières, qui réclament un traitement et des attitudes intellectuelles particuliers. Mais c’est par la réflexion rationnelle organisée qu’on le découvre, pas en racontant d’emblée n’importe quoi. Parmi les philosophes que j’apprécie, Descartes a exemplairement su trouver cet équilibre : il constitue une théologie naturelle (par exemple il prouve l’existence de Dieu) en respectant les exigences générales de la « méthode » qu’il applique à tout objet de pensée. Mais, chemin faisant, il découvre en Dieu une propriété particulière et qui n’appartient qu’à lui, l’infinité. Cela le conduit à spécifier le type de rapport intellectuel qu’on entretient avec cet objet : on dira que Dieu est pensable, intelligible (en latin qu’on peut l’intelligere, raisonner de façon viable à son propos), mais qu’un esprit fini comme le nôtre ne peut pas prétendre épuiser cet objet, le « comprendre » (au sens de cumprehendre : faire le tour, embrasser). Il me semble que, dans les grandes lignes, Thomas d’Aquin fait à peu près la même chose dans sa Somme de théologie : les cinq « voies » qui permettent de poser l’existence de Dieu reposent sur des principes de la raison naturelle. Puis la réflexion avance, et s’efforce de prendre en compte, dans les thèses comme dans la méthode (l’analogie), ce que cet objet a de particulier.
Puisque vous me tendez une perche à ce propos dans votre question, permettez-moi de dire aussi un mot à propos des « traits d’humour » que je mets, ou essaie de mettre, dans mes ouvrages. C’est quelque chose d’important pour moi. Je n’ai jamais compris pourquoi historiquement parlant, la philosophie, et la théologie aussi, se sont majoritairement construites comme des disciplines pas drôles, très austères, en se privant des ressources du rire et du sourire. Je considère par exemple les Méditations métaphysiques de Descartes comme le plus grand chef-d’œuvre de la philosophie. Mais il n’y a aucun moment où ces réflexions font sourire. À vrai dire, les rares penseurs assez drôles sont souvent des antichrétiens (on peut faire une exception pour Pascal, avec les Provinciales), Voltaire par exemple, ou Nietzsche. Comme la joie est une notion essentielle pour moi, que je voudrais (je ne dis pas que j’y arrive toujours !) que ce soit la tonalité affective centrale de mon existence, je souhaite que cela transparaisse dans mes livres, qu’ils soient, parfois, joyeux, ou au moins donnent envie de sourire. C’est important que les gens y trouvent quelque chose de la joie. J’aime beaucoup un texte de Paul de Tarse dans la Seconde lettre aux Corinthiens (9, 7). Dans les bibles actuelles, on traduit souvent par « Dieu aime celui qui donne dans la joie », ce qui est déjà une thèse forte (à laquelle Spinoza, par exemple, pourrait tout à fait souscrire). Mais dans le grec, ou le latin de la Vulgate, on trouve les mots (hilaros, hilaris) qui ont donné « hilarité » en français, si bien qu’on peut aussi comprendre « Dieu aime celui qui donne en riant ». C’est une belle idée, non ? Je pense bien entendu ici à ce bon rire simple et franc qui est l’indice de la présence de la joie, celui dont parle Spinoza en Ethique IV, 45, scolie, pas au rire qui veut blesser ou à l’amère et facile ironie, dont notre époque abuse à mes yeux.
AP : Pour ma part, je crois qu’il y a une ironie mordante dans les Méditations qui peut prêter à sourire, ironie d’ailleurs bien plus fine que celle que l’on trouvera un siècle plus tard chez les auteurs des Lumières. L’adresse des Méditations aux doyens et docteurs, par exemple, est un chef-d’œuvre de drôlerie lorsque Descartes convoque les infidèles risquant de croire qu’il y a un cercle vicieux dans les raisonnements des théologiens, alors que tout homme rationnel – et pas seulement les infidèles – perçoit l’évidence du cercle dont il est question.
Mais revenons au traitement théorique de Dieu né des besoins de la raison. Vous entretenez à ce sujet un rapport clair à l’existence de Dieu du point de vue de la raison et de l’argumentation rationnelle en faveur de l’existence de Dieu que vous énoncez ainsi : « Pour ma part, je défends une position aujourd’hui philosophiquement minoritaire puisque j’estime que la plupart de ces arguments sont valides. »[13]. Et si vous contestez la faiblesse des arguments physico-théologiques, vous exaltez au contraire les arguments ontologiques et cosmologiques :
« je considère pour ma part que les arguments dits ontologiques et cosmologiques, dans les versions thomiste et cartésienne, sont aussi convaincants et démonstratifs qu’il est possible de l’être en philosophie. J’estime donc, pour le dire autrement, qu’on peut rationnellement montrer, avec des chances élevées d’être « dans le vrai », qu’il existe quelque chose d’infini (version cartésienne de l’argument cosmologique), d’unique, parfait ou à qui appartient tout ce qui existe en termes de perfection, bref de « tel que rien de plus grand ne se peut penser » (preuve ontologique), et qui est cause de tout ce qui existe (la voie thomiste qui a été présentée). »[14]
Paradoxalement, je me demande si vous ne pointez pas ici une limitation de la philosophie davantage qu’une force des démonstrations de l’existence de Dieu ; autrement dit, il me semble que vous définissez un cadre, celui de la philosophie, où aucun argument ne saurait être pleinement convaincant, et dans ce cadre-là d’argumentation imparfaite, les preuves proposées par Thomas d’Aquin ou Descartes en faveur de l’existence de Dieu seraient parmi les moins imparfaites dont la philosophie est capable.
DM : Votre remarque engage une question vaste et compliquée, sur laquelle je ne suis pas sûr d’être parvenu à des conceptions parfaitement claires et distinctes : celle du type de vérité qu’on peut prétendre atteindre par un raisonnement philosophique. Nous avons tous, moi le premier, en tête un modèle plus ou moins cartésien à ce propos : le « cogito » fournit une première vérité absolument indubitable, certaine, nécessaire, indiscutable. Et, idéalement, les énoncés qu’on établit à partir de ce premier principe doivent tous être affectés du même coefficient de certitude (Descartes estime qu’en métaphysique au moins, il n’y a pas de déperdition de certitude lorsqu’on progresse dans les « chaines de raisons » qu’il construit). J’ai longtemps pensé ainsi, et puis en vieillissant, j’en suis revenu, pour une raison de bon sens : hors peut-être quelques premiers principes de la pensée et le cogito, qui a effectivement de ce point de vue un statut tout à fait particulier, je ne connais pas vraiment de thèse philosophique sur laquelle tout le monde se mette d’accord — comme tout le monde peut, par exemple, se mettre d’accord sur le résultat d’une opération ou d’une démonstration mathématique. Ce fait d’une certaine discordance intersubjective est bien l’indice que le type de certitude qu’on atteint en philosophie n’est pas le même que celui qu’on trouve dans les sciences « dures ». Mais je me refuse à verser pour autant dans le scepticisme, en disant que toutes les thèses philosophiques se valent, qu’on n’atteint rien de solide ou d’assuré en philosophie, qu’elle ne produit que du vent ou du baratin. Pour reprendre votre expression, je dirais que, lorsqu’on a de bons arguments, on atteint en philosophie ce que j’appellerais de façon paradoxale (et peu cartésienne, je le reconnais), des certitudes imparfaites issues de l’usage d’une rationalité souple, ou élargie (par opposition à une rationalité étriquée qui réduirait la rationalité aux sciences dites « dures »). En un sens et de façon plus pessimiste que moi, Pascal dit cela au sujet des « preuves de l’existence de Dieu » qu’on a prétendu tirer du spectacle du monde.
Si je n’y [dans la nature] voyais rien qui marquât une divinité, je me déterminerais à la négative. Si je voyais partout les marques d’un Créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais voyant trop pour nier, et trop peu pour m’assurer, je suis dans un état […] où j’ai souhaité cent fois que si un Dieu soutient la nature, elle le marquât sans équivoque, et que si les marques qu’elle en donne sont trompeuses elle les supprimât tout à fait ; qu’elle dît tout, ou rien ; afin que je visse quel parti je dois suivre. (Pensées, Lafuma, 429).
Comme Pascal dans ce texte, je crois que les arguments en faveur de l’existence, ou de l’inexistence, de Dieu ne permettent pas d’atteindre une certitude catégorique à ce sujet. Mais je vais plus loin de Pascal, je me sens assez proche de ce qu’affirme par exemple Richard Swinburne : certains arguments en faveur de cette existence sont valides, même s’il ne sont pas indiscutables et qu’il existe des contre-arguments dignes d’intérêt. En additionnant ces arguments, on ne peut pas affirmer de façon absolument nécessaire que Dieu existe, mais on le fait avec une probabilité raisonnable, voire assez forte. C’est peut-être tout ce que peut proposer la philosophie à ce sujet. Mais ce n’est pas rien !

AP : Beaucoup de penseurs vous diraient pourtant que « nous savons depuis Kant » (selon la formule consacrée censée clore toute discussion) que l’on ne peut pas appliquer les concepts de l’entendement pur à ce qui excède le cadre phénoménal. Pour quelle raison les arguments thomiste et cartésien vous paraissent-ils résister à la réfutation principielle de Kant ?
DM : La Critique de la raison pure est un livre génial, un des plus grands chefs-d’oeuvre de la philosophie. Mais je suis, comme vous, agacé par cette façon dont le nom de Kant fait, en France, office d’argument d’autorité. C’est peut-être un peu moins vrai à présent, mais, quand j’étais étudiant, dans les années 1980-1990, combien de fois n’ai-je pas entendu des phrases comme « depuis Kant, nous savons bien que… » ou bien « après Kant on ne peut plus dire cela », etc. Il y avait dans le temps un petit adage latin en cours dans l’Eglise catholique, pour désigner la façon dont une intervention du Vatican clôt les débats doctrinaux : Roma locuta, causa finita est (“Rome a parlé, le débat est clos”). J’ai un peu le sentiment que dans l’Université française, on s’en tient souvent, en guise d’argument, à : Kant locutus, causa finita. Evidemment, en raison de la conception de la vérité philosophique que j’ai essayé d’esquisser en réponse à votre précédente question, je ne suis pas d’accord avec cette idée que ce qu’a avancé Kant est catégoriquement indiscutable.
Concernant l’argument thomiste en faveur de l’existence de Dieu (disons pour être plus précis les deux premières des cinq « voies » de la Somme de théologie, celles qui s’appuient sur les idées de cause et de mouvement) il me semble qu’il stipule, comme Kant, qu’il faut effectivement un point de départ phénoménal, l’effet dont on part. Mais, contre Kant, il soutient qu’il n’y a pas besoin de remonter de façon phénoménalement effective toute la série des causes pour pouvoir appliquer cette exigence de la raison : il faut une cause qui a inauguré la série de causes et d’effets dont on examine le terme. J’aime bien l’amusante illustration de ce point par le philosophe Patterson Brown : (« Infinite causal regression », 510-525 dans The Philosophical Rewiew, 1966) :
« Considérez le cas suivant. M. Alpha est dans sa voiture, arrêté à un carrefour. Juste derrière lui se tient M. Bêta dans sa propre voiture. Derrière M. Bêta il y a M. Gamma, derrière qui se trouve M. Delta, et ainsi de suite indéfiniment. Soudain, la voiture d’Alpha est poussée par l’arrière, ce qui endommage son pare-choc. M. Alpha, voulant se faire rembourser les frais de réparation de sa voiture, accuse M. Bêta d’avoir causé l’accident et engage des poursuites contre lui. Mais lors du procès, Bêta se défend avec succès en expliquant que lui-même a été poussé dans Alpha par Gamma. Alpha poursuit donc Gamma. Mais il s’avère que ce dernier a lui-même été embouti par Delta. Alpha entame donc des poursuites contre Delta. Et ainsi indéfiniment. Si cette série de carambolages s’étendait à l’infini, il n’y aurait personne qu’Alpha puisse poursuivre avec succès pour avoir cabossé son pare-choc ; il n’y aurait, en bref, aucune cause de l’accident. Mais s’il n’y avait pas de cause, rien qui donne le mouvement, alors il n’y aurait non plus pas d’effet, rien de remué – ce qui est évidemment faux, puisque la voiture d’Alpha est cabossée et a été remuée. On ne peut donc pas avoir une régression à l’infini des voitures qui se poussent, mais il y a plutôt quelqu’un qui est la première cause de toute cette série d’accidents ; quelqu’un dont on peut dire à proprement parler qu’il a poussé Bêta dans Alpha, Gamma dans Bêta, Delta dans Gamma, et ainsi de suite. Il y a donc quelqu’un auprès de qui Alpha pourra se faire rembourser ses frais de garagiste ».
On n’a accès, phénoménalement parlant, qu’à la fin de la série causale (ma voiture emboutie, les deux ou trois qui se sont elles mêmes embouties avant elle), mais on pose bien l’existence nécessaire d’un premier caramboleur lui-même non carambolé. Et je crois, contre Kant, qu’on a raison de le faire.
Chez Descartes, il y a deux types d’arguments. Tout d’abord, la (ou les deux versions de la) « preuve par les effets » de la Troisième Méditation. C’est intéressant de noter que Kant ne s’attaque pas vraiment à cet argument cartésien : il faut une cause actuellement infinie pour expliquer la présence de l’idée d’infini en moi. Evidemment, sauf à tenir l’idée pour un phénomène, on est ici complètement en dehors du cadre « phénoménal », mais l’argument me semble digne de considération : parmi mes idées, l’une, l’idée d’infini », « détonne », elle mérite une enquête particulière, elle est comme une trace, en moi, de quelque chose d’autre que moi et qui ne se laisse pas réduire à ce que je suis.
Concernant l’argument dit (par Kant) « ontologique » qu’on trouve dans la Cinquième Méditation et auquel Kant essaie de ramener tous les autres arguments en faveur de l’existence de Dieu, je ne suis pas convaincu du tout par l’affirmation kantienne que « être n’est pas un prédicat réel » (affirmation qui n’est d’ailleurs pas très originale : on en trouvait déjà des modulations chez Gaunilon s’adressant à Anselme, ou chez Caterus objectant à Descartes). C’est peut-être un peu bêta, mais je pense que l’existence est quelque chose, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose de plus si j’ai un billet de cent euros dans ma poche que si j’ai seulement le concept d’un billet de cent euros. On saisit peut-être mieux cela si l’on se réfère à la version de l’argument ontologique donnée par Anselme de Cantorbery : Dieu est id quo nihil majus cogitari potest, « ce qui est tel qu’on ne peut rien penser de plus grand ». Quand je dis cela, j’ai l’idée de Dieu, Dieu dans mon esprit, Dieu en pensée. Ce Dieu que je pense existe-t-il non seulement dans mon esprit, mais aussi dans la réalité ? Anselme répond : oui, inévitablement. Appelons en effet A le fait d’être dans mon esprit, d’être pensé, et B le fait d’exister. Si Dieu n’existe pas, il est seulement dans mon esprit, ce qui est moins que d’être dans mon esprit et d’exister (A < A + B, si B non nul ; mais il semble difficile de prétendre qu’exister n’est rien). Si donc Dieu est seulement dans mon esprit, s’il n’est que pensé, il est tel qu’on peut penser plus grand que lui, c’est-à-dire A + B, Dieu dans mon esprit et Dieu existant. Mais il a été admis que Dieu est « ce qui est tel qu’on ne peut rien penser de plus grand » : affirmer que Dieu n’existe pas est donc absurde, contradictoire, puisque cela revient à dire que « ce qui est tel qu’on ne peut rien penser de plus grand » n’est pas « ce qui est tel qu’on ne peut rien penser de plus grand ». Descartes dit quant à lui : Dieu est l’être infiniment parfait, qui possède toutes les perfections ; l’existence est une perfection ; donc Dieu existe. Sur le fond, je pense que c’est le même argument que celui d’Anselme. Mais nous avons plus de mal à le comprendre parce que nous donnons au mot « perfection » un sens moral ou axiologique qu’il n’avait pas nécessairement au XVIIe siècle. En latin, perfectus signifie parachevé, complet (et imperfectus, manquant, déficient). Quand Descartes définit Dieu comme infiniment parfait, il veut dire qu’il est l’être à qui rien ne manque (et donc pas l’existence). Il retrouve pas là le « plus grand » d’Anselme.
AP : Il semble à vous lire que Dieu apparaisse somme toute en philosophie bien moins comme une personne dictant une Loi ou s’incarnant que comme une « substance infinie ». En quel sens alors la voie argumentative que vous retenez ne vous mène-t-elle pas nécessairement au spinozisme et peut-on argumenter en faveur d’une différence nette entre Substance infinie divine et Univers ?
DM : C’est une excellente question avec laquelle je me débats depuis longtemps, et d’autant plus que je me sens sous bien des aspects, et de plus en plus, proche de Spinoza. Je me rassure en me disant que je ne suis pas le seul, parmi les philosophes chrétiens, à me débattre ainsi : Leibniz ou Malebranche, par exemple, ont passé une bonne partie de leur parcours philosophique à tenter d’expliquer qu’ils n’étaient pas spinozistes, que les principes fondamentaux de leur pensée ne conduisaient pas logiquement à cette philosophie. Je me dis souvent que le spinozisme est une sorte de « trou noir » qui attire, aspire à lui les pensées de l’Age classique. Et peut-être aussi, plus modestement, ma propre pensée. Si je devais synthétiser en quelques mots la position philosophique qui est actuellement la mienne, je dirais que je suis sur une sorte de ligne de crête entre Descartes et Spinoza. Cela signifie aussi, qu’à mes yeux, ils ne sont pas très éloignés l’un de l’autre, si bien qu’il faut relire Descartes au prisme du spinozisme, mais aussi Spinoza au prisme du cartésianisme.
Je pense effectivement, avec Descartes et Spinoza, que la description « substance infinie » est une de celles, et peut-être la meilleure de celles, qu’on peut philosophiquement donner de Dieu. Est-ce que cela conduit à identifier Dieu et l’univers (ou la nature) ? Je n’en suis pas sûr, si du moins par univers ou nature on entend la seule totalité potentiellement visible ou observable des choses matérielles (peut-être ce que Spinoza nomme facies totus universi dans la Lettre 64). L’immensité spatiale ainsi entendue, c’est au mieux une dimension d’une substance infinie qui, par définition, en a une infinité, de dimensions. Donc, au lieu d’identifier Dieu à la « nature » ou à l’univers, je dirais : Dieu, c’est le Réel. Et je signalerais, cum grano salis, que, devant cette identification de Dieu à la Réalité, les bons esprits gardiens sourcilleux de la saine doctrine chrétienne devraient peut-être se garder d’hurler trop vite au spinozisme, au panthéisme ou à l’« ontologisme » — ou bien ils ne négligeront pas d’englober dans leur courroux le pape Benoît XVI, qui n’est pourtant pas réputé pour ses fantaisies théologiques, mais a dit : « Dieu est la Réalité. La Réalité qui porte toute réalité » (dans le texte allemand : « Gott ist die Realität. Die Realität, die alle Realität trägt » ; Dernières conversations, Paris, Fayard, 2016, p. 269).
Concernant Spinoza, je ferais deux remarques. Il est tout d’abord remarquable que, contrairement à ce que pourrait faire croire la tradition interprétative qui l’a érigée en étendard, la formule « deus sive natura », « Dieu, c’est-à-dire la nature » soit rare chez lui, et n’apparaisse pas par exemple dans la partie I de l’Éthique, celle qui est précisément consacrée à Dieu. Cela signifie à mes yeux que, pour Spinoza lui-même, « substance infinie » décrit mieux Dieu que « nature ». En second lieu, Spinoza affirme que cette substance infinie est dotée d’une infinité d’attributs, et que nous n’en connaissons que deux : la pensée et l’étendue. Cela signifie qu’il y a une infinité (moins deux !) de dimensions de Dieu que nous ne connaissons pas, auxquelles nous n’avons pas accès. Je me demande si cela ne suffit pas à rétablir une forme de transcendance du Dieu de Spinoza, et à casser l’identification de la substance infinie à l’immanence de l’univers. Donc je veux bien qu’on dise que mon concept de Dieu est spinoziste (ou cartésien), mais alors c’est un spinozisme dissident, assez éloigné des lectures strictement immanentistes, et souvent matérialistes, qu’on donne communément de cet auteur. Je me sens assez proche d’un courant certes minoritaire chez les spinozistes, mais en définitive assez vivace et continu, ce qu’on pourrait appeler le spinozisme chrétien. Je me sens donc assez proche, dans la lecture de Spinoza, de la Préface qui fut ajoutée par Jellesz (et Meyer ?) à ses Opera Posthuma, de Stanislas Breton de Jacqueline Lagrée, d’Alexandre Matheron, d’Henri Laux, de Graeme Hunter. Cela dit, je ne veux évidemment pas faire de Spinoza un auteur qui accepterait tous les dogmes qui définissent l’orthodoxie catholique : il conteste la réalité de la résurrection (Lettre 78), récuse la possibilité d’une nature humano-divine du Christ et par voie de conséquence celle de la Trinité (Lettre 73), ironise sur la présence divine dans l’eucharistie (Lettre 76) ou encore critique de façon radicale la notion de libre-arbitre (par ex. Lettre 58). Ces éléments, ainsi que quelques autres pièces de sa philosophie, interdisent à l’évidence d’attribuer à Spinoza un christianisme, et plus encore un catholicisme, traditionnels, et ils vouent d’avance à l’échec toute tentative pour aligner le spinozisme sur une des formes instituées de l’orthodoxie chrétienne. Mais je trouve chez Spinoza une philosophie extrêmement puissante pour penser cette notion cardinale du christianisme qu’est la joie ; je prend au sérieux les textes du Traité théologico-politique qui insistent sur la puissance libératrice des enseignements évangéliques, défendent la destination universelle d’un salut qui se diffuse par la seule force de la passion du Christ (TTP XII, §8) et voient dans le Christ « la bouche de Dieu » (TTP IV, §10), celui qui, seul dans son cas, « communiquait avec Dieu d’esprit à esprit » (TTP I, §18). Disons pour synthétiser qu’en tant que catholique désireux de ne pas trop sortir des clous de l’orthodoxie doctrinale de ma religion, je ne peux pas être complètement spinoziste. Mais c’est une pensée qui accompagne et nourrit mon christianisme. Elle le provoque aussi parfois, en me poussant, comme vous-même avec cette question, dans mes retranchements conceptuels.
AP : Avant de passer à la théodicée, j’aimerais vous proposer une remarque concernant Hegel ; vous mentionnez de nombreux auteurs ayant défendu l’argumentation philosophique en faveur de l’existence de Dieu parmi lesquels vous faites figurer Hegel. Or il me semble que ce que disent Thomas, Descartes, Spinoza ou Leibniz n’est pas du tout du même ordre que ce que vise à établir Hegel. Les premiers visent à prouver que, de manière absolue, existe un Dieu qui se trouve être accessible au moins pour son existence à la pensée humaine. En revanche, Hegel entreprend une démarche qui me paraît fort différente, à savoir non pas statuer en-soi sur l’existence de Dieu mais savoir si, au regard du concept, le concept de Dieu est analogue aux autres concepts, et donc s’il est licite du point de vue subjectif de différencier Dieu des thalers. Le but de Hegel n’est donc aucunement de prouver qu’il existe en-soi un Dieu mais bien plutôt de prouver que la pensée a raison du point de vue de la pensée de parler de Dieu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les deux paragraphes que vous mentionnez sont tirés de la Science de la Logique qui n’a pas d’autre visée que d’élucider le sens de la pensée.
En somme, je crois que Hegel veut dire ceci : les preuves de l’existence de Dieu sont satisfaisantes pour la pensée rationnelle, et comme il n’existe pas d’autre point de vue pour nous que celui de la pensée, alors pour nous de telles preuves sont satisfaisantes en soi, puisqu’il appartient à l’absolu d’être relatif (la substance est toujours sujet). Mais il demeure ce « pour nous », qui fait que le sens de la preuve diffère fondamentalement de toutes les autres entreprises en la matière. Cela étant dit, je me demande si, au fond, vous n’êtes pas beaucoup plus proche de Hegel que des autres auteurs auxquels vous vous référez, lorsque vous dites que les arguments sont convaincants « autant qu’il est possible de l’être en philosophie », manière de signifier que vous vous situez bien moins dans l’absolu (en un sens non hégélien) que dans une perspective rationnelle où l’on évaluerait ce qui, pour la raison, apparaît comme correct. A cet égard, votre thèse serait celle-ci, à savoir non pas que Dieu existe en-soi mais que pour la raison il n’est pas absurde de considérer qu’il existe et que son existence est argumentable, ce qui ferait de vous un hégélien plus qu’un cartésien ou un spinoziste.
DM : Je vous fais toute confiance quant à la validité de votre exposé de doctrine hégélienne, et celle de votre diagnostic final sur ma propre pensée. Mais si je suis un hégélien, c’est un hégélien qui s’ignore. Je n’en suis pas fier, mais je dois vous avouer que je n’ai jamais réussi à entrer dans la pensée de Hegel, je ne comprends pas grand chose à la Phénoménologie de l’Esprit, et encore moins à la Science de la logique. Je connais des gens très bien qui me disent que c’est absolument génial, et je suis tout disposé à les croire. Mais le fait est que c’est une pensée qui me reste assez impénétrable (cela dit, il n’est pas interdit d’espérer que les choses finissent par s’améliorer : j’ai longtemps eu le même genre de problème avec la première partie de l’Éthique de Spinoza, et puis, à force de la relire, un jour, cela s’est éclairé). Peut-être suis-donc, comme vous le suggérez, une sorte de Monsieur Jourdain de l’hégélianisme. Mais ne n’ai pas le savoir nécessaire pour pouvoir m’auto-diagnostiquer comme tel !
La suite de l’entretien est consultable à cette adresse.
[1] Antoine Arnauld, Textes Philosophiques, édition de Denis Moreau, Paris, PUF, coll. Épiméthée
[2] cf. Antoine Arnauld, Des vraies et fausses idées, Paris, Vrin, 2011. On peut en consulter la recension ici- : https://www.actu-philosophia.com/Antoine-Arnauld-Des-vraies-et-des-fausses-idees].
[3] Denis Moreau, Y a-t-il une philosophie chrétienne ? Trois essais, Paris, Seuil, coll. Points, 2019.
[4] Ibid., p. 7.
[5] Ibid, p. 8.
[6] Denis Moreau, Comment peut-on être catholique ?, Paris, Seuil, 2018.
[7] Denis Moreau, Y a-t-il une philosophie chrétienne ?, op. cit., p. 100.
[8] Ibid., p. 101.
[9] Denis Moreau, Nul n’est prophète en son pays. Ces paroles d’évangiles aux origines de nos formules familières, Paris, Seuil, 2019.
[10] Ibid., p. 9.
[11] Ibid., p. 10.
[12] Ibid., p. 43.
[13] Ibid., p. 60.
[14] Ibid., p. 64-65.








