On peut consulter la première partie de l’entretien à cette adresse.
C : Le mal et les tentatives de théodicées
AP : Avant d’aller plus avant dans les questions de théodicée, j’ai une question d’inspiration nominaliste : nous sommes sûrs qu’il existe des douleurs physiques, des souffrances mentales, une dureté physique et morale de notre être au monde ; mais avons-nous raison d’hypostasier ces douleurs et ces souffrances en une sorte de principe ontologique, le mal, qui semble surajouter à une réalité concrète une surréalité unifiée se manifestant de manière diversifiée ? Y a-t-il un gain réel de renvoyer la réalité de la douleur et de la souffrance à un principe presque axiologique ?
DM : Cette distinction classique entre mal physique (souffrance) et mal moral (faute ou péché) est techniquement commode pour aborder la question des théodicées, mais elle ne me semble pas complètement satisfaisante, surtout, si, comme vous, on la durcit. On pressent bien en effet que les deux catégories ne sont pas sans rapport. Une partie des souffrances subies dans le monde résulte en effet des actes mauvais des hommes : les fautes commises par les uns causent la douleur des autres, et, dans une mesure qui reste à déterminer, mes propres fautes me font parfois souffrir, lorsqu’elles débouchent sur une punition qu’on m’inflige, ou bien dans les phénomènes de remords et de culpabilité, ou encore lorsqu’un comportement tenu selon certains pour moralement condamnable (par exemple l’abus délibéré et réitéré d’alcool) provoque une maladie. De façon symétrique, une partie des actes mauvais des hommes découle des souffrances qu’ils subissent : parfois, la douleur rend méchant, conduit à mal se comporter envers autrui. On pressent donc que « mal physique » et « mal moral » ne désignent pas deux classes absolument distinctes et sans aucun rapport l’une avec l’autre. Leibniz et Paul Ricœur l’ont dit chacun à sa manière, le premier en proposant la catégorie de « mal métaphysique » qui englobe selon lui toutes les sortes de maux, le second en expliquant que les deux types de maux « pointent en direction d’une énigmatique profondeur commune », un « unique mystère d’iniquité ». Donc quand vous demandez « Y a-t-il un gain réel de renvoyer la réalité de la douleur et de la souffrance à un principe presque axiologique ? », il me semble que le gain, c’est qu’on serre de plus prêt à la réalité quand on parle du mal physique d’une part, du mal moral d’autre part, en évitant de considérer que ce sont là deux catégories parfaitement insulaires, imperméables, compartimentées, dont chacune renvoie à des classes d’événements sans aucun rapport entre elles. Sur ce point, je crois que votre approche hyper-nominaliste laisse passer quelque chose d’essentiel. Je veux bien qu’on ne multiplie pas les êtres, ou les catégories, sans nécessité, mais il faut tout de même les multiplier suffisamment pour rendre compte de la réalité telle que nous la rencontrons.
AP : Venons-en alors aux coordonnées, comme on dit aujourd’hui, de la théodicée. Vous en relevez cinq qui, jointes ensemble, font problème. La théodicée, dites-vous, repose sur 5 postulats :
- Dieu existe
- Dieu est créateur de toutes choses.
- Dieu est tout-puissant.
- Dieu est bon.
- Le mal existe.
On voit ici que le problème est purement logique en ceci qu’on ne voit pas comment un Dieu créateur, omnipotent, bon, peut créer volontairement le contraire de lui-même. Mais avant d’être logique, le problème n’est-il pas d’abord subjectif au sens où, même si l’on admettait qu’il était pertinent d’introduire le mal, le premier scandale du mal serait que l’on en ait conscience ? On pourrait en effet tout à fait supposer que Dieu soit créateur, bon, omnipotent, que le mal existe mais si nous n’avions pas conscience de ce dernier, c’est-à-dire si Dieu ne nous avait pas conféré la possibilité d’interpréter consciemment la douleur et la souffrance sous l’angle du mal, il n’y aurait plus de scandale ni de réflexion à son sujet. Autrement dit, on pourrait tout à fait considérer que la conscience du mal introduit une distance vis-à-vis de certains états qui, s’ils n’étaient pas interprétés comme mauvais, paraîtraient normaux et ne nécessiteraient pas de réflexion menée à leur endroit. N’est-ce donc pas la conscience du mal conçue comme distance à l’endroit de certains états physiques et mentaux qui constitue le fondement du problème, davantage qu’un problème de compatibilité logique ? Ma question ne porte pas tout à fait sur la distinction que vous reprenez à Cavaillès entre philosophie du concept et philosophie de la conscience, mais il est possible qu’elle la croise sur certains aspects.
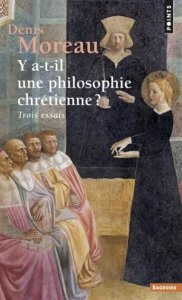
DM : Je ne suis pas certain de bien comprendre votre question. Si vous me dites qu’il n’y a de problème du mal que pour un être capable de se poser des problèmes (un être développant une pensée assez élaborée, donc), je vous l’accorde volontiers. Si vous me dites qu’il n’y a de problème du mal que pour un être qui est capable de ressentir le mal (disons, par exemple et pour autant que je le sache, pas pour les cailloux), je suis aussi d’accord. Donc, il me paraît évident que la conscience que, « du mal, il y en a », précède, chronologiquement aussi bien que logiquement, toute formalisation du « problème du mal » comme celles que proposent les théodicées. La point essentiel (et je retrouve par là Cavaillès) est de savoir quelle valeur philosophique on accorde à cette conscience immédiate que nous avons, cette expérience fondamentale que nous faisons : du mal, il y en a. Il y a des théodicées, celles que je propose d’appeler « théodicées du concept », qui expliquent que, finalement, cette conscience doit être dépassée par la réflexion, qu’elle n’a pas vraiment de valeur de vérité ou d’intérêt philosophique. C’est ainsi que je comprends Leibniz : sa réflexion sur la manière dont Dieu a agi, et donc sur la structure de notre monde, induit quelque chose comme une coupure radicale entre ce qui est appréhendé et ce qui est compris, entre d’une part ce qui est existentiellement constaté, ce que nous expérimentons, ressentons (il y a du désordre, nous souffrons), et d’autre part ce que nous démontrons, les conclusions imposées par la réflexion rationnelle (ce monde est le meilleur possible). Pour ce genre d’auteur, lorsqu’il est question du mal, ou de la bonté du monde, il convient de différencier les plans de discours (le vécu et le réfléchi), de leur attribuer à chacun une signification distincte (le subjectivement ressenti, l’objectivement connu), et de les hiérarchiser du point de vue de la vérité de leurs énonciations. La pensée ne s’objective ainsi que loin de l’expérience, et un large fossé se crée entre l’être des choses et le sens qu’elles ont pour nous. Leibniz propose ainsi une théodicée du concept : c’est un discours qui part du concept de Dieu et qui par voie déductive aboutit à la position de la thèse du meilleur des mondes possibles, sans accorder beaucoup d’importance au fait que cette thèse ne soit pas validée, ou même de notre point de vue soit contredite, par notre expérience : « il est a priori certain que » notre monde est le meilleur des mondes possibles, la raison exige qu’il en soit ainsi, etc. Et s’il semble en découler un conflit entre cette exigence de la raison et notre expérience (de la douleur, du mal), c’est l’expérience qui doit céder, c’est-à-dire que nous devons apprendre à admettre que ce que nous identifions de manière spontanée comme du désordre et du mal n’en constitue pas vraiment.
Mais vous avez d’autres théodicées, plus rares (celle de Malebranche en est un bon exemple) qui refusent cette dissolution de la conscience que nous avons du mal par les exigences de la rationalité. Malebranche édifie donc quant à lui une théodicée de la conscience. Elle prend en effet pour point de départ la conscience que nous avons du monde comme le lieu d’événements douloureux, tragiques, désordonnés et considère que la réflexion philosophique doit conserver la valeur de vérité de ce rapport immédiat au réel, c’est-à-dire qu’il faut tenir l’expérience du mal comme un fait premier et indépassable. La théodicée malebranchiste se présente alors comme une tentative héroïque pour élaborer un concept de Dieu qui permette d’expliquer ce fait. Nul doute que ce soit malaisé. Certaines difficultés théoriques, qui ont souvent été reprochées à Malebranche et qu’il n’a d’ailleurs pas cherché à nier, sont comme la contrepartie de cette confiance placée dans la valeur de notre rapport immédiat au monde, ou de cette forme de validation métaphysique de l’expérience. Mais au moins ce discours-là parle-t-il de nos vies et permet-il de conserver une signification forte à l’expérience de la douleur ou de l’injustice. Et c’est la grandeur du malebranchisme que de parvenir à faire coïncider métaphysique du mal et expérience de la souffrance en une même affirmation de l’imperfection du monde. Se résorbe ainsi la coupure entre pensée et existence, ou bien entre être et sens, entre métaphysique du mal et expérience de la douleur, qui est si frappante chez Leibniz, et chez quelques autres philosophes (Hegel, par exemple, si jamais je l’ai bien lu sur ce point).
Je remarque en vous répondant que, d’une certaine façon, on retrouve ici la question de la valeur du subjectivisme et du ressenti sur laquelle vous m’avez interrogé plus haut. Vous avez raison, c’est décidément une sorte de fil rouge dans mes textes. Je ne m’en étais jamais rendu compte jusqu’à ce que vous me le fassiez remarquer, et je ne suis pas certain d’avoir, pour le moment, théorisé cela de façon unifiée et satisfaisante. Mais manifestement, comme on dit, ça me travaille.
AP : Un point que j’ai trouvé marquant dans votre analyse des paroles d’évangile passées dans le langage quotidien tient à l’absence de dimension morale de formules que l’on relierait volontiers aux questions du bien et du mal. Lorsque vous analysez par exemple « à chaque jour suffit sa peine », vous y voyez soit un sens psychologique, soit un sens à relier à l’action de la Providence mais pas une réflexion sur la douleur même de l’être-au-monde. De la même manière, lorsque vous abordez le fameux « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » de la femme adultère, vous introduisez le contexte par un quasi dilemme logique, Jésus étant pris dans l’étau d’une réputation de bonté et d’une nécessité de respecter la Loi, le « pardon » apparaissant sous votre plume comme la solution morale d’un problème logique. Diriez-vous que l’Évangile affronte le problème de « la difficulté d’être » pour parler comme Cocteau, de la douleur de l’être-au-monde et du mal ou diriez-vous que l’Évangile contourne paradoxalement cette perspective ?
DM : Disons que j’ai essayé d’éviter une lecture trop immédiatement moralisante des Évangiles, tout comme cette évidence souvent trop vite admise qu’il y aurait quelque chose comme une « morale chrétienne ». Je m’explique un peu sur ce point, il est important à mes yeux. Si on entend par morale une liste développée d’interdictions, de règles et de recommandations systématisées à un certain degré et destinées à organiser le détail du comportement des humains (comment se vêtir, se nourrir, s’habiller, etc.), on ne trouve rien de tel dans le Nouveau Testament. La Torah des juifs (les cinq premiers livres de la Bible, que les chrétiens appellent le Pentateuque), avec les 613 commandements qu’elle contient selon la tradition, constitue, elle, une sorte de morale, de même que les prescriptions venues du Coran et des Hadiths des musulmans. Mais dans le Nouveau Testament l’idée dominante, défendue par le Christ aussi bien que par Paul, est qu’il faut se libérer du réseau vétilleux et ritualiste des 613 commandements de la « Loi » (juive) pour leur substituer un unique double commandement d’amour ainsi synthétisé par Jésus lorsqu’on lui demande ce qui est le plus important dans la Loi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit / Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu, 22, 37-40). Ainsi le christianisme, au contraire d’autres religions, n’est pas une morale, ou n’en véhicule pas. Il constitue d’abord un style d’existence, une façon de se tenir face aux principales structures — la vie, l’amour et la mort — qui définissent la condition humaine.
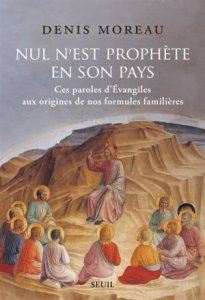
Il est vrai que le Nouveau Testament, puis la tradition chrétienne, proposent aussi des prescriptions morales stricto sensu. Mais elles ne définissent pas de morale spécifiquement chrétienne puisqu’elles n’ont rien d’original : ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, préférer la douceur à l’agressivité, se montrer bons camarades et travailleurs consciencieux, secourir les miséreux, etc. Ici, on n’a pas affaire à une morale chrétienne, parce que la morale des chrétiens est simplement la morale en général, celle des honnêtes gens. Je n’ai donc jamais éprouvé de difficultés à adopter, en théorie au moins (la mettre en pratique est une autre affaire !), la « morale chrétienne ». C’est pourquoi je me défie des discours incantatoires sur les valeurs chrétiennes : non seulement on peut préférer la classique notion de vertu à ce concept de valeur venu du monde de l’économie pour contaminer celui de l’éthique, mais encore une notable partie de ces « valeurs » dites chrétiennes ne le sont justement pas. C’est aussi pourquoi l’utilisation polémique faite par certains chrétiens de cette (trop ?) fameuse phrase de Dostoïevski « Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis » est stupide et insultante. Il suffit de fréquenter le monde pour rencontrer des « athées honnêtes hommes », d’une exigence et d’une rectitude morale remarquables. Affirmer qu’il n’y a pas de morale chrétienne, c’est donc aussi refuser les discours de type catho-apocalyptique sur le post-christianisme : si le bon Dieu n’existe pas, tout le monde va devenir très méchant. Le Nouveau Testament lui-même affirme d’ailleurs que les concepts moraux se laissent penser naturellement, sans révélation particulière de Dieu : « les païens qui n’ont pas la Loi [= les prescriptions morales du judaïsme] pratiquent spontanément ce que dit la Loi » (Lettre aux Romains, 2, 14).
Bien sûr, je force le trait. On trouve dans les Évangiles des thèses morales spécifiquement chrétiennes, par exemple tout ce que Jésus enseigne dans le« sermon sur la montagne » aux chapitres 5, 6 et 7 de l’Évangile de Matthieu. Bergson a très bien vu cela dans Les deux sources de la morale et de la religion, quand il distingue la morale « close », « statique », (celle des honnêtes gens, qui n’est évidemment pas à mépriser) et la morale « ouverte » apportée par Jésus. La morale en ce qu’elle a de spécifiquement chrétien est peut-être ce qui fait éclater les cadres quelque peu étriqués, ronronnants, raisonnables de la morale ordinaire. C’est comme cela que je comprends les « antithèses » présentées par Jésus au chapitre 5 de Matthieu : « on vous a dit [le « on » est celui de la morale close] tu ne commettras pas de meurtre, œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi / moi je vous dis [ce « moi » est celui qui dévoile la morale ouverte] ne te mets pas en colère contre ton frère, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends lui encore l’autre, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Mais comme je suis assez agacé par la façon dont une bonne partie des catholiques contemporains donnent en permanence des leçons de morale au monde entier, je n’ai pas cru utile d’en ajouter dans cette veine. Tant que nous y sommes dans les expressions évangéliques, celle qui stipule qu’il faut ôter la poutre de son oeil avant de regarder, et dénoncer, la paille dans celui du voisin pourrait peut-être calmer quelque peu ces ardeurs moralisantes de bon nombre de mes coreligionnaires…
AP : Toujours dans Nul n’est prophète en son pays, vous évoquez le fameux Vade retro, Satana de Mathieu, qui est peut-être l’un des passages les plus importants quant à la personnification de Satan qui n’est plus ni un nom commun, ni une fonction, ni le mixte d’une fonction et d’une identité comme cela semblait être encore le cas dans le livre de Job. A cet égard, un des points déroutants du christianisme tient à ceci que non seulement la Vérité est quelqu’un – le Christ – mais aussi à ceci que le mal est quelqu’un – Satan. Cela ne semble avoir pourtant eu qu’une incidence minime dans la réflexion philosophique consacrée au mal, comme si l’hypostase du mal importait davantage que son incarnation.
DM : Je vais peut-être vous surprendre et vous apparaître comme un drôle de philosophe, mais je suis assez convaincu de l’existence du diable, et ce au nom d’arguments qui me paraissent tout à fait rationnels — c’est une question que j’ai plusieurs fois rencontrée dans mes livres. Cette existence me paraît, en un sens, plus évidente que celle de Dieu. Mais il faut s’entendre sur ce concept de « diable », qui est sujet à bien des malentendus. Par diable, je n’entends pas une sale bête cornue ou un barbichu armé d’une fourche et ridicule dans son pantalon moulant rouge. Et je ne crois pas que les productions diaboliques soient celles, pittoresques, auxquelles ont habitué les films d’exorcisme et de possession : corps démantibulés, yeux révulsés, vociférations, grognements et comportements bestiaux, etc. Ces images sont au mieux naïves et plus probablement grotesques, de sorte que si, comme l’affirmait Baudelaire, la suprême ruse du diable est d’avoir persuadé les hommes de son inexistence, de telles représentations ont puissamment contribué à la réussite de ce plan. En tout cas, qu’il soit clair que je n’ai jamais été confronté à de tels phénomènes.
Par diable, j’entends, conformément à l’étymologie (le diabolos : le diviseur, ce qui désunit), une puissance qui apporte la division, désagrège, défait, là où devraient régner l’unité, l’union, la concorde, une force qui saccage, lacère et déchiquette les belles et bonnes choses présentes dans nos vies, l’amour, la joie, la démocratie, la justice, la paix. Or c’est une évidence objective, phénoménologique, qu’une telle puissance de dislocation, un diviseur, est à l’œuvre dans le monde. Il suffit d’ouvrir le journal ou de se regarder vivre pour s’en convaincre : conflits intérieurs, tensions et déchirements, disputes familiales et professionnelles, séparations amoureuses et épidémie de divorces, bagarres, massacres, vaines chicanes et coups bas politiques et diplomatiques à n’en plus finir, guerres civiles, guerres tout court.
Pour expliquer ces divisions, on peut se contenter d’une hypothèse semblable à celle de Spinoza en Éthique III et IV : le jeu naturel des affects conduit à des passions tristes et des situations malheureuses. Mais la catastrophe est si systématique, violente, permanente qu’on peut se demander si le hasard et la nécessité seuls suffisent à en rendre compte. Il n’est donc pas absurde d’estimer que, pour comprendre le monde comme il (ne) va (pas), il faut d’une façon ou d’une autre faire une place à celui qui fut longtemps désigné comme « le prince de ce monde », une puissance mauvaise et défaisante qui se diffracte dans nos vies de façon cohérente et organisée. Ainsi, en un sens, l’existence d’une force de ce type — l’Adversaire — est plus crédible et attestée que celle du bon Dieu. Après, la question est bien sûr de savoir si le diable ainsi décrit est juste une sorte de symbole ou de personnification de toutes ces forces de destruction, ou si c’est effectivement quelqu’un, et quelqu’un d’assez rusé, qui pousse à toutes ces catastrophes. On ne peut pas, bien sûr, démontrer catégoriquement la validité de cette seconde hypothèse, mais il me paraît loin d’être absurde de s’y intéresser. Et on peut effectivement regretter que les philosophes ne l’aient pas explorée, pour la laisser aux seuls théologiens (qui n’en ont pas toujours fait le meilleur usage !) ou littérateurs (Bernanos est ce que je connais de mieux sur le sujet).
AP : Revenons peut-être à la philosophie. Dans les Méditations Métaphysiques qui contiennent nombre d’arguments que reprendra Leibniz pour rendre compte du mal, Descartes ne définit jamais Dieu à partir de la bonté, allant jusqu’à faire de l’attribution de la bonté un vague on-dit dans la Première Méditation, qu’il s’agit de révoquer en doute. Seule la Sixième Méditation, qui ne cherche plus à définir conceptuellement Dieu, attribue à deux reprises la bonté à ce dernier. J’ai modestement tenté de montrer il y a quelques années que la logique de la non-tromperie divine n’impliquait aucunement la bonté divine mais son absence de malice, absence de malice compatible avec une certaine indifférence de Dieu à l’endroit de la situation humaine. Et, parallèlement à cela, j’ai essayé de montrer que dans la logique même du cartésianisme, les catégories de bien et de mal n’étaient pas pertinentes pour penser Dieu et la création.
Si j’évoque cette hypothèse, cela tient au fait que l’indifférence de Dieu à l’endroit de la condition humaine est une des possibilités logiques que vous mentionnez au début de votre analyse, et je me demandais si vous accepteriez, d’une part, de faire de Descartes un représentant de cette position et si, d’autre part, vous considériez que les notions de bien et de mal sont des catégories signifiantes de la pensée cartésienne ou si ce sont des éléments que Descartes juge non pertinents pour penser Dieu et sa création.
DM : Si je reviens au tout début de votre question, je ne suis pas sûr de lire comme vous l’affirmation cartésienne « Dieu n’est pas trompeur ». On en donne souvent, et j’ai le sentiment que c’est votre lecture lorsque vous évoquez le thème de la « malice », une interprétation moralisante : Dieu est parfait, mentir c’est mal, donc Dieu ne ment pas. Cela me paraît un argument assez faible. Quand Descartes écrit « Dieu n’est pas trompeur », j’ai plutôt le sentiment qu’il veut dire quelque chose comme « le Réel est épistémologiquement bien constitué », c’est-à-dire que, lorsque je conduis ma pensée au plus haut point de qualité dont elle est capable (clarté et distinction), cette pensée rend bien compte de la réalité. Là encore, j’ai, je crois, une lecture de Descartes assez proche de ce que dit Spinoza.
AP : Je vous rejoins sur ce point mais je voulais simplement dire qu’il était intrigant de noter l’absence totale d’attribution de la bonté à Dieu avant la Sixième Méditation, en dépit des multiples propriétés qu’en décline Descartes ; autrement dit, la non-tromperie ne s’appuie aucunement sur la bonté et, à ce titre, je rejoins votre manière de ne justement pas moraliser l’approche divine telle que la propose Descartes.
DM : Pour la deuxième partie de votre question, je ne crois pas du tout qu’on puisse faire de Descartes un défenseur de l’idée que Dieu est indifférent à la situation humaine. A cela au moins une raison : il a toujours hautement professé son adhésion à un catholicisme orthodoxe, et cette thèse ne l’est pas du tout, catholiquement orthodoxe ! Ce qu’il dit de la Providence, par exemple dans la correspondance avec Élisabeth ou via le thème de la « préordination » qui revient plusieurs fois sous sa plume, va mal aussi avec l’idée d’un Dieu indifférent. Le Dieu de Descartes est, de façon assez classique, un Dieu « provident » : Jean Laporte l’a bien montré dans le paragraphe « Providence et finalité » de son livre Le Rationalisme de Descartes, auquel je me permets de renvoyer ici parce que je n’ai rien à y ajouter. Et Descartes parle bien de Dieu comme « source de toute bonté et vérité » (par exemple Principes I, §22 ou Sixièmes Réponses, point 8).
En revanche, il est vrai que de prime abord, Descartes traite peu de ce thème de la sollicitude divine en philosophie. Peut-être considère-t-il que c’est avant tout en théologie (révélée) qu’on l’aborde et l’on sait qu’il est réticent à se lancer dans se domaine. Mais une thèse philosophique comme celle dite de la « création continuée » peut tout à fait recevoir une interprétation théologique en termes de sollicitude divine : elle dit que Dieu, dont nous savons, même si nous ne les connaissons pas, qu’il a des « fins », intervient à chaque instant pour me maintenir dans l’être. D’un point de vue chrétien, cette thèse philosophique peut tout à fait donner lieu à quelque chose comme une action de grâce : merci mon Dieu de me maintenir dans l’être. Dans cette optique, un certain nombre de thèses cardinales du cartésianisme me semblent susceptibles d’être « théologisées » ou, plus exactement, « spiritualisées » en ce sens qu’on peut (mais ce n’est bien entendu pas une nécessité, c’est quelque chose comme une strate de signification qu’un croyant peut surajouter aux thèses cartésiennes) les prolonger en considérations qui nourrissent une spiritualité chrétienne. Malebranche, par exemple, s’y essaiera, en articulant des « considérations » (philosophiques et d’inspiration cartésienne) à des « élévations » spirituelles, dans un court texte peu connu mais qui mérite l’intérêt : le Méditations pour se disposer à l’humilité et à la pénitence. J’aimerais bien écrire un jour quelque chose sur cette possible « spiritualité cartésienne ». Cela me semble un angle d’attaque plus intéressant que la question, rebattue et en définitive assez stérile : Descartes a-t-il écrit une théologie, une théologie cartésienne est-elle possible ?
Concernant le bien et le mal comme catégories morales, il est indiscutable que Descartes n’en parle pas beaucoup. Peut-être, là encore, laisse-t-il cela à la théologie. Ou peut-être cela renvoie-t-il au fait qu’il n’a sans doute pas écrit la « plus haute et plus parfaire morale » qui devait couronner son arbre de la philosophie. J’entends bien ce que vous dites, je m’interroge effectivement sur les raisons de ce silence que vous pointez, mais j’ai de la peine à me figurer Descartes indifférent à la question du bien et du mal.
AP : Pour ma part, j’aurais tendance à penser que Descartes n’accorde aucune réalité, aucun poids ontologique, au bien et au mal qui me semblent être pour lui une manière humaine, trop humaine, de se représenter ce qui advient. Mais peu importe, ici, ma lecture de Descartes.
Un aspect magistral de votre ouvrage tient à la présentation que vous proposez du combat titanesque en matière de théodicée entre Leibniz et Malebranche, votre faveur allant à ce dernier. Vous montrez admirablement comment Malebranche, dans le Traité de la nature et de la grâce et dans les Entretiens sur la métaphysique et la religion essaie de montrer que notre monde n’est ni le plus parfait possible, ni créé par les voies les plus parfaites possibles ; il est bien plutôt le meilleur compromis, le monde qui correspond au couple « ouvrages / voies » qui offre la perfection maximale. Cela implique le fait que Malebranche assume la pleine réalité du mal et du désordre dans le monde. Par ailleurs, vous rappelez que Malebranche insiste sur la défiguration du monde, tout en forgeant un concept, celui d’être ou d’événements « pires que le néant ». Un monde qui les comprend est moins bon qu’un monde où ils n’apparaîtraient pas. Je vous cite :
« Malebranche refuse ainsi que le mal physique soit placé hors de la sphère de l’être, comme cela a souvent été le cas : définir le mal comme pire que le néant et insister sur sa puissance de défiguration, c’est dire qu’il est quelque chose et non pas une privation, une absence ou un néant d’être, et c’est tenter de penser sa « négativité positive » en faisant apparaître le poids de sa présence dans le monde. »[1]
Mais une telle thèse amène à penser que la sagesse s’oppose à la perfection autant qu’à la toute-puissance. Une telle thèse vous semble-t-elle compatible avec une visée chrétienne ? N’a-t-on pas là un pas de côté d’un philosophe qui, quoiqu’oratorien, semble faire primer la réalité de la conscience du mal sur la pertinence de la réponse traditionnellement apportée ?
DM : Oui, Malebranche tel que je le comprends « fait primer la réalité de la conscience du mal sur la pertinence de la réponse traditionnellement apportée », au moins par la tradition augustino-thomiste. Après, je vois mal en quoi donner du prix au témoignage de la conscience serait fondamentalement incompatible avec une visée chrétienne. Et Malebranche, que je sache, ne se proclame ni athée ni déiste. Le point sur lequel il est peut-être à la limite de l’orthodoxie chrétienne, c’est lorsqu’il écrit, en une affirmation théologiquement stupéfiante : « Sa sagesse rend Dieu impuissant. » (Traité de la nature et de la grâce, I, §38 additions ; à la fin de sa vie, Malebranche a nuancé cette affirmation en « sa sagesse rend Dieu pour ainsi dire impuissant »). Si l’on se souvient que la première phrase des grandes professions de foi (les « Credo » ou les « Symboles ») qui ont fixé la foi chrétienne dans les premiers siècles (par ex. Credo de Nicée-Constantinople, IVe siècle) proclame sans ambiguïté une foi en « Dieu le Père tout-puissant », cette affirmation explicite d’une impuissance divine semble de fait problématique du point de vue de l’orthodoxie chrétienne. Mais cette question est peut-être plus complexe qu’elle paraît de prime abord : les textes des grands Symboles font une obligation au chrétien de professer sa foi en la « toute-puissance » de Dieu, mais il ne fournissent ni définition ni concept de cette toute-puissance, qui restent donc à déterminer. On remarquera qu’un penseur aussi peu suspect d’hétérodoxie doctrinale catholique que saint Thomas d’Aquin affirmait lui aussi qu’il y a des choses que Dieu ne peut pas faire : par exemple un cercle carré, et plus généralement tout ce qui est contradictoire (voir Commentaire sur les Sentences, I, 42-44 ; Somme contre les gentils, II, 25). En un sens, Malebranche ne fait qu’aller un peu plus loin que saint Thomas dans cette direction d’une limitation de la puissance divine par les exigences de la sagesse. Ce qu’il indique me semble digne d’être considéré : si on souhaite mener une réflexion philosophique sur les rapports entre un Dieu d’allure chrétienne et le mal dont l’existence est constatée dans le monde, il est difficile de faire l’économie d’un examen critique du concept classique de toute-puissance divine, entendue comme « capacité-d’organisation-intégrale-du-moindre-détail-de-l’univers » ; et il faut concevoir la relation de Dieu au monde sur un autre mode que celui du (potentiellement) tout-intervenant. Ces réflexions malebranchistes sur l’impuissance divine anticipent de façon saisissante un thème développé par Hans Jonas (1903-1993) dans son célèbre texte sur Le Concept de Dieu après Auschwitz : « Après Auschwitz, nous pouvons affirmer, plus résolument que jamais auparavant, qu’une divinité toute-puissante, ou bien ne serait pas toute-bonne, ou bien resterait entièrement incompréhensible (dans son gouvernement du monde, qui seul nous permet de la saisir). Mais si Dieu, d’une certaine manière et à un certain degré, doit être intelligible, […] alors il faut que sa bonté soit compatible avec l’existence du mal, et il n’en va de la sorte que s’il n’est pas tout-puissant. C’est alors seulement que nous pouvons maintenir qu’il est compréhensible et bon, malgré le mal qu’il y a dans le monde. Et comme de toute façon nous trouvons douteux en soi le concept de toute-puissance, c’est bien cet attribut-là qui doit céder la place ».
AP : J’aimerais vous faire part d’une impression que j’ai eue en découvrant la théodicée de Malebranche pour la première fois. Ce dernier assume la réalité du mal, limite la toute-puissance divine et fait de la sagesse l’instrument d’une sorte de rapport de forces entre l’ordre et le désordre, dont on ne peut pas bien déterminer lequel l’emportera. D’ailleurs, le rôle dévolu à la praxis humaine corrigeant l’œuvre divine procède de cette ambiguïté. Mais un tel schéma me semble très proche, en tout cas dans ses grands traits, de textes égyptiens antiques : loin du cosmos grec où l’ordre prime, l’univers égyptien est bien plus précaire et se fait volontiers théâtre de la lutte entre Maât (l’ordre) et Isfet (le désordre) ; pis encore, la présence du désordre est telle dans la réalité du monde qu’il convient de vaincre chaque soir le serpent Apophis sous peine de quoi le soleil ne réapparaîtrait pas ; seules la ruse et la puissance d’Isis permettent à la barque de Rê d’avoir jusqu’à présent vaincu, mais rien ne garantit qu’il en aille ainsi pour l’avenir. Je veux dire par là qu’il y a dans cette vision du monde une manière d’assumer la réalité du désordre que, quotidiennement, il faut vaincre, ce qui témoigne de la précarité ahurissante du monde dans lequel nous vivons mais aussi de l’impuissance de certains dieux à garantir la marche même du monde. Je ne dis naturellement pas que Malebranche s’est inspiré de la mythologie égyptienne, mais je suis frappé par la correspondance de ce que l’on pourrait appeler ce « sentiment du monde » entre la mythologie égyptienne et cet aspect de la pensée de Malebranche que vous qualifiez d’ailleurs de « tentative héroïque »[2]
DM : Là, c’est encore pire que pour Hegel tout à l’heure : je ne connais absolument rien à la pensée de l’Égypte antique ! Ce que vous dites de Malebranche me paraît juste, mais je vous laisse la responsabilité de ce surprenant rapprochement. Sur le fond, j’ai tendance à concevoir l’histoire de la pensée philosophique (au sens large) comme la répétition, dans des contextes intellectuels et culturels différents, de thèses analogues voire identiques. Si ce que vous dites est exact, on en aurait là un bon exemple. Et, si je suis incapable d’en évaluer la pertinence, l’idée que Malebranche soit « l’égyptien du Grand Siècle » ne me choque pas. Vous devriez écrire un article sur le sujet, c’est un point qui, à ma connaissance, n’a pas encore été abordé par les études malebranchistes….
Conclusion : le problème de la philosophie chrétienne
AP : Je songerai à votre proposition d’article !
Vous abordez dans le dernier chapitre une question classique, peut-être surdéterminée par certains textes de Heidegger ou de Gilson, portant sur l’existence ou non d’une philosophie chrétienne. A cet effet, vous montrez d’une part que le christianisme a choisi de se réfléchir dans des catégories philosophiques, et d’autre part que la question est peut-être mal posée en ce sens que le vrai problème n’est pas de savoir si une philosophie est chrétienne mais si elle est vraie. Et vous ajoutez que, pour un chrétien, si c’est vrai alors c’est chrétien. Mais, j’aimerais justement vous demander ce que signifie « vrai » pour un chrétien, car il me semble que l’envoi johannique de l’identification de la Vérité au Christ rend problématique la portée conceptuelle de la vérité : lorsque vous dites que si c’est vrai, alors c’est chrétien, faut-il entendre par « vrai » la présence de la personne du Christ ? Et si tel n’est pas le cas, alors en quel sens cette vérité serait-elle encore vraie pour un chrétien ?
DM : Pour le christianisme, le Christ, comme Dieu, c’est le Verbe, le Logos dont parle le premier verset de l’Évangile de Jean, qu’on pourrait traduire, ainsi que l’ont proposé saint Augustin et Malebranche : « Au commencement était la Raison ». C’est tout de même une thèse assez extraordinaire, surtout quand on s’intéresse à la philosophie et c’est vraiment une idée très forte — qu’on ne trouve pas, à ma connaissance dans d’autres univers religieux : le monde est principiellement rationnel. Donc, oui, si la personne du Christ c’est la Raison de Dieu, la vérité même n’est autre que le Christ. Et du point de vue chrétien, les enseignements de Jésus, Verbe incarné, n’ont pas autre but que de montrer cette vérité. On perd un peu de vue cela, parce que les Évangiles ne sont pas, à première lecture au moins, un traité de philosophie. Et il n’est pas fréquent que, dans la bouche de ce Jésus qui préférait les historiettes et les paraboles à la sèche rigueur du concept, on trouve une thèse à fort potentiel spéculatif (mais il y en a quelques unes, comme le « la vérité vous rendra libres » de Jean 8, 32). Mais saint Augustin, avec le thème du maître intérieur, ou Malebranche, avec la théorie dite de la « vision en Dieu » des idées et vérités, attirent notre attention sur ce point : selon eux, quand nous sommes dans le vrai, que nous atteignons la vérité, c’est la personne du Christ que nous rencontrons, même si nous ne nous en rendons pas compte. C’est pourquoi, d’un point de vue chrétien, il n’y a pas de plus belle activité que la recherche de la vérité. Et c’est un peu pourquoi j’en ai fait mon métier !
AP : Oui, mais de manière plus générale, on a souvent distingué le Dieu des philosophes du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le Dieu des philosophes semble incapable de saisir ce Dieu de la révélation et sans doute plus encore le Christ comme vérité. Mais dans ce cas, en revenant presque au point de départ de notre entretien, que peut apporter en matière de vérité, dans une perspective chrétienne, la démarche même de la Philosophie ?
DM : Concernant l’impossibilité d’une saisie du Christ comme vérité, je viens de vous expliquer pourquoi je ne suis pas d’accord avec vous. Concernant l’opposition (que vous présentez dans les termes de Pascal, qui n’était peut-être pas le plus grand ami de la philosophie qui se puisse concevoir) entre le « Dieu des philosophes » et « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », je la vois plutôt comme une articulation de deux points de vue différents et complémentaires sur Dieu. J’ai essayé, dans mes livres, de dédramatiser cette opposition prétendue, je n’aime pas beaucoup les conflits, à mes yeux artificiels et dénués de fondement, qu’on organise souvent entre foi et raison, ou révélation et philosophie. Je trouve que sur ce point Pascal, par exemple, exagère et fait fausse route, en suscitant du conflit, du polémos, là où il n’y a pas lieu d’en mettre. Je préfère de beaucoup la sereine conception des rapports entre foi et raison qu’on trouve chez Descartes, et qu’il a synthétisée dans un beau texte des Notae in programma quoddam
« … il y a trois genres de questions qu’il faut distinguer. Certaines choses en effet ne sont crues que par la foi, comme le sont le mystère de l’Incarnation, la Trinité, et d’autres semblables. D’autres, bien qu’elles regardent la foi, peuvent pourtant être recherchées par la raison naturelle ; parmi elles, les théologiens orthodoxes ont coutume de recenser l’existence de Dieu, et la distinction entre l’âme humaine et le corps. Et enfin d’autres ne concernent en aucune façon la foi, mais seulement le raisonnement humain, comme la quadrature du cercle, la façon de fabriquer de l’or [c’est-à-dire une question de géométrie, et une autre de chimie], et d’autres semblables. Mais ils abusent des paroles de la Sainte Écriture, ceux qui, en les expliquant mal, pensent en tirer des [énoncés] de la troisième catégorie ; et de même, ils portent aussi atteinte à l’autorité de l’Écriture ceux qui s’efforcent de démontrer des énoncés de la première catégorie par des arguments tirés de la seule philosophie ; néanmoins tous les théologiens soutiennent qu’il faut montrer que ces énoncés mêmes ne sont pas contraires à la lumière naturelle, et c’est en cela qu’ils font principalement consister leur travail » (AT VIII, 353, je traduis le latin).
La raison permet d’établir un savoir philosophique sur certains aspects de Dieu (existence, infinité, etc.). La révélation en apporte d’autres, que la raison seule a du mal à, ou ne peut, en cette vie, saisir (puissance de pardon toujours offert, « amour »). Et certains traits de Dieu apportés par la révélation peuvent, aussi, être déterminés par la raison (éternité, bonté peut-être. Il n’y a vraiment pas de quoi en faire un drame : le discours philosophique sur Dieu est pleinement légitime en son ordre et, pour ceux qui ont la foi, foi et raison se complètent, et coopèrent, dans la construction de ce que nous disons de Dieu. Après, avec Malebranche, je tiens fermement que « l’évidence, l’intelligence est préférable à la foi » (Traité de morale, I, 2, §11). La foi est une connaissance imparfaite des choses divines, il en va ainsi en cette vie, mais dans l’autre vie promise aux chrétiens, la foi disparaîtra, nous verrons Dieu tel qu’il est par une connaissance beaucoup plus accomplie, que j’identifie à une forme supérieure de connaissance rationnelle. Et il n’y a pas que Malebranche ou moi pour dire des choses pareilles, c’est aussi dans saint Paul : « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face » (Première lettre aux Corinthiens, 13, 12). Là aussi, je suis parfaitement d’accord avec Malebranche : « la foi passera, mais l’intelligence subsistera éternellement » (loc. cit.) . En d’autres termes, le paradis tel que je me le figure, la « vision béatifique » que la foi promet, c’est une sorte d’orgie de philosophie. Et quand nous connaissons certains aspects de Dieu par la raison, j’y vois un emparadisement, ou encore ce que le latin goûteux des scolastiques désignait comme une inchoatio vitæ aeternæ ou beatitudinis ou gloriæ, un commencement de vie éternelle, ou de béatitude, ou de gloire. C’est aussi ce que dit, de façon certes un peu inattendue, la fin de la Troisième méditation de Descartes, et c’est aussi ce que je lis, depuis mon spinozisme quelque peu hétérodoxe, dans la Cinquième partie de l’Ethique
AP : Pour finir sur une note plus légère, j’ai lu dans un de vos entretiens que Dieu appréciait Palestrina, Bach, mais aussi les Wampas, Iggy Pop, ou les Ramones mais nettement moins Wagner, Michel Sardou Joe Dassin ou Laddy Gaga[3]. Puis-je vous demander quels sont les critères musicaux de Dieu ?
DM : Oui, bien sûr, c’est très simple : le bon Dieu a bon goût ! Comme moi …
[1] Y a-t-il une philosophie chrétienne ?, op. cit.}, p. 141.
[2] Ibid., p. 164.
[3] L’entretien est consultable ici : https://au-cabaret-du-bon-dieu.blogs.la-croix.com/denis-moreau-philo-rockn-roll-et-bonne-musique/2012/07/26/]








