Entretien avec Dominique Pradelle : Autour de Intuitions et idéalités (partie 1)
C. INTUITION ET REMPLISSEMENT
AP : Votre ouvrage déploie à mon sens une structure très intéressante, voire surprenante. Si en effet son point de départ consiste dans l’interrogation sur la possibilité d’une intuition des objets mathématiques, et plus particulièrement des objets mathématiques formels, le concept clef de sa conclusion n’est pas celui d’intuition mais celui de remplissement. Il me semble qu’il y a une tension au sein de votre ouvrage entre ces deux concepts, puisque si l’un se substitue à l’autre il ne s’agit pas pour autant d’abandonner le premier concept. En quel sens le concept de remplissement permet donc d’approfondir la question de l’intuition et de répondre par là-même à la question initiale de votre ouvrage?
DP : Mais justement si : il s’agit bien de passer du concept d’intuition catégoriale, c’est-à-dire de l’idée d’une donation en personne incarnée de l’objet lui-même, à celui de remplissement catégorial, par lequel il faut à mon avis le remplacer. Lors d’un colloque, je discutais de ce point dans un couloir avec Hourya Benis Sinaceur qui a eu cette formule heureuse : « remplissement catégorial, oui, je suis d’accord, mais intuition catégoriale, non » ! Pourquoi cela ? Toutes les analyses de l’ouvrage vont dans ce sens, et se situent évidemment dans le sillage de la pensée de Desanti et Caveing. Aux yeux de Husserl, l’intuition est supposée réaliser ou remplir la visée, et donner l’objet qui au départ était seulement visé à vide, tel qu’il était visé. L’intuition fait ainsi en principe passer du niveau du sens à celui de la dénotation mathématique : en elle, l’objet serait présent. C’est la double idée d’une telle présence immédiate de l’objet mathématique à la pensée, et, corrélativement, d’objets mathématiques qui se situeraient au-delà du plan de la signification, que j’ai voulu mettre en question.
Tout d’abord, en mathématiques et en logique la notion d’objet ne correspond plus au corrélat de la perception, mais de la validation : ce qui est objet, c’est le corrélat d’une procédure de validation, et il faut donc analyser ce que sont les procédures de validation si l’on veut élucider le sens de la notion d’objet mathématique. Or de telles procédures n’ont pas le même sens aux différentes strates de la logique traditionnelle (c’est-à-dire de la logique et de la mathématique) ; ainsi, à chaque niveau, je me suis posé la question de savoir ce que pouvait signifier la notion de remplissement, entendue comme un intitulé formel désignant une pluralité de modes de validation. Au niveau de la morphologie pure des significations, les modes de validation, ce sont l’élucidation des catégories et des formes syntaxiques de la signification, celle des lois d’enchaînement des significations, et les modes du raisonnement métamathématique. Au niveau de la logique de la conséquence, il s’agit de l’élucidation des principes de la logique, du passage des théories aux formes de théorie (axiomatisation), et des preuves métamathématiques de validité de ces formes de théorie – qui se heurtent aux résultats métamathématiques de Gödel et conduisent à la démonstration par Gentzen de la consistance de l’arithmétique élémentaire. Au niveau de la logique de la vérité, il s’agit de la conversion des principes de validité et d’implication analytiques en formes noétiques inférentielles, des procédures démonstratives et de la théorie des modèles (c’est-à-dire du passage des systèmes axiomatiques à leur interprétation, qui leur assigne un certain champ d’objets).
Ce bref parcours suffit à montrer une chose : substituer la notion de remplissement catégorial à celle d’intuition est tout sauf un pur et simple changement terminologique ou une querelle de mots, mais engage les choses mêmes. De la même façon qu’il existe une multiplicité de modes de donation des choses (donation temporelle, donation spatiale unilatérale, donation de la chose matérielle, etc.), de même il y a une pluralité de modes de remplissement des objets catégoriaux, relatifs aux différents niveaux auxquels on pose la question. Ces modes de remplissement sont toujours discursifs, médiats, d’une certaine technicité théorétique, et jamais achevés. Suivant une intuition de Paul Bernays selon laquelle l’axiomatisation d’une théorie peut être faite dans différentes perspectives, j’ai été conduit à l’idée que loin que le mode de remplissement soit unique ou univoque, il admet une pluralité de voies et de perspectives ; le chapitre final tente d’ailleurs de décrire plusieurs modalités du remplissement catégorial, ainsi que sa structure holiste et en abîme.

AP : Vous soutenez que Husserl ne fait que supposer dans la Sixième Recherche Logique la possibilité d’une intuition catégoriale, c’est-à-dire d’une intuition purement formelle sans pour autant penser jusqu’au bout sa possibilité. Est-ce qu’il s’agit pour vous, à travers votre concept de remplissement, de mettre à jour ce qui n’est qu’à l’état latent au sein de la phénoménologie de la Husserl, en lui “emboîtant le pas”[1], ou s’agit-il bien plutôt d’une mise à jour d’une limite inhérente à la phénoménologie husserlienne? Il me semble en effet que Husserl décrit assez clairement ce qu’est une intuition catégoriale au sein de la Sixième Recherche Logique, notamment aux § 40-41, mais que tout simplement cette description n’est pas apte à saisir la spécificité d’une intuition purement formelle, puisqu’elle est nécessairement fondée (fundiert) sur une intuition sensible, c’est-à-dire perceptive.
DP : Ah non ! Précisément, Husserl ne décrit pas l’intuition catégoriale aux §§ 40 et suivants de la Sixième Recherche ! Il démontre seulement par le raisonnement la nécessité de son existence, par un double raisonnement qui est analogique et méréologique. Rappelons le chemin qu’il suit : il pose la question de savoir si la visée de tous les éléments de signification d’une proposition est susceptible d’un remplissement. Or, parmi ces éléments, on trouve des matériaux (sémantiques : papier, blanc) et des formes (syntaxiques : est, et, ou, etc.) ; la visée des formes syntaxiques est-elle susceptible de remplissement au même titre que l’est la visée des matériaux ? Exemple : je vois du papier blanc, je constate que ce papier est blanc et je dis « je vois du papier blanc », c’est-à-dire « je vois du papier qui est blanc ». La visée des moments sémantiques se remplit par l’intuition d’essence matériale, sur fond de perception sensible : papier, blanc. Mais quant à la visée du est, qu’en est-il ? Vu qu’il s’agit d’une pure forme syntaxique, le remplissement ne peut avoir lieu ni par la perception sensible, ni par l’intuition eidétique d’un contenu général. Cependant, Husserl met en œuvre un raisonnement méréologique : quand j’énonce la proposition « ce papier est blanc » en constatant que le papier qui est sous mes yeux est effectivement blanc, la visée propositionnelle se remplit et devient intuition de l’état de choses ou du fait « que ce papier est blanc » ; or l’intuition du tout enveloppe celle de ses parties ; donc l’intuition globale de l’état de choses implique les intuitions partielles de ses différents moments, y compris du moment syntaxique est. D’où la thèse analogique : il doit par conséquent y avoir une forme d’intuition qui, au regard du moment syntaxique du est, rende les mêmes services que l’intuition eidétique matériale vis-à-vis moments sémantiques de la proposition ; thèse qui établit uniquement la nécessité d’une existence, sans décrire aucunement les modalités d’une telle intuition catégoriale. Or, rappelons qu’en phénoménologie on n’est pas censé procéder de façon démonstrative et établir des résultats par le raisonnement, mais seulement décrire ! Aussi cette preuve d’existence de l’intuition catégoriale laisse-t-elle ouverte la tâche de décrire, sur fond de réflexion transcendantale, les modalités noétiques d’effectuation d’un tel acte : comment cet acte a-t-il lieu ? Vers quel terme téléologique tend-il ? Possède-t-il des structures noétiques générales ?
Aussi la fin essentielle de mon travail est-elle de dépasser cette limitation afin de caractériser positivement les modes possibles de l’intuition catégoriale, et je pense y être parvenu aux différents niveaux de la pars construens de l’ouvrage : dans les chapitres centraux, qui traitent du sens possible et des modalités du remplissement dans les trois strates de la logique traditionnelle retracées par Husserl ; dans le chapitre sur l’infini actuel, où j’essaie d’arracher le remplissement des infinis actuels à tout acte effectuable ainsi qu’à toute procédure constructive ; et surtout dans le chapitre final, où je tâche de dégager certaines structures eidétiques du remplissement catégorial.
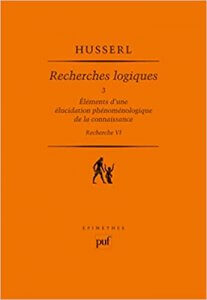
AP : Pourquoi avoir choisi pour votre concept de remplissement l’équivalent allemand d’Erfüllung et pas celui de Fülle? Est-ce que le concept de Fülle n’est pas plus apte à saisir ce caractère d’intuitivité graduelle et téléologique qui est essentiel pour votre concept de remplissement? Je me réfère notammennt à la description de ce concept que l’on retrouve au § 21 de la Sixième Recherche Logique.
DP : Précisément le terme de Fülle, plénitude, caractérise en propre l’intuition donatrice de son objet : cette intuition est plénière pour la raison qu’elle est censée donner en personne l’objet visé, et tel qu’il est visé ; il s’agit du concept thomiste de la vérité comme adéquation, mais repensé phénoménologiquement comme adéquation entre sens visé et objet donné, ou (sur le plan des actes) entre visée du sens et donnée de l’objet. Or, en substituant à la notion d’intuition catégoriale celle de remplissement catégorial, mon intention centrale était de mettre en doute qu’il y eût, au-delà de la compréhension du sens mathématique, quelque intuition formelle qui fût réellement donatrice des objets catégoriaux correspondants. À l’idée d’une donation de l’objet correspondant à la signification catégoriale, je substitue celle d’un remplissement qui demeure dans le domaine de la signification sans le transcender vers celui des objets, qui consiste en procédures médiates et non en une ostension immédiate (un rapport immédiat à l’objet, dirait Kant) et qui enfin demeure transitif et inachevé, parce que débouchant sur d’autres actes de thématisation. Il n’y a pas de Fülle de la conscience mathématicienne, mais il n’existe que des processus de remplissement relatifs : validation démonstrative d’un résultat, position motivée d’axiomes, explicitation d’un concept structurel commun à divers domaines (comme celui de continuité), etc. J’insiste : il s’agit d’un processus qui admet plusieurs voies possibles, et non d’un terme absolu auquel on s’arrêterait ; et c’est bien cette pluralité qualitative de modes de remplissement possibles qui met en défaut le paradigme de la présence perceptive et montre qu’il n’y a là nulle métaphysique de la présence.
D. NOMBRE, ECRITURE
AP : Le nombre est au sein de votre analyse un exemple paradigmatique d’objet mathématique formel. Un objet mathématique formel par définition ne peut pas nous être donné en tant que tel dans une intuition immédiate. Or, n’avons-nous pas tous une certaine compréhension intuitive immédiate de ce qu’est un nombre, du moins ce qu’on appelle en langage mathématique un nombre naturel?
DP : Permettez-moi de vous répondre par analogie. Maurice Caveing me racontait un jour que Maurice de Gandillac lui avait dit : la visée des idéalités géométriques a évidemment une origine perceptive ; regardez donc la lune, elle est ronde, cela nous donne l’idée du cercle ! Gandillac ne faisait que reprendre la thèse husserlienne de l’origine des idéalités géométriques depuis les idéalités morphologiques du champ perceptif : la droite viendrait de la forme vague du droit, le cercle de la forme vague du rond, l’ellipse de la forme vague de l’ovale, le plan de la forme vague du plat, etc., par un procès d’idéalisation qui, des formes perceptives anexactes, fait passer aux idéalités exactes. Cela engage le rapport de la mathématique à son dehors : en vertu du principe holiste selon lequel l’« intentionnalité n’est rien qui soit isolé », on peut certes replacer l’intentionnalité mathématicienne au sein des autres formes de l’intentionnalité – intentionnalité perceptive, pratique, culturelle, etc. Cela a une légitimité, mais elle est limitée : car dès que l’on entre dans la caractérisation mathématique de ce qu’est une droite, un triangle, un cercle, on se trouve d’emblée transporté dans le champ thématique des figures du plan euclidien (ou non), et l’on cesse alors de se rapporter à la précompréhension inframathématique que l’on avait des formes perceptives ; on se situe désormais dans un champ opératoire rigoureux.
Or, pour les nombres, c’est la même chose ! Évidemment que nous avons une précompréhension perceptive de ce qu’est une pluralité, que dans la pratique du commerce ou de l’arpentage l’homme a mis au point des pratiques du calcul, etc. Mais tout cela (champ perceptif, pratiques culturelles) ne forme que le soubassement qui a motivé l’émergence de la théorisation mathématique, comme une sorte de terreau favorable. Dès qu’en revanche on entre dans la thématisation proprement arithmétique du nombre entier, la pensée doit se dépouiller de la référence à la temporalité ou à la spatialité (conditions seulement psychologiques de l’appréhension de pluralité) pour ressaisir rigoureusement ce qui entre dans le contenu conceptuel du nombre cardinal ; on rencontre ainsi la critique que Couturat avait adressée à Kant, d’avoir de manière fallacieuse intégré au concept de nombre les conditions psychologiques (temporelles) de l’appréhension du nombre. Quelles sont alors les opérations les plus élémentaires et le matériau de pensée minimal qu’il faut présupposer pour en dériver l’idée de cardinal ? L’idée d’ordre fait-elle ou non partie de celle de nombre cardinal ? Peut-on dériver celle-ci de fondements purement logiques, ou ensemblistes ? De même, peut-on dépouiller l’idée de continu de tout import de type géométrique pour la penser de façon intrinsèquement arithmétique, voire purement structurale (Dedekind) ? Telles sont les questions qui, à mes yeux, relèvent de l’intuition purement catégoriale ; il est question de l’intérieur de la mathématique, et non de son rapport avec un dehors. Le rapport avec le dehors intervient non pas dans les questions de validation qui m’intéressaient dans ce livre, mais concernant le problème de l’émergence du sens mathématique et le conflit entre épistémologie internaliste et externaliste ; j’y travaille dans l’ouvrage qui va suivre.
AP : Vous consacrez de très belles pages à la question de l’infini actuel. En relation avec cette question vous introduisez la distinction entre formation logique et construction symbolique[2]. Pourriez-vous expliquer cette distinction ainsi que son importance pour la notion husserlienne de pensée en tant qu’idée[3] que vous mobilisez pour votre thèse anticopernicienne?
DP : Le chapitre sur l’infini constitue à mes yeux une partie très importante du livre. Il est orienté contre une double thèse qui tend assez aisément à s’imposer dans le milieu phénoménologique qui réfléchit sur les mathématiques. La première, affirmée à la fois par Oskar Becker et Hermann Weyl, est que la phénoménologie serait spontanément très proche de l’intuitionnisme : Husserl ne refuse-t-il pas, comme Brouwer, de scinder l’objet de son mode de donnée subjectif ? La seconde consiste à interpréter la constitution en un sens étroitement normatif et à récuser a priori la possibilité de penser l’infini actuel : le sujet étant fini, il n’a pas la faculté d’embrasser par le regard de la pensée un ensemble de puissance infinie, mais peut seulement penser une suite indéfinie normée par une procédure de choix bien définie, ou une suite indéfinie de libres choix. Or le premier point n’est guère évident, pas plus que le second. Certaines réflexions de Husserl tendent certes à pointer les limites des formalismes – le présupposé de la décidabilité en soi des propositions, l’ancrage de la logique dans un monde réel et la mise en question de la validité universelle des principes formels de la logique. Mais quant au but de la mathématique formelle, Husserl le voyait dans la constitution d’une théorie des formes de théorie et des formes de domaine d’objets associé (les multiplicités), ce qui signifie qu’il était plus proche de Hilbert que de l’intuitionnisme – comme l’avait du reste noté Cavaillès.
Au-delà du rapport entre phénoménologie et intuitionnisme, la question que je pose est la suivante : la finitude du sujet l’empêche-t-elle d’accéder à l’infini actuel ? Réduit-elle le règne cantorien des nombres transfinis à un royaume chimérique ? Une première solution, d’ordre purement calculatoire, consiste à dire : bien que nous n’accédions qu’à du fini, nous pouvons mettre en place des procédures calculatoires qui transgressent le fini ; mais ce n’est qu’un règle de constructions symboliques auxquelles rien ne correspond en termes d’objectités idéales. Ce que j’ai voulu montrer, c’est ceci : à partir du moment où l’on pense le sujet transcendantal comme étant dépourvu de préconstitution, de nature ou de facultés, il existe une plasticité historique de l’entendement mathématicien ; à chaque époque de l’histoire, il se définit par l’intériorisation d’un certain nombre de procédures opératoires, de positions d’objets et de méthodes, de sorte que sa finitude ne signifie plus qu’il ait une nature arrêtée (comme l’est le système kantien des catégories). Dès lors, on ne peut plus énoncer de principe d’inaccessibilité radicale d’un territoire des mathématiques à la pensée. En outre, ce postulat d’inaccessibilité de l’infini actuel présuppose par avance ce que sont les voies admissibles par lesquelles l’entendement est autorisé à penser l’infini : détermination d’une procédure de choix, suite de libres choix. A contrario, j’applique ici le principe anticopernicien selon lequel tout type d’objet prescrit au sujet son mode de donnée ou sa structure régulatrice : l’infini actuel, les nombres transfinis impliquent un mode de rationalité autre que celui que prescrivent les limitations intuitionnistes.
L’exemple central est celui de l’axiome du choix de Zermelo, qui postule la possibilité de former l’ensemble de choix qui, à une infinité actuelle d’ensembles, prélève un seul élément sans aucune procédure de choix. Si vous assignez au terme de choix le sens d’un acte psychologique effectuable, il est évident que tel n’est pas le cas, personne ne pouvant faire une infinité actuelle de choix sans règle ! Aussi ce terme n’a-t-il pas le sens d’un acte de pensée réellement effectué par le sujet ; c’est une procédure noématique idéale, non un processus noétique. Ce qui valide l’ensemble de choix, ce n’est pas la possibilité pour le sujet d’effectuer réellement un acte mais, d’une part, la démonstration de sa cohérence avec les autres axiomes de la théorie des ensembles et, d’autre part, le fait qu’il soit requis par maint raisonnement de cette théorie.
Cela a une conséquence essentielle pour la phénoménologie, qui est de l’arracher radicalement à la psychologie : la phénoménologie des mathématiques n’est pas une psychologie de l’entendement mathématicien et n’enquête pas sur ses actes effectifs de pensée, mais tâche de retracer la typique essentielle des actes de pensée nécessaire pour penser tel ou tel type d’objet ou de théorie. Cette typique ne dessine pas la structure invariable de l’entendement humain, mais l’Idée d’entendement mathématicien qui correspond à telle ou telle situation théorétique. Sur ce point, c’est à mon avis l’insistance de Heidegger (expressément orientée contre le néokantisme) à affirmer que le sujet transcendantal était un sujet bien concret (et non purement logique) qui, en phénoménologie des mathématiques, a une funeste influence en invitant à penser que ce qui n’est pas concrètement effectuable se réduit à des mathématiques verbales ; on se rapproche ainsi de la position empiriste d’Émile Borel et de sa condamnation des « mathématiques verbales », ou du verdict émis par Poincaré contre les cardinaux transfinis de Cantor. Or, dans le domaine des mathématiques, le sujet concret, c’est le mathématicien au travail, et de ce dernier il n’y a point d’essence fixe lestée d’une structure catégoriale invariante – mais une structure noétique qui, chaque fois, correspond aux domaines d’idéalités qui sont maniés, et qui est par conséquent affectée de variabilité historique. On m’accusera sans doute de verser dans le relativisme historique, mais cela ne changera pas la nature des choses !
AP : Vous affirmez sur un ton derridien que “l’écriture est première” et que “sans l’idéalité des symboles il n’y aurait pas de mathématiques”[4]. Comment faut-il comprendre cette primauté de l’écriture pour les mathématiques et quelles conséquences doit-on en tirer pour la question de l’intuition des objets mathématiques?
DP : Desanti me parlait un jour d’un ami mathématicien qui lui avait déclaré : « mes écritures sont plus intelligentes que moi ». Tout mathématicien sait qu’il ne peut travailler s’il n’a au moins à disposition une feuille et un crayon ; jamais un mathématicien ne réfléchit les yeux fermés, absorbé dans l’intériorité de sa conscience et tout entier abîmé dans l’intentionnalité signifiante ! Il est frappant que lorsque Husserl thématise la constitution catégoriale d’idéalités élémentaires (un nombre cardinal, un ensemble fini), jamais il ne fasse intervenir l’écriture ; traitant au § 119 des Ideen de la constitution d’un ensemble fini, il nous enseigne comment, partant de la perception d’une pluralité, on peut faire abstraction de la nature des éléments et les rassembler par une conjonction (ceci et cei et ceci, etc.), puis convertir la visée polythétique en visée monothétique – comme si tout se passait entre la conscience, les objets de degré inférieur et les objets d’ordre supérieur, sans médiation de l’écriture. Or jamais la constitution des idéalités ne s’effectue ainsi ! Elle n’a pas lieu sur un sol vierge de toute théorie préalable, mais se situe toujours au sein d’une histoire de la discipline : des textes l’ont précédé, des insuffisances et des problèmes ont vu le jour que ne parviennent pas à résoudre avec les méthodes et techniques en usage ; il faut donc trouver autre chose, et les nouvelles méthodes mettront toujours en jeu de nouvelles opérations sur des suites de signes. C’est pourquoi aussi bien Bolzano que Peirce ont signalé l’importance de la sémiologie pour les mathématiques.
D’ailleurs, Husserl a lui-même tardivement reconnu cet aspect des choses. Au début de Logique formelle et logique transcendantale, il consacre un alinéa à l’incorporation langagière de la logique (donc des mathématiques, puisque son concept large de logique englobe les mathématiques) et à l’idéalité spécifique qui appartient aux signes. Dans le livre, je tâche d’analyser toute la partie des mathématiques qui raisonne sur les systèmes et les séquences de signes (essentiellement, les antinomies et les questions métamathématiques). Cependant, je tâche aussi de montrer que cette orientation sur les seuls signes n’est pas une thèse philosophique affirmant que la pensée mathématicienne porterait sur les seuls signes (telle est la pensée de Hilbert telle que l’interprète Cassirer), mais un procédé mathématique limitatif qui a toujours un but limité : sécurisons les mathématiques en les restreignant à des opérations sur les signes, et ce afin d’éviter tout basculement vers une pensée qui traite d’entités inexistantes (Hilbert) ; élaborons une méthode de projection qui permette d’exprimer une champ des mathématiques par un système de signes (Gödel, arithmétisation de la syntaxe). Mais sur le plan philosophique, au contraire, une thèse essentielle du livre est que la pensée mathématique, arrimée aux systèmes de signes, vise à penser autre chose que les signes (les concepts mathématiques, les entités mathématiques). Et c’est l’articulation entre signes, significations et objectités que je tâche de penser ; au-delà de Husserl, c’est d’inspiration beaucoup plus frégéenne que derridienne car, comme le Husserl de la Première Recherche, je pars de la stratification entre expressions, sens et dénotation.
E. PHENOMENOLOGIE ET MATHEMATIQUES
AP : Pensez-vous que votre ouvrage pourrait avoir un intérêt pour les mathématiques contemporaines, en permettant par exemple aux mathématiciens de mieux se situer par rapport à certaines controverses qui animent leur discipline, telle que la controverse intuitionnisme/formalisme?
DP : Je crains de n’avoir vraiment pas la compétence nécessaire pour répondre à une telle question, car je ne suis pas mathématicien de métier ; je ne suis qu’un historien de la philosophie qui tente d’être philosophe et de s’intéresser à la mathématique et aux questions de philosophie des mathématiques. Je fus élève de Maths sup et de Maths spé au lycée Louis-le-Grand ; j’étais un élève passable, et surtout l’enseignement prodigué me décourageait, car il était essentiellement orienté vers la résolution d’exercices, plutôt que vers la compréhension des théories et de leur apparition. Ce fut une expérience assez frustrante et traumatisante – et pourtant, je dois dire que notre professeur de HX2, Jean-François Ruaud, était un esprit éclairé, pas du tout scolaire, et de surcroît s’intéressait à la philosophie. Au fond, bien des années plus tard, j’ai tenté de retrouver du sens là où, jadis, il se dérobait obstinément ; j’ai tâché de comprendre ce dont traite la mathématique, le type d’objets auquel elle a affaire, sans doute pour peupler le vide que j’avais ressenti alors.
Je n’ai aucune prétention à avoir quelque influence que ce soit sur le travail des mathématiciens actuels, et ne suis pas certain qu’ils soient encore concernés par l’opposition entre formalisme et intuitionnisme (je me trompe peut-être…). À l’École Normale Supérieure, on essayait jadis de faire dialoguer philosophes et scientifiques (en particulier mathématiciens) en organisant des cours de philosophie pour scientifiques et des cours de sciences dures pour philosophes. Fort belle tentative ! Quant au résultat, c’est une autre affaire : il n’est pas toujours aisé, pour le philosophe, de s’orienter dans les savoirs positifs et d’en acquérir une maîtrise suffisante pour pouvoir les surplomber et établir la connexion avec les questions et doctrines philosophiques sur lesquelles il se sent compétent ; à l’inverse, il n’est pas aisé pour le mathématicien d’acquérir une maîtrise suffisante des questions et doctrines philosophiques pour ne pas verser, quand il réfléchit sur son travail et sa discipline, dans une philosophie spontanée du savant. Le philosophe se heurte à la technicité mathématique et le mathématicien, à la technicité philosophique. Je crains que mon livre, s’il est accessible aux phénoménologues et aux philosophes des mathématiques, le soit nettement moins pour des mathématiciens. Cela étant, je souhaite évidemment le contraire ; je salue par exemple le travail effectué par les Éditions Spartacus pour publier des travaux et des réflexions sur la pratique mathématique, de même que la curiosité intellectuelle dont fait preuve un grand mathématicien comme Pierre Cartier qui, dans les séminaires, m’a vivement impressionné par sa clarté d’esprit. Mais je dois reconnaître que ma véritable dette est à l’égard des professeurs qui m’ont enseigné la philosophie des mathématiques : André Pessel qui, en khâgne au lycée Louis-le-Grand, nous faisait lire l’œuvre de Cavaillès ; Michel Fichant surtout qui, lorsqu’il était Maître de conférences à l’Université Paris 1, nous donnait des cours de philosophie des mathématiques où, sans entrer dans des développements d’une trop grande technicité mathématique, il parvenait à faire la synthèse et établir un dialogue entre des questions de mathématiques et des doctrines classiques de théorie de la connaissance ; puis Desanti, Caveing et Hourya Benis Sinaceur, essentiellement par leurs livres, qui offrent une synthèse de connaissances mathématiques et d’interrogation philosophique vive ; enfin Didier Franck qui, à l’École Normale Supérieure, m’a permis d’approfondir la connaissance de la phénoménologie et d’y frayer ma propre voie. J’ai une grande dette intellectuelle envers toutes ces personnes, envers la clarté d’esprit dont ils faisaient preuve et le type de questions qui les animait.
De manière générale, je tiens à dire tout ce que je dois à l’enseignement public tel qu’il existait à l’époque où j’étais étudiant. Les professeurs n’étaient pas harassés par l’excès de tâches administratives les détournant de leur vocation ; ils avaient une certaine idée de ce qu’était la pratique de la philosophie et avaient pour désir de transmettre leurs habitus philosophiques ; on se mouvait dans la sphère du sens philosophique, le reste étant secondaire. En plaçant au premier plan le souci de la position des universités dans le classement de Shanghai, les considérations de rentabilité et d’économie, la visibilité sur internet et le renouvellement constant des maquettes d’enseignement, la pratique de l’évaluation permanente, l’asservissement des chercheurs par le système des appels à projets, etc. – c’est-à-dire en appliquant aux universités le modèle entrepreneurial – les technocrates qui nous gouvernent menacent la seule chose qui importe réellement à l’université : son sens intrinsèque, qui réside dans la pratique, la transmission et le renouvellement des savoirs. On a instauré une loi portant le nom fallacieux d’« autonomie des universités » tout en travaillant à leur hétéronomie maximale, c’est-à-dire visant à placer le monde intellectuel dans une dépendance accrue vis-à-vis de décideurs qui imposent des règles sans rien connaître aux disciplines. C’est triste, mais notre époque travaille à la médiocrisation systématique des esprits.
Mon travail philosophique n’est pas seulement redevable à quelques influences, mais à ce qu’était alors la formation scolaire. Enfant, j’ai grandi à l’époque bénie des « maths modernes » d’inspiration bourbakiste. J’ai ainsi appris au Cours préparatoire à compter en base deux, trois, quatre, …, dix, et acquis tout jeune la conscience de la relativité du système décimal ; j’ai appris en classe de Quatrième à faire des démonstrations géométriques en disposant les choses sous la forme « données du problème, liste des axiomes et théorèmes utilisés, puis démonstration », ce qui m’a donné la conscience de la rigueur démonstrative ; j’ai appris en classe de Seconde des rudiments de logique formelle (calcul des propositions et calcul des prédicats du premier ordre), ainsi que l’existence de structures algébriques générales (structure de groupe, relation d’équivalence, notions de commutativité, d’associativité, etc.), ce qui m’a donné la conscience de ce qu’étaient l’aspect structural des mathématiques et l’importance du raisonnement général sur des variables littérales. L’école visait à former des esprits, à inculquer une discipline par l’intériorisation d’habitus intellectuels. En quelques décennies, à partir de l’ère Allègre, on a supprimé l’exigence démonstrative au profit de l’aspect calculatoire, le raisonnement abstrait au profit des applications, la logique symbolique au profit de rien du tout, etc. Résultat : tout ce dont, sur le plan scientifique, pouvait s’enorgueillir le pays, a été bousculé et piétiné par les décideurs qui assimilent les enseignants à des animateurs, ont fait enseigner le français sans littérature, les langues sans culture littéraire, ont supprimé les langues anciennes au prétexte qu’elles ne servent à rien (à droite) et seraient élitistes (à gauche), etc. J’ai donc peur que mon livre ne devienne illisible pour les générations d’étudiants qui suivront, et ne le redevienne que lorsqu’on aura compris que l’école doit avoir pour fin première de former les esprits et que l’université doit être régie par un système paritaire et demeurer aux mains des universitaires, au lieu d’être gouvernée de l’extérieur par des décideurs repliés dans des officines ministérielles, qui n’entendent rien aux disciplines et à la discipline intellectuelles.
AP : La fin de votre livre ouvre vers une phénoménologie de la constitution du sens mathématique, qui reste encore à élaborer. Ne pourrait-on pas rechercher la clef de cette constitution dans la notion même de remplissement qui appelle toujours à élucider certaines unités de sens mathématiques et par là-même à découvrir de nouvelles unités de sens?
DP : Tel est l’objet du livre que je suis en train d’écrire. Pour résumer le problème, je dirai simplement que la question du remplissement a trait aux seuls problèmes de validation d’un sens déjà posé, puisqu’une thèse essentielle du livre est que l’objectité mathématique n’est pas l’autre du sens mathématique, mais reste de l’ordre du sens ; simplement, c’est du sens non simplement visé, mais validé par diverses procédures que j’ai tâché de caractériser à plusieurs niveaux. Or, en-deçà de ces questions de validation, il y a la question de l’émergence d’un sens nouveau, en général visé par le biais de notations nouvelles : pourquoi et comment de nouvelles significations mathématiques font-elles leur apparition ? Je ne crois pas, cette fois, que la notion de remplissement puisse donner la clef du problème, qui se trouve au contraire en-deçà des questions de validation.
En conclusion de cet entretien, chère Veronica Cibotaru, je dois vous remercier très vivement de la pertinence des questions et de l’intelligence philosophique qu’elles trahissent.
[1] Ibid., p. 472.
[2] Ibid., p. 347.
[3] Hua XXX, 78.
[4] Dominique Pradelle, Intuition et idéalités, Phénoménologie des objets mathématiques, p. 218.








