Les deux ouvrages de Guillaume Le Blanc, Canguilhem et les normes1 ainsi que Canguilhem et la vie humaine2 commentent les thèses de philosophie de la médecine qui ont contribué à la renommée de Georges Canguilhem. Le premier ouvrage est une introduction succincte au texte de Canguilhem, le Normal et le pathologique3, ou plutôt aux deux textes écrits à vingt ans d’écart : l’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique de 1943 et les Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique de 1963-1966. 2010 est décidément l’année de la réédition des œuvres majeures de Canguilhem et de ses commentaires. Mais là où le texte Canguilhem et les normes est parfois quelque peu allusif bien que clair, Canguilhem et la vie humaine approfondit et montre par le détail les emprunts et les confrontations avec les thèses d’autres auteurs, philosophes, médecins, neurologues, sociologues, psychologues, ethnologues. La joute dialectique avec Claude Bernard, Goldstein, Bergson, Alain, Nietzsche, Friedmann, Foucault, Ricœur, Merleau-Ponty, Lévy-Bruhl, Piaget, Lagache, Ruyer, Simondon est tout à fait exaltante. L’ouvrage est exigeant. Dans son premier texte, Guillaume Le Blanc ne faisait qu’esquisser ces discussions ; l’enjeu n’était pas le même, il s’agissait d’une étude courte et linéaire. Son deuxième ouvrage sur Canguilhem reprend les mêmes thèses (la maladie du malade, l’expérience par la maladie de la précarité de la vie comme avènement de la subjectivité, les rapports entre science et technique, l’enracinement ou la distinction entre normes sociales et normes vitales, les formes aliénantes du travail, la pathologie comme erreur…), mais a pour spécificité de se confronter plus directement aux thèses dont s’inspire et se déprend Canguilhem : il s’agit bien de s’interroger sur ce que peut bien être l’anthropologie de Canguilhem et sur le statut des sciences humaines dans leur ensemble. « Qu’est-ce qu’un homme ? », « quel est l’homme dont parlent les sciences humaines ? » sont au centre du questionnement. Par homme il ne s’agit pas d’entendre un substrat métaphysique, mais avant tout un être vivant dans toute sa contingence. Place est faite à la fois à la singularité et à la vie humaines. Il ne s’agit cependant pas de parler d’existence ou de vie vécue dans une perspective phénoménologique, il s’agit de partir du vital. Là réside le cœur le problème : si l’homme est d’abord un être vivant, que faire de la fameuse différence anthropologique ? Quelle place donner à la culture, à la technique, à l’art, au travail ? Quelle anthropologie construit-on en conséquence ? L’enjeu est bien de réfuter certaines conceptions de l’homme que véhiculent la médecine, la psychiatrie, la sociologie, la psychologie, les conceptions rationnelles à outrance du travail, non pour les détruire, ni pour les fonder, mais pour montrer la nécessité d’une réflexion philosophique et anthropologique. Comme l’écrit Dominique Lecourt, il est peut-être plus juste de qualifier Canguilhem, venu tardivement, à l’âge de 32 ans, aux études de médecine, de « philosophe et médecin » que de « médecin et philosophe » 4. Mais le risque majeur d’une anthropologie fondée sur la biologie et la médecine, l’écueil d’une philosophie de la vie, est celui d’une réduction abusive du social au vital et donc d’une forme de « darwinisme social »5 ou d’une conception métaphysique de la vie dont les scientifiques ne cessent de vouloir se débarrasser. Posant la question d’une définition possible d’une « philosophie de la vie », G. Le Blanc se demande « sous quelles conditions nous pouvons encore avoir accès à ce que nous nommons la vie ».6 Parler de la vie consiste d’une part à saisir le lien entre le vivant dans sa singularité et son milieu, à saisir le lien entre ce vivant et les autres vivants, et d’autre part à considérer le rapport entre la vie et la mort, entre la santé et la maladie, en son sens biologique pour les animaux en général, en son sens social pour l’humain en particulier. Il s’agit alors de remonter, en-deçà des vivants individuels, à la vie elle-même. L’enjeu est de taille. Quel lien peut-on établir entre la vie et les normes ? Il s’agit « d’articuler la vie sans condition à la vie sous condition »7. Il s’agit donc, à la fois de saisir ce que sont les vies singulières ordinaires, et ce qu’est la vie en général, autrement dit de faire une « philosophie de la vie ordinaire » et une « philosophie de la vie », en articulant l’une à l’autre.
Il y a plusieurs manières de faire de l’anthropologie en fonction des dispositifs que l’on privilégie. La méthode de G. Le Blanc est archéologique et généalogique : selon le dispositif privilégié (le travail, le langage, la vie), il devient intéressant « d’analyser les sciences humaines dans la pluralité de leurs histoires et de révéler combien l’histoire des savoirs de l’homme croise des discours philosophiques eux-mêmes sans commune mesure entre eux. » 8 La méthode est inspirée de Nietzsche et Foucault. L’enjeu est clairement posé dès l’introduction : il s’agit de réfléchir sur « les rapports entre anthropologie et biologie et sur le rôle que sont amenées à jouer, dans cette connexion, la médecine et les sciences humaines. Que signifie être en vie pour un homme ? En quoi cette interrogation aboutit-elle à une réforme de l’anthropologie ? Pourquoi la médecine et les sciences humaines s’inscrivent-elles dans ce dispositif ? »9 Deux choses sont à retenir : 1) la biologie et la médecine sont intégrées dans le champ de l’anthropologie ; 2) il doit être possible, Broussais et Comte indiquent la voie, de faire une « histoire française de l’anthropologie écrite selon l’indicateur théorique de la vie » 10
Avant de s’interroger sur les spécificités de la vie humaine et sur la vie en général, il faut se poser la question de savoir ce que signifie vivre pour un vivant (et plus particulièrement, mais pas exclusivement, ce qu’est vivre pour un vivant humain). Cela présuppose une interrogation épistémologique sur la biologie, mais également sur la médecine. Si la physique est régie par des lois universelles et rigides, il n’en va pas de même pour la biologie qui se doit de prendre en compte les spécificités du vivant. Ce dernier ne peut être réduit indûment à du physico-chimique. L’expérimentation en biologie animale doit donc prendre en compte ces spécificités, elle doit prendre en compte que l’effet de la caféine n’est pas le même sur la grenouille verte que sur la grenouille rousse, que les lois de Pflüger sur l’extension progressive des réflexes conviennent au lapin, mais pas au chien ou chat, que le phénomène de réparation des fractures osseuses diffère de l’animal à l’homme. Ce qui vaut donc pour telle variété ou telle espèce ne vaut pas nécessairement pour telle autre variété ou telle autre espèce, et ce qui vaut pour tel animal ne vaut pas nécessairement pour l’homme11. Le terme de valeur est essentiel : la vie est une valeur et l’être vivant a pour caractéristique d’instaurer des normes, de composer son milieu en opérant des préférences, en sélectionnant dans l’« exubérance du milieu physique » « quelques signaux » 12. On se rappelle le fameux exemple de la tique sensible à trois excitants, olfactif, thermique et tactile, exemple exposé par Jacob von Uexküll et particulièrement commenté par Heidegger dans les Concepts fondamentaux de la métaphysique et par Deleuze dans le « A comme Animal » de l’Abécédaire 13. Ces préférences témoignent de normes que les vivants instaurent, toute la question étant de définir ce concept et de s’interroger sur les rapports entre les normes biologiques et les normes sociales pour saisir ce qu’est la « vie humaine ». En quel sens peut-on parler de normes pour un être vivant ? Deux choses doivent être déterminées au préalable : il faut saisir ce qu’est un être vivant et quelles sont les conditions de sa vie.
Individu, subjectivité et sujet
Le livre de G. Le Blanc s’articule autour de ces trois concepts. Un être vivant est d’abord caractérisé comme un individu. L’individu n’est pas entendu ici au sens métaphysique du terme, encore moins au sens politique, mais au sens biologique, tout le problème étant de savoir où se trouve l’individualité biologique. G. Le Blanc se fonde d’une part sur Spinoza14, en montrant que ce qui d’un certain point de vue vaut comme un tout, vaut comme une partie d’un autre point de vue, et d’autre part sur Canguilhem afin de remettre en cause le dogme de la cellule comme fondement de l’individualité. L’identité fondée sur la cellule est une fiction. Si la cellule a été considérée comme le fondement de l’individualité, c’est parce que toute cellule provient d’une autre cellule et qu’il y a des organismes unicellulaires ou pluricellulaires. Mais on peut également considérer la cellule comme un tout, parce qu’on peut parvenir à des composants de la cellule qui sont « à la limite entre la substance vivante et la molécule chimique » 15. G. Le Blanc commente ainsi l’article de Canguilhem « la théorie cellulaire », article qui pose deux thèses critiques : 1) la théorie cellulaire n’est pas une théorie, mais un dogme hérité d’habitudes linguistiques et sociales (la cellule est ce qui est indivisible). Ce qui est déterminé techniquement, plus précisément par l’usage du microscope, reçoit une surdétermination sémantique qui pousse à voir dans la cellule le fondement de l’individualité ; 2) la théorie cellulaire hérite elle-même des présupposés d’autres théories, et notamment de l’atomisme psychologique de Hume et de l’atomisme de Newton. Ces présupposés mènent ainsi la biologie sur la pente mécaniste puisque le tout est ramené à la somme de ses parties. Mais il ne s’agit pas pour autant de revenir à l’organisme pris comme un tout, c’est-à-dire à une forme de vitalisme fondé sur des théories politiques et romantiques. La solution de Canguilhem semble extrêmement proche de celle de Spinoza : « L’individualité dénote un rapport de rapports. Elle désigne le rapport entre des rapports internes et des rapports externes. […] L’individualité n’est pas un être mais une relation au milieu interne et au milieu externe. Le milieu ne représente pas l’environnement externe neutre mais plutôt ce qui, à l’extérieur est vécu comme convenant. » 16 Canguilhem semble lier la conception spinoziste selon laquelle un individu se comprend selon des rapports de mouvement et de repos17 et sur la définition que donne Claude Bernard, dans les Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, de la vie (et non pas simplement du vivant) : « Le phénomène vital n’est donc tout entier ni dans l’organisme, ni dans le milieu : c’est en quelque sorte un effet produit par le contact entre l’organisme vivant et le milieu qui l’entoure. » Troisième concept essentiel (dans la droite ligne de Spinoza) : l’activité ; troisième auteur important : Goldstein. Si ce sont les relations qui importent et non l’être individuel en lui-même, alors on peut dire qu’« il y a individu quand un sens biologique global se construit dans une activité biologique » 18. Le premier enjeu, véritable parricide aristotélicien, est de considérer la biologie comme une « science des individus » ; le deuxième, de disjoindre radicalement biologie et physique ; le troisième, de quitter le dogme de la théorie cellulaire, ce qui a pour conséquence un retour à l’organisme, mais pris dans son aspect dynamique. L’organisme, pris dans son ensemble, manifeste des normes propres, et s’individualise à partir du moment où il témoigne d’un sens. Or le sens n’est que global, il réside dans la vie même de l’individu.
De la même manière, en neurologie et en psychopathologie, un symptôme ne prend sens qu’au sein d’une totalité organique. Quatre références chères à Merleau-Ponty sont mobilisées par Canguilhem et développées à nouveau par G. Le Blanc : Goldstein19, Monakow, Mourgue et Viktor von Weizsaecker. Comme il a été dit précédemment, un processus d’individuation consiste en un rapport de deux rapports, c’est-à-dire en une articulation d’un milieu interne et d’un milieu externe ; Canguilhem parle de deux types de « normes ». Ainsi, « le fait biologique fondamental est à chercher dans la capacité de l’organisme de maintenir ses propres normes dans un milieu de vie particulier. »20. Les normes organiques sont de l’ordre de l’« autorégulation ». Un être vivant, c’est d’abord ce qui a la capacité de se réguler intérieurement. Claude Bernard a bien montré que les animaux (complexes en particulier) régulent leur milieu intérieur organique, notamment par son travail sur le foie, foie qui se révèle avoir la capacité de produire du sucre. Mais la vie ne peut se comprendre sans un milieu extérieur : le vivant ne s’arrête pas aux limites de l’ectoderme. D’où un deuxième type de normes : les « normes de centration » qui traitent du rapport du vivant au milieu extérieur.
La notion de milieu externe mérite quelques remarques. Auguste Comte la mettait au centre de sa philosophie : pas d’anthropologie sans étude, dans l’ordre, du milieu astronomique, physique, chimique et biologique. Il faut commencer par être au plus loin de soi pour se poser ensuite la question suivante, sociale avant tout : qu’est-ce qu’être à soi-même son propre milieu ? Que dit Canguilhem lorsqu’il parle de « centration » pour le vivant ? Les considérations épistémologiques ne sont jamais loin : si l’espace physique est pensé de manière homogène et quantitative, l’espace biologique est qualitatif et hétérogène. Un vivant organise son milieu en se concevant au centre de ce milieu. Une tique construit son milieu, un hérisson construit son milieu, un homme construit son milieu, et ces milieux ne se superposent pas. La question est cependant sous-jacente : peut-on parler du milieu humain comme des milieux animaux ? Ou n’y a-t-il là qu’une dangereuse homonymie ? Le chapitre IV sur les « usages de la culture » revient sur le concept de milieu. L’homme transforme son milieu techniquement. Ce milieu n’est donc plus naturel mais artificiel. Y a-t-il alors disjonction entre le vital et le social ? Si chaque vivant configure un milieu, crée des valeurs, en quoi en serait-il autrement pour l’homme ? C’est l’école de géographie, et en particulier Pierre Vidal de La Blache, qui permet à Canguilhem de lier social et vital tout en spécifiant la vie humaine. En réalité, l’homme ne s’insère pas dans un « milieu physique pur », mais dans « des milieux géographiques complexes ». Il crée une « configuration géographique » et non la « configuration d’un milieu ». Or, « configurer une géographie, c’est imposer un milieu humain en lieu et place d’un milieu physique. »21 L’anthropologie doit donc prendre en compte une géographie. L’homme peut faire des choix multiples, ce qui n’est pas le cas de l’animal, même si celui-ci possède une certaine plasticité. Dans la mesure où ses constructions sont collectives et non pas simplement individuelles, l’homme peut instaurer de nouvelles normes, revenir sur celles qu’il a instituées et configurer de nouveaux milieux : il peut très bien décider de relier les régions dans lesquelles il vit par des routes goudronnées, traverser le lieu des amours ou le terrain de chasse des hérissons, il n’empêche que le hérisson ne fait pas un tel usage de la technique pour transformer le milieu géographique 22 Il n’en reste pas moins que tout individu vivant, animal ou humain, articule deux types de normes : « Les normes organiques de la régulation et la centration individualisent le vivant par l’unité qu’elles autorisent. Cette unité est unité de régulation interne (harmonie du milieu interne) mais aussi unité de centration externe (harmonie à l’égard du milieu externe). Ces deux formes de normes ne doivent pas être pensées comme deux types de normes séparées mais comme deux modes de la même logique normative. » 23
Il faut cependant préciser davantage ce qu’est une norme dans la mesure où c’est le concept qui permet de distinguer individualité et subjectivité. Canguilhem voit dans la vie une capacité à imposer de nouvelles normes : le vivant normal, et en cela Canguilhem rejoint Kurt Goldstein, c’est ce qui est capable d’organisation, mais aussi de réorganisation, autrement dit c’est ce qui est capable d’adaptation, tandis que le vivant pathologique est celui qui a une capacité réduite à tolérer la nouveauté. Bergson aurait parlé de création, Nietzsche de volonté de puissance. Canguilhem n’en opère pas moins un déplacement par rapport aux théories de Goldstein, puisque se restreindre à une norme (même non-réduite) est déjà le signe d’une pathologie, la santé biologique consistant à innover, à créer et à passer facilement d’une norme à l’autre, et non à maintenir une structure intègre et stable. Il ne s’agit pas de conservation, mais de création ou de puissance de destituer les anciennes valeurs biologiques au profit de nouvelles. Une des conséquences directes de cette conception est le classement de la biologie au sein des sciences de l’esprit, dans lesquelles, selon la distinction de Dilthey, il s’agit de comprendre et non d’expliquer. La biologie suppose « l’immersion dans le style de vie du vivant et la restitution de son allure propre » 24. D’où également une définition précise de la biologie comme « science empirique qui a pour objet d’étude la compréhension des critères significatifs par lesquels il y a individualisation. » 25 La biologie est donc la science qui s’occupe de l’individu et de son processus d’individualisation. Enfin, l’étude de l’homme, l’anthropologie, est elle-même une partie de la biologie – une partie importante puisque le sujet humain est ce à partir de quoi il pourra y avoir une biologie générale, ce qui implique une certaine proximité entre l’objet et le sujet.
Une question se pose cependant : si la vie saine consiste à pouvoir sans cesse renouveler ses propres normes, peut-on encore parler de normes ? Non, parce que, contrairement aux usages conventionnels de ce terme, la norme n’est pas pour Canguilhem ce qui est suivi par la majorité des individus, autrement dit ce qui est dans la moyenne. Une norme est strictement individuelle. Le concept de norme n’est-il pas alors complètement dilué dans une forme de relativisme ? Non, parce que chaque individu sait très bien (en fait il le sent) faire la différence entre un état qui, pour lui, est normal et un état qui, pour lui, est pathologique. La distinction entre « labilité », « normalité » et « normativité » est importante. « La labilité indique la capacité pour tout vivant de s’adapter à de nouvelles normes, à un nouveau milieu » 26, « la stabilité normale n’est que l’arrêt momentané dans l’effort de labilité ou encore la stabilité n’est qu’une labilité confirmée », « la labilité ne se confond pas totalement avec la normativité » puisque « la labilité est ce qui rend possible la normativité. » 27. Si la normalité est une allure usuelle du vivant, si la santé est la normativité, si la normativité est la capacité à instituer de nouvelles normes, alors le vivant sain est celui qui peut changer, donc qui est labile. La vie n’est jamais en accord total avec elle-même, mais se déphase, c’est ce « déphasage » de la vie par rapport à elle-même qu’est la labilité. En réalité, il ne faut pas opposer normal et pathologique, mais sain et pathologique, puisque la pathologie est elle-même constituée de normes. C’est sur la pathologie elle-même qu’il faut alors s’interroger puisque c’est ce domaine qui va permettre de saisir ce qu’est la subjectivité, en distinction de l’individualité.
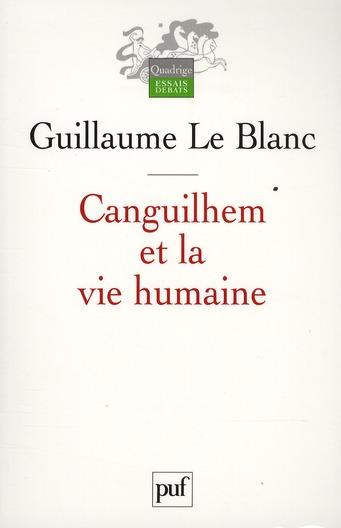
La thèse est devenue un lieu commun de la philosophie de la médecine, mais il est des lieux communs qu’il est toujours bon de rappeler : la médecine se doit de s’occuper du malade dans sa singularité et du point de vue de sa vie. Elle se fonde donc moins sur une anatomie que sur une physiologie, et moins sur une physiologie caractérisée par des normes identifiées à des moyennes, que sur une pathologie. La pathologie a pour stricte origine un individu se sentant malade, malade parce qu’incapable de devenir normatif, parce que vivant dans ce que Goldstein, dans La structure de l’organisme, nomme un milieu de vie « rétréci ». L’individu pathologique craint les réactions en catastrophe, les maladies auxquelles, malade, il ne pourrait plus survivre. Les exemples sont parlants : être normatif consiste à pouvoir rentrer à pied le soir quand il n’y a plus de bus, à changer de boulangerie si celle où l’on va habituellement est exceptionnellement fermée ; cela consiste à pouvoir physiquement et psychiquement affronter les risques, en particulier celui de tomber malade, et à pouvoir tolérer les changements du milieu, en adoptant, si nécessaire, de nouvelles normes. Pour passer de l’individu en général, homme ou animal, à la subjectivité, il faut en passer par l’expérience de la maladie. Tout le chapitre 2 est consacré à la « subjectivité malade ». Le chapitre 1 nous a permis de parvenir à saisir des individus et à constituer les prémices d’une anthropologie biologique. Nous n’avons cependant plus de spécificité de l’homme : si l’anthropologie ne veut pas se résorber totalement dans la biologie, encore faut-il saisir ce qui spécifie l’homme. Si, d’une part, l’anthropologie doit rester biologique, la constitution de la spécificité de l’homme doit se faire à partir du concept de norme (concept qui convient également aux animaux). Si, d’autre part, on veut encore distinguer phénoménologie et anthropologie biologique 28, il faut redéfinir avec précision la subjectivité qui désigne l’individu humain.
La norme présuppose la pathologie, et ce en trois sens. 1) En un sens biologique, le vivant humain est ce vivant singulier qui a pour caractéristique de s’intéresser à ses propres pathologies et d’y remédier techniquement grâce à la médecine. 2) Socialement, les normes y sont « les règles admises d’une société, non codifiées, qui convergent cependant vers des formes de pratiques individuelles » 29. Chaque individu social se place donc face à ces normes en les confirmant ou les infirmant. « La norme est à la fois ce que l’homme rencontre dans son histoire et ce qui l’expose à une histoire extérieure. » 30 D’où l’importance de la notion de norme en sociologie, toute la question étant de savoir de quelle manière faire de la sociologie. 3) En un sens existentiel, chaque individu adopte une attitude particulière vis-à-vis des normes en désirant être dans les normes ou s’en écarter. Un animal, une plante s’individualisent de manière assez stable. Un humain en revanche, peut donner différents sens à son existence 31 Les thèses sont essentielles dans la philosophie de Canguilhem : que ce soit d’un point de vue vital ou d’un point de vue social, il n’y a pas de normalité en soi. D’un point de vue biologique, une pathologie ne se distingue pas quantitativement, mais qualitativement de la santé : il s’agit alors d’une forme d’incapacité à se modifier, d’une forme de réduction de ses capacités à multiplier les normes. Afin de défendre l’idée selon laquelle la subjectivation se fait par la maladie, Canguilhem fait un détour par la psychopathologie. Il faut rester au plus près de l’individu concret. C’est pourquoi c’est d’abord la clinique qui permet une véritable réflexion sur le normal et le pathologique. La psychopathologie est préférée à la physiologie. La psychiatrie est ainsi moins liée à la médecine et à la physiologie qu’à la philosophie et à la psychologie. Dans Le normal et le pathologique s’engage une discussion serrée avec Charles Blondel, Lagache et Minkowski. Canguilhem retient de Blondel l’idée que, dans la pathologie, le malade est autre à lui-même et autre pour les autres. Selon Blondel, il ne peut ni se comprendre lui-même, ni être compris par le médecin. L’essentiel est que cela s’oppose au dogme selon lequel le pathologique ne serait qu’une variation du normal. De Lagache, Canguilhem retient qu’il y a bien altérité du pathologique au normal, mais il y a du pathologique incompréhensible, et du pathologique compréhensible (selon la distinction de Jaspers) lorsqu’il est possible de rapporter la pathologie à la personnalité antérieure du malade. Cette thèse a une conséquence importante : la psychologie ne s’occupe pas de « l’homme social (sociologie) », ni de l’homme « vivant (biologie) », mais de « l’individu concrètement révélé dans ses pensées et ses conduites. » 32 De Minkowski, Canguilhem retient que l’aliénation mentale se distingue de la maladie somatique, car, d’un point de vital, l’aliénation nie la vie, alors que d’une part « la normalité se confond avec le dynamisme vital (le bien) » 33, et que, d’autre part, dans la maladie du corps, l’individu ne nie pas la vie, mais compose avec elle. Canguilhem transfère alors les conceptions du normal et du pathologique du domaine de la psychopathologie dans le domaine de la médecine somatique. Il « convertit l’hétérogénéité psychique du normal et du pathologique en hétérogénéité somatique. » G. Le Blanc cite Canguilhem : « Etre malade, c’est vraiment pour l’homme vivre d’une autre vie. » 34 Le malade somatique est celui qui a des difficultés à « créer de nouvelles normes », mais pour autant, il ne s’agit pas d’une altération quantitative, mais d’une altérité qualitative. Ainsi « les conduites du malade, de l’animal, de l’enfant, du primitif ne peuvent se comprendre à partir du comportement sain, adulte et civilisé de l’homme normal. » De la même manière qu’un malade, un enfant ou un soi-disant primitif ne peuvent se comprendre à partir d’un individu sain, d’un adulte ou d’un civilisé, un daltonien, un asthmatique ou un hémophile ne peuvent se comprendre à partir des individus somatiquement sains.
L’expérience de la maladie n’est cependant pas qu’un changement de normes, c’est aussi le lieu de la subjectivation, l’opérateur de l’avènement de la subjectivité étant la douleur. La douleur « autorise le passage de l’individualité biologique à la subjectivité. » 35 C’est l’avènement de cette subjectivité au sein de l’individualité biologique qui permet alors de distinguer l’humain de l’animal. « Ce qui est à l’origine d’une individuation, c’est une perception : l’individu se sent malade. En revanche, ce qui est à l’origine de la subjectivité, c’est une construction significative que l’individu donne à cette perception initiale par laquelle il s’éprouve comme sujet de la maladie dans un acte de conscience : il se sait malade et, par conséquent, il est malade. […] L’individualité concerne la globalité d’un comportement alors que la subjectivité se dévoile dans la possibilité consciente de donner un sens à ce comportement. » 36 En bonne santé, le sujet reste inconscient de son corps, alors que la conscience naît avec la douleur. C’est lorsqu’il se sent fragile que l’individu se comprend en tant que subjectivité. La subjectivité naît donc de l’expérience d’une pathologie, parce que la pathologie crée une conscience accrue de soi et de ses incapacités, alors que la santé ne fait que maintenir l’individu dans l’inconscience de lui-même. Canguilhem ne cesse de citer Leriche : « La santé, c’est la vie dans le silence des organes. » L’idée est bien entendue discutable, mais l’important n’est pas là. « la maladie, en réduisant les possibilités de l’organisme, tend à imposer une norme de vie unique qui met en péril la normativité organique, laquelle devient alors valeur de vie pour la subjectivité. […] La maladie n’est plus une possibilité parmi d’autres, mais plutôt ce qui fixe les limites mêmes du possible ». 37 Pour reprendre une distinction précédente, l’humain malade a perdu la labilité et donc sa capacité à instituer de nouvelles normes.
La subjectivation provient de la douleur provoquée par la maladie, ainsi que de la douleur de la rupture vis-à-vis de la vie normale. D’où la nécessité de la clinique pour prendre en compte l’homme concrètement (en distinction de la méthode expérimentale) et pour prendre en compte le désir du malade de résoudre ses conflits et donc de faire l’objet d’une thérapeutique. Par conséquent, si l’on met l’accent sur la clinique, la médecine devient plus proche de l’art que de la science, puisqu’il s’agit avant tout de poser un diagnostic qui prenne en compte l’histoire de l’individu dans toute sa contingence. Ainsi « la valeur de la clinique vient de la reconnaissance de l’être-sujet dans l’expérience de la maladie. » 38 Le médecin, en tant que vivant, est alors le moyen que trouve la vie pour se restaurer elle-même. S’opposent une médecine fondée sur l’étude du général, de l’homme normal puis des maladies, et une médecine comme savoir-faire ou « manière de vivre » 39. La vie a une valeur, la pathologie dévalorise la vie, la médecine est un acte de valorisation, ou plutôt de revalorisation de la vie d’un individu au moment qui convient. La médecine est donc une technique, au sens aristotélicien du terme, ainsi qu’une pratique, et cherche le kairos, le « moment opportun » pour agir. Ce n’est donc pas tant l’expérimentation en tant qu’elle permet d’atteindre le général et le nécessaire qui importe que l’expérience en tant qu’elle saisit le singulier et le contingent. Il faut alors préciser que la guérison n’est pas un retour à l’état normal antérieur à la maladie. Elle est nécessairement imposition de nouvelles normes et exercice de la labilité. Le temps de la santé, de la maladie, puis du retour à la santé, est irréversible et doit être conçu comme une histoire linéaire et non comme un cycle. La maladie provoque des pertes et des réparations, mais jamais le rétablissement d’un état antérieur. Et G. Leblanc de conclure : « Le pathologique dit autre chose sur la vie que le normal. La vie se dit de plusieurs manières. Il n’y a pas à chercher une unité philosophique première mais plutôt à comprendre comment la vie forme un pluriel. » 40
L’idée selon laquelle toute valeur réelle n’est qu’individuelle va alors directement à l’encontre de l’idée selon laquelle la pathologie ne serait qu’une déviation qu’il faudrait corriger. La maladie est une expérience qui se doit d’être méditée en tant que telle. La conception de Canguilhem de la norme contredit donc l’idée usuelle que l’on a de la normalité en tant qu’elle est construite rationnellement. La norme est moins de l’ordre de la raison que de l’ordre de l’expérience. Or il se trouve que les sciences humaines s’attachent particulièrement à construire ces normes, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Les déterminations scientifiques oublient l’expérience de la normalité et du pathologique.
La critique des conceptions normatives des sciences humaines
Les sciences humaines se construisent sur un oubli de l’expérience. Cela peut sembler légitime si l’on considère, dans la droite ligne d’Aristote, qu’il n’y a de science que du général et que la raison, par définition, est abstraction. Habituellement, la norme n’est pas ce qui est rapporté à un individu singulier et à son histoire, mais ce qui permet d’évaluer un ensemble d’individus : l’homme en général (ou des groupes d’hommes) en biologie, des communautés en sociologie. La tâche que se donne G. Le Blanc est particulièrement intéressante puisqu’il entend retracer, dans le sillage de Canguilhem, une « généalogie » de la catégorie de normalité en médecine, en psychologie et en sociologie, afin de dénoncer un « dogme scientifique à valeur idéologique » 41.
Dans les sciences humaines, en psychologie, en sociologie, en ethnologie, la construction des normes est abusive parce que subordonnée à une volonté d’homogénéisation des vies humaines et vise donc une forme de pouvoir sur les individus. On retrouve les thèses développées par Michel Foucault 42. Une distinction conceptuelle est essentielle ici afin de bien distinguer ce qui rapproche et ce qui distingue Canguilhem et Foucault : le concept de « normalisation » est à différencier de celui de « normativité ». La normalisation est la tendance qu’à la société à imposer des normes aux individus, alors que la normativité est la tendance des individus à remettre en cause ces normes et à constituer ses propres normes. La normalisation est la manifestation de « l’arbitraire social » 43 et se disjoint quelque peu de la vie. Le problème surgit lorsque la société supplante la vie et tente d’être elle-même sujet des normes. Michel Foucault montre que les normes sont de l’ordre de la discipline (à l’école, dans l’hôpital, dans les prisons) et que le modèle politique de la loi a laissé place au modèle disciplinaire de la norme qui s’inscrit dans les corps et dans les esprits. Il s’agit alors avant tout de surveiller plutôt que de punir. De la sorte, les disciplines s’étendent hors des institutions elles-mêmes. Les processus de subjectivation, qui passent par des écarts à la norme, ne subsistent que dans « l’acte de penser », l’amitié et les mouvements révolutionnaires. L’acte de penser permet une véritable « subjectivation de soi » 44 ou un « exercice de soi non normé » 45 et consiste à saisir ce que sont les normes de pouvoir et de savoir afin de pouvoir s’en déprendre, non en rejetant sa propre culture (ce qui ne serait qu’une manière négative d’en manifester encore le pouvoir), mais en jouant à l’intérieur. La métaphore du jeu d’échec, dans le cadre d’une réflexion sur Bachelard, est particulièrement éclairante : « Piéger sa propre culture ne signifie pas changer de partie d’échecs ou renverser le jeu d’échecs existant mais rester sur le même jeu d’échecs et renverser les grosses pièces par les petites. » 46 Moins rarement, dans l’amitié, relation éthique par excellence, « les amis inventent des formes de relations singulières », ce qui permet non de sortir des « normes », mais de les « oublier » 47. L’expérience du soulèvement historique, en dernier lieu, est l’occasion d’une réflexion sur la notion d’événement. L’événement révolutionnaire n’est pas réductible à un ensemble de causes, sauf à le faire disparaître en tant qu’événement ; il est de fait. Ainsi, « la désobéissance est l’expression d’une réactivité vitale (normativité) face à l’activité normalisatrice des pouvoirs » 48, qu’il s’agisse du délinquant, du fou, ou du peuple opprimé. Mais la subjectivité (qu’elle passe par la pensée, la pratique ou l’histoire) est rare chez Foucault, alors qu’elle est normale chez Canguilhem. D’autre part, là où la normalisation est négative chez Foucault, elle est tolérée par Canguilhem et constamment débordée par la normativité. Toute normalisation n’est pas une aliénation à la société. Ce qui importe, selon Canguilhem, c’est « la capacité qu’ont l’individu, le groupe ou la société de revenir sur les normes édictées, de remettre en question les valeurs au fondement des normes et de rester sujet de ses propres normes. » 49 Et cela peut être quotidien.
Cela présuppose qu’on cesse de relier, dans les sciences humaines, la norme avec la normalisation au détriment de la normativité. Canguilhem, lecteur des Règles de la méthode sociologique, discute les thèses de Durkheim, en en pointant les contradictions et les inconséquences. La distinction faite par Durkheim entre le normal et le pathologique consiste à identifier normal et fréquent, pathologique et rare. Ce qui est normal est donc ce qui est dans la moyenne. C’est d’ailleurs ce pourquoi le crime reste normal dans une société. La sociologie procède donc par induction et forge des « types moyens » qui sont « abstraction (extraction) d’une tendance à partir d’une fréquence reconnue » 50. Par conséquent, la sociologie est analogue à la physiologie : « à l’organisme moyen correspond une société moyenne. » Mais comme la fréquence ne suffit pas à constituer la normalité, il faut aussi que cela soit utile socialement et actuellement. Canguilhem pose trois objections : d’un point de vue vital, le sociologue dépasse ses prérogatives en utilisant l’argument de l’utilité parce cela transforme une normalité de fait (fréquente) en une normalité de droit (utile socialement). Du point de vue de la subjectivité, il y a des contradictions. D’un point de vue social, c’est éminemment conservateur, ce qui empêche une certaine dynamique sociale chère à Canguilhem. La norme sociologique est donc une valorisation implicite du social tel qu’il existe. Le présupposé est le suivant : « cette coordination et cette conservation imposent une idée du social qui privilégie la solidarité à la rivalité, l’organicité à la conflictualité. » 51 Durkheim élude donc la question des conflits à propos des normes elles-mêmes. La sociologie devient donc une « discipline normative », oublieuse « des décisions normatives du sociologue. » 52
Canguilhem entend montrer que les capacités normatives œuvrent sans cesse dans la société tout en renouvelant la manière de considérer les normes en sociologie. Il n’en reste pas moins que la tendance à la normalisation est réelle. Mais le sujet est caractérisé par son activité et notamment par ses capacités de résistance. La notion de résistance, d’un point de vue social, est un opérateur de subjectivation. Il se trouve que le milieu social peut se retourner contre lui-même. La configuration du milieu peut se renverser et devenir configuration de l’homme par son milieu, autrement dit aliénation. Il y a donc une dialectique entre l’homme comme configurateur d’un milieu géographique, la configuration de l’homme par son milieu, la résistance de l’homme à sa configuration par le milieu. Canguilhem s’inscrit ainsi dans la critique du capitalisme et du machinisme développée par G. Friedmann dans les Problèmes humains du machinisme industriel. L’individu, avec la rationalisation et la parcellarisation du travail, perd les « valeurs de la vie au profit des valeurs de société » 53. Le travail aliéné désubjective. « La résistance devient la valeur normative de la subjectivité. » 54 L’impératif de Taylor selon lequel l’ouvrier devrait se contenter d’exécuter et ne pas penser, s’avère, dans les faits, impossible. Comme le dit Canguilhem dans son article « Milieu et normes de l’homme au travail » : « Il est évidemment désagréable que l’homme ne puisse s’empêcher de penser, souvent sans qu’on le lui demande, toujours quand on le lui interdit. » 55 Par conséquent, « l’histoire du vivant humain devient une histoire de la résistance du vivant humain à la dissolution de la subjectivité dans les milieux de vie extérieurs. » 56 Il faut rappeler que l’homme, comme l’animal, a des normes de centration. Le concept de résistance intervient lorsque l’homme risque de ne plus être au centre de son propre milieu. Le vivant humain résiste à la soumission à une rationalisation technique outrée. La « logique de rentabilité » entre donc en conflit avec la « logique de viabilité »57. Le sujet est avant tout celui qui agit ou continue à agir en résistant. Canguilhem refuse l’idée d’une norme ontologique et absolument coercitive. « La normalisation est une normativité instituée tandis que la normativité est une normalisation contestée. Or, ce rapport de la normalisation à la normativité fait un avec le sujet collectif ou individuel des normes. Une normalité en soi ne veut rien dire. Toute norme est relative à une énonciation. »58 Il y a « perspectivisme » parce que « chaque sujet (individuel ou collectif) s’affirme dans le rapport aux normes qu’il préfère ou qu’il conteste. » 59 « S’écarter des normes apparaît alors comme l’acte de subjectivation par excellence, en ce qu’il redonne à un sujet l’initiative dans le rapport aux normes. La normalité, fruit de la normalisation sociale instituée, ne prive pas la société, le groupe ou l’individu de la capacité normative à être sujet de ses propres normes. »60 Là où il y a une forme de pessimisme chez Foucault et Bourdieu qui pourtant n’assimilent jamais le déterminisme social à un nécessitarisme, là où Foucault aménage une triple possibilité de subversion des normes, là où Bourdieu considère qu’il ne s’agit pas de détruire les normes, mais de mieux comprendre le jeu social pour y créer des déplacements, Canguilhem pose d’emblée l’idée que la vie sociale n’est pas close sur elle-même. Pour reprendre l’exemple du travail, il n’y a jamais pure adaptation aux normes prescrites. Le travailleur crée des écarts aux normes et se montre inventif. G. Le Blanc revient sur la distinction d’Yves Schwartz dans Expérience et connaissance du travail entre le « travail réel » et le « travail prescrit » 61 et reprend la citation d’un ouvrier ajusteur : « Jamais un ouvrier ne reste devant sa machine en pensant : je fais ce qu’on me dit. » Le travail, dans la mesure où il est un composant essentiel de la santé psychique, doit permettre une subjectivation et ne peut se résumer à une pure contrainte. Les normes sont elles-mêmes travaillées par des « micro-normes » 62 qui permettent aux individus de rester des sujets. Le travailleur ne peut pas être dans la pure reproduction du code de normes qu’on lui impose, mais se confronte avec ce code. Travailler n’est donc pas se conformer. Maintenir stricto sensu les normes est alors anormal car opposé à la vie qui vise la création. Une trop grande adaptation serait la mort de la normativité. Pour résumer, « réduire le travail au maintien des normes existantes, c’est donc envisager la vie humaine sous l’angle de la maladie (qui est primat de l’identique et conjointement impossibilité de faire advenir de la nouveauté) plutôt que de la santé (qui est création de nouveauté et conjointement refus de l’identique). » 63 Si en revanche chaque individu impose ses propres normes (même des micro-normes qui ne sont pas pour autant en contradiction totale avec la normalisation sociale instituée), alors le travail est dans le prolongement direct de la vie. Par conséquent, une norme ne peut être saisie qu’a posteriori. Il est donc illusoire de considérer qu’il y a transcendance des normes. On est au plus loin de Durkheim. Penser la norme comme transcendante est en fait idéologiquement orienté : cela permet de considérer certaines normes comme étant des déviances par rapport à la norme du groupe. Il y a donc deux manières de considérer les choses d’un point de vue sociologique : soit on valorise le critère d’adaptation en méconnaissant la « coconstruction des normes par les sujets », soit on reconnaît la « relation de réciprocité entre normes et sujets », et donc on dévalue le concept d’adaptation au profit d’une « valorisation inverse de l’inventivité humaine. » 64 Canguilhem défend la seconde option. Il s’agit de ne pas être trop adapté, sinon cela met la vie, qui est diversité, en danger. Il y a alors une véritable opposition entre une « psychologie de l’activité » et une « psychologie de l’adaptation ».
La remise en cause d’une certaine sociologie coïncide donc avec la remise en cause d’une certaine manière de faire de la psychologie. Ce sont toujours les notions d’individu, de subjectivité et de sujet qui sont au centre de la réflexion de G. Le Blanc sur les sciences humaines. Si une norme ne peut être saisie qu’a posteriori, alors il faut considérer que le sujet est premier et que le psychologue est second. Cela implique, encore une fois, que la clinique est toujours logiquement première et que le savoir théorique ne peut jamais s’ériger de manière absolue comme valant pour tous les individus, puisque chaque individu a une manière singulière de se subjectiver. Dans la mesure où il n’existe pas de lois préétablies dans la vie humaine, une normalité abstraite ne peut être que de l’ordre de l’invention. Ainsi, seule une « psychologie anthropologique ou philosophique » qui « ne se considère pas comme instrument d’une efficacité sociale meilleure mais comme travail de compréhension des valeurs humaines » 65 peut être valable pour Canguilhem. Il s’agit d’une psychologie « respectueuse des conflits humains », autrement dit tolérante. Elle doit donc être de l’ordre de la description et non de la prescription, et viser à comprendre ce qui caractérise tel ou tel comportement individuel. G. Le Blanc retrace la généalogie qui a fait de l’homme un outil 66, qui a instrumentalisé le psychologue, lequel a alors acquis une utilité d’insertion de l’individu dans le tissu social. Ainsi, « la psychologie et le psychologue sont des moyens de la normalisation de l’homme. Leur fonctionnement est avant tout d’ordre adaptatif. » 67 C’est pourquoi « la psychologie n’est plus une connaissance de l’homme, [mais] une politique de l’homme destinée à en faire l’instrument d’un corps politique qui lutte pour son maintien. » Le but de la généalogie de Canguilhem est donc de montrer, en remontant du présent jusqu’à ce qui est resté irréfléchi dans la constitution d’une science, qu’une certaine psychologie a ainsi acquis un rôle de « contrôle social », autrement dit un rôle « disciplinaire ». C’est pourquoi la psychologie ne doit pas être disjointe totalement de la philosophie qui peut exprimer ces impensés. Dès que la psychologie instrumentale vise à mieux insérer l’homme dans la société, elle perd non seulement son humanité, mais surtout sa scientificité. Le seul rôle de la philosophie et de la généalogie est d’empêcher la dérive policière de la psychologie. « La psychologie ne garde de valeur que si elle renonce à se comprendre comme police de l’esprit, pratique sociale de l’expertise et de l’habileté, pour se désigner de l’intérieur d’une anthropologie, pratique philosophique de la sagesse. » 68
Il faut d’ailleurs en conclure que les normes qualitatives ainsi constituées ne valent pas mieux que les normes quantitatives. Dans son cours de 1942-1943, Canguilhem retrace la généalogie du normal et du pathologique dans l’ensemble des sciences humaines : comme nous l’avons rapidement vu avec Durkheim, en sociologie, la norme est constituée quantitativement et revient à la moyenne qui elle-même s’identifie au fréquent 69 ; en ethnologie, la normalité est qualitative et se construit par rapport au civilisé ; en psychologie de l’enfant, la normalité est qualitative et se construit en référence à l’adulte. Canguilhem discute dans ce cours de 1942-1943 l’ethnologie de Lévy-Bruhl et la psychologie de l’enfant de Jean Piaget. Les thèses sont connues : la « pensée primitive » et la « pensée enfantine » ne sont pas des stades inférieurs de la pensée logique et de la pensée adulte, mais d’autres formes d’expériences, qui ont leur normalité propre. Le primitif diffère donc qualitativement du civilisé et l’enfant de l’adulte, toute hiérarchisation étant malvenue et signe d’incompréhension. « La pensée primitive prélogique et la pensée enfantine ne valent pas relativement à l’intelligence de l’homme occidental et de l’adulte mais posent en elles-mêmes leur propre normalité. Le primitif est étranger à la logique moderne comme l’enfant est étranger à la pensée logique adulte. » 70 Une norme qualitative n’est cependant pas à mettre sur le même plan qu’une norme quantitative. Mais il faut préciser que les sciences humaines, en fonction de leur attachement aux normes quantitatives ou qualitatives, soit sont dans l’ordre de la « réduction » puisque tout phénomène peut être caractérisé en fonction d’une moyenne (ce qui empêche une distinction stricte entre normal et pathologique), soit prennent en compte une certaine « spécificité » 71 des expériences, mais se confrontent au redoutable problème épistémologique suivant : comment avoir accès à d’autres formes de normalité, alors même qu’on est pris soi-même dans un régime normal singulier ?
Ce n’est cependant qu’en donnant une véritable place à l’individu, à ses processus de subjectivation et en saisissant la dynamique des processus de normativité, qu’il sera véritablement possible de sortir des « jugements de normalité » érigés par une certaine manière de faire des sciences humaines.
Le vital et le social
L’anthropologie ne se résorbe pas totalement dans la biologie. Nous avons déjà commencé à le voir en montrant que l’homme est configurateur de milieux géographiques et dans l’exemple du travail. La culture est-elle véritablement réductible au vital ? Avec la subjectivité malade, l’entrée dans l’anthropologie se fait par la souffrance et l’« expérience de la perte ». 72 Avec la culture, elle se fait par ce qui est valorisé dans certains groupes d’hommes en particulier. « La culture pluralise ainsi les modes de vivre du vivant humain. » 74. Or, si la technique est antérieure à la science, pour quelle raison y a-t-il science ? La science naît de l’échec de la technique. « La technique suppose la possibilité d’un accord entre l’activité du vivant (les réponses aux « besoins ») et les contraintes du milieu (« les choses ») alors que la science intervient dès que cet accord ne peut être réalisé. » 75 Deux problèmes se posent : 1) si la technique peut être reliée à la vie parce qu’elles sont deux sortes d’organisation, la science semble interdire une « anthropologie biologique radicale et totale. » 76 2) Comment concevoir l’art à partir d’une telle valorisation de la technique ? L’art n’est pas conçu à partir des œuvres d’art, il n’est pas conçu à partir d’une interrogation sur l’inspiration ou le génie de l’artiste, ni à partir du sentiment esthétique du beau, mais à partir des instruments techniques utilisés par l’artiste et à partir de l’activité de celui-ci. Ce qui importe, c’est l’acte de création lui-même. Ainsi, « la vérité de l’art ne réside pas dans l’autonomie des formes culturelles qu’il engendre mais dans sa capacité à réorienter les créations techniques. » 77 Sur ce point, nous sommes dans la droite ligne d’Alain, dont Canguilhem a suivi avec passion les cours au lycée Henri-IV. Ainsi, il n’y a pas de créateur avant l’acte de création lui-même, ce qui importe étant avant tout l’activité elle-même. La création n’est pas à rapporter à un obscur génie ou même à une intention préexistante dans la tête de l’artiste, mais à la vie en ce qu’elle a un potentiel de création imprévisible. L’art n’est donc pas réductible à un ensemble de règles, mais est de l’ordre de la « transgression » 78. Ainsi, « une philosophie biologique doit être pensée comme une philosophie de la production des formes dans la mesure où la vie est à l’origine des formes tant techniques qu’artistiques. » 79 La technique est ce qui fait le lien entre la vie et l’art puisque la création artistique présuppose l’existence préalable d’instruments. C’est donc l’instrument qui engendre l’œuvre, l’art et le créateur. Autant d’instruments que d’arts. Par conséquent, la différence entre art et artisanat devient ténue. Dans le chapitre 4 sur les « usages de la culture », G. Le Blanc confronte avec précision Canguilhem à Alain et Bergson. Canguilhem suit Alain dans l’idée qu’il n’y a pas de distinction de nature entre l’artiste et l’artisan : cela lui permet de maintenir le lien entre vie et art. Canguilhem suit Bergson dans l’idée que l’art est une force. On voit bien cependant que la philosophie de Canguilhem est avant tout une philosophie de la technique. Il est fort probable que « la culture [ne soit] alors rien d’autre qu’une organologie construite par la vie. » 80
Or, si la technique est ce qui permet à l’homme de configurer différents milieux, si elle augmente le monde des possibles, il n’en reste pas moins qu’en enracinant l’anthropologie dans la biologie, en continuant à faire usage du concept de milieu et en refusant de dissocier le vital du social, on ne comprend plus vraiment ce qui fait la spécificité des formes sociales. Dans le chapitre 5 de son ouvrage (« la création sociale »), G. Le Blanc met en lumière les tensions et les évolutions de la philosophie de Canguilhem. Si le premier essai reproduit dans Le normal et le pathologique et l’article « le normal et le pathologique » inséré dans La connaissance de la vie enracinent le social dans le vital, ce qui a pour conséquence directe la perte de la spécificité de l’histoire humaine, le second essai, plusieurs articles des Etudes d’histoire et de philosophie des sciences de 1968 et l’ouvrage Idéologie et rationalité de 1977 disjoignent le vital et le social. « Il demeure ainsi une tension dans l’histoire des normes entre son versant naturel et son versant social. Les formes sociales, référées à leur origine normative, s’enracinent dans l’histoire naturelle des normes : la production normative des vivants s’aménage un milieu de vie. Les formes sociales, rapportées à la conscience de la fragilité de l’individualité vivante (la maladie) ou à l’opacité des milieux de vie sont productrices d’un ordre symbolique spécifiquement humain composé de sollicitations et de contraintes qui fixent le sens de leurs actions aux vivants humains. Dans le premier cas, le social (à titre d’élément différentiel en lequel l’ordre humain se reconnaît) s’enracine dans le vital ; la subjectivité n’est autre que le prolongement de l’individualité. Dans le second cas, le social relève d’une logique de production propre, étrangère à la vie, qui se réalise, pour une part, dans la conscience subjective du négatif vital (la maladie) et, pour une autre part, dans la conscience subjective du négatif social (les contraintes techno-économiques du milieu de vie humain) ; la subjectivité se retourne contre l’individualité. » 81 Un concept permet au final de distinguer le vital du social : celui d’« allure ». La perspective vitale et la perspective sociale sont deux allures différentes de la vie elle-même. Comme on l’a vu précédemment avec l’exemple du travail, la société peut s’ériger en tant que sujet et empêcher les individus d’être eux-mêmes sujets. La normalisation sociale peut étouffer la normativité individuelle. Ainsi, ce qui spécifie la vie humaine, c’est qu’il y a une « expérience culturelle de la normalisation » 82. La société ne devient un danger pour la vie que si la normativité sociale ne peut plus s’exercer. Chaque individu, dans son travail par exemple, doit pouvoir instaurer ces micro-normes qui lui permettent de rester un sujet. Chaque individu doit pouvoir rester actif afin d’éviter de se perdre lui-même au profit d’une totale adaptation à la société. « La perspective sociale, comme la perspective vitale, reste une production de la vie, une « allure ». Seulement les allures ne se superposent pas. […] Deux allures de la vie sont produites par deux sujets différents, la société et la vie. » 83 De la même manière que l’individu biologique se subjectivise en faisant l’expérience de la précarité de la vie, l’individu social se subjectivise en faisant l’expérience de la précarité des normes sociales. Une norme sociale collective, contrairement à une loi de la nature, peut toujours être remise en cause par un individu. Une valeur sociale peut être remplacée par une autre valeur sociale. Les normes, au sein d’une société, peuvent entrer en conflit. La perspective sociale diffère de la perspective vitale parce qu’au niveau vital, la normalité réside dans la normativité, alors qu’au niveau social, la normalité est à la fois dans une certaine normalisation sociale et dans la normativité des sujets. Ce qui rapproche le vital du social, c’est cette normativité, cette espèce de logique créatrice du vivant.
Ce qui reste donc en dernier lieu à comprendre, c’est en quel sens on peut considérer la vie elle-même comme un sujet. Dans le dernier chapitre, « la vie-sujet », G. Le Blanc s’attaque à cette difficile question et aux rapports entre le concept et la vie. Si « la philosophie de Canguilhem s’accomplit en perspectivisme » 84, la vie est « la perspective de perspectives » 85. Mais la vie n’est pas située en-deçà des perspectives individuelles actuellement mises en œuvre. Pourquoi dire que la vie est sujet de ses opérations ? C’est l’occasion d’une réflexion sur le lien entre vie et concept 86. La connaissance, contrairement à un lieu commun forgé un peu rapidement, ne détruit pas la vie. La science, postérieure à la technique, vise à résoudre les conflits entre l’homme et l’organisation de sa vie. Comme l’écrit G. Le Blanc dans Canguilhem et les normes à la page 113, « la connaissance est le relais que la vie invente pour lutter contre ses propres obstacles. Elle se comprend comme une tactique de la vie, une méthode de résolution des tensions entre l’homme et son milieu. » La science, comme la technique, est une activité de la vie. Canguilhem se place donc dans le camp d’Aristote et Hegel contre Kant et Bergson, autrement dit du côté de ceux qui identifient le concept et la vie contre ceux qui les disjoignent. 87 L’identification entre la vie et le concept implique, classiquement, une critique de Bergson. Celui-ci a en effet montré que l’intelligence ne peut concevoir la vie autrement qu’en l’envisageant comme déjà-morte, en la spatialisant, en niant les singularités au profit des généralités. La vie ne peut être saisie que par intuition. Or il y a un dilemme : « soit la proximité à la vie éloigne la proximité au concept. Soit la proximité au concept éloigne la proximité à la vie. »88 En conceptualisant, l’homme simplifie, abstrait pour permettre l’action. La fonction du concept est donc fondée sur le besoin. Si la vie produit du concept, c’est parce que c’est utile à la vie, mais le concept lui-même ne permet pas de comprendre la vie. L’intelligence n’est donc qu’un outil inadéquat en ce qui concerne la compréhension de la vie. Il s’agit alors pour Bergson de sortir de l’intelligence pour saisir la vie par intuition. Mais « le drame bergsonien est alors posé. Si l’homme sort de son identité intellectuelle, il se confond avec la vie mais il ne peut rien en dire, sauf à se retrancher symboliquement de l’ordre vital. S’il ne sort pas de son identité intellectuelle, il est voué à une distance symbolique non résorbable à l’égard de la vie et est cantonné dans un ordre humain séparé de l’ordre vital. »89 Alors que le paradoxe ne semble pouvoir être résorbé chez Bergson, Canguilhem entend « articuler concept et vie, d’un côté, connaissance de la vie et vie, de l’autre côté. »90 Selon Bergson, la vie est antérieure à la connaissance, seule l’intuition correspond à une connaissance précédant les symbolisations par le langage et le concept. Selon Canguilhem, en revanche, « l’antériorité de la vie à la connaissance […] est à comprendre en 1966 comme l’antériorité d’un logos vital sur le logos théorique. La logique n’est pas d’abord une affaire de connaissance mais de vie : le sens de la vie est antérieur au sens de la connaissance. […] L’interprétation scientifique des normes de vie admet d’être située relativement à une perspective biologique qui lui échappe en partie. Une connaissance de la vie reste partiale. Seulement cette partialité peut être interprétée dans le sens d’une opacité de la vie biologique mais aussi d’une opacité de la vie sociale. La perspective scientifique ne peut être annexée à la perspective biologique parce que l’homme qui la produit se situe dans une perspective sociale qui n’est pas la perspective biologique. La connaissance appartient à la fois à la perspective sociale de l’homme et à la perspective biologique du vivant humain. Le sujet de la science est situé dans sa double appartenance à la vie biologique et sociale. Il en résulte que la connaissance ne peut plus appréhender la totalité de la perspective biologique. » 91 Par conséquent, si la connaissance est biologique et que ce qui s’oppose à la connaissance est l’erreur, alors l’erreur est également biologique. Il faut se reporter au dernier chapitre des Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique : « Un nouveau concept en pathologie : l’erreur. » « Les maladies génétiques sont ainsi des erreurs de l’organisme, la substitution erronée d’un arrangement à un autre. » 92 Le concept d’« erreur innée » repose sur une « science ordonnée de l’hérédité » et des concepts relevant d’une « théorie de l’information », et ce de manière non métaphorique. S’il y a erreur, c’est parce que l’arrangement visé par la vie est la santé. Si la vie se déploie à partir d’un sens, il y a toujours risque d’erreur. En cela, Canguilhem va plus loin que Nietzsche qui s’arrête au concept de volonté de puissance. En-deçà de la normativité, il y a le sens de la vie. « Une telle philosophie est nécessairement un perspectivisme (différent du perspectivisme métaphysique de Nietzsche), impliquant un quadruple rappel de la perspective sociale, de la perspective biologique (ou identification de la vie et du concept), de la mise en perspective de la connaissance au regard de la vie biologique, de la caractérisation de sa connaissance par sa propre perspective (le vivant humain) sans la dissoudre dans la perspective biologique. Une philosophie de la vie est alors, par le perspectivisme qui est le sien, un pluralisme. La perspective biologique n’est pas la vie mais une perspective de vie qui en tant que telle est pluralité de perspectives, perspective des perspectives et non-être. » 93
Conclusion
Ce qui est normal, c’est la modification, la normativité active au sein des régularités biologiques et sociales. Chaque individu instaure ses propres normes et éprouve singulièrement ces normes, dans l’expérience des maladies biologiques et sociales. Ce sont ces maladies qui lui permettent de se subjectiver, ce sont ces activités de modification des normes qui lui permettent de s’éprouver comme sujet. De la sorte, jamais un individu ne sort des normes. La vie humaine est caractérisée par ces normes, facilement modifiables dans le cas de la santé, difficilement dans le cas de la pathologie. Comme l’écrit G. Le Blanc, « il n’est pas absurde de penser que, de Comte à Canguilhem via Cournot, Tarde, Bergson, se dessine une pensée des rapports entre la norme et la modification travaillée dans deux directions, quantitative et qualitative, quantitative pour Comte, Cournot, Tarde, qualitative pour Maine de Biran, Bergson et Canguilhem. Ainsi, il n’y a pas, pour Canguilhem, d’objectivité de la normalité. La normalité est toujours subjective, au sens le plus fort du terme. De la sorte, Canguilhem ne définit pas l’homme de manière métaphysique, il ne le laisse pas non plus dans un certain flou conceptuel comme le font parfois les sciences humaines ; il le caractérise à partir de sa vie, en prenant donc en compte son histoire. D’où le fait que G. Le Blanc parle de la philosophie de Canguilhem comme d’une « philosophie de la vie ordinaire » ou d’une « une anthropologie philosophique de la vie ordinaire » 94. Cette nouvelle anthropologie permet de repenser les sciences humaines qui légifèrent sur le normal et le pathologique. Ainsi « la figure de l’homme n’est plus définie par un dedans incertain et nébuleux. Elle est désormais ressaisie dans ses fabrications multiples, selon des mouvements d’activités qui sont également des mouvements de subjectivation, en fonction d’un sujet pré-individuel, la vie. » 95
- G. Le Blanc, Canguilhem et les normes, Paris, PUF Philosophies, 1ère édition 1998, 2ème édition 2010.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, Paris, PUF Quadrige, 1ère édition 2002, 2ème édition 2010.
- G. Canguilhem, Le Normal et le pathologique, Paris, PUF Quadrige, 1ère édition 1966, 2ème édition 2010.
- D. Lecourt, Georges Canguilhem, Paris, PUF, QSJ, 2008, p. 29.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 7.
- Ibid., p. 10.
- Ibid., p. 12.
- Ibid., p. 15.
- Ibid., p. 13.
- Ibid., p. 17.
- cf. G. Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », in La connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1998, p. 26-28.
- G. Canguilhem, « Le vivant et son milieu », in La connaissance de la vie, op. cit., p. 145.
- Canguilhem le reprend aux pages 145 et 146 de La connaissance de la vie
- Notamment sur la fameuse lettre XXXII à Oldenburg qui utilise l’exemple du ver dans le sang. Le petit abrégé de physique, au scolie de la proposition XIII de la deuxième partie de l’Ethique va d’ailleurs tout à fait dans le même sens.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 43.
- Ibid., p. 49.
- Tout individu exerce un effort (conatus) et ne saurait venir en dehors d’un milieu. Il n’y a pas de rapport interne sans rapport externe.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 50.
- cf. Notamment le chapitre VI de La structure de l’organisme
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 55.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 235-236.
- Cf. Canguilhem, « L’expérimentation en biologie animale », in La connaissance de la vie, op. cit., p. 39.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 56-57.
- Ibid., p. 60.
- Idem.
- Ibid., p. 120.
- Idem.
- Les animaux en général et l’homme en particulier ont pour caractéristique la vitalité entendue comme « présence à la vie » (G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 84). Canguilhem, contrairement à Ricœur qui considère qu’il faut distinguer la « vie vécue » de la « vie vivante » et que seule la vie vécue permet l’avènement de la subjectivité, enracine la vie humaine dans la vie biologique. La phénoménologie de Ricœur se distingue du vitalisme de Canguilhem, et si Canguilhem et Merleau-Ponty ont une manière similaire de définir l’organisme, il reste que le concept de « norme » permet de rester dans le vital lorsqu’on parle de l’homme, alors que le concept de « comportement », la distinction entre vie et esprit grâce à la notion de conscience, disjoint le vécu du vital. Le vivant humain, chez Merleau-Ponty, est avant tout une incarnation de la conscience dans le corps. Le « corps propre » se distingue donc du corps organique. D’où l’affirmation suivante : « le passage à l’homme est un saut qualitatif qui ne peut plus être pensé dans les limites d’une anthropologie biologique, puisque le corps humain en vient à différer du corps vivant. » « Le comportement et la norme appartiennent à deux régimes philosophiques différents. » (Ibid., p. 83)
- Ibid., p. 85.
- Idem.
- cf. G. Canguilhem, « Le normal et le pathologique », in La connaissance de la vie.
- Ibid., p. 98.
- Ibid., p. 100.
- Ibid., p. 111 et 112
- Ibid., p. 114.
- Ibid., p. 115-116.
- Ibid., p. 121.
- Ibid., p. 128. Les pages 128 et 129 sont très claires : « l’action thérapeutique est à comprendre par référence à la singularité du malade. Loin que la médecine dissolve l’unicité de l’individu dans la classification nosographique, elle est plutôt une prise en compte de la singularité de l’expérience subjective à laquelle elle est confrontée. C’est pourquoi son centre de gravité n’est pas la science, dont le fonctionnement suppose toujours une certaine référence à l’universalité, mais la technique pensée comme art singulier. La vérité de la médecine se situe du côté de la clinique et de la thérapeutique et non du côté du savoir médical. La médecine est ainsi en elle-même une expérience nécessairement singulière commandée par la singularité du malade. « Soigner, c’est toujours entreprendre au profit de la vie quelque expérience. » Là encore, une épistémologie du savoir biologique est contournée par Canguilhem au profit d’une philosophie de la pratique médicale. La médecine est un art lié à une forme d’acte, l’acte de soigner. Un tel acte prolonge de manière aiguë la vie. La légitimation de la médecine vient donc de sa capacité à prendre en charge la normativité de la vie. […] L’acte du médecin restaure la déficience des actes de la vie. »
- Ibid., p. 132.
- Ibid., p 142.
- Ibid., p. 146.
- Cf. en particulier M. Foucault, Surveiller et punir ; Le pouvoir psychiatrique, Cours au Collège de France de 1973-1974 ; Les anormaux, Cours au Collège de France de 1974-1975 (Gallimard Seuil, Hautes études, 1999). Les pages 45 et 46 de ce dernier cours citent explicitement Canguilhem.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 253.
- Ibid., p. 268.
- Ibid., p. 265.
- Ibid., p. 268.
- Ibid., p. 269.
- Ibid., p. 272.
- Ibid., p. 277.
- Ibid., p. 170.
- Ibid., p. 177.
- Ibid., p. 180.
- G. Le Blanc, Canguilhem et la vie humaine, p. 249.
- Ibid., p. 250.
- Ce passage est cité par G. Le Blanc à la page 250.
- Ibid., p. 251.
- Ibid., p. 252.
- Ibid., p. 282.
- Idem.
- Ibid., p. 283.
- cf. Ibid. p. 285.
- Ibid., p. 287.
- Ibid., p. 288.
- Ibid., p. 296
- Ibid., p. 153-154.
- Ibid., p. 163 : « L’homme-outil désigne l’homme normal construit par les jugements de normalité de la psychologie. »
- Ibid., p. 162.
- Ibid., p. 168.
- Dans Le normal et le pathologique, Canguilhem discute de manière assez précise les thèses de Quêtelet et d’Halbwachs.
- Ibid., p. 181.
- Ibid., p. 183.
- Ibid., p. 187.
- Idem.] Canguilhem interroge en particulier ces formes culturelles que sont la technique et l’art. La différence anthropologique usuelle est donc réitérée, en même temps que l’enracinement dans le vital est réaffirmé : l’homme a bien, comme les autres animaux, un milieu, mais il met en forme son milieu grâce à la technique. Le premier rapport de l’homme à la nature est donc d’ordre technique. C’est pourquoi Canguilhem affirme, dans un article de 1937 intitulé « Descartes et la technique », qu’il y a antériorité de la technique sur la connaissance. Les techniques ont leurs propres normes en rapport avec les usages. Elles ne sont pas la simple application d’un savoir, même si, bien sûr, la science peut avoir des effets techniques de la même manière que les techniques des effets scientifiques. L’usage est donc antérieur à la perception et la pratique prime sur la vérité 73cf. Un article de 1938 : « Activité technique et création. »
- Ibid., p. 192.
- Ibid., p. 198.
- Ibid., p. 205.
- Ibid., p. 211.
- Ibid., p. 212.
- Ibid., p. 203
- Ibid., p. 246.
- Ibid., p. 302.
- Ibid., p. 247.
- Ibid., p. 247.
- Ibid., p. 305.
- cf. L’article de Canguilhem « Le concept et la vie ».
- Trois domaines permettent l’identification du concept et de la vie : la génétique, la cybernétique et la théorie des patterns innés de comportement. G. Le Blanc discute les thèses de Ruyer et de Simondon : Canguilhem se rapproche de Ruyer dans le sens où il refuse l’identification du vivant à une machine, la machine n’ayant pas cette capacité qu’est la normativité. Il se rapproche de Simondon en considérant l’information comme une structure de la vie.
- Ibid., p. 340.
- Ibid., p. 348.
- Ibid., p. 349.
- Ibid. p. 349.
- Ibid. p. 350.
- Ibid., p. 358.
- Ibid., p. 363.
- Ibid., p. 365.








