III. Aimer
« Tout fonctionne à l’image de cette Trinité en état continuel de vie, de respiration, d’aspiration, de fonctionnement, personnelle, transcendante et créatrice. »
(P. Claudel)
Aimer : de toutes, la chose la plus difficile. Le Verbe proscrit est à l’image et à la ressemblance de son objet. Sans conteste, il est des trois premiers volumes de la tétralogie celui dont la texture est la plus dense, et celui dont la traversée est la moins aisée. Le lecteur vacille parfois, pris de vertige, au devant de l’ivresse vivifiante qui semble saisir le texte lui-même, où les mots surgissent les uns des autres, et s’engendrent les uns les autres, follement et très raisonnablement, comme pris d’une fulgurante envie de se démultiplier pour dire avec toujours plus de profondeur et de précision ce dont il est question. Aussi la première lecture peut-elle surprendre, ou déconcerter, ou bien même effarer puis effrayer : ce que l’on tient dans les mains, ni de fond ni de forme, ne ressemble à nul autre livre – quand bien même l’on sortirait, tout frais et tout fier, de l’étude sage des auteurs de la tradition réputés les plus obscurs, et dont la pensée s’élève jusqu’aux altitudes les plus considérables. Les mots ont tous l’air d’être là vivants et vibrants d’une vie innombrable ; et ils s’agitent, et ils vont à de fascinantes métamorphoses, et se reproduisent, et dansent sur la page en d’infinis engendrements, et fusent, et se diffusent comme des vapeurs de sens et de sonorité, et rebondissent les uns contre les autres. « Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant », écrivait Victor Hugo ; et sans doute aucun livre n’avait réalisé mieux, n’avait mieux avéré cette déclaration du vénérable maître. Ici, dans Le Verbe proscrit, le style est celui d’une perpétuelle fécondité du lexique, qui se démultiplie par génération spontanée, ou bien plutôt par cela que sa proximité perpétuelle avec sa source surnaturelle lui procure de prolificité, de fertilité et d’abondance. Le langage est saisi soudain d’une fastueuse fièvre d’incroissance, que je définis au contraire de l’excroissance comme une croissance au-dedans, une exubérance par intensification, comme l’effloraison d’une rose qui pousserait ses pétales mystiques non vers l’extérieur, mais vers l’intérieur, ouvrant et découvrant en elle l’espace d’un épanouissement possible à l’infini. Que l’on ne s’attende pas ni que l’on n’espère un texte qui prenne le lecteur par la main ; c’est bien plutôt par la cime des cheveux qu’il le prend, et l’emporte là où la philosophie, depuis le XIIIe siècle, farouchement et puis convulsivement, ne voulait plus aller : par Dieu, jusques en Dieu même. Les perruques ne tiendront pas plus au crâne, alors, que les pensées basses aux cervelles.
Saint Thomas définissait la foi comme l’acte de cogitare cum assensione, « penser avec assentiment »[1]. L’on pourrait définir la pensée, ou l’expérience de la pensée telle qu’on la fait en lisant Maxence Caron, comme l’acte de cogitare cum ascensione, « penser avec une ascension » : en allant vers son centre, sa possibilité et sa source, l’esprit prend son envol par-dessus lui. En allant au cœur de lui, il va au-delà de lui, au-dessus de lui – jusque dans les hauteurs de son Principe. Aussi faut-il au lecteur des souliers solidement culottés, car le sentier non seulement est sinueux, mais le dénivelé en outre est considérable, et la respiration de la pensée pas toujours aisée lorsque l’on atteint à de certaines altitudes. La marche patiente, parfois pénible, en vaut cependant la peine qui conduit l’homme aux confins de ses intimités célestes. Là-haut, « l’air est pur, le ciel admirable » (Baudelaire), et les épuisements du chemin sont récompensés par l’apaisement immense de la contemplation – de quoi ? Encore et toujours – car il n’est rien d’autre, nulle part, à contempler – du Principe en tant que Principe, dans la consistance pleine et parfaite de son être, c’est-à-dire dans sa Différence fondamentale. Mais précisément, il s’agit maintenant de penser la teneur même, en elle-même et pour elle-même, de l’Être par soi, qui est présence à soi, en pensée et par amour, – c’est-à-dire qui est Trinité. Penser l’Être selon lui-même, penser Dieu selon lui-même, c’est le penser comme la Trinité qu’il est ; et c’est donc, nécessairement, formuler une pensée de la Trinité à partir d’elle-même.
 Comment cela est-il possible ? La question mérite un examen minutieux, car l’on sait combien un saint Thomas d’Aquin, par exemple, repoussait avec fermeté toute possibilité d’une déduction rationnelle a priori de la Trinité, c’est-à-dire indépendamment de la Révélation : est-ce de cela qu’il s’agit ici ? Certes, non ; et il faut revenir un instant à La Transcendance offusquée pour s’en convaincre. On y lit en effet ceci de capital que la science trinitaire « n’est plus du ressort du seul Diaphorisme transcendantal qui atteint rationnellement à la seule dimension de l’âme comme image principielle, car cette Science Trinitaire demande que l’âme ait grandi sur le chemin de la ressemblance, qu’elle ait été guidée par le surplus mystique de la croissance paraclètique. » Et encore : « Le Diaphorisme transcendantal est la condition de la conscience pour cet accroissement car du Principe il reçoit dans l’accession permanente à l’image le gage paraclètique capacitaire, mais le Diaphorisme transcendantal n’est pas lui-même cet accroissement car cette croissance est l’œuvre même de l’Initiative du Principe qui est Esprit Saint. »[2] De vrai, la catégorie même de raison naturelle n’a pas de sens ici, car la raison si elle est la nature de l’homme, n’est jamais un fait seulement de la nature : la panoranoèse n’est proprement ni naturelle ni même surnaturelle, mais antéréelle, elle est « la conscience in statu anterealitatis »[3] ou bien plutôt, en l’occurrence, la conscience remise à sa réflexivité possibilisatrice, c’est-à-dire à sa dimension antéréelle. La raison, sauf dans la mesure précise où elle est obscurcie par le péché, n’est jamais indépendante de la Révélation, ou, pour mieux dire, la lumière qui éclaire l’homme par la Révélation ne diffère pas de celle qui l’éclaire au-dedans de son âme. C’est en ce sens que Maxence Caron peut parler de « PréIncarnation du Principe en l’homme »[4], pour désigner son être réflexif ; et de citer à l’appui une formule de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité : « il se fait en mon âme comme une Incarnation du Verbe ». Il faut donc, et c’est de toute première importance, commencer par restituer la conscience à sa condition de possibilité qui est la réflexivité, puis reconduire cette réflexivité elle-même à sa source, c’est-à-dire la considérer dans sa relation d’institution et de constitution avec le Principe. Autrement dit, et cela explique pourquoi la science trinitaire « n’est plus du ressort du seul Diaphorisme transcendantal », la rationalité dont il est ici question est toujours celle d’une conscience abandonnée à la toute-initiative de précédence du Principe, c’est une rationalité toujours fidèle, donc fonctionnant en régime de foi, qui signifie la pleine fidélité à ce qu’elle est et ce dont elle est. La proclamation du Catéchisme de l’Église catholique est dès lors pleinement respectée qui est la suivante : « Dieu certes a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de Création et dans sa Révélation au cours de l’Ancien Testament. Mais l’intimité de Son Être comme Trinité Sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison et même à la foi d’Israël avant l’Incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint Esprit. »[5] L’on peut même voir là manière de synthèse de ce que Le Verbe proscrit accomplit dans son ensemble : reconduire tout ce qui fut déjà pensé à son ultime et à sa suprême condition de possibilité, c’est à savoir l’Incarnation du Fils et la mission du Saint Esprit. Tout le système a été écrit, toujours déjà, au point de vue ouvert ou rouvert par la Révélation en son point le plus haut, et le plus intense, qui est la venue dans le monde du Principe du monde en personne. Le point d’arrivée est le point de départ ; et la fin était bel et bien dans le commencement, mais tacite encore, et implicite.
Comment cela est-il possible ? La question mérite un examen minutieux, car l’on sait combien un saint Thomas d’Aquin, par exemple, repoussait avec fermeté toute possibilité d’une déduction rationnelle a priori de la Trinité, c’est-à-dire indépendamment de la Révélation : est-ce de cela qu’il s’agit ici ? Certes, non ; et il faut revenir un instant à La Transcendance offusquée pour s’en convaincre. On y lit en effet ceci de capital que la science trinitaire « n’est plus du ressort du seul Diaphorisme transcendantal qui atteint rationnellement à la seule dimension de l’âme comme image principielle, car cette Science Trinitaire demande que l’âme ait grandi sur le chemin de la ressemblance, qu’elle ait été guidée par le surplus mystique de la croissance paraclètique. » Et encore : « Le Diaphorisme transcendantal est la condition de la conscience pour cet accroissement car du Principe il reçoit dans l’accession permanente à l’image le gage paraclètique capacitaire, mais le Diaphorisme transcendantal n’est pas lui-même cet accroissement car cette croissance est l’œuvre même de l’Initiative du Principe qui est Esprit Saint. »[2] De vrai, la catégorie même de raison naturelle n’a pas de sens ici, car la raison si elle est la nature de l’homme, n’est jamais un fait seulement de la nature : la panoranoèse n’est proprement ni naturelle ni même surnaturelle, mais antéréelle, elle est « la conscience in statu anterealitatis »[3] ou bien plutôt, en l’occurrence, la conscience remise à sa réflexivité possibilisatrice, c’est-à-dire à sa dimension antéréelle. La raison, sauf dans la mesure précise où elle est obscurcie par le péché, n’est jamais indépendante de la Révélation, ou, pour mieux dire, la lumière qui éclaire l’homme par la Révélation ne diffère pas de celle qui l’éclaire au-dedans de son âme. C’est en ce sens que Maxence Caron peut parler de « PréIncarnation du Principe en l’homme »[4], pour désigner son être réflexif ; et de citer à l’appui une formule de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité : « il se fait en mon âme comme une Incarnation du Verbe ». Il faut donc, et c’est de toute première importance, commencer par restituer la conscience à sa condition de possibilité qui est la réflexivité, puis reconduire cette réflexivité elle-même à sa source, c’est-à-dire la considérer dans sa relation d’institution et de constitution avec le Principe. Autrement dit, et cela explique pourquoi la science trinitaire « n’est plus du ressort du seul Diaphorisme transcendantal », la rationalité dont il est ici question est toujours celle d’une conscience abandonnée à la toute-initiative de précédence du Principe, c’est une rationalité toujours fidèle, donc fonctionnant en régime de foi, qui signifie la pleine fidélité à ce qu’elle est et ce dont elle est. La proclamation du Catéchisme de l’Église catholique est dès lors pleinement respectée qui est la suivante : « Dieu certes a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de Création et dans sa Révélation au cours de l’Ancien Testament. Mais l’intimité de Son Être comme Trinité Sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison et même à la foi d’Israël avant l’Incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint Esprit. »[5] L’on peut même voir là manière de synthèse de ce que Le Verbe proscrit accomplit dans son ensemble : reconduire tout ce qui fut déjà pensé à son ultime et à sa suprême condition de possibilité, c’est à savoir l’Incarnation du Fils et la mission du Saint Esprit. Tout le système a été écrit, toujours déjà, au point de vue ouvert ou rouvert par la Révélation en son point le plus haut, et le plus intense, qui est la venue dans le monde du Principe du monde en personne. Le point d’arrivée est le point de départ ; et la fin était bel et bien dans le commencement, mais tacite encore, et implicite.
Il s’agit désormais, donc, de faire voir ce qui fonde, suprêmement, la possibilité pour l’auteur de parler et de penser en la façon qui est la sienne depuis le premier volume de sa tétralogie. Que la Trinité soit méditée selon elle-même n’est possible à la fin que parce que, depuis le début, elle est le lieu où la reconnaissance de la consistance panoranoétique place la conscience. Être tenu et maintenu dans la dimension de précédence qu’est la pensée connue comme liberté, c’est-à-dire comme différence réflexive antéréelle, c’est être tenu et maintenu, toujours déjà, dans le déploiement de la Décision de franchissement créatrice du Principe, et c’est en conséquence être tenu et maintenu, toujours déjà, dans le fondement trinitaire de cette décision amoureuse. Or, la compréhension aussi complète que possible à l’esprit humain de cette fondation trinitaire ne peut advenir que par une prise en compte du fait de l’Incarnation, qui n’est pas autre chose que la présentation à l’homme de la Décision amoureuse qui le suscite. Et c’est cela, précisément, qui définit et distingue la spécificité de ce troisième volume, en ce que, écrit Maxence Caron, l’on passe avec celui-ci du « Système du diaphorisme transcendantal » au « Principe du diaphorématisme transcendantal »[6]. En effet, de l’un à l’autre, il y a cet approfondissement de l’essence diaphorique de la réflexivité, qui conduit à faire apparaître pleinement, au cœur d’elle, la présence du Verbe en sa puissance spécifique d’incarnation, c’est-à-dire d’advenue en propre, en personne, au sein même de la dimension de finitude que le Principe a posée, et d’une manière telle qu’il va jusqu’à la mort, et jusqu’à la traversée de la mort. Plus simplement : il s’agit désormais de lier explicitement la réflexivité et l’Incarnation, pensée en ses plus amples déploiements, qui sont la mort et la résurrection du Christ, lesquels, tous deux, sont les signes efficaces de l’illimitation de la Décision créatrice, et par là de la disproportion qui est entre la teneur infinie et parfaitement consistante en soi de l’Être, d’une part, et d’autre part celle, passagère et finie, des étants créés. À quoi il faut ajouter que l’Incarnation avère la liberté humaine, et lui révèle tout à la fois son origine et sa profondeur et son étendue, en ceci qu’elle lui fait voir que, quoi qu’elle décide, quoi qu’elle fasse, où qu’elle veuille aller se perdre, au plus loin d’elle-même, son Créateur a la volonté et la puissance de l’aller rechercher. L’Incarnation manifeste que le don de Dieu ignore tout abandon, comme il ignore toute absence : il est toujours avec l’homme, où que l’homme soit, où qu’il désire de s’égarer. Aussi loin de son Principe que l’homme espère s’enfuir, il le retrouvera toujours en avant et au-devant de lui.
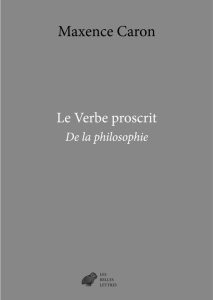 Or donc, Le Verbe proscrit commence où s’arrêtait La Transcendance offusquée, c’est à savoir sur les deux conclusions suivantes : d’abord, le fait que la pensée n’est telle que par présence en elle du Verbe, c’est-à-dire en tant que PréIncarnation ; ensuite, le fait plus complexe que la Décision de franchissement par le Principe de sa propre Différence infinie se déploie selon sa propre infinité, c’est-à-dire prête à excéder toutes les dimensions de la finitude où elle apparaît. Autrement dit, « il y a au cœur du diaphorisme la présence même structurelle de la parole et de l’assentiment à souffrir le sang pour éployer l’Éternité »[7]. Dans le passage donc, qui est intensification pensive, du diaphorisme au diaphorématisme, il faut entendre les deux mots grecs, contractés, de ῥῆμα, la parole, et αἷμα, le sang ; lesquels sont tous deux les conséquences de la méditation, jusqu’au bout, du concept même de PréIncarnation, de présence pré-incarnative du Verbe dans l’âme, et qui seule la constitue réflexive. Mais il faut aussi nommer cette présence de l’effusion extrême du sang consentie au sein même du Principe, et tel est le sens de l’un des concepts fondamentaux de l’ouvrage : la Prohémaïrèse, construit en intégrant « αἷμα », le sang donc, au cœur littéral de « προαίρεσις », la décision. Il n’y a pas deux décisions en Dieu, d’abord la création, et puis, après coup, l’Incarnation et la Passion, pour courir après l’homme, et le rattraper au plus bas de sa catastrophe. Il n’y a qu’une seule et même décision, prise dans l’infinité de l’amour divin, qui contient toujours déjà la possibilité de se déployer par-delà la mort, laquelle il ne faut pas l’oublier n’est pas autre chose que le plus noir des fruits noirs du péché. Ainsi, la continuité rationnelle de la Passion (mort et résurrection du Christ), de l’Incarnation et de la Création est-elle posée d’emblée comme condition de toute méditation ultérieure. Hors de là, rien n’est pensable, et surtout pas la consistance trinitaire de l’Être même par soi subsistant. C’est pourquoi la deuxième partie du Verbe proscrit, celle sur quoi nous allons concentrer nos efforts et qui est son centre spéculatif, porte le titre suivant : « Endodiaphase et Staurorématique : la Trinité et l’Incarnation »[8]. L’Endodiaphase en effet dit la teneur proprement trinitaire de la Trinité, considérée et exprimée selon elle-même ; et la staurorématique dit, de manière littérale, la « parole de la Croix », c’est-à-dire la pensée qui place au centre et de la décision de création, et de l’âme humaine comme éminent résultat de cette décision, la possibilité transcendantale du sacrifice sanglant, de la mort traversée et transverbérée. Citons par anticipation, afin que la destination spéculative soit lisible d’emblée : « la structure de la réflexivité est formée par celle de la Croix, au regard souverain du Principe : en sa possibilité comme en sa naissance, en son antéréalité comme en son essence, la conscience est staurorhème »[9]. Tel est le dernier degré à quoi le Système nous conduira, quant à la connaissance de l’âme humaine.
Or donc, Le Verbe proscrit commence où s’arrêtait La Transcendance offusquée, c’est à savoir sur les deux conclusions suivantes : d’abord, le fait que la pensée n’est telle que par présence en elle du Verbe, c’est-à-dire en tant que PréIncarnation ; ensuite, le fait plus complexe que la Décision de franchissement par le Principe de sa propre Différence infinie se déploie selon sa propre infinité, c’est-à-dire prête à excéder toutes les dimensions de la finitude où elle apparaît. Autrement dit, « il y a au cœur du diaphorisme la présence même structurelle de la parole et de l’assentiment à souffrir le sang pour éployer l’Éternité »[7]. Dans le passage donc, qui est intensification pensive, du diaphorisme au diaphorématisme, il faut entendre les deux mots grecs, contractés, de ῥῆμα, la parole, et αἷμα, le sang ; lesquels sont tous deux les conséquences de la méditation, jusqu’au bout, du concept même de PréIncarnation, de présence pré-incarnative du Verbe dans l’âme, et qui seule la constitue réflexive. Mais il faut aussi nommer cette présence de l’effusion extrême du sang consentie au sein même du Principe, et tel est le sens de l’un des concepts fondamentaux de l’ouvrage : la Prohémaïrèse, construit en intégrant « αἷμα », le sang donc, au cœur littéral de « προαίρεσις », la décision. Il n’y a pas deux décisions en Dieu, d’abord la création, et puis, après coup, l’Incarnation et la Passion, pour courir après l’homme, et le rattraper au plus bas de sa catastrophe. Il n’y a qu’une seule et même décision, prise dans l’infinité de l’amour divin, qui contient toujours déjà la possibilité de se déployer par-delà la mort, laquelle il ne faut pas l’oublier n’est pas autre chose que le plus noir des fruits noirs du péché. Ainsi, la continuité rationnelle de la Passion (mort et résurrection du Christ), de l’Incarnation et de la Création est-elle posée d’emblée comme condition de toute méditation ultérieure. Hors de là, rien n’est pensable, et surtout pas la consistance trinitaire de l’Être même par soi subsistant. C’est pourquoi la deuxième partie du Verbe proscrit, celle sur quoi nous allons concentrer nos efforts et qui est son centre spéculatif, porte le titre suivant : « Endodiaphase et Staurorématique : la Trinité et l’Incarnation »[8]. L’Endodiaphase en effet dit la teneur proprement trinitaire de la Trinité, considérée et exprimée selon elle-même ; et la staurorématique dit, de manière littérale, la « parole de la Croix », c’est-à-dire la pensée qui place au centre et de la décision de création, et de l’âme humaine comme éminent résultat de cette décision, la possibilité transcendantale du sacrifice sanglant, de la mort traversée et transverbérée. Citons par anticipation, afin que la destination spéculative soit lisible d’emblée : « la structure de la réflexivité est formée par celle de la Croix, au regard souverain du Principe : en sa possibilité comme en sa naissance, en son antéréalité comme en son essence, la conscience est staurorhème »[9]. Tel est le dernier degré à quoi le Système nous conduira, quant à la connaissance de l’âme humaine.
Mais avant que d’aller plus avant, rappelons brièvement quelques points. La pensée n’est possible que par la présence en l’homme du Principe, par mode d’image, ou bien plutôt la pensée n’est pas autre chose que cette présence même, qui déploie dans l’homme l’espace intime d’une rétrocession infinie sur tout objet, et sur elle-même au-dedans d’elle, faisant de l’âme un non-lieu naturel, un lieu surnaturel au sein même de la nature, qui se tient et consiste en soi à côté de tout étant naturel que précisément, par-là même, elle peut prendre en considération. Cet espace est la dimension propre de l’âme en tant que mens ad imaginem Dei, à savoir la « dinanimension », ou « dimension eïkautopoïète »[10] que longuement présente et étudie La Transcendance offusquée. Ainsi, l’Être transmet-il la Différence de sa transcendance à l’âme humaine, en la faisant 1/ différente infiniment de toute chose à l’entour ; mais aussi et surtout 2/ constituée par une fractale réflexive intime qui la rend infiniment différente d’elle-même, et capable d’être toujours avant ou au-devant d’elle-même (en pensant qu’elle pense, et en pensant qu’elle pense qu’elle pense, etc). Mais il y a plus. De par sa détermination d’image, l’âme de l’homme a vocation ontologique suprême à se tourner non seulement vers les étants naturel, mais surtout et par-dessus tout vers son Modèle, – à faire donc en quelque sorte retour vers lui afin d’attendre à la plénitude et perfection de son essence d’image, s’accomplissant alors dans la ressemblance en actes avec son Principe. La pensée est faite pour penser Dieu, en toutes choses et en lui-même ; c’est là, et non ailleurs, qu’elle s’accomplit selon sa nature et sa destination. Ou encore : « la connaissance de la Trinité est le sens de toutes les connaissances possibles »[11]. Il n’est rien de profane pour la pensée, et surtout pas elle-même, qui est tissée de sacralité, ainsi que de sacramentalité. La pensée est donc et littéralement sacra-mentis, sacrée en tant que mens, en tant qu’espace ouvert sur l’Infini, par la présence dans l’homme de l’Infini lui-même, sur le mode de l’image. Aussi n’est-elle jamais plus ni mieux fidèle à son essence que lorsqu’elle tourne son attention vers Dieu, et tâche non de le mesurer aux catégories de sa finitude, mais au contraire « connaît l’immensurabilité de la Différence fondamentale pour seul étalon et applique cette mesure absolument antécédente, et possibilisatrice de toute évaluation, à la connaissance de l’Ultime »[12]. Ainsi, et seulement ainsi, « le cœur même dont est tissé l’infini éclat de la Gloire prononce de soi-même sa teneur et avère la Trinité comme seule stance de l’unité de la Transcendance dont la Différence infinie a pour essence de démultiplier infiniment en soi et dans l’unité de soi l’indicible éclat de sa Gloire ». Il faut donc laisser paraître, d’elle-même et dans sa propre lumière, la texture intime du Principe, qui est Trinité, et qui certes ne se déduit ni a priori ni a posteriori, mais qui se révèle dans sa propre image, et se révèle à sa propre image, dès lors que celle-ci accepte de se déprendre de toute ambition de primauté et de précédence. L’enjeu, bien sûr, est de penser la démultiplication intime de la substance divine sans pour autant penser en elle une quelconque division, d’une part, et d’autre part de la penser hors toute catégorie transitive, c’est-à-dire intrinsèquement liée au transcendement, comme celle du procès, du déploiement, etc. Ni donc introduire en Dieu de la différence avec soi, ni du mouvement – ce qui était très précisément le double geste spéculatif que Hegel avait accompli en son temps, avec le génie que l’on sait[13].
Cela commence par se demander ce que signifie, en toute rigueur, que d’être fini, ou bien plutôt que d’être l’Être infini, celui qui est purement et simplement, sans contrainte, sans limite, sans succession, sans besoin et sans défaut. Un tel infini, seul véritable, ne peut s’échapper à lui-même, il ne peut se dérober à lui-même, puisqu’elle ne connaît point de borne ; il se tient donc parfaitement en lui-même, il consiste et il in-siste pleinement par soi. Son extensivité sans fin est, en même temps et par elle-même, intensivité sans limite. S’il n’avait pas cette tenue qui est sa seule teneur possible, il n’en aurait aucune digne de son infinité. L’Être par soi, infini, se con-tient, donc se « tient avec » lui-même, du simple et du seul fait de son unité illimitée ; et dès lors il y a présence de l’Être à lui-même, en un mot il y a l’Être lui-même, l’Être et lui-même, que la théologie nomme le Père (l’Être) et le Fils (l’Être lui-même, identique à soi, subsistant comme la connaissance de l’identité à soi de l’Être, infiniment même que soi). Présence, donc, de l’infini à l’infini, qui démultiplie infiniment l’infini en lui-même, – et qui par là ne fait rien autre chose que d’ex-pliquer, de déployer, l’essence même de l’infini dont, par définition, il est absurde de penser qu’il peut être moins qu’une infinité de lui-même, qu’une multiplication de soi par soi, dans soi-même. Ou encore, comme l’écrit Maxence Caron : « le Principe a donc pour Présence l’extension et l’extensivité infinies de l’infini propre à l’infini dans l’unité de l’infini, autrement dit l’engendrement de l’infinité au sein de l’infinité, et, en miroirs jumeaux face-à-face, l’infini regardant l’infini et le démultipliant infiniment par lui-même »[14]. Cette disposition intime de l’Être plongeant son propre regard en lui-même, et par là même avérant son infinité en la démultipliant de manière intensive, cette disposition est désignée dans Le Verbe proscrit par le nom d’Endodiaphase : soit la transparence intérieure (ἔνδον et διαφανής), soit l’affirmation intérieure de la Différence divine (ἔνδον, διά et φάσις). Ou plutôt : l’un et l’autre simultanément, puisque l’affirmation de la consistance en soi du Principe est aussi, et en tant que telle, la transparence à soi de l’immensité divine, qui se sait telle et s’aime dans cette coïncidence parfaite, et donc infinie, de l’infini avec lui-même.
 Cependant, il ne faut pas se laisser fasciner croyons-nous par la considération, ici prépondérante, de l’Être sous l’aspect de son infinité : ce qui demeure au fondement du déploiement de sa structure trinitaire, c’est sa consistance ou son in-sistance en soi-même. « L’Endodiaphase, note Maxence Caron, équivaut à ce qu’inclut la stance de la Trinité »[15]. Constat aussi discret en apparence qu’important en réalité, afin d’abord de ne pas commettre de contresens lorsque l’on lit, à mainte reprise, que la teneur propre du Principe est « l’expansion », ou « l’expansion illimitée ». Il ne s’agit là d’aucun mouvement ni de croissance ni de développement : l’expansion intime de l’Être trinitaire est une « stante expansion »[16], autrement dit la démultiplication éternelle de soi par la seule et simple affirmation de soi selon soi-même. Dès lors, si l’infini paraît exhaussé au rang d’attribut principal du Principe, il ne faut pas se méprendre : c’est toujours et c’est uniquement en vue d’expliquer par lui-même le fait de sa subsistence en soi, parfaite, qui fonde sa transcendance sur toute autre chose que lui. L’Endodiaphase signifie ainsi et littéralement la teneur de l’Être, sa tenue en soi, – et l’expansion qui en est déduite n’est pas une accroissement mais l’impropre (forcément impropre) façon de dire sa présence à soi, donc le fait d’être au-devant (præ sum) soi-même, auprès de soi sans sortir de soi. Ne pas s’échapper, pour l’Être même, c’est contenir sa propre infinité, la considérer et la comprendre – donc porter sur elle un regard approbateur qui soit de parfaite, pleine et immédiate coïncidence, sans nulle distanciation phénoménologique entre soi et soi-même, sans nul rebond au-dehors afin de revenir à soi. Ne pas s’échapper, pour l’Être même, c’est consister en Trinité. Comme l’écrit Thomas d’Aquin, « ex hoc ipso quod esse Dei est per se subsistens non receptum in aliquo, prout dicitur infinitum, distinguitur ab omnibus aliis », c’est-à-dire « de cela même que Dieu est subsistant par soi, et non reçu dans un autre, selon quoi il est dit infini, il se distingue de tout autre étant »[17]. On le voit, l’infini est dit de Dieu selon sa subsistence par soi, et non l’inverse : il est l’ex-plication de la perfection de l’Être, considéré dans sa transcendance et dans sa Différence fondamentale. La Trinité est le seul nom possible, exact et précis, pour l’Être même subsistant par soi, dont l’infinité est seule mesure, autrement dit dont l’infinité est seule dé-mesure, non pas au sens d’une perte de soi dans une immensité indistincte même et d’abord pour elle-même, mais au sens au contraire d’une intensification immensurable de sa consistance ontologique, ou encore de son in-stance dans et par soi. Ce pourquoi la théologie nomme chaque hypostase une Personne, la Personne étant la réalité la plus dense qui se puisse concevoir, celle-là qui se possède plus et mieux que toute autre, et celle-là enfin à qui le terme de « subsistence » se peut appliquer suprêmement. La personne en effet est cela qui, par excellence, existe par soi ; ce qui est, précise saint Thomas, le mode d’existence le plus digne[18]. Mais comment comprendre le rapport entre ce mode d’être par soi, et l’autre détermination fondamentale de la personne qui est, en tant même que « ce qu’il y a de plus parfait dans la nature », également et surtout « ce qui subsiste dans une nature raisonnable »[19] ? En considérant que la subsistence en soi et par soi désigne le plus haut degré d’intensité ontologique qui soit, lequel implique nécessairement la proximité profonde de l’étant avec lui-même, c’est-à-dire la présence de soi à soi-même, l’ontoréflexivité. Au double sens du verbe, Dieu se conçoit : il n’est pas débordé, excédé, dépassé par lui-même, donc il se tient dans sa propre et parfaite considération de soi ; mais en outre et par-là même, il s’engendre, il engendre en lui-même non pas un deuxième dieu, mais une deuxième hypostase[20], c’est-à-dire qu’il démultiplie intimement l’infini de sa tenue et de sa teneur en soi-même, l’Être divin n’étant qu’une seule subsistence, mais en trois « stases », en trois relations subsistantes, – ie. celle de connaissance et celle d’amour.
Cependant, il ne faut pas se laisser fasciner croyons-nous par la considération, ici prépondérante, de l’Être sous l’aspect de son infinité : ce qui demeure au fondement du déploiement de sa structure trinitaire, c’est sa consistance ou son in-sistance en soi-même. « L’Endodiaphase, note Maxence Caron, équivaut à ce qu’inclut la stance de la Trinité »[15]. Constat aussi discret en apparence qu’important en réalité, afin d’abord de ne pas commettre de contresens lorsque l’on lit, à mainte reprise, que la teneur propre du Principe est « l’expansion », ou « l’expansion illimitée ». Il ne s’agit là d’aucun mouvement ni de croissance ni de développement : l’expansion intime de l’Être trinitaire est une « stante expansion »[16], autrement dit la démultiplication éternelle de soi par la seule et simple affirmation de soi selon soi-même. Dès lors, si l’infini paraît exhaussé au rang d’attribut principal du Principe, il ne faut pas se méprendre : c’est toujours et c’est uniquement en vue d’expliquer par lui-même le fait de sa subsistence en soi, parfaite, qui fonde sa transcendance sur toute autre chose que lui. L’Endodiaphase signifie ainsi et littéralement la teneur de l’Être, sa tenue en soi, – et l’expansion qui en est déduite n’est pas une accroissement mais l’impropre (forcément impropre) façon de dire sa présence à soi, donc le fait d’être au-devant (præ sum) soi-même, auprès de soi sans sortir de soi. Ne pas s’échapper, pour l’Être même, c’est contenir sa propre infinité, la considérer et la comprendre – donc porter sur elle un regard approbateur qui soit de parfaite, pleine et immédiate coïncidence, sans nulle distanciation phénoménologique entre soi et soi-même, sans nul rebond au-dehors afin de revenir à soi. Ne pas s’échapper, pour l’Être même, c’est consister en Trinité. Comme l’écrit Thomas d’Aquin, « ex hoc ipso quod esse Dei est per se subsistens non receptum in aliquo, prout dicitur infinitum, distinguitur ab omnibus aliis », c’est-à-dire « de cela même que Dieu est subsistant par soi, et non reçu dans un autre, selon quoi il est dit infini, il se distingue de tout autre étant »[17]. On le voit, l’infini est dit de Dieu selon sa subsistence par soi, et non l’inverse : il est l’ex-plication de la perfection de l’Être, considéré dans sa transcendance et dans sa Différence fondamentale. La Trinité est le seul nom possible, exact et précis, pour l’Être même subsistant par soi, dont l’infinité est seule mesure, autrement dit dont l’infinité est seule dé-mesure, non pas au sens d’une perte de soi dans une immensité indistincte même et d’abord pour elle-même, mais au sens au contraire d’une intensification immensurable de sa consistance ontologique, ou encore de son in-stance dans et par soi. Ce pourquoi la théologie nomme chaque hypostase une Personne, la Personne étant la réalité la plus dense qui se puisse concevoir, celle-là qui se possède plus et mieux que toute autre, et celle-là enfin à qui le terme de « subsistence » se peut appliquer suprêmement. La personne en effet est cela qui, par excellence, existe par soi ; ce qui est, précise saint Thomas, le mode d’existence le plus digne[18]. Mais comment comprendre le rapport entre ce mode d’être par soi, et l’autre détermination fondamentale de la personne qui est, en tant même que « ce qu’il y a de plus parfait dans la nature », également et surtout « ce qui subsiste dans une nature raisonnable »[19] ? En considérant que la subsistence en soi et par soi désigne le plus haut degré d’intensité ontologique qui soit, lequel implique nécessairement la proximité profonde de l’étant avec lui-même, c’est-à-dire la présence de soi à soi-même, l’ontoréflexivité. Au double sens du verbe, Dieu se conçoit : il n’est pas débordé, excédé, dépassé par lui-même, donc il se tient dans sa propre et parfaite considération de soi ; mais en outre et par-là même, il s’engendre, il engendre en lui-même non pas un deuxième dieu, mais une deuxième hypostase[20], c’est-à-dire qu’il démultiplie intimement l’infini de sa tenue et de sa teneur en soi-même, l’Être divin n’étant qu’une seule subsistence, mais en trois « stases », en trois relations subsistantes, – ie. celle de connaissance et celle d’amour.
Transposé analogiquement à l’Être principial, qui est au sens littéral subsistant par excellence – cela veut dire la perfection que nomme précisément l’Endodiaphase, dont l’approfondissement conduit à la notion d’énantioménalité. De vrai, nous tournions autour d’elle depuis quelque temps, sans le dire, lorsque nous tâchions à souligner qu’il appartient essentiellement au Principe, considéré dans sa consistance ontologique propre, de se tenir, de se con-tenir, d’être à soi pleine conscience de sa tenue, etc. L’unité en effet du Principe s’exprime, écrit Maxence Caron, « dans l’expansion de l’entre-tien d’immensité, du face-à-face de l’immensité avec soi mirant énantiomilétiquement son infinité »[21]. Décomposons le mot : ἐναντίος signifie « qui se tient en face de », et ὁμιλία tout à la fois « conversation », « entretien », « société », « assemblée ». L’Être par soi subsistant, en tant que trinitaire, possède donc la propriété essentielle de l’énantiomilie comme vérité de l’Endodiaphase : il n’est par nature en relation qu’avec lui-même, mais il l’est selon sa nature ; en d’autres termes, il est en relation tout à la fois infinie et infiniment consistante avec lui-même. Ainsi, « une immensité en relation avec soi-même est naturellement une immensité qui démultiplie par soi-même ce qu’elle est déjà infiniment soi-même »[22]. On voit alors comment et pourquoi ces deux notions se convoquent l’une l’autre, puisqu’il convient de penser le Principe comme tout à la fois infini et subsistant, c’est-à-dire qu’il convient de le penser selon une infinité de qualité et non de quantité, qui s’échappe indéfiniment à elle-même, dans l’extériorité de la série. L’Endodiaphase dit cette expansion statique, cette dilatation stable de l’Être en lui-même, – elle dit l’Être selon son infinité. L’énantioménalité dit quant à elle la con-tenance de l’Être infini en démultiplication intime de soi, elle dit le rapport qu’il doit entretenir avec lui-même, en totalité, pour être une plénitude d’identité à soi, de coïncidence avec soi. « L’énantioménalité, écrit Maxence Caron, est l’élément de la relation substante : l’Énantiomilie est l’essence de la relation subsistante. »[23] Pour donner sens en effet, comme l’a montré La Transcendance offusquée, à la Décision divine d’ouverture de soi à la possibilité de créer un monde infiniment différent de soi, il faut commencer par donner sens à la perfection ontologique du Principe, qui n’est en nécessité d’aucune extériorité. Afin que soit possible la Décision de poser un monde hors de Dieu, il faut que Dieu soit parfaitement en soi, et qu’il soit parfait en soi. Il y a conclusion de Dieu avec lui-même, en quelque sorte. Et l’on comprend alors que Claudel pouvait écrire : « Dieu lui-même a mis en lui le type de la fermeture par la Sainte Trinité »[24]. Car, comme on le peut lire dans Le Verbe proscrit, « c’est parce qu’il est Endodiaphase ou relation en un sens périchorétique différential, que le Principe est sans relation à quoi que ce soit, sans lien au transcendement, qu’il est Différence fondamentale. »[25] L’essence trinitaire de l’Être principial est, tout à la fois, cela par quoi il est complet, et cela par quoi, n’ayant besoin de rien d’autre, il peut librement et amoureusement décider de faire partager la joie d’être à d’autres étants que lui. L’on ne peut se donner qu’à la mesure exacte où l’on s’appartient. Cela est vrai pour l’homme, et aussi et surtout et d’abord pour Dieu. C’est la raison pourquoi ce dernier doit être pensé, si l’on ose dire, comme étant plus encore qu’une personne, – comme étant trois Personnes, qui s’entre-tiennent substantiellement au sein de son unique subsistance. Démultiplication intime de la perfection ontologique de la personnalité, « conclusion » de l’infini sur lui-même, et dans lui-même, comme condition de possibilité non de son extériorisation, comme le voulait Hegel, mais du franchissement par décision d’amour de sa propre clôture, en vue de communiquer à ses créatures, à la mesure de leur finitude, la réjouissante perfection de l’esse, et de communier avec elles en cette jubilation. En somme, et si l’on résume, l’Endodiaphase dit le mode propre de l’infinité divine, cependant que l’énantiomilie dit le mode propre de l’unité divine ; l’une bien sûr ne pouvant pas être pensée sans l’autre[26].
Il ne faudrait pas cependant oublier la troisième hypostase, celle que la théologie nomme le Saint Esprit, l’amour subsistant en Dieu, dont la procession est philosophiquement désignée par Maxence Caron du nom d’énantiagapê. Le Père et son Verbe sont en relation de miroirs jumeaux face à face[27], par quoi l’un engendre éternellement c’est-à-dire infiniment l’autre, sa propre image, sa conception de soi-même, à la mesure de soi-même. L’amour hypostatique, lui, est l’épanouissement – toujours intime bien sûr – de cette relation d’entretien subsistant de l’Être avec lui-même, et dans lui-même. Il en est le gaudium subsistens, la joie subsistante de la plénitude de l’Être qui se considère en sa perfection. « Au sein de cette énantioménalité en qui l’infini conste émultiplicativement en son infinité, écrit Maxence Caron, la relation substante énantioménale se manifeste donc en deux processions énantiomènes : l’Énantiomilie, mettant vis-à-vis l’infini qui engendre et, en miration l’infini engendré – donc le Père et le Fils –, l’Énantiagapê, mettant en vis-à-vis et en communion l’aspiration et l’inspiration soit la spiration de l’amour de l’Inengendré pour le Monogène et du Monogène pour l’Inengendré. »[28] L’unité de connaissance se parachève, si l’on peut dire, dans l’unité de volonté embrasée par elle-même, et embrassante absolument d’elle-même ; en d’autres termes : l’unité de connaissance s’accomplit dans et par l’unité d’amour. Le Principe se sachant, il ne peut que se savoir selon exactement la perfection de son être, et cette connaissance est une joie amoureuse qui subsiste en lui, au même degré d’intensité ontologique que les deux premières hypostases : tel est le Saint Esprit.
 Toutes trois, donc, disent la Trinité, démultiplication subsistante de l’Être même en son infinité, et par son infinité. Et la Trinité, ayant alors manifesté sa teneur propre, manifeste également sa puissance de création, ainsi l’on passe de la considération de l’Endodiaphase (la Trinité en et pour elle-même) à la staurorématique, qui est regard porté sur l’Être du Principe en tant qu’il décide de donner l’être, par amour, à d’autres que lui, et spécialement à l’homme, qu’il dote d’une âme où il met de lui-même la plus parfaite image qui soit au sein du monde, et à qui il offre la plus parfaite participation à sa gloire qui se puisse concevoir pour une créature finie : la participation comme épanouissement de sa propre nature trinitaire, par connaissance de lui et par amour (c’est-à-dire décision libre) de lui. À l’homme il est proposé, il est offert, il est donné de pouvoir connaître et aimer Dieu ; et cette proposition, comme telle, est plus forte que tous les refus ou toutes les fuites, folles ou frénétiques, de la créature humaine – aussi ira-t-elle la rechercher jusqu’au profond des ravins de la mort, au cœur même des ténèbres par elle-même configurées dans l’univers visible. Or, c’est précisément cela, cette précédence absolue non plus cette fois dans l’Être même du Principe, mais dans son action au-dehors, dans sa Décision de créer, qui doit être méditée maintenant. La « Bestimmung des Menschen », pour parler comme Fichte, la vocation de l’homme, c’est d’accomplir l’essence de son âme, forme de son être, qui est image de Dieu, par la ressemblance, c’est-à-dire la fidélité active et pensive à cette « destination ». Car la créature humaine est faite pour Dieu, elle est faite en vue de lui, à fin de lui ; mais elle l’est d’éminente façon, puisqu’elle l’est en conformité avec sa nature libre et rationnelle, qui la rend donc capable d’aller en direction de Dieu par une décision de sa volonté, aimantée par l’amour que fait naître en elle une connaissance véritable et vécue de Celui qui est, et qui l’a toujours déjà aimée infiniment, puisqu’il a désiré la tirer hors du néant (ex nihilo) et lui donner la joie d’être. Ainsi, et pour reprendre le double sens du beau terme allemand de « Bestimmung », l’homme n’est pas déterminé à aimer ni à connaître Dieu, il y est appelé ou convoqué – ce qui signifie qu’il se doit de répondre, par oui ou par non, à littéralement cette pro-vocation de son Principe à devenir aussi sa Destination, à cette pro-vocation du Sens à devenir de manière libre et consciente le sens vers quoi il veut orienter sa vie, enfin à cette pro-vocation de sa Cause à devenir pleinement sa raison d’être. Répondre, c’est correspondre ou ne point correspondre à telle sollicitation qui nous est faite, c’est-à-dire à tel appel qui provient de qui a souci (sollicitatio) de nous.
Toutes trois, donc, disent la Trinité, démultiplication subsistante de l’Être même en son infinité, et par son infinité. Et la Trinité, ayant alors manifesté sa teneur propre, manifeste également sa puissance de création, ainsi l’on passe de la considération de l’Endodiaphase (la Trinité en et pour elle-même) à la staurorématique, qui est regard porté sur l’Être du Principe en tant qu’il décide de donner l’être, par amour, à d’autres que lui, et spécialement à l’homme, qu’il dote d’une âme où il met de lui-même la plus parfaite image qui soit au sein du monde, et à qui il offre la plus parfaite participation à sa gloire qui se puisse concevoir pour une créature finie : la participation comme épanouissement de sa propre nature trinitaire, par connaissance de lui et par amour (c’est-à-dire décision libre) de lui. À l’homme il est proposé, il est offert, il est donné de pouvoir connaître et aimer Dieu ; et cette proposition, comme telle, est plus forte que tous les refus ou toutes les fuites, folles ou frénétiques, de la créature humaine – aussi ira-t-elle la rechercher jusqu’au profond des ravins de la mort, au cœur même des ténèbres par elle-même configurées dans l’univers visible. Or, c’est précisément cela, cette précédence absolue non plus cette fois dans l’Être même du Principe, mais dans son action au-dehors, dans sa Décision de créer, qui doit être méditée maintenant. La « Bestimmung des Menschen », pour parler comme Fichte, la vocation de l’homme, c’est d’accomplir l’essence de son âme, forme de son être, qui est image de Dieu, par la ressemblance, c’est-à-dire la fidélité active et pensive à cette « destination ». Car la créature humaine est faite pour Dieu, elle est faite en vue de lui, à fin de lui ; mais elle l’est d’éminente façon, puisqu’elle l’est en conformité avec sa nature libre et rationnelle, qui la rend donc capable d’aller en direction de Dieu par une décision de sa volonté, aimantée par l’amour que fait naître en elle une connaissance véritable et vécue de Celui qui est, et qui l’a toujours déjà aimée infiniment, puisqu’il a désiré la tirer hors du néant (ex nihilo) et lui donner la joie d’être. Ainsi, et pour reprendre le double sens du beau terme allemand de « Bestimmung », l’homme n’est pas déterminé à aimer ni à connaître Dieu, il y est appelé ou convoqué – ce qui signifie qu’il se doit de répondre, par oui ou par non, à littéralement cette pro-vocation de son Principe à devenir aussi sa Destination, à cette pro-vocation du Sens à devenir de manière libre et consciente le sens vers quoi il veut orienter sa vie, enfin à cette pro-vocation de sa Cause à devenir pleinement sa raison d’être. Répondre, c’est correspondre ou ne point correspondre à telle sollicitation qui nous est faite, c’est-à-dire à tel appel qui provient de qui a souci (sollicitatio) de nous.
Que l’homme donc ne soit pas déterminé mais appelé, cela signifie qu’il est libre, afin d’être capable d’aimer, et que Dieu, en décidant de le créer à son image, se refuse, si l’on peut dire, à jamais s’imposer à lui, à jamais forcer le cœur de sa créature pensante. Le drame advient lorsque la volonté de l’homme se fait contraire à la volonté de Dieu, et se fige et se fixe dans cette diversion qui se nomme le péché. Alors, soudain, et du seul fait de la créature humaine, il y a antagonisme entre sa destination et ses aspirations, – non pas même, donc, antagonisme entre elle et son Principe, mais entre elle et sa propre vérité, car le refus de Dieu est toujours aussi pour l’homme un refus de soi, de sa propre humanité et de sa vocation de liberté, de raison et d’amour. Plus on pèche, moins on n’est selon le cœur de Dieu, c’est-à-dire que plus l’on pèche, moins on est selon l’humaine (donc divine) vocation de l’homme. Comme l’écrivait magnifiquement Léon Bloy, en une page fameuse de Dans les ténèbres : « L’homme ayant compromis sa destinée éternelle par ce qu’on appelle le Péché, Dieu veut qu’il entre dans l’ordre de la Rédemption. Dieu le veut infiniment. Alors s’engage une lutte terrible entre le cœur de l’Homme qui veut fuir par sa liberté et le Cœur de Dieu qui veut se rendre maître du cœur de l’homme par sa puissance. On croit assez facilement que Dieu n’a pas besoin de toute sa force pour dompter les hommes. Cette croyance atteste une ignorance singulière et profonde de ce qu’est l’homme et de ce qu’est Dieu par rapport à lui. La liberté […] n’est rien que ceci : le respect que Dieu a pour nous. Et ce respect est à un tel point que jamais, depuis la loi de grâce, Il n’a parlé aux hommes avec une autorité absolue, mais au contraire avec la timidité, la douceur et je dirai même l’obséquiosité d’un solliciteur indigent qu’aucun dégoût ne serait capable de rebuter. Par un décret, très mystérieux et très inconcevable, de sa volonté éternelle. Dieu semble s’être condamné jusqu’à la fin des temps à n’exercer sur l’homme aucun droit immédiat de maître à serviteur, ni de roi à sujet. »[29] Mais cela signifie-t-il pour autant que Dieu, comme nous l’avons déjà suggéré plus haut, court derrière l’homme, et s’adapte en quelque sorte ou bien plutôt adapte ses sollicitations et ses appels, aux réponses de sa créature ? Non, bien sûr, car en nulle situation le Principe ne peut être conçu comme n’étant pas premier. En conséquence de quoi, dans la profondeur et l’intimité de l’unique Décision d’amour par quoi Dieu choisit de créer le monde et l’homme, il se trouve la possibilité transcendantale d’aller à la rencontre de l’âme humaine où qu’elle se veuille égarer. Autrement dit, la possibilité de l’Incarnation est comprise, de manière toute rationnelle, dans l’événement même de la création de l’homme, du don de l’être à une créature libre. Et cet événement, à son tour, est reconduit par le Système à la subsistence trinitaire du Principe. Parce que Dieu est, au sens absolument parfait du terme, parce que donc il est comme Trinité, alors il peut franchir l’infinie distance qui le sépare ce qu’il décide, par amour, de faire advenir à la joie d’être. Enfin, il peut également, et dans la même décision, venir personnellement en présence dans la dimension ouverte par son acte créateur, venir personnellement en présence au cœur de sa Création, afin d’exprimer sa précédence toute-puissance sur tous les errements possibles de l’humanité, ainsi que sur toutes les possibles conséquences de ces errements, – jusqu’à la mort. La condescendance de Dieu jusqu’au cœur des abîmes où l’homme se vautre apparaît alors comme le corrélat rigoureux de sa transcendance.
Mais désormais que la dimension trinitaire du Principe est ouverte en et pour elle-même, il convient de préciser le rôle surtout du Verbe, mais aussi de l’Esprit, dans l’événement de la création de l’homme, et c’est précisément ce à quoi nous convie la méditation approfondie de la PréIncarnation, c’est-à-dire du propre de la dimension de l’âme, qui est image de Dieu et comme telle qui reconduit et reproduit en elle le Verbe. Ainsi, écrit Maxence Caron, « la Paradidonodiaphore ouvre la dimension de l’âme et nous offre de nous y maintenir de sorte que, remis à la PréIncarnation initiale du Logos dans la diaphoranoèse, nous soyons semblables à ce que le Fils assume pour nous y conduire, nous y ramener, nous y maintenir, et nous reproduisons ainsi, en fin et plénitude, dans la communion absolue qu’il nous offre avec sa Présence et sa principialité Transcendante, nous reproduisons, dans l’image que nous sommes du Principe, l’image consubstante connaturelle qui nomme la relation du Principe à son Logos. »[30] Attardons nous quelques instants sur cette phrase dense et difficile. La Paradidonodiaphore, d’abord, qu’est-ce ? Dans Le Verbe proscrit, ce qui relève du franchissement de soi que choisit d’accomplir Dieu en créant, ou encore de la dimension de transmissibilité de soi, que Dieu décide car elle n’est en rien attachée nécessairement à son être, – cela donc est désigné par le mot de Paradidonodiaphase. Le terme quant à lui de Paradidonodiaphore désigne de plus spécifique façon ce qui, dans cette décision, se donne l’homme (PréIncarnation) et son salut (Incarnation) pour finalité. Littéralement, cela signifie que le Principe se porte (φέρω), par-delà lui-même, au cœur de sa propre Création, afin qu’y soit présente en Personne la possibilité pour l’homme de se tenir à nouveau dans la dimension diaphorématique de sa propre conscience, et donc dans l’image vive du Verbe. Ce faisant, Dieu ne renonce pas à sa nature divine ; au contraire, il trans-porte la plénitude de sa gloire et de sa grâce, la perfection de son Être, au sein du domaine du transcendement et de la finitude. Nulle déchéance du Principe, dès lors, mais une assomption de l’homme déchu dans la subsistance divine qui, l’exhaussant en elle, le sauve. Ce que la théologie formule en proclamant et en méditant que le Christ possède deux natures, divine et humaine, qui subsistent dans une seule personne, laquelle est divine, laquelle n’est autre que le Fils lui-même. C’est pourquoi, au fond, la Résurrection du Christ n’a rien même d’étrange, de bizarre ou de surprenant, une fois admise et comprise la continuité rationnelle qui préside à l’approfondissement ou au prolongement de la Création dans la création spécifique de l’homme, où le Verbe se pré-incarne, et qui elle-même implique sa destination surnaturelle librement par lui consentie, ou bien refusée, c’est-à-dire son salut et par là même la possibilité de l’Incarnation comme prise en considération par le Principe de toutes les conséquences, même et surtout les plus funestes, du don à sa créature raisonnable de la liberté. En donnant à l’homme l’être et la pensée, donc la liberté et l’amour, Dieu évidemment agit en telle sorte que jamais, quoi que l’humanité fasse de ce privilège, sa puissance infinie pourra toujours l’atteindre et lui proposer ce qu’il la désire voir embrasser de tout cœur : la béatitude éternelle. Dieu donc ne s’adapte pas, comme un père à celles de ses enfants, aux « bêtises » de l’homme, fussent-elle si graves que le péché originel ; il ne change pas non plus, suite à ces bêtises, le dessein qu’il a sur lui. Comme l’écrit le frère Jean-Miguel Garrigues, « la Rédemption réside dans la manière dont elle se réalise pour nous à travers le péché, mais elle n’est pas seulement une réponse au péché, elle précède notre création elle-même, car elle lui donne sa finalité dans le dessein de Dieu »[31]. La Rédemption précède la création ; ou plus exactement : la Rédemption est toujours déjà comprise dans la Décision de création, elle est au cœur même de cette Décision. Car toute possibilité d’effarement, d’égarement, d’effondrement, doit être dès lors comprise, de toute éternité, dans la seule et simple décision de créer l’homme en tant qu’homme, en tant que créature rationnelle capable de participer suprêmement à la nature divine elle-même.
C’est ainsi qu’il faut comprendre la mystérieuse déclaration de saint Pierre, dans sa Première Épître, où l’on peut lire que les hommes ont été rachetés « par le précieux sang de Jésus-Christ, comme de l’Agneau sans tache et sans défaut, qui avait été prédestiné avant la création du monde » (I P 1, 19-20). L’agneau était signe et symbole du Christ en son aspect proprement sacrificiel, il paraît de prime abord incongru, inexplicable, voire scandaleux, que saint Pierre le proclame prédestiné dès avant la création du monde – dès avant même, donc, toute possibilité de péché, et de mort. De vrai, il n’en est rien, l’agneau innocent étant en effet prédestiné toujours déjà, dans l’amoureuse Décision de création du monde, comme le signe même de la toute-initiative du Principe, laquelle il a désir de conserver bien sûr vis-à-vis de sa créature aimée, quelles que soient ses fautes, et ses endurcissements, et ses révoltes. L’agneau sacrificiel, « sans tache et sans défaut », est au cœur du dessein créateur de Dieu, il est l’amour même de Dieu en tant qu’il peut et qu’il veut pouvoir recevoir de la liberté humaine la contradiction la plus extrême. Ainsi, selon un raccourci lumineux et très exact du frère Jean-Miguel Garrigues : « c’est le mystère de notre liberté qui donne la forme de l’agneau au dessein éternel de Dieu »[32]. Au point de vue de la considération de la forme même de l’essence d’homme, libre et rationnelle, libre parce que rationnelle, cela signifie que la dimension de possibilité incarnative et sacrificielle (la dimension du sang divin) est inscrite dans, et lisible à même, déjà, la structure ontoréflexive de la conscience humaine. Ce pourquoi l’âme, en sa texture réflexive, donc panoranoétique, est dite « staurorhème », car « la différence réflexive de la panoranoèse porte, signifie, manifeste et désigne antéréellement, et dans les termes d’une exacte simultanéité, la Différence fondamentale, d’une part, et le franchissement de la Différence fondamentale dans la Décision paradidonodiaphorique, donc dans la Prohémaïrèse, d’autre part. »[33] Ou encore, à la même page : « la conscience, la réflexivité, est ainsi imprégnée, à même soi et avant soi, de la prohémaïrétique miséricorde qui est source de la PréIncarnation et dans la possibilitation de laquelle s’ouvre l’immensité rétrocessive de la fractale réflexive. » Simplifions : la Croix, la possibilité de la Croix, et l’effusion du saint sang de Jésus-Christ, est déjà dans la structure réflexive de la conscience humaine, qui la fonde et dont elle provient[34].
Revenons à la phrase plus haut citée, afin de bien entendre le rôle précis du Verbe dans cette continuité rationnelle qui va de la Création jusques à la Croix – en ligne droite, si l’on ose dire. C’est donc l’Incarnation qui « ouvre à chacun la possibilité de se maintenir au cœur de la dimension diaphorique de l’homme »[35], autrement dit, après la Chute, c’est par le fait de la présence réelle, concrète et personnelle du Verbe parmi l’humanité, qu’il est donné à l’homme, qu’il lui est redonné, d’habiter la dimension antéréelle de sa propre conscience, de se tenir donc à la hauteur de son âme, bref, de retrouver son centre et d’y demeurer. Répétons-le : on comprend alors que la totalité du Système parle, et parlait toujours déjà, depuis ce lieu-là, celui de l’Incarnation, depuis le lieu même qu’à présent il désigne en toute clarté. L’advenue du Verbe, en Personne, parmi les hommes, rend possible à ceux-ci d’être remis aux mains de leur propre essence, qui est la réflexivité, et de se tenir en eux-mêmes ; elle rend en somme les hommes à ce pour quoi ils sont faits ; elle les rend à leur destination qui est de ressembler au Principe, et de reproduire à notre échelle « l’image de Dieu qu’est le Fils »[36]. Imiter le Christ en effet, parfaite image du Principe venue parmi les hommes, c’est atteindre à la perfection de sa nature humaine, en conduisant son âme, image de Dieu, vers la ressemblance pleine et conscience, vivante et active. Imiter le Christ, c’est se rejoindre, c’est rejoindre la dimension propre de son âme, dont le fonctionnement parfait n’est pas autre chose que de reproduire à sa mesure la relation de filiation qui unit le Père et le Fils, et de l’un à l’autre conspire une société d’amour dans le Saint Esprit. Il faut préciser en effet que la décision de franchissement, Création et Incarnation, est prise dans l’amour et pour l’amour – elle est ainsi pleinement un choix, une décision, et en aucune façon une nécessité de nature, parce qu’elle est posée par appropriation dans le Saint Esprit. Le Verbe est celui par qui l’amour de Dieu est transmis aux créatures rationnelles : la totalité bien sûr de la Trinité est donc engagée dans cette décision, puisque par le Christ on va au Père, dans et en vue de l’amour du Père et du Fils, qui est l’Esprit-Saint.
 Ainsi, dans l’Incarnation qui va jusqu’à la mort et la résurrection, « le Principe fait transmission du Principe, il fait transmission de soi afin que l’homme, recueilli et rassemblé dans la dimension infinie, réflexive et fractale de l’âme, fasse retour de louanges, d’abandon et d’amour sans réserve à la prépotence et toute-puissance aimante de sa paternelle et prohémaïrétique possibilisation »[37]. Par Dieu seul on va à Dieu, par lui seul on revient à lui. Et quant à l’approfondissement de l’essence de la panoranoèse, les considérations qui précèdent doivent nous faire voir que la réflexivité comprise en sa plénitude et sa profondeur fait voir à même l’homme tout à la fois la présence en lui de la Différence comme différence infinie, consistante en soi et transcendante, mais également et par conséquent, comme Différence ayant franchi la distance infinie qui la sépare du lieu – le monde – où cette structure se déploie. Autrement dit, « lors de la PréIncarnation le franchissement de la Différence transmet à la fois et simultanément 1) l’ontodiaphoréité de la Différence fondamentale à ce qui n’est pas la Différence fondamentale, de sorte que soit produite dans la fractale réflexive de l’homme l’image même du Transcendant, 2) le franchissement même – et la forme du franchissement même – en vertu duquel est transmise l’ontodiaphoréité, franchissement dont la vérité est la Prohémaïrèse, et la référence structurelle à la Différence fondamentale de cela même en qui la Différence fondamentale se transmet. »[38] C’est en ce sens, complexe et précis, que la conscience doit être dite staurorhème, en tant qu’elle manifeste de manière simultanée la Différence du Principe dans sa transcendance et dans sa puissance de franchissement de cette transcendance, non seulement dans l’acte de la création, mais aussi, en tant qu’ils en constituent le prolongement, dans ceux de l’Incarnation, de la Passion et de la Résurrection. La Croix décidée dès avant la fondation du monde est donc transcendentalement comprise dans la conscience, qui en a la forme, en tant que réflexivité : « La Croix est, Prohémaïrèse, gravée transcendantale en lui, dans la structure fondamentale de l’être d’homme et la différence de la réflexivité »[39].
Ainsi, dans l’Incarnation qui va jusqu’à la mort et la résurrection, « le Principe fait transmission du Principe, il fait transmission de soi afin que l’homme, recueilli et rassemblé dans la dimension infinie, réflexive et fractale de l’âme, fasse retour de louanges, d’abandon et d’amour sans réserve à la prépotence et toute-puissance aimante de sa paternelle et prohémaïrétique possibilisation »[37]. Par Dieu seul on va à Dieu, par lui seul on revient à lui. Et quant à l’approfondissement de l’essence de la panoranoèse, les considérations qui précèdent doivent nous faire voir que la réflexivité comprise en sa plénitude et sa profondeur fait voir à même l’homme tout à la fois la présence en lui de la Différence comme différence infinie, consistante en soi et transcendante, mais également et par conséquent, comme Différence ayant franchi la distance infinie qui la sépare du lieu – le monde – où cette structure se déploie. Autrement dit, « lors de la PréIncarnation le franchissement de la Différence transmet à la fois et simultanément 1) l’ontodiaphoréité de la Différence fondamentale à ce qui n’est pas la Différence fondamentale, de sorte que soit produite dans la fractale réflexive de l’homme l’image même du Transcendant, 2) le franchissement même – et la forme du franchissement même – en vertu duquel est transmise l’ontodiaphoréité, franchissement dont la vérité est la Prohémaïrèse, et la référence structurelle à la Différence fondamentale de cela même en qui la Différence fondamentale se transmet. »[38] C’est en ce sens, complexe et précis, que la conscience doit être dite staurorhème, en tant qu’elle manifeste de manière simultanée la Différence du Principe dans sa transcendance et dans sa puissance de franchissement de cette transcendance, non seulement dans l’acte de la création, mais aussi, en tant qu’ils en constituent le prolongement, dans ceux de l’Incarnation, de la Passion et de la Résurrection. La Croix décidée dès avant la fondation du monde est donc transcendentalement comprise dans la conscience, qui en a la forme, en tant que réflexivité : « La Croix est, Prohémaïrèse, gravée transcendantale en lui, dans la structure fondamentale de l’être d’homme et la différence de la réflexivité »[39].
Comprenons bien ce que cela signifie : le fait de la pensée, comme panoranoèse, désigne comme son origine un Être par soi subsistant saisi tout à la fois dans sa différence et dans sa proximité, dans sa présence à même la conscience qui consiste en celle-ci, et par celle-ci. Et l’Incarnation alors apparaît comme la venue du Christ hors de l’homme, afin qu’il puisse, par lui, avec lui et en lui, rejoindre le Verbe qui, par mode d’image éminente, est en lui, et constitue l’espace d’épanouissement de sa pensée comme telle. Par l’Incarnation, le Principe en (deuxième) Personne rappelle à l’homme la PréIncarnation, c’est-à-dire la structure et la constitution de sa conscience ; et par là même elle le rappelle à la PréIncarnation, elle le sollicite à y demeurer de nouveau, elle lui rend possible de l’habiter pleinement. L’Incarnation reconduit l’homme à son in-stitution, au fait pour lui de se situer en lui-même, dans la dimension antéréelle de son âme. Ainsi, elle rend possible qu’il soit restitué à sa situation intime d’origine, qui est d’être une vivante référence diaphoranoétique à son Principe. Autrement dit, les deux mouvements suivants sont simultanés, synonymes et sont un et même : reconduire l’homme à la dimension de son âme, et le reconduire à Dieu, dont son âme est une image, c’est-à-dire une réalité dont la teneur et la consistance est précisément de renvoyer à son modèle. Or, cela n’est possible et n’est pensable que pour la raison que tout ce qui est dans le Christ, tout ce que le Christ vient, par sa seule présence, faire voir aux hommes, tout cela est aussi, à la mesure de sa finitude, dans la créature humaine. L’Incarnation, encore une fois, ouvre à nouveau la conscience de l’homme à sa vérité, qui est sa constitution pré-incarnative, et libère un chemin rectiligne pour la considération par lui de la texture cruciforme de son âme, – « quia rectae viae Domini, et justi ambulabunt in eis » (Os XIV, 10). De même que, essentiellement, le Fils renvoie au Père[40], et que donc l’Incarnation fait paraître au-devant de l’homme cette relation de filiation archodiaphorique ; de même la conscience est-elle reconduite à sa propre situation et signification filiale : en se voyant, elle voit la Différence principiale dans sa double détermination de subsistance parfaite, et de puissance de franchissement d’elle-même. Et saint Thomas pouvait ainsi affirmer la parfaite synonyme de l’adoption à la filiation divine et de la conformation au Christ, c’est-à-dire, littéralement, de la forme retrouvée du Fils dans l’âme humaine : « Nihil enim aliud est adoptio filiorum quam illa conformitas. Ille enim qui adoptatur in filium Dei, conformatur vero filio eius. »[41] Mais surtout, c’est ici qu’intervient la troisième personne de la Trinité, le Saint Esprit, inséparable du Fils bien sûr, et qui constitue l’hypostase de la con-spiration infiniment statique du Père et du Fils, ce dernier donc transmettant aux hommes, par sa parole et sa seule présence parmi eux, ce qui est tout à la fois l’amoureux liant de l’intime teneur trinitaire et, conséquemment, la « raison » du franchissement créateur déployé jusque dans ses plus extrêmes conséquences salvatrices. Par le Saint Esprit, l’homme donc « retrouve la relation entre le Père et le Fils étendue jusqu’à la condition errante et erratique de l’humain qui, s’il communie au point sacré de l’aboutissement et du résultat paradidonodiaphorique, au point sacramentel eucharistique, pénètre en conscience au sein de la Paradidonodiaphore c’est-à-dire de l’Hypostase même de la relation étendue métadiaphoriquement et prohémaïrétiquement entre le Père et le Fils, pénètre en conscience au sein de la Paradidonodiaphore dont l’Hypostase est le Saint Esprit. »[42] Par l’hypostase de la con-spiration amoureuse du Père et du Fils, en elle, l’homme est in-spiré jusqu’à son centre qui communique diaphorématiquement avec le cœur même, trinitaire, de l’Être par soi subsistant. Et l’on peut écouter alors, à propos, la belle prosopopée de Paul Claudel : « Apprends, homme, le fruit des méditations de l’Éternel, le commandement qu’Il te fait de L’aimer totalement, Il ne veut pas qu’il t’ait été signifié en vain : non seulement de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit, mais de toute ta fortitude, de tout ce qui est en toi la catégorie de la force verticale. Soutiens-Le qui va te communiquer le mystère radical de la Trinité, le ressort même de son fonctionnement, Dieu qui va te faire participer à la génération même de son actualité. »[43]
L’Esprit-Saint est proprement le maintien de la créature humaine dans la dimension de son conscience, le maintien donc d’elle dans la dimension de la PréIncarnation, par le moyen de l’Incarnation. L’Esprit Saint est « esprit de vérité » (Jn XIV, 17) qui ne laisse pas les hommes orphelins, parce qu’il est l’amour même par quoi le Verbe, renvoyant en une ad-miration éternelle et infinie à son Père, est présent à l’intimité de leur âme. C’est pourquoi le Christ peut proclamer à ses disciples : « Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime. Or celui qui m’aime, sera aimé de mon Père ; et je l’aimerai aussi, et je me découvrirai moi-même à lui » (Jn XIV, 21) ; et encore : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » (Jn XIV, 23) Aimer Dieu en vérité, c’est demeurer dans le Saint Esprit, et c’est avoir aussi et par là même en soi, au creux et au fond de son cœur, l’Esprit-Saint à demeure, comme l’on dit, qui n’est jamais seul puisqu’il importe avec lui, en ce lieu, le Père et le Fils dont il est l’embrassement et l’embrasement de condilection. L’on peut alors ressaisir ainsi la distinction tout à la fois et l’articulation de l’image et de la ressemblance : d’abord, écrit Maxence Caron, « ce qui produit en nous l’image de Dieu, c’est la participation au Fils, donc, dans la Décision de la Prohémaïrèse prise par le Principe librement aimant autrement dit par la Trinité en l’Hypostase de sa caritospiration, dans le Saint Esprit » ; ensuite : « ce qui produit en nous la ressemblance divine, c’est, ainsi, la participation dans le Fils à l’Esprit, la participation dans le Fils à l’Esprit du Père et du Fils, la participation à la ressemblance même de la Trinité afin que soit menée à l’épanouissement de sa source la différence réflexive qui par sa forme diaphorématique contient le sceau, la marque et la disponibilité à la Différence fondamentale dont elle est une décision »[44]. Participation au Verbe (Image parfaite) et participation au Saint Esprit (Amour) doivent donc être tout à la fois discernées l’une de l’autre, et cependant considérées dans leur intime entrelacement, car ce serait sinon morceler l’action ad extra du Principe trinitaire. La première ne peut advenir que par le Saint Esprit, au point de vue de son origine, qui est la Décision amoureuse de franchissement créateur prise par le Père et le Fils dans l’Amour dont ils conspirent. La seconde advient par le Fils ; elle est participation de l’homme à l’Esprit-Saint, en tant que celui-ci accompagne la seconde Personne en l’événement de son Incarnation, non seulement, comme dit, en tant que la venue du Fils dans le monde est en pleine continuité avec la Décision de création, mais en outre et plus précisément encore en tant que là où est une hypostase, les deux autres sont avec elle, d’indissoluble façon, quoique sans confusion et selon des modes distincts. Au point que saint Thomas d’Aquin pouvait aller jusqu’à écrire : « Per gratiam Christi sive per Spiritum Sanctum »[45], identifiant ainsi la grâce du Christ, celle-là même qu’il répand universellement, à l’Esprit-Saint lui-même. Ce qui est transmis à l’homme dans et par l’Incarnation, c’est alors la vie intime même de la Trinité, soit « la relation énantioménale elle-même, l’énantioménalité en tant que telle »[46], dont l’homme re-connaît que la structure de son âme en est dès toujours tissée, en tant qu’imago Dei, c’est-à-dire imago Trinitatis. L’Incarnation ne transmet pas « seulement » (ce qui n’a aucun sens) le Fils, elle transmet, dans et par lui, non seulement les trois Personnes conjointes, mais la possibilité renouvelée, pour la créature rationnelle, de participer, comme son essence y aspire, à la vie même, périchorétique, de la Trinité. Le Principe, en effet, si l’on ose dire, n’a rien d’autre à donner que lui-même – il n’est riche que de lui-même, comme l’écrit encore Thomas d’Aquin[47]. Ainsi, « l’Incarnation rend l’homme à l’être d’homme, l’âme à sa dimension, la conscience à l’antéréalité, l’être d’homme à l’image de Dieu. »[48] Et il faut en conclure que l’homme est remis au vivant souvenir de la vérité de sa conscience réflexive, de son essence panoranoétique, par cela même, le Principe trinitaire, qui la rend possible : la pensée est redonnée à elle-même (PréIncarnation) par la condition de possibilité transcendantale de la pensée qui, en personne (Incarnation), s’avance dans la présence visible au-devant de l’humanité oublieuse de son origine et de sa fin, et donc oublieuse d’elle-même. L’Incarnation est l’événement d’une restitution de l’homme à lui-même, d’une re-institution de l’homme au centre réflexif de sa propre conscience. La transmission à lui, dans et par le Christ, de la vie in-statique de la Trinité, le remet à sa propre teneur intime, lui donne de se tenir à nouveau dans l’immensité stable et céleste de son esprit.
Comme nous l’avons dit plus haut par anticipation, Le Verbe proscrit médite donc cela même, l’Incarnation et son fondement trinitaire, par quoi la pensée des conclusions de La Vérité captive et surtout de La Transcendance offusquée était possible, déjà. La catégorie de la « raison naturelle » tant prisée par un certain thomisme étouffant et minuscule, n’a pas ici le moindre lieu d’être. La connaissance en effet est toujours déjà reprise par sa propre dimension, qui est antéréelle, et jamais « seulement » naturelle – puisque l’homme par son âme, précisément, se tient tout à la fois dans et au-dessus de « la nature », ou bien disons plutôt du domaine de transcendement. En effet, « par la sigillité de la liberté que fonde la diaphoranoéticité de la conscience, Dieu a structurellement et intimement élevé l’homme à l’ordre supernaturel. »[49] Rien, dans cette tétralogie, n’a été écrit ni pensé indépendamment de la Révélation ; bien plutôt, c’est à la dépendance totale vis-à-vis de l’initiative du Principe et de sa Parole, en son être même, et sa possibilité, que l’intelligence humaine est reconduite et rendue par la méthode et les conclusions du Système, qui sont montrées dans leur toute-cohérence rationnelle, non pas en tant qu’elles seraient soudain sans mystère, mais tout au contraire en tant qu’elles situent l’homme au cœur du mystère et lui donnent d’y être filialement compris, en tous sens de ce verbe. Pour ce qui regarde la Trinité, donc, « la connaissance est parfaitement possible mais elle doit être préalablement excentrée dans la principialité, dont l’initiative gouverne la relation entre sa Différence fondamentale et notre différence réflexive par l’intensification eucharistique infinie dont bénéficient ceux qui s’en remettent aux fruits de la prévenance paradidonodiaphorique, soit aux fruits surabondamment médiateurs de l’Incarnation qui nous remet par le Principe au cœur du Principe. »[50] Et la science alors s’avère et s’achève en sagesse, engageant non seulement la connaissance de soi, mais ensuite le comportement idoine à cette connaissance qui désigne à l’homme sa divine provenance, laquelle est aussi sa divine destination. Aussi la philosophie, connaissance du Premier et de soi, ne peut-elle s’accomplir, s’épanouir, fleurir en somme, qu’en poésie, c’est-à-dire en chant de louange, exhaussant la raison jusques à l’oraison qui est sa perfection ; car la sagesse qu’il faut est alors bien celle-là que chantait Verlaine, « cette douce raison, / Que la Cathédrale termine en oraison. »[51]
Et l’on ne peut à la fin que renvoyer, ou bien envoyer, le lecteur vers les éblouissantes dernières pages du Verbe proscrit, qui sont elles-mêmes un « Envoi » intitulé : Grandes odes archiloges, au nombre de cinq, où tout est ressaisi dans une langue torsadée comme une colonne de flammes où viennent s’entre-illuminer en ascendance et le sens et le son, – et qui s’élance et qui lèche de ses longues langues écarlates les barreaux de la mystérieuse « colonne scalaire d’une échelle infinie qui monte là où nulle finitude ne saurait aller soi seule »[52]. Ici, comme dans les deux précédents volumes, la poésie surgit à la fin, diadème musical de la pensée ; et fait voir que la pensée poussée à son plus haut point d’incandescence, nécessairement, s’embrase comme un buisson de sonorités qui flambent sans se consumer. Littéralement, la poésie apparaît comme la quinte-essence de la pensée : à force de condensation des concepts, d’intensification des notions, il y a soudain flamboiement à même les mots et leur rythme et leur musique. La poésie de Maxence Caron, c’est sa prose qui a pris feu ; et, selon un vers de la quatrième Ode, tous ses mots « sont lourds de la lumière qui les précède »[53].
***
[1] Thomas d’Aquin, ST, II-IIae, Q. 2, art. 1.
[2] TrO, p. 196.
[3] Maxence Caron, Le Verbe proscrit (Vp), Les Belles Lettres, Paris, 2022, p. 34.
[4] Vp, p. 44 ; même page pour la citation qui suit.
[5] Catéchisme de l’Église catholique, n°237.
[6] Vp, p. 41.
[7] Vp, p. 42.
[8] Vp, p. 81.
[9] Vp, p. 461.
[10] De εἴκω, « être semblable à » et ποιητής, « créateur ».
[11] Vp, p. 176.
[12] Vp, p. 87.
[13] Cf. La Vérité captive, bien sûr ; mais aussi : Maxence Caron, Être & identité, Cerf, Paris, 2006.
[14] Vp, p. 90.
[15] Vp, p. 92.
[16] Ibid. Cf. aussi p. 107 : l’infinité du Transcendant « est infinité dans l’unité dont la constance est en elle-même l’illimitation c’est-à-dire tout simplement l’infinité comme telle, sans croissance mais sans limite, donc sans extension au sens transcendemental et immanent du terme, mais en extension endodiaphatique stante soit en expansion fixe. »
[17] Thomas d’Aquin, ST, Ia, Q. 7, art. 1, ad 3.
[18] Cf. De Pot., Q. 9, art. 3, Réponse.
[19] ST, Ia, Q. 29, art. 3, Réponse.
[20] Στάσις signifiant l’action de se tenir dans la stabilité ; et ὑπό ayant ici le sens de : « en son propre fond ».
[21] Vp, p. 100.
[22] Vp, p. 169.
[23] Vp, p. 184.
[24] P. Claudel, Correspondance Claudel-Massignon, éd. D. Millet-Gérard, Gallimard, Paris, 2012, p. 121.
[25] Vp, p. 184.
[26] Cf. p. 112 : « Tout est Dieu en Dieu : c’est l’Endodiaphase. Il y a unité de nature et non pas prolongement par enchaînement : l’Endodiaphase se corrèle à l’Énantiomilie, elle est, de soi, énantioménale. »
[27] Vp, p. 90.
[28] Vp, p. 185.
[29] L. Bloy, Dans les Ténèbres, in Essais et pamphlets, Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2017, p. 1304.
[30] Vp, p. 177.
[31] J.-M. Garrigues (op), Dieu sans l’idée du mal – Méditations sur la miséricorde, Ad Solem, 2016, p. 112.
[32] Ibid, p. 102.
[33] Vp, p. 142.
[34] Cf. Vp, p. 315 : « la conscience est structurée par la présence de la Croix qui est incluse au cœur du Sang différential, au cœur du franchissement diaphorématique, au cœur de la Prohémaïrèse : la conscience est différence réflexive et parce qu’elle est différence réflexive, parce qu’elle est possible en tant que différence réflexive, elle est donc possibilisée par cette présence transcendantale de la Croix différentiale. La conscience est ainsi staurologe : elle connaît en elle-même dans son propre cœur le propre cœur de l’épansion paradidonodiaphorique qui dit en elle et en sa possibilisation l’assomption dès toujours de la Croix dans la Décision aimante de créer l’homme. »
[35] Vp, p. 177.
[36] Ibid.
[37] Vp, p. 270.
[38] Vp, p. 142.
[39] Vp, p. 1201.
[40] « Je suis la voie, la vérité et la vie : personne ne vient au Père que par moi. [] Philippe, celui qui me voit, voit aussi mon Père. » (Jn XIV, 6-9)
[41] Thomas d’Aquin, In Ad Rom., ch. VIII, lec. 6, n°704.
[42] Vp, p. 151.
[43] P. Claudel, La Rose et le Rosaire, in OC XXI, Gallimard, Paris, 1963, p. 210.
[44] Vp, pp. 162-163.
[45] Thomas d’Aquin, In Ad Rom, ch. VIII, lec. 2, n°628.
[46] Vp, p. 193.
[47] Deus « est dives per seipsum, et non per aliquid aliud » (In Ad Rom., ch. VIII, lec. 3, n°647.
[48] Vp, p. 194.
[49] Vp, p. 219.
[50] Vp, p. 196. Et l’auteur d’ajouter, à la même page : « La Vérité étant plus grande que nous et n’étant précisément aimée que parce qu’elle est plus grande que nous, personne ne peut connaître la Vérité sinon en adhérant à la Vérité : il faut donc que celui qui désire connaître la Vérité adhère à la Paradidonodiaphore qui nous en ouvre la conscience en même temps que s’ouvre la possibilité de notre conscience réflexive ».
[51] P. Verlaine, Oxford, in Œuvres posthumes, t. I, Messein, Paris, 1911, Premier volume, p. 62.
[52] Vp, p. 1313.
[53] Vp, p. 1311.








