Professeur de philosophie moderne et contemporaine à l’université de Lille III, Antoine Grandjean est un des meilleurs connaisseurs actuels de Kant, dont il vient de traduire aux PUF deux textes richement introduits : Sur l’échec de tout essai philosophique en matière de théodicée et Sur un prétendu droit de mentir par humanité[1].
En 2009, Antoine Grandjean avait publié un ouvrage remarquable, Critique et Réflexion, dont nous avions ici rendu compte en 2010. Plus récemment, il a consacré à la construction kantienne du concept d’empirisme une longue analyse développée avec brio dans Métaphysiques de l’expérience[2], analyse sans doute d’abord esquissée dans un collectif dirigé par ses soins en 2017, Kant et les empirismes[3].
 Thibaut Gress : Antoine Grandjean, vous venez de publier aux PUF une traduction de deux petits textes de Kant[4], très richement introduite, qui fait suite à Métaphysiques de l’expérience paru en 2022. Très dense, stimulant comme rarement, Métaphysiques de l’expérience se déploie selon plusieurs perspectives, dont toutes me paraissent entrer en discussion avec un chapitre de Critique et réflexion, « circularité et réflexion », sur lequel nous reviendrons sans doute en conclusion, car il me semble que l’investigation génétique que vous avez entreprise est en tension avec vos analyses de la nature du discours kantien et de votre volonté initiale d’exclure le génétique du transcendantal. Quoi qu’il en soit, Métaphysiques de l’expérience apparaît comme un livre puissant et d’une richesse rare dont l’envergure est telle que le présent entretien ne pourra sans doute donner qu’un petit aperçu de son étendue.
Thibaut Gress : Antoine Grandjean, vous venez de publier aux PUF une traduction de deux petits textes de Kant[4], très richement introduite, qui fait suite à Métaphysiques de l’expérience paru en 2022. Très dense, stimulant comme rarement, Métaphysiques de l’expérience se déploie selon plusieurs perspectives, dont toutes me paraissent entrer en discussion avec un chapitre de Critique et réflexion, « circularité et réflexion », sur lequel nous reviendrons sans doute en conclusion, car il me semble que l’investigation génétique que vous avez entreprise est en tension avec vos analyses de la nature du discours kantien et de votre volonté initiale d’exclure le génétique du transcendantal. Quoi qu’il en soit, Métaphysiques de l’expérience apparaît comme un livre puissant et d’une richesse rare dont l’envergure est telle que le présent entretien ne pourra sans doute donner qu’un petit aperçu de son étendue.
A : « l’invention de l’empirisme »
Commençons, si vous le voulez bien, par l’introduction, et notamment son premier moment, qui prend le contrepied d’une idée reçue, à savoir que Kant réagirait à une sorte de corpus cohérent, que l’on pourrait qualifier d’empiriste, et contre lequel il échafauderait la réponse criticiste. Là-contre, tout comme Marx créant le concept de « capitalisme » pour mieux déterminer conceptuellement son adversaire, Kant, dites-vous, déterminerait conceptuellement l’ « empirisme » afin d’en mener l’analyse et la contestation. « Avant Kant, écrivez-vous, l’ « empirisme » n’existe pas. Les notes de ses étudiants portent d’ailleurs la marque de son invention kantienne[5]. » Et vous ajoutez aussitôt :
« Kant est en effet l’inventeur de l’empirisme. Non qu’il ait donné naissance à la chose même (quoique ce point appelle discussion, puisque certains, on le verra, soutiennent que la chose au fond n’existe pas, l’invention kantienne du concept d’empirisme étant celle du seul empirisme qui soit, un fantôme tout au plus utile à des fins polémiques).[6] »
Quant à l’empirisme ainsi déterminé, il serait « entendu comme cet empirisme du concept, c’est-à-dire comme cette thèse génétique qui identifie dans l’expérience la source véritable de toutes nos représentations, et qui récuse en ce sens toute possibilité d’une connaissance pure, c’est-à-dire absolument a priori, ou intégralement rationnelle, si la raison désigne le pouvoir de la connaissance a priori en général, le rationnel s’opposant ainsi à l’empirique[7]. »
On voit à cet effet que l’empirisme tel que déterminé par Kant désigne une thèse génétique quant à la provenance des concepts ; mais qu’ajoute l’explicitation de ce concept à la clarté des textes d’un Locke qui, dès le début de L’essai sur l’entendement humain, affirme « mener des recherches sur l’origine [the original], sur la certitude et sur l’étendue de la connaissance humaine[8] », ce qu’il réaffirme au paragraphe suivant, en disant chercher « l’origine [the original] des idées, des notions (…)[9]. » ? Qu’est-ce qui, chez un Locke, pouvait paraître insuffisant du point de vue génétique pour rendre nécessaire une requalification de son entreprise ? La même question pourrait être posée d’ailleurs pour Hume dont la section I du Traité de la nature humaine est bien intitulée « de l’origine de nos idées ».
Antoine Grandjean : Il ne manque rien à Locke ni à Hume pour mériter le nom d’« empiriste », leur entreprise correspondant tout à fait à ce que Kant entend par là (contrairement d’ailleurs à ce que nombre de lecteurs se sont depuis efforcé d’établir contre Kant). Ce qui ne se trouve pas chez eux, c’est précisément ce nom, et le concept qu’il dénote, concept dont Kant est l’inventeur. Avant lui, « empirisme », qui est d’usage récent, ne désigne pas une doctrine philosophique concernant l’origine de nos connaissances, qui en affirmerait l’exclusive empiricité, mais quelque chose comme un charlatanisme, une revendication anti-méthodique, une pratique anti-rationnelle de la connaissance ; le terme est utilisé, sur le mode d’une imputation négative, à des fins de déconsidération de ceux que Bacon, prenant la suite des médecins grecs, caractérisait comme des « empiriques ». C’est du concept moderne d’empirisme que Kant est l’inventeur. Mais il l’invente en effet pour déterminer ce paradigme génétique que les philosophies lockienne et humienne (entre autres) défendent.
ThG : Un élément, peut-être légèrement extérieur à votre propos, me vient à l’esprit. Lorsque l’on regarde les textes de Locke et Hume, on s’aperçoit assez vite que Locke recherche the original des idées alors que Hume en reste à the origin, Locke se mettant donc en quête d’une sorte d’élément extérieur à l’esprit, dont celui-ci aurait la copie, alors que Hume ne sort pour ainsi dire jamais de la perception, puisque les impressions ne sont jamais définies comme étant celles qu’exerce sur nous un objet extérieur mais bien comme étant celles qui, des perceptions, entrent avec le plus de force et de violence. De là, d’ailleurs, sa critique de l’idée d’existence et d’extériorité de la section VI de la seconde partie, et plus encore de la seconde section du Livre IV, qui semble dire l’impossibilité de sortir de la perception et la nécessité d’enraciner l’origine dans la perception elle-même, là où Locke admet d’emblée des corps extérieurs, qui sont les originaux dont proviennent nos copies. D’ailleurs, vous marquez très bien la position de Hume pour qui « penser quelque chose, c’est faire référence à ce qui fut un jour senti. »[10]
Jusqu’à quel point est-il éclairant de forger un concept commun d’empirisme pour qualifier une question génétique qui, dans les faits, est profondément hétérogène puisque divergeant radicalement sur le sens de la source, et qui se voit artificiellement unifiée, et ce bien que sous l’angle sceptique vous distinguiez par la suite Locke de Hume ?
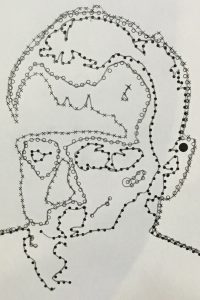 AG : Que la thèse constitutive de l’empirisme, et par suite commune à tous les empiristes, soit celle de l’origine empirique de toute connaissance, cela n’exclut en rien des spécificités radicales et des oppositions internes majeures à ce courant. De fait, tout dépend précisément de la manière dont on conçoit l’expérience dont toute connaissance procède, comme tout tient ensuite à la conséquence avec laquelle on conclut à partir de cette originarité exclusive de l’expérience. Sur ce point, Locke, aux yeux de Kant, n’est ni radical ni conséquent, à la différence précisément de Hume. Déterminer l’expérience comme impression, c’était en effet réduire au rang de fiction la transcendance de l’objet aussi bien que la consistance du sujet. Aux yeux de Kant, Hume a parfaitement raison dans ses conclusions. Ce sont toutefois ses présupposés qui posent question, et qui posent question parce qu’ils ne sont peut-être pas pleinement fidèles à l’inspiration empiriste elle-même : Hume ne peut produire la genèse intégrale de notre expérience – une genèse qui est très largement celle d’une fiction – à partir de l’impression que parce qu’il se donne des séquences semblables d’impressions semblables, alors que l’impression est en droit chaotique. Selon Kant, Hume amortit le caractère en droit absolument chaotique du donné impressionnel, présupposé sans lequel, faute de régularité empirique minimale, l’expérience-impression ne saurait engendrer l’expérience-monde-de-la-vie (qui est très largement tissée de fictions). Il y a donc des différences nettes au sein de la « famille » empiriste, dont Hume est pour Kant la figure accomplie (avec son pendant antique, Epicure), et donc celui avec lequel se joue la destinée de tous. Pour autant, on le voit, ces différences modulent bien une thèse génétique commune (cette thèse génétique est l’ADN empiriste, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots !). Or il est intéressant de la déterminer conceptuellement, pour interroger ses motivations, ses présupposés, son horizon et ses conséquences. C’est ce que l’invention kantienne du concept d’empirisme permettait de faire.
AG : Que la thèse constitutive de l’empirisme, et par suite commune à tous les empiristes, soit celle de l’origine empirique de toute connaissance, cela n’exclut en rien des spécificités radicales et des oppositions internes majeures à ce courant. De fait, tout dépend précisément de la manière dont on conçoit l’expérience dont toute connaissance procède, comme tout tient ensuite à la conséquence avec laquelle on conclut à partir de cette originarité exclusive de l’expérience. Sur ce point, Locke, aux yeux de Kant, n’est ni radical ni conséquent, à la différence précisément de Hume. Déterminer l’expérience comme impression, c’était en effet réduire au rang de fiction la transcendance de l’objet aussi bien que la consistance du sujet. Aux yeux de Kant, Hume a parfaitement raison dans ses conclusions. Ce sont toutefois ses présupposés qui posent question, et qui posent question parce qu’ils ne sont peut-être pas pleinement fidèles à l’inspiration empiriste elle-même : Hume ne peut produire la genèse intégrale de notre expérience – une genèse qui est très largement celle d’une fiction – à partir de l’impression que parce qu’il se donne des séquences semblables d’impressions semblables, alors que l’impression est en droit chaotique. Selon Kant, Hume amortit le caractère en droit absolument chaotique du donné impressionnel, présupposé sans lequel, faute de régularité empirique minimale, l’expérience-impression ne saurait engendrer l’expérience-monde-de-la-vie (qui est très largement tissée de fictions). Il y a donc des différences nettes au sein de la « famille » empiriste, dont Hume est pour Kant la figure accomplie (avec son pendant antique, Epicure), et donc celui avec lequel se joue la destinée de tous. Pour autant, on le voit, ces différences modulent bien une thèse génétique commune (cette thèse génétique est l’ADN empiriste, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots !). Or il est intéressant de la déterminer conceptuellement, pour interroger ses motivations, ses présupposés, son horizon et ses conséquences. C’est ce que l’invention kantienne du concept d’empirisme permettait de faire.
ThG : Un moment important de la construction de l’empirisme, et peut-être inattendu, est constitué par Leibniz dont vous montrez la resémantisation de l’a priori et de l’a posteriori selon le rationnel et l’empirique, sans que cela n’engage pour autant un statut génétique différencié car, dites-vous, cela désigne d’abord des modes d’accès subjectifs à la connaissance de telle ou telle vérité.
AG : En effet, il faut distinguer la manière dont un sujet empirique s’approprie une vérité (rationnellement ou historiquement) et le statut du fondement de cette vérité. Je peux apprendre le théorème de Thalès … de Thalès, en m’en tenant à la proposition qu’il énonce, ou je peux le produire comme une connaissance rationnelle en le démontrant. Leibniz maintient l’opposition du rationnel et de l’empirique comme de deux manières de savoir, le seul fait pour le second, sa raison pour le premier. Mais ces manières de savoir ne signifient pas la même chose que le fondement de la vérité. Une vérité mathématique est selon Kant une connaissance a priori, quand bien même tel ou tel peut en prendre une connaissance historique. Pour le dire autrement, une même vérité peut être connue rationnellement ou empiriquement chez Leibniz, alors que l’opposition de l’apriorité et de l’empiricité (ou du rationalisme et de l’empirisme) est chez Kant une opposition de contradiction.
 ThG : Venons-en à Kant alors. A quel moment avez-vous pris conscience de la dimension « construite » voire « reconstruite » de l’ « empirisme » kantien ? Quand on lit votre article « La politique empiriste de la raison. Anarchisme ou despotisme ? » ainsi que votre présentation générale de Kant et les empirismes publié en 2017, on a l’impression – peut-être trompeuse – que vous prenez encore l’empirisme comme une sorte de fait historique ou de corpus déterminé, et non comme une construction requise par la pensée kantienne.
ThG : Venons-en à Kant alors. A quel moment avez-vous pris conscience de la dimension « construite » voire « reconstruite » de l’ « empirisme » kantien ? Quand on lit votre article « La politique empiriste de la raison. Anarchisme ou despotisme ? » ainsi que votre présentation générale de Kant et les empirismes publié en 2017, on a l’impression – peut-être trompeuse – que vous prenez encore l’empirisme comme une sorte de fait historique ou de corpus déterminé, et non comme une construction requise par la pensée kantienne.
AG : Je pense que si le concept d’empirisme est une invention kantienne, le corpus historique qui l’incarne est bien une réalité (philosophique !). La construction du concept n’était pas une invention de la chose même. Le volume collectif que vous évoquez est le résultat d’un colloque qui s’était tenu à Lyon et que j’avais organisé dans le cadre des travaux empirico-transcendantaux (!) dont Métaphysiques de l’expérience est le produit. Je travaillais donc précisément à l’analyse historico-problématique du motif empiriste comme concept d’origine kantienne. Ce qui est venu ensuite, et en partie grâce aux discussions qui ont eu lieu durant ce colloque, c’est plutôt la prise de conscience de ce que Kant retenait positivement de l’empirisme, c’est-à-dire son acquisitionnisme. Ce qui m’a conduit aux recherches concernant l’épigénèse de la raison pure et l’acquisition originaire de l’a priori, dont la seconde partie de l’ouvrage présente les résultats.
ThG : Un point peut-être d’interprétation dans votre lecture. Vous écrivez – et vous nous avez redit – à quel point l’enjeu spécifique de Kant est génétique, sans pour autant chercher à dépasser le clivage empirique / rationnel. Plus encore, dites-vous, il conviendrait d’abandonner l’irénisme critique, la Critique étant certes une voie pacificatrice mais certainement pas de manière pacifique ; elle propose une « paix armée[11] » parce que « c’est une paix à défendre sur plusieurs fronts[12]. » Est-ce à dire que dans la lecture que vous faites de Kant, l’empirisme est construit pour se trouver intégralement récusé au seul et exclusif profit du rationalisme ?
AG : Oui, c’est cela. Kant construit l’opposition entre rationalisme et empirisme comme celle de deux contradictoires : ni conciliation ni troisième voie ne sont envisageables. Le rationalisme affirme qu’il y a des connaissances a priori (proposition particulière affirmative) ; l’empirisme nie que nous disposions d’aucune autre connaissance qu’empirique (proposition universelle négative). Ce sont bien des contradictoires, entre lesquels il faut choisir. Kant pense réfuter l’empirisme, et valider ainsi une position rationaliste. Il faut en finir avec le mythe du Kant synthétique ou tiède en toutes circonstances ! Pour autant, comme je l’ai dit, l’empirisme intégralement récusé comme tel possède bien une vérité négative, dans son refus de tout innéisme. Le rationalisme de Kant est un rationalisme qui partage le rejet empiriste de l’innéisme. Mais partager un refus ne constitue pas une identité positive commune.
B : « Métaphysique de l’empirisme »
ThG : J’aimerais à présent aborder la question sceptique qui est au cœur de la première partie de Métaphysiques de l’expérience et qui trouve, me semble-t-il, une expression déjà très claire en 2017 dans votre article « la politique empirique de la raison. Anarchisme ou despotisme ? » Vous y montrez très bien que la position kantienne consiste à mettre en évidence le fait que la thèse empiriste implique nécessairement un scepticisme, ce qu’avait d’ailleurs déjà établi Leibniz dans la préface des Nouveaux essais sur l’entendement humain. Mais Kant, écrivez-vous, « entend se livrer à un véritable épuisement de l’empirisme par radicalisation extrême de sa conséquence sceptique. Il montre que tout accorder à l’expérience en termes de genèse conduit à la dissolution même de l’expérience comprise comme épreuve de quelque chose par quelqu’un[13]. » En somme, si l’empirisme était vrai, si tout était connu selon une provenance extérieure, alors la source empirique serait impossible ; si l’empirisme était vrai, nous ne pourrions pas percevoir une maison, ou faire l’expérience d’un événement ; elle ne serait l’expérience de rien. Pourriez-vous expliquer ce paradoxe d’un empirisme dissolvant toute expérience possible ?
AG : Au fond, le raisonnement kantien consiste à établir que l’expérience-impression est impuissante à produire l’expérience-monde de la vie, l’expérience au sens de l’épreuve de quelque chose par quelqu’un. L’expérience que nous faisons, au sens très basique de la perception, est toujours celle d’un objet et non une succession discontinue de purs vécus sans identité ni référence. Or la référence objective, qui est incluse dans toute expérience, est le résultat d’une synthèse conceptuelle qui apporte une liaison nécessaire à nos impressions, synthèse dont la nécessité présuppose le caractère a priori de l’unité conceptuelle selon laquelle le multiple est à chaque fois liée. La perception d’une maison ou celle d’un événement ne diffère d’une simple succession de vécus sans objet que parce que les différents vécus en lesquels cette maison ou cet événement se donnent sont liés entre eux de façon nécessaire, cette contrainte logique valant institution d’une référence objective : ces vécus sont ceux de quelque chose en ce qu’ils ne sont pas simplement des vibrations contingentes de ma sensibilité. Affirmer que tout procède de l’impression, récuser l’a priori, c’est dès lors annuler cette référence objective que toute expérience inclut. Mais c’est aussi annuler sa polarisation subjective, dès lors que la conscience d’identité du sujet de l’expérience consiste strictement dans la conscience de la liaison des vécus entre eux. Le moi n’advient, selon Kant, qu’en tant qu’il est à l’œuvre, précisément dans cette synthèse conceptuelle du multiple impressionnel. Le destin du sujet est strictement lié à celui de l’objet, l’identité du premier à lui-même n’ayant d’autre élément que la synthèse objectivante. Bref, si tout procède de l’impression, il n’y a plus de place pour l’épreuve de quelque chose (d’un objet) par quelqu’un (par un sujet conscient de son identité, i. e. par une personne), mais seulement pour une succession de vécus sans objet ni sujet. Et si Hume prétend rendre raison de la genèse de la fiction-objet et de la fiction-sujet sur une base purement impressionnelle, c’est, encore une fois, parce qu’il se donne une régularité minimale des impressions qui, selon Kant, n’est aucunement une conséquence de ce que l’impression donne à voir d’elle-même, ce qui contrevient au fond au principe empiriste lui-même.
ThG : Dans ce cas, peut-être faut-il affronter une difficulté inhérente au texte kantien, à savoir ce que l’on aborde souvent comme l’équivocité de sa notion d’expérience qui, de toute évidence, commence avec l’ambivalence de l’objet. Dans un texte que vous avez-vous-même traduit, Les progrès de la métaphysique, un des suppléments contient une affirmation pour le moins déroutante :
« Par l’intuition, qui est conforme à un concept, l’objet est donné [wird der Gegenstand gegeben] ; sans elle, il est simplement pensé [bloß gedacht]. Par cette simple intuition sans concept, l’objet est certes donné [wird der Gegenstand zwar gegeben], mais non pensé ; par le concept sans intuition correspondante, il est pensé, mais aucun objet n’est donné ; et ainsi, dans les deux cas, on ne connaît pas[14]. »
Kant dit et redit que, même sans concept, un objet [Gegenstand] est donné par l’intuition qui, comme réceptivité, reçoit les objets, fussent-ils non informés conceptuellement. Cette affirmation est doublement troublante : une première fois parce qu’on peine à comprendre comment il se fait que c’est un « objet » qui est donné en l’absence de concept, et une seconde parce que s’il y a « objet » par intuition alors il y a une sorte d’expérience pré-conceptuelle, qui introduit une équivocité du terme puisqu’il est aussi bien employé pour qualifier l’expérience impressionnelle que pour celle de l’objet. Nonobstant, vous contestez qu’il y ait là une équivocité du terme et préférez parler d’une « ambivalence réglée[15] » conduisant à une « dualité fondée dans la chose même, au demeurant thématiquement exploitée par Kant. Car circuler d’une dimension de sens à l’autre, c’est montrer que la seconde (dimension expérientielle) ne suffit pas à fonder la première (signification épistémique pleine), écart au sein duquel une bonne part de l’argumentation transcendantale va s’engouffrer[16]. » On comprend bien que vous voulez montrer que, lorsque l’expérience est « source », prise dans l’optique génétique, elle est hylétique. Mais justement : en quel sens est-elle encore une « expérience » puisqu’en aucun cas je n’expérimente cette matière en tant que telle ? Autrement dit, que peut bien vouloir dire « expérience » dans le cas de la matière impressionnelle qui n’est justement jamais expérimentée comme telle, mais est toujours deux fois informée, par les formes de la sensibilité et par celles de l’entendement ?
AG : Il s’agit d’une abstraction. Le donné non-informé conceptuellement ne nous est pas donné dans son infraconceptualité, puisque précisément nous informons conceptuellement ce que nous recevons. Il n’empêche que ce dont nous faisons l’expérience, expérience qui inclut une synthèse conceptuelle de l’expérimenté, ne nous est pas donné par cette synthèse. Il faut donc penser ce que la synthèse synthétise et ne produit pas. Cette couche purement impressionnelle est une reconstruction depuis l’expérience pleine. Plus largement, Kant exploite la différence et la distance entre les deux dimensions constitutives de l’expérience : sa dimension d’épreuve, ou expérientielle, et sa dimension cognitive ou gnoséologique (en un sens pré-épistémique) ; l’expérience est épreuve de quelque chose par quelqu’un, sa dimension d’épreuve ne suffisant pas à produire sa dimension de référence objective et d’attribution subjective.
ThG : Je me permets d’insister pour deux raisons. D’une part pour une raison de « grammaire », car il est difficile de comprendre ce que peut être une expérience de l’inexpérimenté, d’autre part en me fondant sur vos propres écrits. Vous dites dans La philosophie de Kant qu’une phénoménalité sauvage, non réglée, serait une phénoménalité sans phénomènes, une confusion mentale absolue, et vous thématisez vous-même deux sens de la phénoménalité : d’une part le surgissement de la donation et d’autre part le donné ayant la consistance d’un objet. Et vous concluez ainsi : « dès lors que la donation sensible signifie une affection, le donné ne peut que consister dans une modification de celui qui s’y trouve exposé : le reçu est ontologiquement solidaire de sa réception[17]. » Mais justement : dire que le reçu est « ontologiquement solidaire de sa réception », n’est-ce pas dire qu’il n’y a expérience que de la réception et non de la donation comme telle ?
AG : Cette distinction entre réception et donation me semble abstraite et conséquence d’une hypostase indue. La réception est réception d’un donné, c’est-à-dire une donation de … à …. Ce n’est qu’un seul et même événement, tout au plus accentué selon deux points de vue différents, cette dualité tenant à la dimension de passivité qui caractérise la donation (l’intuition, la présence à et de) pour un être fini, pour lequel le donné n’est pas donné par lui, et donc reçu. Par ailleurs, la question de l’information conceptuelle du donné, qui seule permet qu’il devienne à proprement parler un objet (le vis-à-vis d’un sujet, irréductible à une modulation de la subjectivité du second, et donc partageable pour tout autre sujet), ne conduit nullement à réduire la passivité de la donation même. Enfin, ce que Kant veut montrer, c’est que ce que j’appelle une phénoménalité sauvage, non réglée logiquement, serait une phénoménalité sans phénomènes, un apparaître sans objet, comparable à ce qui est vécu dans un état de confusion mentale, « moins qu’un rêve », ou ce qu’il compare parfois au vécu animal.
Il y aurait épreuve, vécu, si l’on veut, donc, mais pas expérience, qui signifie toujours épreuve de quelque chose pour quelqu’un, et qui engage ainsi une double polarité, ou si l’on veut objectivité (en un sens non-épistémique) et personnalité.
ThG : J’aimerais ici introduire une question de biais. Ce que vous appelez l’ambivalence réglée de l’expérience n’est-elle pas en fin de compte la profonde ambivalence de ce que Kant appelle « donné » ? Celui-ci en effet est particulièrement difficile à cerner car il concerne tout autant ce qui de la chose en soi se donne via la réceptivité – la « donation » par laquelle surgit la « matière » du phénomène – que la forme sous laquelle le sujet la reçoit, puisque l’objet est donné « comme phénomène » et non uniquement comme matière. L’ambivalence réglée de l’expérience n’est-elle pas le symptôme de l’ambivalence kantienne – pour ne pas dire plus – entre le donné comme donation et le donné comme reçu modifié ?
AG : Je crois que c’est autre chose. L’ambivalence qui concerne la relation entre phénomène et chose en elle-même, et qui est massive, me semble être le symptôme de la difficulté de ce qu’il y a pour Kant à penser ici. Il tâtonne, approfondit, et son propos ne manque pas d’être parfois équivoque, voire confus. Mais encore une fois, et c’est peut-être le cas de le dire, je pense que cela tient à la difficulté de la chose même. L’ambivalence de l’expérience, c’est autre chose, car c’est une ambivalence qui ne produit pas d’équivoques ou qui est exempte de confusion : l’expérience c’est, à la fois, ce que caractérise une dimension d’épreuve et une double polarisation objective et subjective qui a une consistance cognitive. Kant s’emploie à faire droit à ces deux dimensions, et à montrer que la première ne peut produire la seconde, non plus que la seconde ne peut réduire la première.
ThG : Dans La philosophie de Kant, vous braquez le projecteur sur la donation (indépendante) et le donné (conditionné), ce qui du reste éclaire beaucoup la compréhension de Kant. Or, un élément souvent remarqué est que chez les « empiristes » comme Locke et Hume ne figure pas la notion de donné alors que chez un anti-empiriste comme Kant elle trouve son origine. Feriez-vous un lien entre le fait que Kant crée le concept d’empirisme et soit également le premier à formuler le gain de l’intuition dans les termes de la donation et du « donné » ? Le « donné » kantien n’est-il pas d’ailleurs le gage d’une empiricité plus « forte » que celle de Hume, si l’on entend par « empiricité » une source extérieure, en ceci qu’il garantirait que la pensée ait bien affaire à une réalité extérieure quoique sous les formes de la subjectivité transcendantale, ce que l’économie conceptuelle de la pensée humienne ne permet en aucun cas de garantir ?
AG : Kant est un anti-empiriste qui confère une importance absolument décisive à l’empiricité comme telle, puisque toute pensée n’acquiert selon lui une réalité objective que pour autant que lui correspondent non seulement des intuitions, mais bien des intuitions empiriques. Par ailleurs, Kant est évidemment un philosophe de la donation, qu’elle soit celle de la matière empirique ou des structures, intuitives, intellectuelles ou rationnelles qui sont celles de l’a priori. Pour autant, l’empiricité n’est donc qu’une dimension de la donation. Je ne suis donc pas sûr que ce soit l’attention au « problème empirisme » qui conduise Kant à prêter attention à la donation. S’il doit y avoir un lien entre les deux problématiques, il est peut-être inverse : découvrir que toute intuition, pour un être fini, est sensible, c’est-à-dire que toute donation signifie pour lui une réception, c’est être conduit à identifier l’empiricité comme l’unique élément de l’objectivité.
ThG : Revenons si le voulez bien à la question empiriste et à l’analyse qu’en mène Kant. Celui-ci, montrez-vous très bien, ne se contente pas d’établir les liens entre l’empirisme et le scepticisme mais franchit un pas supplémentaire en établissant la portée naturaliste de l’empirisme : « L’empirisme conséquent, est un immanentisme[18]. » Autrement dit, la pensée ne peut pas aller au-delà du donné empirique ce qui nous ramène une fois encore au donné, puisque l’être, dans cette optique, ne saurait être différent du donné lui-même, propulsant ce qui n’est pas donné dans le domaine de la fiction. Le scepticisme n’est donc pas le dernier mot de l’empirisme décomposé jusqu’à ses plus ultimes conséquences.
AG : En effet, la conséquence sceptique de l’empirisme ne signifie pas la suppression de son horizon, qu’il faut dire métaphysique, en un sens qui n’est paradoxal qu’en apparence. L’empirisme conséquent implique selon Kant une ontologie de l’expérience, c’est-à-dire une équation de l’étant et du donné, ou une réduction de l’être au sensible. C’est ce qui constitue l’empirisme comme un naturalisme, qui se décline dans les antithèses respectives des quatre antinomies. Et Kant de souligner que ce naturalisme soutient l’intérêt théorique de la raison, en ce qu’il interdit que soit jamais brisé le fil conducteur de la légalité naturelle. En matière de connaissance, cette ontologie de l’expérience est plus féconde que la tentation de la transcendance. Il convient simplement de lui donner un sens méthodique, c’est-à-dire de la neutraliser ontologiquement, en lui rappelant la « différence transcendantale » des phénomènes et des choses en elles-mêmes.
ThG : Si nous restons autour de la question naturaliste, nous voyons que Kant entretient avec cette position un rapport subtil car d’un côté il rabat la naturalité sur la légalité, mais de l’autre il exhibe les raisons pour lesquelles il convient de résister à la tentation ontologisante que charrie la raison, et qui ferait du naturalisme une ontologie.
AG : En effet. Kant affirme la légalité extensive de la nature, mais refuse toute naturalisation de l’être L’idéalité transcendantale des phénomènes implique la fausseté d’un naturalisme qui serait par ailleurs dangereux pour la philosophie pratique. La nature, qui épuise le connaissable, et que la légalité structure extensivement, ne sature pas l’être. Cette position conjoint l’exclusion du miraculeux et la reconnaissance du sens de la liberté.
ThG : Pour quelle raison dites-vous à ce sujet qu’il y a dans le traitement kantien de la naturalité comprise comme légalité un « trait anti-newtonien[19] » ?
AG : Newton confère à la légalité de la nature une portée théologique, et participe en cela du courant dit de la « religion naturelle » ou du « théisme expérimental » dont Hume a fait justice dans les Dialogues. Kant est d’accord avec Hume sur l’impossibilité de ne tirer aucune conclusion transcendante de la légalité de la nature. La légalité de la nature est, si l’on peut dire, naturelle. Que la nature soit légale, et que la légalité soit strictement naturelle, cela constitue un trait anti-newtonien.
C : « Paradigme idéatif » et « ontologie de la représentation »
ThG : Le troisième chapitre de votre première partie est consacré à ce que vous appelez le « paradigme idéatif » et « l’ontologie de la représentation ». De manière extrêmement claire, vous expliquez que l’archéologie de l’empirisme étudie au fond la manière dont on a cru pouvoir passer de l’usage des connaissances à leur origine et vous proposez d’appeler la conclusion de l’usage à l’origine une « ontologie de la représentation. Nous entendons par là une conception qui, corrélant distinctement une représentation et l’être qu’elle signifie, ne peut concevoir pour la première une origine qui diffère radicalement de l’élément de sa performance objectivante[20]. » Puis, vous établissez qu’une telle ontologie se confond avec un « paradigme idéatif[21] » selon lequel la forme de la pensée serait de nature idéelle. Si penser signifie « idéer », alors l’usage et l’origine sont homogènes ; à ce titre l’empirisme partage avec le rationalisme un paradigme idéatif. Or, si je vous comprends bien, vous voulez montrer que le paradigme critique n’est opérant qu’au prix d’une rupture avec un tel paradigme.
AG : Oui. Dans l’ordre théorique, la philosophie critique est le résultat de la conjonction de deux découvertes principielles. D’une part, celle de l’idéalité du spatio-temporel, conséquence de l’originarité du caractère sensible de l’espace et du temps ; c’est la « grande lumière » de 1769, qui paraît alors que Kant s’emploie à chercher la solution des antinomies, et dont le Dissertation de 1770 constitue la première publication. D’autre part, celle du caractère fonctionnel du concept, que Kant découvre après la Dissertation, et qui implique que la pensée ne possède pas en elle-même un contenu, qu’elle ne trouve que dans son application à une intuition sensible, et dont sortira l’« Analytique transcendantale ».
ThG : Ne retrouve-t-on pas d’ailleurs dans certaines philosophies réalistes contemporaines une tendance à conclure de l’usage des concepts à l’origine, dans une perspective qui n’est certes pas celle d’une ontologie de la représentation mais qui n’en part pas moins de l’opérativité des concepts pour conclure quant à leur origine ?
AG : Je pense que vous avez raison sur ce point.
ThG : Comme vous le mentionnez, le cœur du problème est sans doute la représentation, mais je confesse ne pas avoir exactement compris les propos selon lesquels le concept ne serait plus représentationnel. Avec Cassirer, vous défendez une approche selon laquelle le concept n’est plus tant une représentation intellectuelle qu’un « opérateur de régulation[22] », vidé de toute ontologie – de toute représentation de quelque chose – ce qui permet d’expliquer ceci : « La version kantienne du paradigme fonctionnel est donc celle qui comprend le concept comme opérateur d’unification consciente du multiple[23]. » Peut-on parler d’une désontologisation de la représentation chez Kant ?
AG : Kant définit le concept comme une règle ou comme une fonction, c’est-à-dire comme ce qui sert à unifier quelque chose d’une façon à chaque fois déterminée. Le concept ne devient donc le concept de quelque chose que pour autant qu’il opère l’unification d’un contenu qu’il ne recèle pas. C’est toute la thématique de la « signification » du concept. Comprendre le concept comme une fonction ou une règle, c’est le vider de tout contenu représentationnel. Le concept, en lui-même, ne peut plus être compris comme la représentation de quelque chose, ce qui est constitutif de l’idée dans son acception cartésienne et postcartésienne. Dans ces conditions, le concept ne procède pas nécessairement de ce dans quoi il acquiert un sens. La détermination fonctionnelle du concept permet à la fois de désontologiser le concept (en lui-même, il ne signifie rien, ne possède pas de contenu) et de l’émanciper des conditions qui permettent son devenir signifiant (s’il ne signifie quelque chose qu’appliqué à l’intuition sensible, et à l’intuition sensible empirique, il ne procède pas lui-même de cette intuition).
ThG : Oui ; c’est d’ailleurs là le célèbre reproche de Hegel à l’endroit de Kant, jugeant que si le concept en lui-même ne signifie rien, c’est que la pensée de Kant demeure empiriste car tributaire de l’expérience pour qu’émerge la portée signifiante du concept.
Il y a toutefois un point que je ne suis pas sûr de comprendre : que le concept soit un opérateur d’unification consciente, cela se comprend aisément. Mais pour quelle raison le fait d’être un opérateur exclurait-il toute dimension représentationnelle de ce dernier ? Ce que vous dites est très éclairant sur l’éviction d’un objet transcendant directement représenté, mais je ne vois pas pourquoi cela congédierait la portée représentationnelle en général d’autant plus que, dans de nombreux textes, Kant maintient l’approche représentationnelle du concept, notamment dans Les Progrès de la métaphysique où il est manifeste que le registre de l’opération d’unification du concept se dit dans le lexique de la représentation :
« Or, les purs concepts d’entendement des objets en général donnés dans l’intuition sont précisément les mêmes fonctions logiques, mais seulement en tant qu’elles représentent [vorstellen] a priori l’unité synthétique de l’aperception du multiple donné dans une intuition en général (…)[24]. »
Et cela me semble tenir au fait qu’à aucun moment Kant n’exclut de la définition du concept son intrinsèque nature représentationnelle ce que là encore confirment Les progrès de la métaphysique :
« Pour ce qui concerne en revanche l’homme, toute sa connaissance consiste en concept et intuition. Chacun des deux est certes une représentation [Vorstellung], mais pas encore une connaissance. Se représenter [vorstellen] quelque chose par concepts, c’est-à-dire de manière générale, s’appelle « penser » et le pouvoir de penser s’appelle l’entendement[25]. »
Il me semble donc que Kant ne rompt pas avec la nature ni avec la portée représentationnelles du concept, mais qu’il l’associe à une fonction, la dimension opératoire du concept ne semblant pas rompre avec sa nature représentationnelle, ce qui explique le fait qu’il permet la « représentation d’un composé [die Vorstellung eines Zuzammengesetzten] », et non simplement sa production. Mais peut-être ai-je mal compris vos intentions, et ai-je cru à tort que la rupture avec le paradigme idéatif revenait à congédier le paradigme représentationnel.
AG : La première citation que vous donnez indique bien que les « fonctions logiques » deviennent des représentations de quelque chose, et ainsi des concepts d’objets, lorsqu’elles sont appliquées au multiple donné dans une intuition. Avant cette application, elles sont si l’on veut des représentations, dont il faut noter qu’il s’agit d’un concept générique que Kant ne définit pas, mais des représentations de rien, ce qui peut aussi bien être dit comme une détermination non-représentationnelle de la pensée en elle-même.
ThG : On peut tirer de vos analyses une conséquence sur le schème. Selon votre lecture, il devient évidemment très difficile à distinguer du concept puisque le concept ramené à sa seule fonction opératoire ne semble plus entretenir de différence nette avec l’opération que permet le schème, laquelle opération ne s’ajoute donc pas à celle du concept : vous dites à ce sujet que le schème est un « redoublement » et non un « dédoublement » car le concept et le schème « disent la même opération de régulation, une fois quant à son style logiquement contraignant, une fois quant à la dimension intuitive de son opérativité. Le schème est la modalité imaginative de la règle conceptuelle même, modalité sous laquelle cette dernière acquiert une efficace régulatrice sur l’intuition, dans son opération de configuration de cette dernière[26]. » Mais là je confesse à nouveau ne pas être sûr de comprendre car ce que vous dites revient à sortir de tout modèle iconique au profit d’une sorte d’opérativité exclusive ; mais dans ce cas, si véritablement on sort d’un tel modèle iconique, pourquoi l’imagination serait-elle à la manœuvre ? Autrement dit, est-ce que cela a du sens de dire d’une « modalité imaginative » qu’elle n’a rien à voir avec une image ?
AG : Selon Kant, qui introduit ici encore une innovation majeure, l’imagination ne se pense pas depuis l’image, mais l’image depuis l’imagination. Le schème n’est jamais l’image. C’est clairement le cas des schèmes transcendantaux, dont Kant dit qu’ils sont ceux de concepts dont on ne peut se faire aucune image : le schème de la cause (succession réglée) n’est pas une image de la cause, mais ce qui donne sens à la causalité, en faisant qu’elle puisse devenir la pensée de quelque chose (d’un événement). Mais c’est aussi le cas des schèmes des concepts empiriques ou des concepts mathématiques : le schème n’est pas l’image mais le procédé par lequel l’imagination donne lieu à des images. On retrouve exactement le même paradigme non-iconique qui est à l’œuvre dans la détermination fonctionnelle du concept, mais cette fois dans la détermination de l’opération de l’imagination elle-même, par laquelle une image du concept peut être produite. C’est pourquoi Kant parle du schème comme d’un « monogramme de l’imagination », par analogie avec le chiffre composé de lettres (initiales) qui n’est pas l’image de quelqu’un mais sert de support à sa représentation imaginative.
D : L’archi-empirique
ThG : j’en viens maintenant à la deuxième partie de votre ouvrage, thématisant ce que vous appelez « l’archi empirique » et visant au fond à montrer que, loin de se confondre avec l’inné, l’a priori doit être « acquis » ; mais n’est-ce pas simplement déplacer l’innéité en faisant de celle-ci ce qui permet d’acquérir l’a priori ?
AG : Selon Kant, ce qui est inné, c’est simplement la passivité et la spontanéité qui caractérisent respectivement notre intuition et notre pensée, mais aucunement les structures nécessaires qui sont les leurs, et qui, en vertu de leur être structurel ou fonctionnel, ne précèdent en rien, et donc pas même au titre de virtualités, leur être-à-l’-oeuvre.
ThG : Ce que vous dites rejaillit sur le statut des catégories, que vous ressaisissez dans un cadre épigénétique : « L’épigénèse ne dénote rien d’autre que cet advenir spontané de formes que la pensée tire de sa performance même. Le système de l’épigénèse défend donc l’évenementialité d’un transcendantal surgissant d’une performance qu’il ne précède en rien et qui relève en l’occurrence d’une authentique spontanéité[27]. » Vous parlez même d’une « épigénétique de la raison pure[28] » !
AG : C’est Kant qui, dans la deuxième édition de la Critique de la raison pure, clôt la déduction transcendantale des catégories par un moment génétique et défend ce qu’il présente comme un « système de l’épigenèse de la raison pure », contre le préformationisme innéiste et contre la « génération équivoque » que constituerait une dérivation empirique de l’a priori conceptuel.
ThG : Dans un dialogue serré avec l’ouvrage de Raphaël Ehrsam, Kant et la question du langage dont nous avions rendu compte ici, vous abordez le rôle du langage dans le cadre de l’acquisition de l’a priori, en particulier la question du pronom « je ». On sait que Raphaël Ehrsam analysait L’Anthropologie comme signifiant le conditionnement de la conscience de soi par la détention du langage et en particulier du pronom « je ». Or, montrez-vous, le § 1 de l’Anthropologie établit l’inverse, à savoir la priorité de la personnalité logique sur la première personne linguistique.
AG : Oui. Sur ce point, Kant reste un penseur du langage comme expression de la pensée, plutôt que comme constitution de la pensée. Parler à la première personne, c’est une expression de la personnalité, non ce qui la constitue. Pour autant, l’événement du « dire je » marque bien pour lui l’événement, plus radical mais non moins événementiel, de l’acquisition de l’unité de l’aperception.
ThG : Il n’est pas possible d’aborder dans le détail toute la richesse de la deuxième partie et je laisserai à regret toute la dimension pratique, mais je voudrais peut-être finir sur un aspect crucial que vous mentionnez concernant la légalité de l’empirique. « L’archi-empiricité, écrivez-vous, ne concerne pas seulement la dimension subjective – physiologique et pragmatique – de cette mise en œuvre du transcendantal qui constitue l’élément exclusif de son advenir. Ce dernier est également suspendu à la donation d’un certain type d’apparaître. La constitution transcendantale de la forme objective du donné dépend de l’exposition à une phénoménalité susceptible de se prêter à pareille mise en forme[29]. » Et cela vous conduit à étudier une « archi-empiricité de la donation[30] »
Ce point est très troublant parce qu’il revient à prendre conscience du fait que la matière se laisse informer par les formes de la subjectivité transcendantale, et donc qu’une sorte d’harmonie semble présider à l’expérience. Vous allez jusqu’à écrire ceci :
« L’homogénéité de l’empirique n’est rien de moins que la condition de possibilité empirique et contingente de l’actualité de la possibilité de l’expérience elle-même[31]. »
On a là une ligne de crête tout de même parce que si l’homogénéité de l’empirique est la condition de possibilité empirique de l’expérience (possible) alors on est à deux doigts de basculer dans un empirisme puisque cela revient à dire que c’est grâce à l’expérience qu’il y a de l’expérimentable. De surcroît, à bien des égards, cette condition de possibilité inscrite dans l’expérience n’est pas plus contingente que celle des formes de la subjectivité transcendantale, puisque celles-ci sont factices – Kant n’en établit jamais la nécessité en tant que telle et n’en donne pas les raisons.
AG : Kant soutient explicitement que l’expérience est l’occasion de l’a priori qui en assure la structuration. Et il va même plus loin, en soutenant que l’expérience en question est une expérience déterminée. C’est-à-dire qu’il faut que l’expérience se prête à son unification. Mais ce n’est pas un empirisme, car les formes a priori dont le fait est suspendu à un certain style d’apparaître ne retirent elles-mêmes rien de l’apparaître qui leur donne occasion d’être en leur donnant matière à opérer. Cela a bien à voir avec la facticité qui est celle des structures a priori en général, dont Kant assume ne jamais pouvoir établir la nécessité, et que j’avais analysée dans un ouvrage précédent. Mais c’est une sorte de radicalisation, dans la suspension de ce fait à quelque chose d’en effet absolument contingent, qui est un certain trait de l’empirique même. Le motif harmonique que vous évoquez sera précisément réintroduit, à ce sujet, dans la Critique de la faculté de juger. Mais comme une manière de donner un sens à cette facticité radicale, et non comme une manière d’en rendre raison.
ThG : Il y a dans votre ouvrage une relative discrétion de l’aperception transcendantale ; la détermination d’une condition empirique de l’expérimentable ne revient-elle pas à atténuer considérablement l’importance de l’aperception puisqu’en fin de compte c’est bien moins l’identité même de la conscience dans ses actes que l’homogénéité comme telle de l’empirique qui permet l’expérience possible ?
AG : Les deux points sont indissociables. L’identité de l’aperception transcendantale n’est pas celle d’un moi sous-jacent, mais celle d’un acte d’unification du multiple. Ce n’est pas atténuer son importance que de comprendre que ce qui gît dans un acte n’advient que dans la performance de ce dernier, performance qui, pour constitutive de toute objectivité qu’elle soit, ne peut elle-même s’accomplir que si certaines conditions empiriques sont réunies. Kant explique dès la Critique de la raison pure, avant d’y revenir dans la Critique de la faculté de juger, qu’une phénoménalité faite d’une discontinuité absolue d’événements tous absolument singuliers n’eût pas été, en droit, absolument impossible, et qu’elle aurait rendu impossible aussi bien la pensée que l’expérience qui a besoin d’elle.
ThG : Ces propos sur l’archi-empiricité et la « précarité du transcendantal » ne renvoient-ils pas exactement à ce que Fichte et Hegel voulaient éviter lorsqu’ils constataient qu’en ne sortant pas de la facticité, Kant passait à côté de la nécessité de ce dont il rendait compte, faisant planer sur l’ensemble de l’édifice l’ombre de la gratuité ?
AG : Bien sûr que oui. Mais toute la question est de savoir si l’assomption de la contingence de la pensée n’est pas indissociable de celle de la finitude … Kant est-il « passé à côté » de la nécessité (absolue ?) ou a-t-il résolument récusé toute tentative de surplomber cette contingence depuis laquelle seulement toute nécessité peut, pour nous, prendre un sens ?
Conclusion
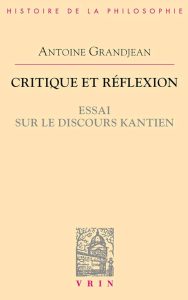
ThG : Je voudrais, pour finir, questionner le rapport entre Métaphysiques de l’expérience et Critique et réflexion. Dans ce dernier, vous affirmiez que « La Critique n’est pas la synthèse génétique qui part des éléments pour produire le tout de notre faculté de connaître. Elle est sa décomposition progressive[32]. » Cela vous permettait d’inscrire la démarche critique dans une espèce de « paradigme chimique » qui participe de la mise à l’écart de toute prétention génétique du philosopher. Ne peut-on pas lire justement Métaphysiques de l’expérience comme étant l’apport d’une nuance significative à l’endroit d’un tel jugement ?
AG : Métaphysiques de l’expérience nuance sur ce point Critique et réflexion, mais au sens d’un complément, me semble-t-il, plutôt que d’une relativisation. Car c’est depuis la Critique, et donc seulement à l’horizon de cette démarche analytique et chimique, que peut se poser la question génétique. C’est exactement ce que Kant fait, concernant les catégories de l’entendement, à la toute fin de leur déduction transcendantale : sachant ce que sont les catégories, quel est leur rôle et à quelle validité elles peuvent prétendre, que peut-on dire de leur advenir ? C’est cette question que j’ai voulu investir dans la seconde partie de Métaphysiques de l’expérience, et qui ne peut l’être que sur le sol dont Critique et réflexion tentait d’analyser la manière dont Kant le conquiert. Pour autant, ce complément confère en effet aux motifs de l’acquisition originaire et de l’épigenèse une importance que je ne soupçonnais pas à l’époque où je rédigeais Critique et réflexion.
ThG : Merci beaucoup de cette généreuse discussion !
***
[1] Cf. Emmanuel Kant, Sur l’échec de tout essai philosophique en matière de théodicée, suivi de Sur un prétendu droit de mentir par humanité, Traduction et présentation par Antoine Grandjean, Paris, PUF, 2024.
[2] Antoine Grandjean, Métaphysiques de l’expérience. Empirisme et philosophie transcendantale selon Kant, Paris, Vrin, 2022.
[3] Cf. Antoine Grandjean (dir.), Kant et les empirismes, Paris, Classiques Garnier, 2017.
[4] La présentation fort érudite des deux textes établit – entre autres choses – que dans son célèbre texte des Réactions politiques, Constant ne cible pas Kant mais Johann David Michaelis lorsqu’il évoque « un philosophe allemand ». Je renvoie à la riche note 2 de la page 118 pour la démonstration nuancée de cet élément.
[5] Ibid., p. 11.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] John Locke, Essai sur l’entendement humain, I, Introduction, § 2, Traduction Jean-Michel Vienne, Paris, Vrin, 2001, p. 58.
[9] Ibid., § 3, p. 59.
[10] Métaphysiques de l’expérience, op. cit., p. 161.
[11] Ibid., p. 33.
[12] Ibid.
[13] Antoine Grandjean, « La politique empiriste de la raison. Anarchisme ou despotisme ? », in Antoine Grandjean (dir.), Kant et les empirismes, op. cit., p. 19.
[14] Kant, Les progrès de la métaphysique, Suppléments, II, AK XX 325, Traduction Antoine Grandjean, Paris, GF, 2013, p. 163-164.
[15] Métaphysique de l’expérience, op. cit., p. 60.
[16] Ibid., p. 66.
[17] Antoine Grandjean, La philosophie de Kant, Paris, Vrin, coll. Repères, 2016, p. 64.
[18] Métaphysiques de l’expérience, op. cit., p. 95.
[19] Ibid., p. 105.
[20] Ibid., p. 141.
[21] Ibid., p. 142.
[22] Ibid., p. 181.
[23] Ibid., p. 187.
[24] Kant, Les progrès de la métaphysique, AK XX, 272 ; Traduction Grandjean p. 96.
[25] Ibid. AK XX, 325 ; Traduction p. 163.
[26] Métaphysiques de l’expérience, op. cit., p. 194.
[27] Ibid., p. 237.
[28] Ibid., p. 245.
[29] Ibid., p. 303.
[30] Ibid.
[31] Ibid., p. 305.
[32] Critique et réflexion, op. cit., p. 163.







