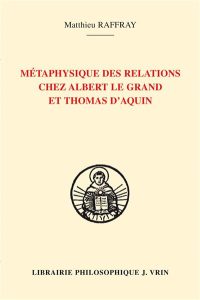 Métaphysique des relations chez Albert le Grand et Thomas d’Aquin de Matthieu Raffray est une étude aux multiples enjeux, qui dépasse le cadre que son titre semble lui imposer. En effet, de Thomas ni d’Albert il n’est question dans les 170 premières pages du livre ; la « métaphysique » dont il est question s’élabore essentiellement dans des œuvres théologiques ; les « relations » sont principalement les relations des personnes divines de la Trinité, et la relation de création entre le Créateur et les créatures. Cette étude est donc plus riche qu’elle ne semble, et les perspectives y sont multiples.
Métaphysique des relations chez Albert le Grand et Thomas d’Aquin de Matthieu Raffray est une étude aux multiples enjeux, qui dépasse le cadre que son titre semble lui imposer. En effet, de Thomas ni d’Albert il n’est question dans les 170 premières pages du livre ; la « métaphysique » dont il est question s’élabore essentiellement dans des œuvres théologiques ; les « relations » sont principalement les relations des personnes divines de la Trinité, et la relation de création entre le Créateur et les créatures. Cette étude est donc plus riche qu’elle ne semble, et les perspectives y sont multiples.
Commençons par ce qui est tout de même le cœur de l’étude : la conception de la relation que se font les deux grands théologiens scolastiques, Albert puis Thomas. Matthieu Raffray les étudie principalement à partir de leur Commentaire des Sentences, qui permet leur comparaison – et donne une longue anthologie bilingue des principaux textes y traitant de la relation (pp.175-227). Sa thèse est que les deux théologiens s’inscrivent dans une ligne strictement aristotélicienne en posant le primat de la substance sur la relation. Plus exactement, ils développent la structure bipolaire du concept de relation : d’une part, l’être de la relation est son accidentalité et donc son inhérence dans la substance (esse-in) ; d’autre part, la raison formelle (ratio) est son rapport à autre chose (ad aliquid), son caractère extatique, son être-vers (esse-ad). « La distinction fondamentale entre la nature accidentelle et la caractéristique propre de tout accident se traduit dans le cas du relatif en une double nature, inesse et adesse, inhérence et relationalité » (p.308). Ces deux pôles doivent toujours être pensés conjointement, et le risque sera d’affirmer l’un des deux unilatéralement, en omettant l’autre.
Il faut insister sur ceci que la relation n’a d’autre être que la substance dont elle est un accident. Elle ne doit pas être conçue comme une entité intermédiaire entre deux substances, elle ne préexiste aucunement aux termes qu’elle met en relation, mais elle dépend d’eux qui la précèdent. Pour Raffray, cela est le fait d’une stricte fidélité à l’analyse aristotélicienne de la relation comme accident de la substance : « il n’y a pas, finalement, écrit-il, dans la métaphysique de relations ; il n’y a que des êtres relatifs : car la relativité est toujours ontologiquement postérieure à la substance à laquelle elle est attribuée. » (p.52). Ainsi l’univers d’Albert le Grand est-il décrit comme « un univers aristotélicien, composé de substances qui entrent en relation, et non de relations qui composent les substances » (p.311).
Plus encore, la relation se voit attribuée l’être le plus faible (ens debilissimum), qui n’a d’autre raison que le rapport à quelque chose. Mais cette imperfection ou cette « faiblesse ontologique » est aussi sa force : elle en fait le genre le plus analogique de l’être, attribuable à toute réalité. « L’ens debilissimum, puisqu’il ne dit qu’un rapport, est le seul qui puisse convenir comme tel à tout être, au sens le plus large de l’analogie, depuis ce qui n’a d’être que comme négation jusqu’à l’ens per se. » (p.396). « La relation, finalement, se donne comme le plus petit dénominateur commun à toute réalité, précisément parce qu’elle a l’être le plus faible, et le plus souple. Elle est partout, à l’intime de l’être. » (p.450).
Cette métaphysique aristotélicienne des êtres relatifs est pleinement assumée par Thomas d’Aquin. Aussi son substantialisme, souvent critiqué, doit-il être compris à la lumière de cette relationalité qui n’en est certes pas l’être, mais une caractéristique importante. En de belles pages, Raffray plaide pour « une conception ouverte et dynamique de la substance. » Celle-ci n’est pas « une réalité close et statique, tournée vers elle-même et incapable de se situer par rapport à d’autres monades aveugles. Au contraire, la relation, parce qu’elle ordonne les substances, est le principe même d’ouverture et de communication de celles-ci. L’accident relatif, tout en demeurant inhérent à son sujet, détermine son regard vers les autres et vers le reste du monde. » (p.451). Il n’est de substance sans relation, sans rapport ni ordination à quelque chose d’autre ; mais réciproquement, il faut affirmer fermement, contre tous les « relationismes » qui revendiquent le primat ontologique de la relation, qu’il n’y a de relation sans substance, en laquelle elle inhère.
Voici pour la métaphysique des relations, ou plutôt des êtres relatifs, que Thomas et Albert bâtissent – pour des motifs et à des fins théologiques, comme on le verra par la suite.
 Il reste que cette perspective aristotélicienne fut souvent contestée et critiquée. Défendre la thèse aristotélicienne de la relation suppose de rendre compte de l’autre conception et d’en montrer l’insuffisance. Raffray la nomme « tentation platonicienne » et la décrit par le fait de « nier le caractère d’inhérence des êtres relatifs, donc le primat de la substance » et de concevoir la relation « comme un absolu, comme une forme séparée, ou comme une hypostase, un milieu entre deux sujets ». Opposé au substantialisme, tel est le « relationisme », dont le principe est la « susbtantialisation de la relation » (p.458). On fait de la relation une entité intermédiaire préexistant aux termes qu’elle constitue et met en relation. Pour reprendre la terminologie scolastique, l’accent y est mis sur le caractère extatique, l’esse-ad de la relation, au détriment de l’accidentialité ou esse-in. Le rapport entre les substances se trouve doué d’un certain être, au lieu de n’être que relatif à elles. Selon cette thèse, les relations subsistent par elles-mêmes, à l’instar des Idées platoniciennes, et les sujets concrets relatifs participent de ces relations idéales substantialisées. Raffray retrace la genèse de cette substantialisation de la relation, qui est moins platonicienne, que néoplatonicienne. Ainsi, un Porphyre écrira que « les relatifs sont la relation mutuelle des sujets, non les sujets eux-mêmes » et que « la relation qui permet l’existence des relatifs est une sorte de milieu entre les sujets » (cité p.64). « Les néoplatoniciens affirment que la relation est une entité réelle, qui existe en dehors des termes de la relation. » (p.64). Dans sa minutieuse analyse de l’histoire antique et surtout tardo-antique puis patristique du concept de relation, Raffray note l’éclipse de la véritable thèse aristotélicienne de l’accidentalité de la relation. Il faudra Augustin pour redécouvrir son sens : « Toute essence désignée en un sens relatif est « quelque chose », indépendamment du relatif » (De Trinitate, VII, 1, 2, cité p.111).
Il reste que cette perspective aristotélicienne fut souvent contestée et critiquée. Défendre la thèse aristotélicienne de la relation suppose de rendre compte de l’autre conception et d’en montrer l’insuffisance. Raffray la nomme « tentation platonicienne » et la décrit par le fait de « nier le caractère d’inhérence des êtres relatifs, donc le primat de la substance » et de concevoir la relation « comme un absolu, comme une forme séparée, ou comme une hypostase, un milieu entre deux sujets ». Opposé au substantialisme, tel est le « relationisme », dont le principe est la « susbtantialisation de la relation » (p.458). On fait de la relation une entité intermédiaire préexistant aux termes qu’elle constitue et met en relation. Pour reprendre la terminologie scolastique, l’accent y est mis sur le caractère extatique, l’esse-ad de la relation, au détriment de l’accidentialité ou esse-in. Le rapport entre les substances se trouve doué d’un certain être, au lieu de n’être que relatif à elles. Selon cette thèse, les relations subsistent par elles-mêmes, à l’instar des Idées platoniciennes, et les sujets concrets relatifs participent de ces relations idéales substantialisées. Raffray retrace la genèse de cette substantialisation de la relation, qui est moins platonicienne, que néoplatonicienne. Ainsi, un Porphyre écrira que « les relatifs sont la relation mutuelle des sujets, non les sujets eux-mêmes » et que « la relation qui permet l’existence des relatifs est une sorte de milieu entre les sujets » (cité p.64). « Les néoplatoniciens affirment que la relation est une entité réelle, qui existe en dehors des termes de la relation. » (p.64). Dans sa minutieuse analyse de l’histoire antique et surtout tardo-antique puis patristique du concept de relation, Raffray note l’éclipse de la véritable thèse aristotélicienne de l’accidentalité de la relation. Il faudra Augustin pour redécouvrir son sens : « Toute essence désignée en un sens relatif est « quelque chose », indépendamment du relatif » (De Trinitate, VII, 1, 2, cité p.111).
Pour Raffray, cette tentation platonicienne est une constante tentation de l’esprit humain, qui s’explique par sa propension à prendre pour réel ce qu’il conçoit. L’esprit est en effet capable de concevoir des « relations de raison », qui n’existent qu’en lui, et non dans la réalité. Mais cette construction rationnelle de relations ne doit pas être projetée dans les choses, car alors elle ferait de la relation un absolu, délié de tout fondement dans la substance.
Demandons-nous maintenant quel est l’avantage métaphysique qu’on peut tirer de la conception aristotélicienne et scolastique de la relation et quel usage spéculatif il en est fait. L’intérêt des pensées systématiques d’Albert et de Thomas est de conférer à la relation une place centrale, matrice d’intelligibilité de la réalité dans toute sa variété. Le concept de relation se révèle fortement analogique, valant aussi bien pour Dieu (relations trinitaires) que pour les choses créées (relation de création). Mieux, Raffray remarque que la relation se dit premièrement des relations divines, et seulement secondairement et de manière dérivée des choses créées. La relation est plus parfaite en Dieu, où elle est identique à l’essence divine (relation subsistante), que dans les créatures, où elle compose avec la substance. Sans entrer dans l’intégralité de l’usage de concept de relation pour penser la Trinité, que Raffray analyse précisément, il faut souligner que la relation est le moteur de la distinction des personnes dans l’unique essence divine. En Dieu, tout est un, sauf les relations d’opposition. C’est la relation en tant que rapport à autre chose qui multiplie les personnes, mais son « faible être » évite de multiplier l’essence divine. « C’est en raison de cette « pureté extatique » de la relation [esse-ad] que celle-ci peut être attribuée à Dieu, contrairement à tout autre prédicat » (p.441).
De plus, la relation permet de penser l’univers des choses créées comme ordonné – les choses sont ordonnées les unes aux autres aussi bien qu’à leur principe et fin qu’est Dieu. Raffray résume ainsi l’acquis de sa lecture : « est apparue chez l’Aquinate une conception systématique du rôle analogique de la relation, qui structure et ordonne l’ensemble de l’être créé et le rapporte à l’être Incréé : l’univers créé est saisi comme un tissu relationnel, d’abord en raison de la relation au principe qui structure l’ensemble des relations à Dieu, créées et incréées, mais aussi en raison de la fin des créatures » (p.443). Le concept de relation permet d’embrasser analogiquement aussi bien les relations divines et les relations créées – et même le rapport des unes aux autres, étant entendu que la procession des personnes divines (ad intra) est la raison et la cause de la procession des créatures (ad extra). Pour Raffray, les relations intra-trinitaires sont donc le fondement et l’archétype de toute autre relation. « Thomas ne se contente pas de distinguer les types de relations, mais il les relie métaphysiquement, il les tient dans une unique hiérarchie qui les ramène toutes à un principe premier, les relations divines. » (p.418). Il y a donc une relation entre les relations, un ordre des relations elles-mêmes. De même, chez Albert, le concept de relation possède une vertu organisatrice et unificatrice de la réalité qui en respecte la variété. Il permet de penser, selon une métaphore que Raffray affectionne, « un tissu de relations qui parcourent l’ensemble du réel pour le structurer et l’ordonner, permettant ainsi de l’appréhender comme un tout systématique » (p.310).
Nous disions que les enjeux de cette étude étaient multiples. On vient d’en percevoir l’enjeu philosophique, en quête d’une juste compréhension du concept de relation, entre accidentalité et relationalité. L’enjeu historique n’est pas moindre. Raffray examine avec pertinence et précision les métamorphoses du problème de la relation et des divers accents depuis Platon et Aristote en passant par le néoplatonisme et la théologie patristique jusqu’à Pierre Lombart et Gilbert de Poitiers au XIIème, au seuil des synthèses scolastiques d’Albert et de Thomas. Cette étude des « sources philosophiques et théologiques de la notion de relation » – titre de la première partie – ne se veut pas absolument exhaustive, mais vise à mettre en lumière l’apparition de problématiques centrales et de points cruciaux ». Une telle présentation de l’histoire de la notion de relation n’est pas sans option interprétative : elle tend à mettre en exergue le caractère d’accomplissement de la réflexion systématique d’Albert et plus encore de Thomas à propos de la relation.
 On peut aussi découvrir dans l’analyse historique de Raffray une implicite démonstration de la fécondité philosophique des spéculations théologiques. Des Cappadociens et Denys à Albert et Thomas en passant par Augustin et Boèce, ce sont les problèmes théologiques – Trinité et création principalement, avons-nous vu – qui occupent la réflexion et c’est à leur occasion qu’ils développent, par surcroît, des théories de la relation. Se perçoit donc la vitalité de ce qu’Etienne Gilson nommait « philosophie chrétienne » : une suscitation ou une fécondation de la philosophie par la théologie. Poursuivant ses propres fins, la théologie produit, par surcroît, de la philosophie, et pousse celle-ci à aller encore plus loin en son propre domaine. « D’une certaine façon, l’histoire de la théologie, dans ses aspects les plus fondamentaux, peut donc être considérée comme le moteur principal d’une conceptualisation toujours plus précise et plus profonde de la question des relations. On peut même affirmer, nous semble-t-il, que ce sont les problématiques théologiques elles-mêmes qui, loin de figer et de stériliser la vie philosophique, ont engendré les étapes les plus significatives d’une intelligence progressive de la notion de relation. » (p.26). Inversement, la théologie doit à la philosophie – en particulier aristotélicienne, comme il a été dit – les outils conceptuels pour penser les principaux dogmes de la foi. La philosophie, en tant qu’elle remplit son rôle de servante de la théologie, se trouve exhaussée et renouvelée, en retour.
On peut aussi découvrir dans l’analyse historique de Raffray une implicite démonstration de la fécondité philosophique des spéculations théologiques. Des Cappadociens et Denys à Albert et Thomas en passant par Augustin et Boèce, ce sont les problèmes théologiques – Trinité et création principalement, avons-nous vu – qui occupent la réflexion et c’est à leur occasion qu’ils développent, par surcroît, des théories de la relation. Se perçoit donc la vitalité de ce qu’Etienne Gilson nommait « philosophie chrétienne » : une suscitation ou une fécondation de la philosophie par la théologie. Poursuivant ses propres fins, la théologie produit, par surcroît, de la philosophie, et pousse celle-ci à aller encore plus loin en son propre domaine. « D’une certaine façon, l’histoire de la théologie, dans ses aspects les plus fondamentaux, peut donc être considérée comme le moteur principal d’une conceptualisation toujours plus précise et plus profonde de la question des relations. On peut même affirmer, nous semble-t-il, que ce sont les problématiques théologiques elles-mêmes qui, loin de figer et de stériliser la vie philosophique, ont engendré les étapes les plus significatives d’une intelligence progressive de la notion de relation. » (p.26). Inversement, la théologie doit à la philosophie – en particulier aristotélicienne, comme il a été dit – les outils conceptuels pour penser les principaux dogmes de la foi. La philosophie, en tant qu’elle remplit son rôle de servante de la théologie, se trouve exhaussée et renouvelée, en retour.
Enfin, le troisième niveau d’enjeu est théologique. Il est manifeste maintenant que c’est au creuset des problèmes théologiques que fut développé le concept de relation. Il fut développé, avons-nous dit, sous le primat aristotélicien de la substance, fût-ce selon une « conception ouverte et dynamique de la substance ». Or, dès l’introduction, Matthieu Raffray constate le développement du « relationisme » dans la théologie contemporaine. Plus encore, c’est la théologie chrétienne qui se trouve créditée du louable travail d’émancipation de la notion de relation hors de l’orbite de la substance. Joseph Ratzinger, par exemple, écrit dans Foi chrétienne hier et aujourd’hui que « l’expérience du Dieu qui dialogue, du Dieu qui n’est pas seulement logos mais dia-logos, pas seulement Pensée et Sens, mais conversation et parole dans la relation entre interlocuteurs, cette expérience fait éclater l’ancienne division de la réalité en substance, être proprement dit, et accident, être secondaire et fortuit. Il devient clair à présent qu’à côté de la substance, le dialogue, la relation représentent une forme de l’être pareillement originelle » (cité p.19). La théologie chrétienne retrouverait donc la déconstruction philosophique de la substance, menée tantôt par Kant et Heidegger – déconstruction que l’auteur rappelle, mais sans l’analyser davantage, ce qui eût été profitable. Plus encore, ce sont même certains thomistes contemporains, à l’instar de Dominique Dubarle, qui attribuent à Thomas d’Aquin lui-même l’initiative d’une ontologie de la relation, nourrie par la théologie trinitaire.
Par conséquent, l’intention avouée de Matthieu Raffray est « d’interroger le bien-fondé de cette intrusion du relationisme dans la théologie contemporaine, en le mettant à l’épreuve de l’histoire et de ses textes. » (p.25). Au terme de son enquête, il peut conclure – légitimement nous semble-t-il, tant elle fut minutieuse – que, s’il y a bien des racines antiques et médiévales au « relationisme », « c’est finalement contre elles, ou du moins par mode de dialogue et de contraposition, que les grandes synthèses d’Albert et de Thomas sont parvenues à se constituer comme des systèmes complets et cohérents, capables de penser sous la raison analogique de relation la consistance du monde et ses rapports avec Dieu comme principe d’unité » (p.453).
Mais il y a encore un enjeu dans l’enjeu, je veux dire un problème intra-thomiste au sein du problème intra-théologique. Pour Raffray, il faut au moins autant critiquer l’intrusion du relationisme dans le thomisme que dans la théologie en général. La forme par laquelle le relationisme lui semble pénétrer dans le thomisme est celle d’une prétendue « relation transcendantale ». Qu’est-ce à dire ? « Une relation transcendantale – par opposition à la relation prédicamentale qui est toujours l’accident d’une substance – est un ordre inclus dans l’essence même d’une chose absolue. Elle désigne donc la relativité non accidentelle d’une chose à une autre, c’est-à-dire un rapport qui ordonne une substance, par elle-même et sans l’entremise d’un accident, à un terme distinct d’elle » (p.330). Également appelée « relation substantielle », elle tâche de penser une chose purement relative, dont l’être n’est que le renvoi à autre chose, une chose dont la substance est sa relation. C’est principalement la relation de création qu’on est tenté de concevoir comme « relation transcendantale ». La créature serait par essence relative au Créateur. En effet, la relation de création a ceci de spécifique qu’elle constitue la substance créée ; celle-ci ne peut en effet préexister à la relation de création qui la crée. La notion est d’abord scotiste : pour Duns Scot, « le fait d’être créé n’est rien d’autre qu’un rapport de dépendance envers Dieu, mais un tel rapport ne peut être accidentel, en raison de son lien consubstantiel avec l’être même de la créature. » (p.332). Certains thomistes semblent ensuite avoir étendu cette notion de « relation transcendantale » à la relation de la matière à la forme (Cajetan), et même de toute puissance à son acte, jusqu’au rapport de l’essence à son acte d’être (Báñez). Les pages que Raffray consacre à la généralisation de cette position, en passant par Suarez jusqu’aux contemporains Dominique Dubarle et Stanislas Breton, pour des motifs parfois divers, font bien voir le succès d’une doctrine dont on ne trouve pourtant pas mot chez saint Thomas. Comme l’a montré la grande exégèse de Krempel dans La Doctrine de la relation chez saint Thomas (1952), dont Raffray suit la conclusion sur ce point, Thomas ne revient jamais sur la thèse de l’accidentalité de la relation à propos de la relation de création.
Cela a d’importantes conséquences quant au rapport, si fondamental et si disputé, entre la nature et la grâce. L’ordination de la créature suit sa substantialité mais n’y est pas identique. Le danger de penser la relation de création comme une relation transcendantale est « une sorte de surnaturalisme » (p.459), qui ne permet pas de penser la créature sans penser son Créateur, et menace l’autonomie du créé. Tel est le grief de fond que Matthieu Raffray adresse au « relationisme » : « Les lectures relationistes de l’homme se révèlent donc non seulement mal fondées historiquement, mais aussi ambiguës et finalement incapables de saisir la consistance propre de la nature humaine en tant que telle, qui, bien qu’autonome dans l’ordre naturel, y est pourtant ordonnée à Dieu comme à sa fin, l’ordre surnaturel ne venant s’ajouter que par surcroît, en raison d’une relation de grâce supplémentaire » (p.460).
À vrai dire, on peut regretter qu’une question aussi fondamentale, qui régule souterrainement tout l’exposé de Raffray, ne soit abordée qu’en conclusion en quelques pages expéditives. Là apparaît sans doute la lacune de cette étude : elle se veut historique, et elle l’est, mais finalement, en tant qu’étude historique, elle n’aboutit qu’à une conclusion relativement restreinte : Thomas et Albert emboîtent le pas du substantialisme aristotélicien. Évidemment, cette étude a une ambition plus grande, mais elle ne prend pas le temps de fournir les justifications spéculatives de ses affirmations conclusives. Une thèse historique ne fait pas une thèse spéculative, même si elle en est sans doute le préalable, en tant qu’elle clarifie les termes du débat. Une authentique « métaphysique des relations » eût supposé d’affronter les nombreuses critiques philosophiques – et non seulement théologiques – anti-substantialistes et d’y répondre, à partir d’Aristote, d’Augustin, d’Albert et de Thomas – mais aussi éventuellement à l’aide de la philosophie analytique. Montrer que ceux-ci sont substantialistes ne suffit en effet pas à justifier le substantialisme – et le plaidoyer pour une « conception ouverte et dynamique de la substance » ne laisse pas d’être programmatique. En bref, l’histoire de la philosophie et de la théologie ne doit pas dispenser de philosophie, ni de théologie. Mais peut-être est-ce trop demander à une étude dont la densité et l’exactitude dans le périmètre qu’elle s’est fixée sont déjà très appréciables.








