Dans un premier compte-rendu, publié sur ce site, nous avons fait état des quatre chapitres de La Chair de Dieu, à travers lesquels E. Falque nous a permis de réfléchir successivement à l’érôs et à l’eucharistie (Jeudi saint), à la souffrance charnelle et à la mort (Vendredi saint), à la descente de Dieu dans nos épreuves humaines (Samedi saint), à la naissance et à la Résurrection (Dimanche de Pâques). Nous avons souligné l’originalité d’une pensée qui ose se dire en marge d’un logos systématique, et se confronter à une expérience quasi esthétique, en même temps que philosophique et théologique. E. Falque insiste sur la nécessité de montrer ce Triduum philosophique comme toujours se faisant, non pas au sens où il serait inachevé, mais en atteignant ce qui constitue son cœur : la chair de Dieu.
En posant la question de « l’épaisseur du corps et le problème de l’âme » (titre de cette seconde partie), E. Falque interroge tous les corps qui se déclinent dans le Triduum philosophique : corps offert et mangé, corps souffrant et mourant, cadavre et corps relevé, chair ressuscitée. Le lecteur pourra alors se demander en quoi ces différents corps sont unifiés, et dans quelle mesure le retrait du corps et la résurrection de la chair, ne nient pas ce qu’il en est de notre corps biologique dans la récapitulation de tout. « Il y va ici, dit Emmanuel Falque, de l’unité de la chair de Dieu de l’incarnation à la résurrection, soit un chemin allant du corps physique (Körper) à la chair ressuscitée (Leib), sans que la seconde (la chair) soit la négation du premier (le corps), mais son assomption et sa transformation. » (p. 211).
- LES TROIS CORPS
Du tombeau vide au matin de Pâques, comment faut-il entendre la non-décomposition du Christ mort, le corps incorrompu du Ressuscité ? E. Falque insiste sur cette non-décomposition afin de montrer justement qu’elle ne renvoie pas à l’absence de sa mort réelle : « Ce n’est pas le cadavre qui est contesté, mais l’hypothèse erronée selon laquelle son corps aurait été totalement oublié de la divinité. » (p. 212). Comme il le dit trois pages plus loin : « Tout n’est pas fini quand tout touche à sa fin. Tel est le point ultime de la « kénose de la finitude », atteignant la chair de Dieu jusqu’en son cadavre. » (p. 215). Si ce qui est uni à la chair de Dieu est sauvé, cette chair de Dieu est aussi à entendre comme « cadavre » pour notre auteur. Et le lecteur comprendra que c’est peut-être là le plus grand défi d’une pensée de la résurrection. Comment penser philosophiquement le corps du Christ ressuscité dès lors que son cadavre ne se tient plus dans le tombeau vide ? Emmanuel Falque nous fait remarquer à juste titre que « l’inertie du cadavre est à la mesure de son relèvement » (p. 213). La peinture est riche d’enseignement en ce sens, et particulièrement la Lamentation sur le Christ mort (peint a tempera vers 1500) d’Andrea Mantegna, joyau de la pinacothèque de Brera, à Milan. Le cadrage resserré et l’effet de perspective sont inhabituels dans l’art. On y perçoit les principaux stigmates du Christ. Tout y est centré sur le Christ qui semble seul dans la mort – les autres personnages étant repoussés sur le bord du cadre, presque hors champ –. Le marbre froid de la mort, le drapé couvrant le mort, les veinures rouge du marbre en écho au sang du Christ. Mantegna met l’accent sur toute l’humanité du Christ, Fils de l’Homme. La tête du Christ auréolée y est très légèrement perceptible. Or entre ce merveilleux tableau et ce que notre auteur nous dit, se tisse une relation métaphysique : ici, une métamorphose déjà s’initie, de sorte qu’une transformation se noue de la chair biologique vouée à la corruption à la chair phénoménologique du « relèvement » du corps. Sur ce tableau précisément, E. Falque fait remarquer au lecteur « le buste bombé en voûte d’ogive comme s’il s’apprêtait à respirer, et donc à être à nouveau indexé au nombre des vivants. » (p. 214) : magnifique commentaire qui ne manque pas non plus de relever la boîte d’aromates à l’angle du tableau : « mélange de myrrhe et d’aloès » offert à Nicodème pour l’ensevelir (Jn 19, 39), mais aussi les « aromates et parfums » préparés par les femmes au jour de la Résurrection (Lc 6, 56). Pour Emmanuel Falque, c’est en tenant la « mort véritable » du Christ, y compris jusqu’à la disparition de la divinité dans son cadavre, que l’on tiendra à sa « vraie résurrection » à laquelle nous pourrons aussi participer. C’est pourquoi, le philosophe nous met en garde contre les tentations de spiritualiser le « corps mort » du Christ, autrement « il nous deviendra étranger et manquera l’horizon de la finitude dans lequel nous sommes avec lui engagés. » (p. 215). E. Falque posant un regard de philosophe sur la peinture ne manque pas de remarquer, à la suite de Daniel Arasse, que tout tient à une lecture du détail, à cette attention qui rend compte d’une exigence de l’esprit capable de déceler le feu de vie sous la cendre de la mort. Et ainsi, dans le tableau de 1521 réalisé par Holbein le Jeune : Le Christ mort dans la tombe (à Bâle) : tout nous y indique le début d’une putréfaction (les pieds tuméfiés, les yeux révulsés). Mais E. Falque nous fait remarquer un détail essentiel : « Le « majeur » de la main crispée par la mort montre le linceul comme unique signe de ce qu’il en sera du ressuscité, laissant voir, ou à tout le moins croire, que là se tient encore de la « vigilance », et donc de l’existence. » (p. 215). Et c’est intentionnellement, aura remarqué le lecteur, qu’E. Falque analyse ce tableau déjà présent dans L’Idiot de Dostoïevski : l’apparence est trompeuse, ou les images nous trahissent. Car si ce tableau pourrait nous faire croire que notre existence s’arrête au cadavre, car cela signifierait que Dieu (la puissance de résurrection du Père) abandonne finalement le corps. Mais pour E. Falque, à défaut d’y être directement trouvée, la divinité s’y tient cachée : « Et à l’instar de la présence cachée du Verbe dans le « pain eucharistique », ainsi en va-t-il aussi du divin toujours tenu dans le cadavre, enfoui à ce point dans notre chair corruptible, que rien ne saurait lui échapper. » (p. 216).
Si le Christ lui-même connaît plusieurs états du corps, et s’il revient au christianisme de poser non pas uniquement la succession de ces moments ou de ces modes d’être mais leur continuité, le corps ressuscité ne doit pas demeurer en complète discontinuité avec le « corps organique souffrant », « avec le corps du squelette qui craque » (Le Passeur de Gethsémani), le « corps épandu ou mangé » de l’érôs consommé dans l’eucharistie (Les Noces de l’Agneau). Dans ce dernier livre d’E. Falque, le lecteur se rappellera que le corps épandu ou le corps vivant se tient à la zone frontalière entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu d’Husserl. Ce corps épandu, son vécu organique, est précisément ici ce qui questionne le philosophe. Car il faut bien de l’organique pour ne pas fuir dans le phénoménologique. Et dans cette perspective, il rejoint les investigations de Nietzsche (et le corps pulsionnel), car il n’y a pas de chair sans corps dès lors que le corps organique est le support de la chair phénoménologique. La chair de Dieu ne désigne donc pas seulement pour E. Falque la chair phénoménologique ni le vivant du corps, ou sa chair biologique, mais cela même qu’il n’y a jamais de vie charnelle sans support corporelle. Et c’est bien là, dans ce chiasme pourrait-on dire, que se tient l’originalité de la thèse d’Emmanuel Falque. Pourquoi ? Car selon nous, l’auteur montre que de l’incarnation à la résurrection, le salut tient à l’assomption de la chair biologique dans la chair phénoménologique. Mais comment le lecteur pourra-t-il entendre cette assomption ?
De la naissance du Christ à Bethléem jusqu’aux récits d’apparition où ses disciples le reconnaissance à son attitude (sa manière de manger, le timbre de sa voix, les gestes des mains), E. Falque insiste sur le fait qu’il n’y a jamais « oubli ou éviction de la matière ». L’auteur nous rappelle que le Christ vient nous montrer la réalité humaine d’un corps. Cette réalité est celle même de la voix singulière, unique, du Christ, que Marie-Madeleine reconnaît au matin de Pâques. « Ceci est mon corps » (hoc est corpus meum), dans le cadre du don eucharistique, rejoint la part du passionnel, du pulsionnel qui se tient dans l’organique, afin de transformer non pas notre humanité en divinité, mais notre animalité en humanité, dans la filiation. Le propre du corps épandu consiste pour E. Falque « non pas seulement à le délimiter comme une extension corporelle ou à l’abstraire dans son vécu charnel, mais à le délimiter comme « organique » en le visant comme proprement humain. » (p. 221). Et pour notre auteur, ce « proprement humain » s’entend dans le verset 39 du chapitre 15 de Marc : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » : la chair de Dieu est reconnue ici d’abord par son corps. Pourquoi ? Parce que dans ce corps, il peut s’unir singulièrement à tout homme. « Le Christ ne nous enseigne pas ce que c’est que d’être Dieu, mais ce que c’est que d’être homme », souligne E. Falque, p. 222. Contre la gnose (Marcion et Valentin), le réalisme charnel des premiers Pères de l’Église (Irénée et Tertullien) nous rappelle à l’organique, à ce « corps épandu » qui rejoint notre animalité. Les réalisations areligieuses de l’art contemporain nous le rappellent. Or pourquoi est-ce « seulement dans les boucheries que, pour Gilles Deleuze, Francis Bacon est un peintre religieux » ? (Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Seuil, p. 30) : en quoi la viande vient-elle ici rejoindre le religieux ? On aurait pu espérer qu’Emmanuel Falque s’étende sur ce point, en envisageant, par exemple, le triptyque de Francis Bacon : Trois études de figures au pied d’une crucifixion que le peintre réalise en 1944. Sur le panneau de gauche, on aperçoit une figure qui se recroqueville sur une sorte de piédestal. Ses omoplates sont arrondies. Au centre, la figure tient d’un oiseau, la face partiellement voilée et criant. Et sur le panneau de droite, la figure est très animale. Elle est plantée sur une jambe unique. Le cou est tendu horizontalement. La bouche hurle : elle est grande ouverte vers le haut. On aperçoit sa denture. Ce que Bacon nous dit de l’Homme est sa violence. Car dans le corps organique, il y a aussi sa violence, cette force qui emporte l’Homme, et le pousse au pire. Il aurait été intéressant qu’E. Falque développe sur cette part pulsionnelle, sur cette violence qui, déjà pour Freud, constituait un malaise dans la culture.
Entre ces forces qui m’agitent, et les contradictions dans lesquelles elles me conduisent, on peut se demander comment être soi-même, devenir soi-même. Si pour notre auteur, comme pour saint Paul avant lui, la pierre angulaire reste le Christ, alors être soi-même revient à traverser la voie qui va du corps que j’ai au corps que je suis, du simple organique qui fait le propre de la vie ici-bas dans une sorte de viatique (l’eucharistie), au vécu psychique voire spirituel auquel seul accède le corps ressuscité. Ce qui est nous est à ce point constitutif (notre corps organique) ne peut pas devenir tellement étranger à ce que nous serons puisque cela aussi nous le sommes. Emmanuel Falque analyse ce point avec beaucoup de pertinence en disant que « la résurrection de la chair n’est pas l’immortalité de l’âme. Mais quelle est l’anthropologie adéquate à cet autre type de corporéité ?
Mais la résurrection est-elle l’acte du retour du « corps » dans la vie future ; ou bien faut-il l’entendre comme l’assomption par la chair de la vie organique, comme « vie » et non pas uniquement comme matière ?
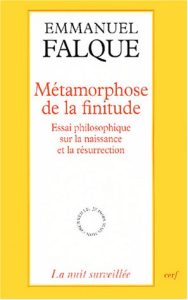 Dans Métamorphose de la finitude, notre auteur l’avait déjà fait apparaître comme un point aveugle quand il disait au § 30 de ce livre : « La résurrection n’est pas seulement la manifestation ou l’apparition d’un autre mode de présence par la chair. Elle est aussi disqualification, ou plutôt retrait, de la substantialité du corps » (MF, p. 229). Par cette dernière expression (« la substantialité du corps »), le lecteur devra entendre la pure matérialité du corps terrestre : E. Falque l’exhorte ainsi à bien comprendre qu’il faut revenir à la « même vie » que nous avons traversée. Mais qu’est-ce que cela signifie au juste ? « Pas de retour dans l’acte de ressusciter, dit notre auteur (qu’il soit de l’ordre de la métempsychose de Platon ou de celui de l’éternel retour de Nietzsche), mais seulement une transfiguration qui fera que le même devient autre, sans cependant devenir tout autre, ou étranger à cela même qu’on était. » (p. 230). Ces formules ont de quoi étonner : que veut nous signifier E. Falque ? De nouveau, il va s’appuyer sur l’Écriture pour le dire, et particulier sur saint Paul. Si le Christ est ressuscité avec son propre corps, il n’est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lu, tous ressusciteront avec leur corps qu’ils ont « maintenant », mais ce corps sera « transfiguré en corps de gloire » (Ph 3, 21), en « corps spirituel » (1 Co 15, 44). Quel est donc ce « maintenant » du corps que nous retrouverons « demain » ? Car si « maintenant » nous sommes bien chair ou vécu du corps, mais aussi corps ou organicité, il faut bien que quelque chose de la chair « et » du corps puisse se relever dans la résurrection. La question du phénoménologue E. Falque dialogue avec la théologie et toute l’exégèse biblique, et prend appui sur le IVème concile de Latran (1215) qui éradiquera toutes les hérésies spiritualistes (en particulier les joachimites) et introduira le « maintenant » du corps présent, pour dire le « demain » du corps ressuscité : « Tous ressusciteront avec leur propre corps qu’ils ont maintenant. » Le lecteur aura compris que nous ne ressusciterons pas avec un corps aérien ou dans quelque espèce de chair, mais dans cette chair avec laquelle nous existons et nous vivons.
Dans Métamorphose de la finitude, notre auteur l’avait déjà fait apparaître comme un point aveugle quand il disait au § 30 de ce livre : « La résurrection n’est pas seulement la manifestation ou l’apparition d’un autre mode de présence par la chair. Elle est aussi disqualification, ou plutôt retrait, de la substantialité du corps » (MF, p. 229). Par cette dernière expression (« la substantialité du corps »), le lecteur devra entendre la pure matérialité du corps terrestre : E. Falque l’exhorte ainsi à bien comprendre qu’il faut revenir à la « même vie » que nous avons traversée. Mais qu’est-ce que cela signifie au juste ? « Pas de retour dans l’acte de ressusciter, dit notre auteur (qu’il soit de l’ordre de la métempsychose de Platon ou de celui de l’éternel retour de Nietzsche), mais seulement une transfiguration qui fera que le même devient autre, sans cependant devenir tout autre, ou étranger à cela même qu’on était. » (p. 230). Ces formules ont de quoi étonner : que veut nous signifier E. Falque ? De nouveau, il va s’appuyer sur l’Écriture pour le dire, et particulier sur saint Paul. Si le Christ est ressuscité avec son propre corps, il n’est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lu, tous ressusciteront avec leur corps qu’ils ont « maintenant », mais ce corps sera « transfiguré en corps de gloire » (Ph 3, 21), en « corps spirituel » (1 Co 15, 44). Quel est donc ce « maintenant » du corps que nous retrouverons « demain » ? Car si « maintenant » nous sommes bien chair ou vécu du corps, mais aussi corps ou organicité, il faut bien que quelque chose de la chair « et » du corps puisse se relever dans la résurrection. La question du phénoménologue E. Falque dialogue avec la théologie et toute l’exégèse biblique, et prend appui sur le IVème concile de Latran (1215) qui éradiquera toutes les hérésies spiritualistes (en particulier les joachimites) et introduira le « maintenant » du corps présent, pour dire le « demain » du corps ressuscité : « Tous ressusciteront avec leur propre corps qu’ils ont maintenant. » Le lecteur aura compris que nous ne ressusciterons pas avec un corps aérien ou dans quelque espèce de chair, mais dans cette chair avec laquelle nous existons et nous vivons.
Toutefois, si la résurrection est « incarnation » ou relèvement du « vécu de la chair », elle doit être aussi incorporation (intégration du corps organique). Et c’est précisément avec cette incorporation qui va de la chair au corps, qu’E. Falque confronte sa pensée philosophique : qu’en est-il au juste de cet « organique », de sa place ? Pour notre auteur, le pivot est l’eucharistie : tout se joue dans ce sacrement. En effet, si la chair de la résurrection assume et transformer le corps de l’eucharistie, c’est bien le corps de l’eucharistie qui conduit et conditionne la chair de la résurrection. Et de ce chiasme le lecteur comprendra qu’il y va de deux voies qui se croisent en quelque sorte : de la passion à la résurrection et de la résurrection à la passion : « Alors qu’on va du corps de la chair sur la voie de la résurrection, on retourne de la chair au corps dans le viatique de l’eucharistie. » (p. 232). Si le trajet est le même, le trajet est inversé : « La voie de l’incarnation est celle de la résurrection, nous dit E. Falque ; et la voie de l’incorporation est celle de l’eucharistie. Au devenir chair du corps (résurrection) répond le devenir corps de la chair (eucharistie). En cela, poursuit-il, les deux mystères ne s’opposent pas, mais ils se tiennent théologiquement. » (p. 233). Et c’est dans cette perspective que notre auteur envisage l’organique comme étant totalement assumé par le Ressuscité.
Or c’est précisément en prenant en compte l’anthropologie paulinienne qu’Emmanuel Falque, comme l’apôtre, et après lui, saint Thomas d’Aquin, ne se satisfait pas de l’opposition du somatique et du psychique, mais pense une assomption du somatique et du psychique par le pneumatique : « Semé corps animal, l’Homme ressuscite corps spirituel » (1 Co 15, 44). Les composants de l’Homme sont « trois » et non pas « deux » : « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour rester irréprochables. » C’est donc à partir du corps et de l’âme pris dans et par l’esprit qu’Emmanuel Falque pense « un enlacement divin » (p. 234). Et en se confrontant jusqu’au bout à la question du corps ressuscité, E. Falque montre qu’il ne s’agit pas d’une reconstitution à l’identique de ce que nous fûmes, mais bien d’une reconnaissance mutuelle dans ce que nous sommes, avec lui, en lui, car la corporéité n’est pas l’agrégat d’éléments physiques : « À la fois en personne, et doté d’un « corps praxique » engagé aussi avec la matière, le Christ ressuscité assume théologiquement les deux dimensions phénoménologiques de la présence « en chair et en os ». » (p. 235). Mais comment alors penser la résurrection de notre corps philosophiquement ? E. Falque précise qu’il n’est pas ici question de penser une reconstitution d’atomes, mais ce qu’il appelle, à la page 238, « un mode artistique d’expression ». Qu’est-ce à dire ? Que doit comprendre le lecteur ici ? Par ce « mode artistique », notre auteur entend un mode par quoi tout ce que notre chair ressuscité devra traduire, manifester, et transformer le tout de ce que nous étions dans ce que nous serons. » (p. 238). Donc, à la fin des temps, nous vivrons avec notre corps, avec tout ce qui le fait être notre corps dans le lien à la chair. E. Falque précise alors qu’il ne s’agira pas seulement de « simples traces pathiques » comme si la chair gardait exclusivement le « souvenir passé » de ce corps, mais d’un véritable nœud vital et substantiel, d’un lien d’union. » (p. 239). On voit ici toute l’influence que Maurice Blondel a pu exercer sur la pensée de notre auteur. Dans son essai L’Être et les êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale, le philosophe dit que c’est bien le lien qui réalise à des degrés différents l’assimilation. L’identité du corps ne se conçoit donc pas à partir de la matière, mais à partir de la personne, à partir de l’âme. Le corps physique devient corps humain par le truchement de la personne. Notre auteur pose donc sa spéculation philosophique avec le théologique, car il se positionne à partir du lien entre l’étendu et le vécu : ni exclusivement l’organique, ni seulement le phénoménologique, mais le métaphysique car c’est bien tout notre être qui, pour Emmanuel Falque est compris dans cette traversée.
 La relation de la chair au corps pose la question du sens de l’être incarné. La corporéité devient pour E. Falque cette zone frontière entre le corps que nous avons et le corps que nous sommes. C’est bien le lien substantiel qui unit ma chair et mon corps qui marque cela de moi qui ressuscite. Citant Être et Avoir de Gabriel Marcel, notre auteur met l’accent sur cet « espèce d’empiétement irrésistible de mon corps sur moi », ce qu’E. Falque ne manque pas de relever, poursuivant ses investigations sur l’identité de la substance avec saint Augustin et saint Thomas d’Aquin. Pour ce dernier, la relation entre mon « avoir » (estomacs, organes génitaux, cheveux, ongles, etc.) et mon « être » (santé, maladie, nutrition, jouissance, souffrance, douleur…) est une question qui l’occupe dans sa Somme contre les Gentils (Contra Gentiles IV, 88) : « Nous ressusciterons avec nos estomacs ou nos organes sexuels mais sans que nous ayons à nous servir de ces organes, car on ne se nourrira plus après la résurrection… Et même si l’on ne s’en sert pas, tous les organes de ce genre seront là pour restituer l’intégrité du corps naturel. » Fidèle à son anthropologie si peu dualiste, saint Thomas dira que nous ne sommes pas membres du Christ par nos âmes seules, mais aussi par nos corps, parce que toute vie de la grâce, si spirituelle qu’elle soit, s’incarne dans notre être corporel, dans le temps. Et c’est dans son propre corps de gloire que le Christ ressuscité est l’instrument de la grâce.
La relation de la chair au corps pose la question du sens de l’être incarné. La corporéité devient pour E. Falque cette zone frontière entre le corps que nous avons et le corps que nous sommes. C’est bien le lien substantiel qui unit ma chair et mon corps qui marque cela de moi qui ressuscite. Citant Être et Avoir de Gabriel Marcel, notre auteur met l’accent sur cet « espèce d’empiétement irrésistible de mon corps sur moi », ce qu’E. Falque ne manque pas de relever, poursuivant ses investigations sur l’identité de la substance avec saint Augustin et saint Thomas d’Aquin. Pour ce dernier, la relation entre mon « avoir » (estomacs, organes génitaux, cheveux, ongles, etc.) et mon « être » (santé, maladie, nutrition, jouissance, souffrance, douleur…) est une question qui l’occupe dans sa Somme contre les Gentils (Contra Gentiles IV, 88) : « Nous ressusciterons avec nos estomacs ou nos organes sexuels mais sans que nous ayons à nous servir de ces organes, car on ne se nourrira plus après la résurrection… Et même si l’on ne s’en sert pas, tous les organes de ce genre seront là pour restituer l’intégrité du corps naturel. » Fidèle à son anthropologie si peu dualiste, saint Thomas dira que nous ne sommes pas membres du Christ par nos âmes seules, mais aussi par nos corps, parce que toute vie de la grâce, si spirituelle qu’elle soit, s’incarne dans notre être corporel, dans le temps. Et c’est dans son propre corps de gloire que le Christ ressuscité est l’instrument de la grâce.
À la suite de Thomas d’Aquin, E. Falque s’attarde sur la question de l’intégrité de la substance (integritas substantiae) : quelle est donc cette visée d’intégrité ? Comment faut-il l’entendre ?
Notre auteur comprend cette « intégrité » comme la restauration de notre beauté plutôt que comme le dénombrement de notre organicité. Si rien ne doit périr du corps, nous ressusciterons avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Cette « intégrité » pourrait étonner le lecteur. Toutefois, s’il comprend bien le propos d’E. Falque, et son insistance sur le lien qui unit le corps à la chair. Et c’est dans la quête de ce lien ou de nœud qu’il se situe, à la suite du courant humaniste, et particulièrement dans l’héritage de Charles de Bovelles que pourtant notre auteur ne cite pas. Or, dans le livre du Sage, les références sont nombreuses à ce « nœud » (nexus) pour désigner l’Homme, et que l’on voit apparaître dans L’Homme de Vitruve de Leonard de Vinci. Mais ce que La Chair de Dieu apporte de nouveau par rapport à toute la littérature de la Renaissance, est l’insistance de notre auteur sur le corps organique, la « matière », dans la résurrection. La chair sans corps ne tient pas en régime chrétien. Elle relève plutôt de l’hérésie gnostique (sous l’égide des maîtres orientaux Basilide, Valentin ou Marcion) ; et cette chair sans corps reste le point aveugle de la phénoménologie. Contre les tendances à spiritualiser l’Homme, ou à mettre trop l’accent sur son esprit, Emmanuel Falque met l’accent sur la relation ontologique de l’âme à la corporalité dans la résurrection. L’Homme intériorise de la matière durant toute sa vie, et même dans la mort il ne se dépouille pas de cette corrélation. Mais qu’en est-il au juste de la cohérence des trois corps (organique, souffrant, ressuscité) ? En quel sens peut-on dire que l’hypothèse du quatrième corps (le cadavre) ne vient pas déstabiliser tout l’édifice du Triduum philosophique d’Emmanuel Falque ?
Répondre à cette interrogation demande à notre auteur de prendre en charge une triple demande dont la demande imposera de lier la « chair de Dieu » – du pur organique (chair au sens courant) au vécu du corps (chair au sens phénoménologique) : le sens de la « décomposition » selon lequel le Christ, qui n’a pourtant pas connu cette décomposition, ne peut ni ne doit cependant échapper à notre commune humanité ; le sens de notre mortalité qui constitue le fond de tout vivant ; le « tombeau vide » qui fait le somatique et le psychique ou l’animal devront totalement être intégrés et transformés dans le spirituel. E. Falque rejoint ici les intuitions les plus profondes de la Kabbale.
- LE CORPS MORT
Selon notre finitude, tout corps connaît la corruption et y est destiné. Nul n’en réchappe : nous ne pouvons pas ne pas mourir. Tel est « l’horizon indépassable de notre humanité », nous rappelle E. Falque (p. 254). « Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas connu la décomposition » (Ac 13, 37). Le lecteur comprend alors toute la difficulté du débat qui fut celui d’hier, et qui est encore le nôtre aujourd’hui : « soit le Christ, dit Emmanuel Falque, n’a absolument pas connu la décomposition, et dans ce cas il échapperait totalement à la loi de la finitude humaine, et ne serait quasiment pas mort ; soit il a connu la décomposition et il faut comprendre quel sens attribuer à cette formule, d’autant qu’il n’est certainement pas né à nouveau de ses cendres ou de la poussière, mais tout au plus du cadavre qu’il est « devenu », et non pas resté, dans la mort. » (p. 246). Pour notre auteur, tout va dépendre de ce qu’on entendra par « décomposition », selon qu’on fera dériver du seul péché, ou qu’on reconnaîtra aussi un certain « caractère naturel » de la mort. En s’appuyant sur les écrits de saint Thomas d’Aquin, mais aussi sur ceux de saint Augustin, Emmanuel Falque interroge notre finitude à la lumière de l’Incarnation du Verbe, et attire l’attention du lecteur sur un point essentiel, celui de ne pas confondre ce que nous sommes devenus par le péché (nous aurions pu ne pas mourir et nous mourons), et ce que nous étions dans l’état pré-lapsaire (nous étions mortels, et donc pouvions mourir). Par conséquent, ce n’est pas la nature qui a donné à l’Homme le pouvoir de ne pas mourir, mais c’est la grâce de Dieu. Il y a donc une image de la finitude en l’Homme qui serait tirée de Dieu même. Déjà, dans la Genèse au sens littéral de saint Augustin, on pouvait lire que notre corps, formé du limon de la terre, était « animal » et non pas « spirituel ». (De Genesi ad litteram, Paris B.A., 48, 2000, L. VI, 19, 30, p. 491). Et c’est bien à travers notre corporéité, nos sensations, nos affections, nos pulsions comme nos passions, que nous vivons les effets de cette animalité (Cf. Somme théologique Ia IIae, q. 24, ad. 2, p. 184). Or pour saint Augustin, « le corps d’Adam est mortel par la condition de son corps animal, immortel par le bienfait du Créateur. » (De Genesi ad litteram, L. VI, 25, p. 501). Comme saint Augustin avant lui, Emmanuel Falque met l’accent sur la distinction entre la « mortalité de nature » et « l’immortalité d’élection ». Que le lecteur comprenne bien le propos tenu ici par notre auteur : à l’état adamique, l’Homme pouvait mourir en raison de sa condition naturelle ou de son corps animal et ne pouvait pas mourir selon la grâce de Dieu, ou son élection. Emmanuel Falque en déduit que « la Métamorphose de la finitude comme de la chair de Dieu n’est pas « réparation » d’abord, ni seulement, mais dès le départ dans le projet divin de notre divinisation. » (p. 250) Mais alors que retrouverons-nous par la résurrection ? C’est à ce point de l’analyse que l’on comprend le mieux le titre choisi par E. Falque pour cette seconde partie de La Chair de Dieu : « épaisseur du corps et problème de l’âme. » Pourquoi ? Car la résurrection comme affaire de justification en l’âme (lieu du libre arbitre), accompagne pour nous la résurrection comme métamorphose ou relèvement du corps prévu de toujours à toujours. Par la résurrection, le lecteur aura compris que nous retrouvons la justice de laquelle l’Homme est déchu par le péché. Nous n’allons donc pas recouvrir un corps spirituel que l’Homme ne possédait pas.
Nous ne pouvons pas ne pas mourir, c’est-à-dire ne pas obéir à la nécessité de mourir en raison du péché. Le péché nous fait passer du « mortel » à la « mort », état dont le Christ seul peut nous relever. Emmanuel Falque nous fait alors remarquer que si « le Christ ressuscité nous a libérés du péché en même temps que de la mort effective (mais non pas le pas le mortel créé) qui en est dérivée, alors désormais la nécessité de mourir est inhérente à notre humaine condition ». (p. 250). L’image de la finitude en l’Homme n’est pas niée puisque, dès avant la faute, nous portons le mortel mais non pas la mort. Le lecteur aura compris la nuance de taille ici : si nous portons en nous la possibilité de mourir, il dépend de notre liberté de passer à la mort. On comprend ainsi pourquoi, selon notre auteur, la nécessité de mourir, ne se tire pas du seul péché, mais appartient à la loi ordinaire de tout vivant. C’est ici avec l’appui de la Théologie de la mort (Zur Theologie des Todes) de Karl Rahner qu’Emmanuel Falque montre en quoi la théologie catholique diffère de la Réforme et du jansénisme : elle maintient que la mort a un caractère naturel, et que cela n’est pas contraire à la loi du créé. La finitude et la décomposition sont donc bien un trait du vivant que Dieu vient métamorphoser. En discernant entre le péché et la mort biologique, notre auteur rend au péché sa véritable nature : « Le péché mortel consiste en une volonté de mort autonome, en un refus d’accepter la mort. » (K. Rahner, Zur Theologie des Todes, p. 137). Le lecteur remarquera que là où Augustin envisageait la corruptibilité comme inscrite dans le créé et la corruption comme conséquence du péché, avec Rahner, E. Falque ouvre vers une corruption inscrite dans le créé et voit dans le refus de mourir la véritable conséquence du péché. Si comme nous le rappelait Michel Foucault dans Les Mots et les Choses (Paris, Gallimard, 1966, p. 323-329), « l’Homme moderne n’est possible qu’à titre de figure de la finitude », et qu’un tel horizon, ajoute E. Falque, « se manifestera aujourd’hui comme ce par quoi le christianisme deviendra « crédible », et non plus uniquement « croyable » au regard de la nouvelle donne de ce qui fait notre modernité ». (p. 254). E. Falque en déduit que le cadavre, comme possibilité de l’être créé, est lui aussi envisagé par Dieu.
 Dans ce chapitre sur « le corps mort », Emmanuel Falque répond donc à Martin Heidegger (Sein und Zeit), en mettant en lumière le contresens de ce dernier sur ce que l’on peut appeler l’essence du christianisme. Contre l’idée heideggérienne stipulant que « l’anthropologie élaborée dans la théologie chrétienne a toujours déjà co-aperçu la mort dans l’interprétation de la vie » (Être et Temps, trad. Martineau, § 49, note 1), E. Falque soutient que « la résurrection ne supprime pas l’angoisse de la mort ici-bas, ni ne suppose le « passage » avant le « pâtir ». Ce serait oublier combien l’horizon de la mortalité, voire de la mort , définit en propre la christianité, dès son origine comme dans ses développements ultérieurs. » (p. 255). La parabole des jeunes filles sages et des jeunes filles prévoyantes nous le rappelle : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » (Mt 25, 13). C’est à cette lumière que l’on comprend en quoi et pourquoi le statut et l’état du « corps mort » du Christ rejaillit avec force. Cette interrogation ancienne sur la corruptibilité du corps du Christ rejoint la question contemporaine de la finitude et, pour notre auteur, la nécessité d’incorporer le corps organique dans la chair ressuscitée. En effet, E. Falque voit dans ce débat qui fut celui des Pères de l’Église et des médiévaux, la « crédibilité théologique » de la résurrection, comme le « principe philosophique » de la finitude, y compris pour le Christ lui-même. » (p. 256). En partant des Écritures, Emmanuel Falque développe l’idée que la non décomposition du corps du Christ (Ac 13, 37), contrairement à la décomposition du corps de Lazare (Jn 11, 39), ne fait pas échapper le Christ à notre « commune humanité ». Mais pour notre auteur, il reste une différence essentiel entre le corps du Christ dans sa mort, et notre propre corps dans notre propre mort : « Nous ressuscitons comme et avec le Christ (« prémices de ceux qui sont morts » 1 Co 15, 20), mais nous-mêmes tirés de la cendre (Gn 3, 19) contrairement à lui-même, n’ayant pas connu la réduction à l’état de poussières. » (p. 258). Si, de prime abord, le lecteur peut considérer ces questions comme ineptes, E. Falque lui fait remarquer qu’elles sont en réalité essentielles, et conditionnent notre existence humaine : « La radicalité des questions théologiques (statut du corps du ressuscité) est passée aujourd’hui dans la radicalité des interrogations philosophiques (sens de l’ego)… L’absence d’une anthropologie du corps adéquate à une théologie de la résurrection a rangé au placard toutes ces anciennes interrogations, pour réduire le discours à la simple renaissance du Christ en moi (Ga 2, 20), sans jamais interroger le statut du corps de celui du ressuscité (1 Co, 15, 45). » (p. 259). Avec La Chair de Dieu, E. Falque relève alors le défi d’une théologie pensante : il ose analyser le donné scripturaire à la lumière de la raison naturelle des philosophes. Déjà pour saint Thomas d’Aquin (Somme théologique IIIa, question 50), dire que le corps du Christ est vraiment mort n’indique pas que son corps se soit ou non putréfié, mais au contraire qu’il n’est plus « homme » c’est-à-dire « vivant » au Sépulcre, mais bien « homme mort », réduit à l’état de cadavre. Qu’en déduit E. Falque ? C’est bien que le corps « sien » au tombeau ne sera véritablement « sien » que dans la mesure où il sera assumé et transformé par un autre type de corps (ressuscité) : « Le corps semé corruptible devient incorruptible » nous disait Paul en sa première épître aux Corinthiens (1 Co 15, 44). Emmanuel Falque reprend les conclusions de Thomas d’Aquin : « à la mort du Christ, dit ce dernier, bien que son âme fût séparée de son corps, ni son âme ni son corps ne furent pourtant séparés de la personne du Fils de Dieu. » (Somme théologique IIIa, q. 52, a. 3). Donc, pour notre auteur, si la mort effective du Christ exige bien la séparation de l’âme et du corps, sa mort en tant que Fils de Dieu n’impose pas sa dissolution absolue, mais le continuel attachement de l’unité âme-corps à sa divinité. Le lecteur comprend donc que ce n’est pas le corps qui meurt en tant qu’humanité, et l’âme qui lui survit en tant que divinité : « C’est l’unité âme-corps séparée dans l’humanité à la mort qui est assumée et transformée dans la divinité dès la descente aux enfers, qui en conserve toujours le « lien », sans jamais vivre en tant qu’ « âme seule », précise E. Falque, qu’il s’agisse du rapport à son propre corps ou du rapport à l’autre. » (p. 262). Le Christ ressuscité retient le lien de ce qui fait l’unité de son âme et de son corps, de sorte que ce n’est pas un « pur esprit », mais véritablement le Verbe de Dieu attaché à son corps qui descend aux enfers. Chair de Dieu, le Christ ressuscité est donc présent corps & âme, c’est-à-dire âme unie à un certain corps, soit « corps divin » lors de sa descente aux enfers. Emmanuel Falque insiste donc que le Christ n’est jamais sans corps, et par conséquent, sur l’importance de la corporéité. Mais que faut-il entendre au juste par cette double manière d’assumer le corps ? Cette double manière d’assumer son corps pose une question essentielle pour l’Homme dans l’attente de la résurrection finale. Et c’est dans cette perspective précisément qu’Emmanuel Falque ose interroger l’oubli de l’âme en phénoménologie, en particulier depuis le suivi univoque de Martin Heidegger qui l’a totalement éludée. La posture de notre auteur est alors tout à fait originale dans l’histoire de la philosophie car il choisit de faire dialoguer le théologique et le philosophique : « Si la phénoménologie semble avoir progressivement fait « l’impasse sur l’âme » en substituant le couple « chair et corps » au couple « âme et corps », ce qui fut opéré à tort dans le devenir de la phénoménologie ne saurait l’être en celui de la théologie. » (p. 265). Or si le Christ mort a vécu une séparation de l’âme et du corps de sorte qu’il fut « vraiment mort », qu’en est-il pour nous qui sommes en attente de la résurrection finale ? Il faut penser un « état intermédiaire » dès lors que les âmes auprès de Dieu attendent cette révélation finale. Mais le lecteur peut se demander ce que signifie l’âme après la mort. Le complexe de l’âme et du corps chez Aristote et Thomas d’Aquin est riche d’enseignement. Et c’est à cette source antique et médiévale que notre auteur nous exhorte à puiser. On sait l’influence du De anima d’Aristote sur Thomas d’Aquin. Pour ce dernier, l’esprit de l’Homme, ce qui, en lui, est à l’image de Dieu, est une âme, c’est-à-dire la forme d’une matière dont elle fait, en l’informant, en l’animant, un corps, tout au service de sa vie et de son destin d’esprit. Si au XIIIème siècle, la philosophie d’Aristote en imposait à tous, Thomas d’Aquin ne pouvait pas accepter la pluralité des principes formels dans un même être au risque de détruire l’unité substantielle de l’être humain, donné de l’expérience aussi bien que de la foi. Thomas applique l’hylémorphisme aristotélicien à la nature humaine, procurant ainsi à l’anthropologie biblique unitaire sa formulation rationnelle. S’il lui arrive de parler de la double nature de l’Homme (le corporel qui obéit aux lois de la nature physique et le spirituel pour tout ce qui touche à la raison et à la liberté), il affirme que le mystère de l’Homme est qu’une seule et unique nature appartienne à la fois à ces deux mondes : « L’unité qui se forme entre une substance spirituelle et la matière corporelle n’est pas moindre que celle de n’importe quelle forme avec sa matière, et peut être plus forte encore. » (II Contra Gentiles, 68). Aussi quand l’Homme pense, c’est le composé tout entier qui pense, bien que ce soit par l’activité propre et spirituelle de l’âme qui, en pensant, se dégage de la matière qu’elle informe, mais non pas au point de pouvoir se passer d’elle et des activités dont elle est inséparable. Et c’est bien cette unité de l’âme au corps qui doit aujourd’hui être reconnu, expérimenté dans notre propre existence pour E. Falque. En osant le pari de rapprocher la phénoménologie de la métaphysique, notre auteur montre à son lecteur combien l’apparaître est redevable à l’être : « nier les deux, dit-il, c’est s’amputer d’une certaine part de réalité ». (p. 270). Mais le paradoxe est là, et le philosophe le rappelle. La phénoménologie a occulté la notion d’ « âme » au profit de celle de « chair » : « la phénoménologie se débarrasse parfois à trop bon compte de termes dont on n’a pas assez mesuré l’importance et l’usage par le passé, quitte à ne pas voir qu’on ne fera jamais du neuf sinon et seulement à partir de la nouvelle interrogation de l’ancien… La dualité de la chair et du corps dans la phénoménologie, quoiqu’en un tout autre sens, la dualité de l’âme et du corps dans la métaphysique. » (p. 272). Le lecteur pourra se demander quel est alors cet « autre sens » ? « Si les champs ne sont pas les mêmes, dit E. Falque, les intentions non plus. » Quand Husserl désubstantialise l’âme et le corps dans ses Méditations cartésiennes, au § 14, afin de les consacrer en actes (le cogito et son cogitatum) plutôt qu’en substrats, E. Falque insiste sur la nécessité de ne pas oublier tout l’apport de Thomas d’Aquin quand il énonce la notion d’acte d’être (Somme théologique Ia, q. 3, a 4, ad 2). Edith Stein l’expérimente ainsi quand elle parle du « noyau de l’âme » (der Kern der Seele) : ce noyau désigne pour elle la possibilité d’une vie actuelle, une possibilité qui n’est pas purement logique, mais qui est réelle : « Le noyau de la personne est le fondement pour sa vie actuelle, il est réel. Et dans la mesure où l’actualité est interprétée comme réalité à l’opposé de la pure possibilité et l’acte comme acte d’être, le noyau de la personne a un être actuel. » (Edith Stein, Potenz und Akt ; Studien zur einer Philosophie des Seins (1931), Gesammtausgabe, vol. 10, p. 129, cité traduit et commenté par B. Bouillot, Le Noyau de l’âme. De l’épochê phénoménologique à la nuit obscure, Paris, Hermann, coll. « De visu », 2015).
Dans ce chapitre sur « le corps mort », Emmanuel Falque répond donc à Martin Heidegger (Sein und Zeit), en mettant en lumière le contresens de ce dernier sur ce que l’on peut appeler l’essence du christianisme. Contre l’idée heideggérienne stipulant que « l’anthropologie élaborée dans la théologie chrétienne a toujours déjà co-aperçu la mort dans l’interprétation de la vie » (Être et Temps, trad. Martineau, § 49, note 1), E. Falque soutient que « la résurrection ne supprime pas l’angoisse de la mort ici-bas, ni ne suppose le « passage » avant le « pâtir ». Ce serait oublier combien l’horizon de la mortalité, voire de la mort , définit en propre la christianité, dès son origine comme dans ses développements ultérieurs. » (p. 255). La parabole des jeunes filles sages et des jeunes filles prévoyantes nous le rappelle : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » (Mt 25, 13). C’est à cette lumière que l’on comprend en quoi et pourquoi le statut et l’état du « corps mort » du Christ rejaillit avec force. Cette interrogation ancienne sur la corruptibilité du corps du Christ rejoint la question contemporaine de la finitude et, pour notre auteur, la nécessité d’incorporer le corps organique dans la chair ressuscitée. En effet, E. Falque voit dans ce débat qui fut celui des Pères de l’Église et des médiévaux, la « crédibilité théologique » de la résurrection, comme le « principe philosophique » de la finitude, y compris pour le Christ lui-même. » (p. 256). En partant des Écritures, Emmanuel Falque développe l’idée que la non décomposition du corps du Christ (Ac 13, 37), contrairement à la décomposition du corps de Lazare (Jn 11, 39), ne fait pas échapper le Christ à notre « commune humanité ». Mais pour notre auteur, il reste une différence essentiel entre le corps du Christ dans sa mort, et notre propre corps dans notre propre mort : « Nous ressuscitons comme et avec le Christ (« prémices de ceux qui sont morts » 1 Co 15, 20), mais nous-mêmes tirés de la cendre (Gn 3, 19) contrairement à lui-même, n’ayant pas connu la réduction à l’état de poussières. » (p. 258). Si, de prime abord, le lecteur peut considérer ces questions comme ineptes, E. Falque lui fait remarquer qu’elles sont en réalité essentielles, et conditionnent notre existence humaine : « La radicalité des questions théologiques (statut du corps du ressuscité) est passée aujourd’hui dans la radicalité des interrogations philosophiques (sens de l’ego)… L’absence d’une anthropologie du corps adéquate à une théologie de la résurrection a rangé au placard toutes ces anciennes interrogations, pour réduire le discours à la simple renaissance du Christ en moi (Ga 2, 20), sans jamais interroger le statut du corps de celui du ressuscité (1 Co, 15, 45). » (p. 259). Avec La Chair de Dieu, E. Falque relève alors le défi d’une théologie pensante : il ose analyser le donné scripturaire à la lumière de la raison naturelle des philosophes. Déjà pour saint Thomas d’Aquin (Somme théologique IIIa, question 50), dire que le corps du Christ est vraiment mort n’indique pas que son corps se soit ou non putréfié, mais au contraire qu’il n’est plus « homme » c’est-à-dire « vivant » au Sépulcre, mais bien « homme mort », réduit à l’état de cadavre. Qu’en déduit E. Falque ? C’est bien que le corps « sien » au tombeau ne sera véritablement « sien » que dans la mesure où il sera assumé et transformé par un autre type de corps (ressuscité) : « Le corps semé corruptible devient incorruptible » nous disait Paul en sa première épître aux Corinthiens (1 Co 15, 44). Emmanuel Falque reprend les conclusions de Thomas d’Aquin : « à la mort du Christ, dit ce dernier, bien que son âme fût séparée de son corps, ni son âme ni son corps ne furent pourtant séparés de la personne du Fils de Dieu. » (Somme théologique IIIa, q. 52, a. 3). Donc, pour notre auteur, si la mort effective du Christ exige bien la séparation de l’âme et du corps, sa mort en tant que Fils de Dieu n’impose pas sa dissolution absolue, mais le continuel attachement de l’unité âme-corps à sa divinité. Le lecteur comprend donc que ce n’est pas le corps qui meurt en tant qu’humanité, et l’âme qui lui survit en tant que divinité : « C’est l’unité âme-corps séparée dans l’humanité à la mort qui est assumée et transformée dans la divinité dès la descente aux enfers, qui en conserve toujours le « lien », sans jamais vivre en tant qu’ « âme seule », précise E. Falque, qu’il s’agisse du rapport à son propre corps ou du rapport à l’autre. » (p. 262). Le Christ ressuscité retient le lien de ce qui fait l’unité de son âme et de son corps, de sorte que ce n’est pas un « pur esprit », mais véritablement le Verbe de Dieu attaché à son corps qui descend aux enfers. Chair de Dieu, le Christ ressuscité est donc présent corps & âme, c’est-à-dire âme unie à un certain corps, soit « corps divin » lors de sa descente aux enfers. Emmanuel Falque insiste donc que le Christ n’est jamais sans corps, et par conséquent, sur l’importance de la corporéité. Mais que faut-il entendre au juste par cette double manière d’assumer le corps ? Cette double manière d’assumer son corps pose une question essentielle pour l’Homme dans l’attente de la résurrection finale. Et c’est dans cette perspective précisément qu’Emmanuel Falque ose interroger l’oubli de l’âme en phénoménologie, en particulier depuis le suivi univoque de Martin Heidegger qui l’a totalement éludée. La posture de notre auteur est alors tout à fait originale dans l’histoire de la philosophie car il choisit de faire dialoguer le théologique et le philosophique : « Si la phénoménologie semble avoir progressivement fait « l’impasse sur l’âme » en substituant le couple « chair et corps » au couple « âme et corps », ce qui fut opéré à tort dans le devenir de la phénoménologie ne saurait l’être en celui de la théologie. » (p. 265). Or si le Christ mort a vécu une séparation de l’âme et du corps de sorte qu’il fut « vraiment mort », qu’en est-il pour nous qui sommes en attente de la résurrection finale ? Il faut penser un « état intermédiaire » dès lors que les âmes auprès de Dieu attendent cette révélation finale. Mais le lecteur peut se demander ce que signifie l’âme après la mort. Le complexe de l’âme et du corps chez Aristote et Thomas d’Aquin est riche d’enseignement. Et c’est à cette source antique et médiévale que notre auteur nous exhorte à puiser. On sait l’influence du De anima d’Aristote sur Thomas d’Aquin. Pour ce dernier, l’esprit de l’Homme, ce qui, en lui, est à l’image de Dieu, est une âme, c’est-à-dire la forme d’une matière dont elle fait, en l’informant, en l’animant, un corps, tout au service de sa vie et de son destin d’esprit. Si au XIIIème siècle, la philosophie d’Aristote en imposait à tous, Thomas d’Aquin ne pouvait pas accepter la pluralité des principes formels dans un même être au risque de détruire l’unité substantielle de l’être humain, donné de l’expérience aussi bien que de la foi. Thomas applique l’hylémorphisme aristotélicien à la nature humaine, procurant ainsi à l’anthropologie biblique unitaire sa formulation rationnelle. S’il lui arrive de parler de la double nature de l’Homme (le corporel qui obéit aux lois de la nature physique et le spirituel pour tout ce qui touche à la raison et à la liberté), il affirme que le mystère de l’Homme est qu’une seule et unique nature appartienne à la fois à ces deux mondes : « L’unité qui se forme entre une substance spirituelle et la matière corporelle n’est pas moindre que celle de n’importe quelle forme avec sa matière, et peut être plus forte encore. » (II Contra Gentiles, 68). Aussi quand l’Homme pense, c’est le composé tout entier qui pense, bien que ce soit par l’activité propre et spirituelle de l’âme qui, en pensant, se dégage de la matière qu’elle informe, mais non pas au point de pouvoir se passer d’elle et des activités dont elle est inséparable. Et c’est bien cette unité de l’âme au corps qui doit aujourd’hui être reconnu, expérimenté dans notre propre existence pour E. Falque. En osant le pari de rapprocher la phénoménologie de la métaphysique, notre auteur montre à son lecteur combien l’apparaître est redevable à l’être : « nier les deux, dit-il, c’est s’amputer d’une certaine part de réalité ». (p. 270). Mais le paradoxe est là, et le philosophe le rappelle. La phénoménologie a occulté la notion d’ « âme » au profit de celle de « chair » : « la phénoménologie se débarrasse parfois à trop bon compte de termes dont on n’a pas assez mesuré l’importance et l’usage par le passé, quitte à ne pas voir qu’on ne fera jamais du neuf sinon et seulement à partir de la nouvelle interrogation de l’ancien… La dualité de la chair et du corps dans la phénoménologie, quoiqu’en un tout autre sens, la dualité de l’âme et du corps dans la métaphysique. » (p. 272). Le lecteur pourra se demander quel est alors cet « autre sens » ? « Si les champs ne sont pas les mêmes, dit E. Falque, les intentions non plus. » Quand Husserl désubstantialise l’âme et le corps dans ses Méditations cartésiennes, au § 14, afin de les consacrer en actes (le cogito et son cogitatum) plutôt qu’en substrats, E. Falque insiste sur la nécessité de ne pas oublier tout l’apport de Thomas d’Aquin quand il énonce la notion d’acte d’être (Somme théologique Ia, q. 3, a 4, ad 2). Edith Stein l’expérimente ainsi quand elle parle du « noyau de l’âme » (der Kern der Seele) : ce noyau désigne pour elle la possibilité d’une vie actuelle, une possibilité qui n’est pas purement logique, mais qui est réelle : « Le noyau de la personne est le fondement pour sa vie actuelle, il est réel. Et dans la mesure où l’actualité est interprétée comme réalité à l’opposé de la pure possibilité et l’acte comme acte d’être, le noyau de la personne a un être actuel. » (Edith Stein, Potenz und Akt ; Studien zur einer Philosophie des Seins (1931), Gesammtausgabe, vol. 10, p. 129, cité traduit et commenté par B. Bouillot, Le Noyau de l’âme. De l’épochê phénoménologique à la nuit obscure, Paris, Hermann, coll. « De visu », 2015).
Aujourd’hui le mot « âme » est devenu équivoque. Pour l’expliquer, E. Falque dit que nous héritons de la conception de René Descartes qui évacue le sensitif et le végétatif de l’âme et la réduit au seul esprit, à cette « chose qui pense » dont il parle dans les Méditations métaphysiques. Mais c’est peut-être oublier alors le Descartes de la Correspondance avec la princesse Elisabeth comme celui du Traité des passions de l’âme où plusieurs nuances apparaissent. Toutefois, là où E. Falque n’a pas tort c’est de dire que l’histoire n’a retenu qu’un visage de Descartes pour qui l’âme n’est plus un principe de vie mais la partie intellective de l’Homme : « L’immatérialité de l’âme est devenue telle qu’elle semble n’avoir plus aucun rapport au corps définitivement abandonné à l’état de cadavre. » (p. 273). C’est pourquoi il apparaît nécessaire à E. Falque de chercher un nouveau langage à propos de l’âme ou de l’état intermédiaire. Il faut admettre l’inséparable unité du corps et de l’âme (celles qu’enseignaient Aristote et Thomas d’Aquin dont nous avons parlé plus haut), mais il faut pourtant ne pas réduire l’âme à une entéléchie liée à la matière. L’âme conserve l’impératif d’une unité de l’être. De même qu’on ne peut pas réduire les défunts à des esprits angéliques, on ne peut pas réduire l’âme à l’esprit. Citant le Contra Gentiles (IV, 81), E. Falque insiste sur la nécessité de l’unité : il n’y a pas trois âmes (végétative, sensitive, intellective) dans l’Homme, mais une seule : « Il n’y a pas, d’un côté, l’âme végétative et l’âme sensitive qui viendraient à se corrompre avec le corps et, de l’autre, l’âme intellective qui « survivrait » seule, remarque à juste titre Emmanuel Falque. Au contraire, chacune d’entre elles étant « identiques à l’âme rationnelle » de sorte qu’il n’y a pas trois âmes mais seulement une, il est de leur devoir de conférer quelque chose de ce qu’elles sont (âme végétative et nutritive) à ce qu’elle est (âme intellective). » (p. 279). E. Falque fait remarquer au lecteur qu’il s’agit d’une structure d’actualisation, et non pas d’étagement. L’unité de l’âme fait l’unité de la personne humaine dès lors qu’elle est attachée au corps, pour notre auteur. Et quand nous mourons, c’est l’âme tout entière qui s’en va au ciel, et non pas seulement l’âme intellective. Si par la grâce de la résurrection, la substantialité de l’âme intellective n’est pas détruite en se séparant du végétatif et du sensitif, elle en conserve la trace, le lien qui l’a unie à ses autres puissances. Le lecteur comprend ainsi que le corps lui-même laisse son empreinte à l’âme qui porte son corps en elle. On peut donc en déduire que selon l’analytique falquienne c’est l’âme qui accomplit et porte transcendantalement le corps, moins dans son être que dans sa manière d’être.
Si donc l’apport de la phénoménologie pour la théologie a su porter ses fruits, la phénoménologie n’a peut-être pas été assez attentive aux transformations apportées par la théologie, et notamment dans la nécessité de repenser un vrai corps biologique, là même où le seul vécu du corps ne saurait dire le tout de l’incarnation christique. « Tout se passe comme si la phénoménalisation de la théologie ne s’était pas accompagnée en même temps d’une théologisation de la phénoménologie », remarque E. Falque avec pertinence (p. 288). Il faut en passer par un apprentissage : l’apprentissage de soi par la souffrance que l’on trouve ainsi formulé sous la plume d’Eschyle (Pathei mathos). Et c’est là le sens du passage pour E. Falque, dans le double sens du « pâtir » et du « passer ». Dans l’acte d’interpréter comme dans celui de décider et de passer se joue « un Iliade qui n’est jamais sans Odyssée », un aller qui n’est jamais sans retour, « de sorte, remarque E. Falque, qu’on ne se satisfera pas de traverser sans revenir modifié par cela qu’on a visité. » (p. 289). Mais comment notre auteur envisage-t-il précisément cette « grande traversée » ?
- LA GRANDE TRAVERSÉE
La limite de la phénoménologie dans son oubli du corps provient pour notre auteur de son enracinement cartésien, nous l’avons dit plus haut. Or l’herméneutique du texte attend une herméneutique du corps, telle que Paul Ricoeur l’envisage dans sa dixième leçon de Soi-même comme un autre (« Vers quelle ontologie ? ») : « C’est seulement lorsque l’ontologie de la chair s’affranchit autant qu’il est possible de la problématique de la constitution qui l’a paradoxalement conquise que l’on peut faire face au paradoxe inverse… : à savoir, non pas ce que signifie qu’un corps soit mon corps (à savoir chair), mais que la chair soit aussi un corps parmi les corps. C’est là que la phénoménologie trouve sa limite : c’est parce que Husserl a seulement pensé l’autre comme un autre moi et jamais le soi comme un autre, qu’il n’a pas de réponse au paradoxe que pose la question : comment comprendre que ma chair soit aussi mon corps ? » (P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, p. 376-377).
Entre le protestantisme de Ricoeur qui fonde son art d’interpréter dans l’Écriture seule (sola Scriptura), et le judaïsme de Levinas qui trouve refuge dans le corps de la lettre, la Thora signant l’acte de contraction de l’infini dans l’Écriture, E. Falque s’interroge sur le sens d’une herméneutique catholique proprement dite. Il s’oriente alors vers les « deux tables » : celle de l’Écriture et celle de l’Eucharistie.
Dans les années 1970, la méthode historico-critique renvoyait à « ce qui a eu lieu », dans sa prise en compte du contexte, de l’histoire et des traditions. Et ces procédés exégétiques ont permis de faire de la Genèse un mythe et des épîtres de Paul un agrégat de plusieurs auteurs. Cette méthode ne renvoie donc pas à la lettre du texte telle qu’elle est écrite, mais à sa littéralité dans l’histoire et le référent où elle fut donnée. Plus tard, avec la fonction herméneutique de la distanciation, Paul Ricoeur proposait un type d’interprétation où toute référence à la réalité peut être abolie. Une triple réduction permettait ainsi d’opérer un affranchissement à l’égard de l’auteur, du lecteur et du référent. « Un monde du texte naît alors pour lui-même, remarque Emmanuel Falque, et par suite un sens du texte vaut par soi, dans son unité propre. » (p. 296). Mais si le texte est un monde en soi, le lecteur qui le lit en est le principal destinataire. Pour Ricoeur, la lecture vise la transformation de soi par le texte. Mais quelle position adopte E. Falque par rapport à la posture herméneutique d’un Paul Ricoeur ?
En s’appuyant sur l’admirable remarque de Paul Claudel dans J’aime la Bible, E. Falque opte pour une autre posture : celle de se laisser interroger par l’Écriture plutôt que d’interroger : « La Bible est un drame, mais un drame dont je ne dirai pas que c’est nous qui le vivons, c’est plutôt lui qui nous vit, comme ses acteurs antérieurs, il les a vécus. » (Claudel, p. 48). Il ne s’agit donc plus pour notre auteur de lire les saintes Écritures, mais plutôt de se laisser lire par Elles. Et c’est en effet le parti qu’il adopte dans La Chair de Dieu. En guise de relève de l’historicité du texte (sens littéral, « ce qui a eu lieu ») et de l’herméneutique du texte (sens tropologique, « ce que l’on doit faire ») Emmanuel Falque s’engage dans une sorte de corps à corps avec le texte entendu comme l’aventure d’une « phénoménalité du texte » (sens allégorique, « ce que tu as à croire » et anagogique, « ce vers quoi tu dois tendre ») et y engage son lecteur : « Plutôt que de se trouver dans le texte, on se perdra en lui. Et davantage que de « se comprendre devant lui », on sera pris et compris en lui – m’incorporant au corps de la Bible dans la liturgie de la parole comme je m’incorpore au corps du Ressuscité et de l’Église dans la liturgie. » (p. 298). Pour le dire autrement, il reprend saint Paul et l’épître aux Philippiens (2, 5) : « Ayez en vous les sentiments qui sont ceux du Christ Jésus. » Emmanuel Falque opère donc un véritable renversement de position : ce n’est pas lui, et ses représentations qui surplombent la Bible, mais l’inverse. Présence vivante de Dieu, Son Verbe sonde les cœurs et les reins, elle perce jusqu’aux jointures et aux moëlles. Ainsi, E. Falque remarque-t-il à juste titre que « ce n’est pas le Christ qui se comprend en moi, comme si mon interprétation pouvait le contenir, mais moi qui me comprends en lui. » (p. 298).
Quelle est donc cette originalité de la visée catholique de l’herméneutique que notre auteur recherche ? à quoi tient-elle ? Car c’est bien à rechercher « son propre » que chaque herméneutique se trouvera et pourra dialoguer avec les autres. Si le texte est bien « un monde », Emmanuel Falque a raison de souligner qu’il n’est monde qu’en cela qu’il dit quelque chose du monde qui le précède et s’incorpore en lui. L’herméneutique entendue comme sens du texte (Ricoeur) ou comme habitation de la lettre (Levinas) honore d’abord un texte, et non pas le monde, la création. Or pour Emmanuel Falque il revient à la visée catholique de servir la création en premier, comme nous le rappelle saint Bonaventure commentant le Cantique des créatures : c’est le monde qui vient avant, pas après : « La phénoménalité du texte, affirme notre auteur, fait entrer dans une véritable intercorporéité intentionnelle du lecteur et des acteurs du texte lui-même, de sorte que c’est le Christ que j’y rencontre (sens allégorique), ou l’union à Dieu lui-même (sens anagogique), et non plus une histoire que l’on vient me dérouler (sens littéral) ni une interprétation qui m’est destinée (sens moral ou tropologique). » (p. 299). Comme il n’y a pas de liturgie de la parole sans la table eucharistique, nous rappelle E. Falque, dire la chair de Dieu réclame aussi du texte, ou plutôt de la voix, nous fait remarquer notre auteur : « La voix a ceci en proche qu’elle s’ancre toujours dans un corps, fût-il caché, mais non pas absent ou supprimé. Pas de voix sans corps. » (p. 300). La catholicisme a ceci de particulier qu’il fait de l’incarné son cœur et son centre, là où le protestantisme ira plutôt du côté du texte (Ricoeur) et le judaïsme du côté de la Thora (Levinas). L’herméneutique catholique n’est ni celle de la seule lecture ni celle de la seule écoute. Elle célèbre et attend la visibilité plutôt que l’invisibilité, le corps davantage que la parole : « La voix du Verbe est à comprendre à présent comme la chair l’était alors. » (Hugues de Saint-Victor, « La parole de Dieu », dans Six opuscules spirituels, Paris, Cerf, I, 2, p. 63). L’herméneutique de la voix permet au lecteur d’E. Falque de reconnaître que le Verbe est dans le vocal une absence devenue présence : « L’autre est toujours déjà là, affirme E. Falque, dans le timbre du son transféré, et son souffle ou sa vibration suffisent à l’identifier. Il est une « singularité de la voix » qu’aucun autre phénomène ne saurait égaler, de sorte que Dieu lui-même use exemplairement de la voix, pour aujourd’hui s’exprimer, comme nous le rapporte ce verset étonnant de Jean 18 : « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » (Jn 18, 37). De même, le « bon pasteur » ouvre la porte aux brebis qui « écoutent sa voix » (Jn 10, 3-4). » (p. 301). La présence du corps du Christ à la table eucharistique est reliée à sa voix lors de la table de l’Écriture ; la parole est pro-fération d’un « Ceci est mon corps » venu se livrer dans le pain se donner, et dans sa parole vibrer. Maintenant nous entendons sa voix, nous le reconnaissons à sa manière, plus qu’à sa matière, à sa tonalité davantage qu’à sa visibilité : « Il se tient par sa voix cachée en sa chair – non pas absent, puisque jamais il n’y aura de voix sans corps, mais autrement présent. » (p. 302). Et c’est sur cet « autrement présent » qu’E. Falque attire l’attention du lecteur, faisant remarquer qu’en philosophie il y a un oubli de la voix plus encore que de l’être : « La pensée aphone de la philosophie gagnerait probablement, comme un « choc en retour », à apprendre ce qu’il en est de la « grande voix », ou de la megalê phônê en théologie : « À la neuvième heure, Jésus cria d’une grande voix : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 34). » (p. 302). Emmanuel Falque nous fait remarquer que la voix ici ne sera pas « nue » seulement, en raison d’un appel qui en confère la signifiance, elle sera « crue », au double sens de la crudité de ce qui se donne sans avoir été préparé, et de l’apprentissage par quoi nous y donnons foi sans jamais pourtant nous y habituer. Le grand cri du Christ sur le bois de la Croix se profère en ses passions et non pas en ses articulation : « Le Verbe en croix » se donnera ainsi comme un Verbe en voix », tenant la voix dans le corps (eucharistique), et donnant corps à la voix (liturgique) : « Entendons notre voix en lui et sa voix en nous » disait déjà saint Augustin dans ses Discours sur les Psaumes (Enarrationes in Psalmos, Psaume 85, Paris, Cerf, 2005, p. 62). Par une herméneutique catholique du corps et de la voix, E. Falque ouvre ses lecteurs vers un autre mode d’expressivité. Mais « la grande traversée » est risquée, et passer le Rubicon ne laisse pas indemne : le risque est à la hauteur de la promesse qui s’ancre elle-même toujours dans la finitude de l’Homme. Aussi, la croyance ne peut-elle être du ressort du seul confessant pour E. Falque, car nous croyons toujours « au monde » ou « en autrui » avant de croire « en Dieu » : « Une croyance originaire (Urdoxa) précède et fonde toute incroyance ou toute méfiance. » (p. 305). C’est pourquoi notre auteur nous rappelle que « le philosophe ou l’homme tout court va s’attacher à suspendre les abstractions du doute. » (p. 306).
Pour Emmanuel Falque, en phénoménologie, il est toujours question de revenir vers des « actes de conscience » qui constituent nos « vécus des choses » comme les choses elles-mêmes plutôt que vers leur empiricité ou leur objectivité. Mais paradoxalement, il reste un sol de croyance universel au monde que personne ne pourra jamais nier. La conscience du monde chez Husserl n’est-elle pas une conscience qui a pour mode de certitude la croyance ? Au commencement, il faut bien reconnaître qu’il y a quelque chose, et non pas rien : « non pas que la chose soit, nous fait remarquer E. Falque, mais en cela que je ne peux pas ne pas croire qu’elle soit, et que cela précisément est indubitable et irréductible. » (p. 308). Si pour E. Falque, la foi philosophique (au monde et en autrui) précède et fonde la foi religieuse (en une transcendance) comme aussi la « foi confessante » (en un Dieu agissant et présent en moi) : L’« Il y a » (Es gibt) ne dit pas seulement ici la donation de ce qui se donne, mais ce fond philosophique de notre croyance commune qu’il convient de retrouver. Et la notion d’Il y a nous ramène à l’absence de Dieu : « Plutôt qu’à Dieu, reconnaît Emmanuel Levinas au sortir de la guerre, la notion d’Il y a nous ramène à l’absence de Dieu, à l’absence de tout étant. Les primitifs sont absolument avant la révélation, avant la lumière. » (De l’existance à l’existant, Vrin, poche, 1990, p. 98-99). E. Falque analyse cette résistance de la présence au chapitre 2 d’Hors phénomène, Essai aux confins de la philosophie. Et, en effectuant ici, dans La Chair de Dieu cette grande traversée méthodologique qui aura rendu possible une lecture phénoménologique de la passion avec les obstacles qu’elle y rencontre, et l’effroi du corps que provoquent les récits d’apparition, il lui donne tout son sens en posant toute sa philosophie de l’expérience religieuse.
Nous sommes tissés d’une même chair et la chair de Dieu, aussi que la nôtre, qu’elle soit matérielle ou organique (chair au sens courant en français) ou qu’elle désigne le vécu du corps (chair en son sens phénoménologique). Par suite, la résurrection n’est pas seulement « coupure » entre un avant et un après, mais aussi coupure entre un maintenant et un demain. Il est essentiel de donner toute sa place au chiasme de Merleau-Ponty. La transformation de notre corps ne dit pas seulement rupture ou Dieu devant nous, mais Dieu avec nous, Emmanuel. Et pour notre auteur, ce dernier l’emporte sur l’Absolu. Là se tient l’expérience de celui qui vit en nous. Mais quel est vraiment le sens de cet « avec » ? Comment faut-il entendre cette proximité ? Et que nous dit-elle sur le rapport particulier de l’Homme à Dieu ? S’il y a bien une philosophie de la religion pour E. Falque, il est encore « une philosophie de l’expérience religieuse, dans laquelle la décision de foi importe aussi, non plus uniquement dans la communauté d’une croyance originaire, mais dans la spécificité d’une adhésion confessante et expérientielle. » (p. 310). La philosophie de l’expérience religieuse donne à entendre autrement ce rapport de l’Homme à Dieu. Emmanuel Falque l’appelle « la vie facticielle » : le soi qui fait l’expérience et ce qui est expérimenté ne sont pas scindés comme s’il s’agissait de deux choses distinctes. Le lecteur peut alors se demander s’il convient d’avoir partagé l’expérience religieuse pour pouvoir parler en matière de religion, « si le passage du Rubicon, dit E. Falque, exige non pas uniquement qu’on ait accepté de quitter la rive de la philosophie pour rejoindre celle de la théologie ; mais si le vécu dont il est question dans la théologie elle-même (le Christ) doit posséder un contenu propre au risque de ne rien comprendre de ce que le philosophe ou le théologien pourrait bien énoncer. Mais E. Falque nuance son propos en rappelant qu’il peut y avoir un « terrorisme de l’expérience en matière de religion » (p. 311) : « La philosophie de l’expérience religieuse ne défère pas aux idoles du seul vécu ou du tout expérientiel, à l’instar de bien des dérives sentimentalistes aujourd’hui. Elle renvoie uniquement, mais pleinement, au « coefficient d’expérience » à la source de tout discours, sûr que ce qui est « pour soi » l’est aussi « pour autrui », dans une singularité qu’il convient de reconnaître plutôt que de rejeter. » (p. 312).
Le lecteur comprendra donc que là où la foi perceptive serait un socle commun à une croyance originaire en autrui ou au monde, la croyance en Christ ressuscité atteste d’une altérité vivante en soi qui modifie de part en part l’art et la manière de décider. E. Falque souligne alors qu’il revient paradoxalement à « la philosophie de l’expérience religieuse » de mettre en lumière une décision en commun : « En tant que croyant confessant, on ne sera plus « un », ni « deux », mais « trois » à décider, si tant est que le chrétien se considère comme inclus en la seconde personne de la Trinité, et que c’est en elle (dans le Fils) qu’il fait le choix de communément aimer. » (p. 313). L’enjeu éthique donnera à penser : il ne s’agit pas du libre arbitre de Descartes ici, ni de la règle de responsabilité de Kant (assumer ce qui a été choisi), mais pour E. Falque, le croyant qui décide comprend qu’il ne choisit pas quelque chose, mais se choisit d’abord lui-même choisissant. Il n’a pas le choix d’avoir le choix : « refuser de choisir est déjà choisir. » (p. 313). Le lecteur pourra alors se demander à quoi tient le choix véritable. Pour E. Falque, le choix véritable revient d’abord à « se tenir dans cette dimension de l’exister, plutôt que de décider pour ou contre un mobile au cœur même de cet horizon » (p. 313). Déjà, chez S. Kierkegaard, grâce au « ou bien-ou bien » apparaissait l’éthique : pour le philosophe danois, il n’était donc pas question de choisir quelque chose, ni même de la réalité de ce qui a été choisi ; mais de la réalité du choix : un choix du choix qui deviendra pour Martin Heidegger, le lieu de la « ressaisie du choix » soit la possibilité pour le Dasein authentique de se décider pour un pouvoir-être puisé dans le Soi-même le plus propre. Contre la position nietzschéenne d’un sujet qui se décide seul à décider, Emmanuel Falque opte pour la posture du croyant. Et il nous fait remarquer, à la suite de Rudolf Bultmann, qu’avec la confession de foi, la « décision de transformation » implique la « transformation du concept de décision ». Croire en Dieu n’est pas croire qu’il est, mais croire qu’il est celui par qui il m’est donné de croire – pour ce qui est de la chair de Dieu, ou de la résurrection de la chair, plus encore que tout dogme : « Dieu croit en moi plut que je croie en lui ; et Dieu croit en moi pour que je croie en lui. » (p. 314). La foi en Dieu convertit ainsi profondément la vision de la structure du monde elle-même, car comme le disait déjà saint Thomas d’Aquin « Dieu est pour nous la cause de l’opération de tout ce qui opère », comme il est pour l’auteur de La Chair de Dieu, la cause de la décision de tout ce qui décide. Emmanuel Falque fait donc ressortir cette structure paradoxale de la décision de foi pour signifier au lecteur que nous devenons avec le Christ ce que, depuis toujours, nous étions appelés à être. Il ne s’agit donc plus de « devenir ce que nous sommes » (selon la citation de Pindare reprise par Nietzsche et par Heidegger), mais bien d’ « être ce que nous devenons » pour E. Falque (p. 315) s’appuyant sur le verset 12 du chapitre III de l’Exode : « Je serai avec toi ». Loin de décider sans nous, Dieu décide avec nous. Et dans notre être en devenir, en chemin, apparaît le sens de cet « en commun de la décision » qui s’appuie ainsi sur le socle humain de la foi philosophique : « Dieu ne demande pas seulement à l’Homme une décision, nous rappelle E. Falque, mais tout en le faisant, il constitue lui-même une décision sur lui. » (p. 315). En reprenant les analyses de Karl Barth, dans sa Dogmatique (tome 2, § 38), Emmanuel Falque nous fait ainsi comprendre que la théologie est un engagement dans une histoire à deux.
Cessant ainsi de renvoyer dos-à-dos métaphysique et phénoménologie, Emmanuel Falque pose leur compénétration comme un regard mutuel d’intelligence et de profondeur, reconnaissant par là quelle ne sont pas ou plus étrangères l’une à l’autre. La métaphysique comme « traversée de la physique ou de la nature » n’appartient pas à l’Homme seulement, quand bien même il lui reviendrait d’abord de l’effectuer en propre. Dieu aussi s’en fait l’héritier, voire le Passeur par qui notre fardeau est embarqué pour être avec lui embarqué. Pâtissant le monde pour le passer au Père, le Fils accomplit en lui cette traversée, « tenant non seulement à nous y accompagner, précise notre auteur, mais aussi à nous y porter, en nous y transformant. » (p. 326). Le lecteur aura donc compris tout le sens de cette « traversée » : la métaphysique n’est pas dans un au-delà, mais dans la transformation de notre en-deçà, et reconnaissance de notre propre poids.
Toute la force de ce grand livre qu’est La Chair de Dieu tient à nous ramener à l’Homme tout court, à ce qu’E. Falque nomme « l’horizon bouché de notre propre existence », pris dans une contingence que rien n’autorise à dépasser. Le philosophe a raison de nous mettre ainsi en garde contre les émerveillements béats et les délires mystiques : « Les disciples d’Emmaüs certes reconnaissent le Christ quand il disparut à leurs yeux (Lc 24, 31) selon l’extraordinaire de sa divinité (phénoménologie de l’illimité), mais sans manquer en même temps de mentionner leur « cœur tout brûlant » (Lc 24, 32), alors qu’ils marchaient avec lui sans le reconnaître et rencontrant précisément d’abord sa pure et simple humanité (phénoménologie de la limite). » (p. 319). Si le « phénomène limité » ne s’oppose pas au « phénomène saturé » pour Emmanuel Falque, la seconde voie radicalise la première, car « rien ne peut recevoir au-delà de sa mesure ». Tenir sa place d’Homme, et y rester, demeure pour le philosophe une condition de possibilité de la rencontre avec Dieu : « Créé et voulu comme « être limité », l’Homme respectera et aimera sa limite, donnant à Dieu d’y habiter sans néanmoins jamais la dépasser. » (p. 319). Car c’est bien en philosophe et théologien qu’Emmanuel Falque travaille à l’assumer, allant moins de l’humanité à la divinité, que de l’animalité à l’humanité, dans la filiation. Car la miséricorde de Dieu demeure dans l’incarné, et le métamorphose.
C’est là tout l’enjeu de La Chair de Dieu : penser au « fil conducteur du corps » (Nietzsche), en mesurer les obstacles (pour ce qui est de l’organique et du problème de l’âme) et poser ainsi le choc en retour de la théologie sur la philosophie. La chair de Dieu devient le creuset par où tout s’assume et se transforme, y compris l’amour, sans néanmoins jamais se supprimer : « Il est bien une « charité de la chair » en Dieu selon saint Bonaventure, rappelle Emmanuel Falque, dès lors que c’est par amour, ou par bienveillance, que Dieu vient à s’incarner. » (p. 329). Le Docteur séraphique va jusqu’à dire, dans son Breviloquium qu’« on ne peut rien penser de plus clément, de plus affectueux, de plus amical » que cette incarnation du Verbe (vol. IV [Incarnation], 1, 2, p. 59 – Quarrachi, V, 241). C’est pourquoi le philosophe E. Falque insiste tant pour tenir ensemble la naissance et la mort dans la parenthèse de l’existence, car le tragique de l’humain ne peut se tenir à la fin (la croix) sans hériter aussi du commencement (la naissance). E. Falque nous rappelle donc cette nécessité de partir de l’expérience de l’Homme tout court à moins de ne rien atteindre de Dieu lui-même : « La charité propre à Dieu répondra donc elle aussi, fût-ce de façon paradigmatique, de ce qu’il en est de l’ « amour » en l’Homme. Mais pour aimer il faut que Dieu vienne kénotiquement à nous le premier. L’amour mutuel, remarque E. Falque, celui par lequel il faut être au moins deux pour aimer, appartient donc aussi bien à l’humain qu’au divin, et constitue le fondement commun : « soit la dilection par laquelle le Père aime le Fils, et le Fils aime réciproquement le Père. » (p. 334). Mais il insiste surtout sur le « comble de l’amour » qui passe de la simple réciprocité d’amour à la charité trinitaire. Car ce n’est pas la dualité qui fait la Trinité, mais bien le tiers du don : Deux (le Père et le Fils) font trois (avec l’Esprit) : « La structure trinitaire se donne dès l’origine comme remède en Dieu lui-même à la jalousie du péché », inscrivant l’antidote de la charité dans la structure trinitaire du divin. » (p. 336). Le propos de notre auteur vise à faire ressortir tout l’enjeu de la Troisième Hypostase trinitaire, qui, très présente dans la théologie orthodoxe (on pensera à V. Lossky), mais peu dans la théologie catholique. Ce livre d’E. Falque vient justement combler cette part manquante et présente l’Esprit Saint comme « une sorte de tiers dans l’amour ». Mais l’extériorité du troisième dans l’amour humain ne dit rien en effet de l’intériorité et de l’égalité des personnes divine dans la périchorèse divine. Seul est ainsi charitable Celui qui est charité en cela qu’il est trinitairement identifié et qu’il donne à un tier ce qu’il ne veut pas conserver à part soi dans une pure réciprocité d’amour. Nous participons nous aussi à cette passion d’amour si nous vivons nous-mêmes dans le Christ en qui se cherche et se vit ce partage d’amour. Seule l’agapè trinitaire peut tout dire et en est capable, et constitue le propre de son amour : « Inscrivant en son cœur ce don continuel de deux (le Père et le Fils) à un troisième (l’Esprit Saint), elle fait de ce « mouvement de charité » le principe même de la circularité. » (p. 337).
 Le lecteur peut ainsi saisir tout le soubassement trinitaire de la métaphysique falquienne : en se donnant à l’Homme, cette passion trinitaire du désir de l’autre en Dieu se mue en pathos de Dieu pour l’humanité, faisant de leur « commune affection » le lieu même de leur rencontre comme de leur possible conversion de l’un par l’autre. Mais reprenant les développements d’Origène, E. Falque va plus loin : le pathos constitutif et originaire par lequel le Père « souffre » d’une altérité s’enracine dans l’acte de la création plus que dans toute autre passion. Donc ce n’est pas seulement l’Incarnation qui a précédé la Passion, mais, d’une certaine manière, la Passion, qui a précédé l’Incarnation. Le pâtir originaire du Père précède donc lui-même la « chair de Dieu ». Et tel est bien pour notre auteur le paradoxe de l’agapè divine. Et ce qui est vrai du Père l’est aussi du Fils : « L’empathie divino-humaine, remarque très justement E. Falque, s’étend alors du Fils à l’Homme, aux saints et aux défunts qui en partagent avec lui l’affect. Si Origène va jusqu’au bout du chemin de l’univocité de l’éros à l’agapè. Si la philanthropie chrétienne de l’Alexandrin corrige l’apathie stoïcienne, Emmanuel Falque nous rappelle la nécessité de la penser trinitairement, faute de pleinement et profondément l’envisager. C’est à cette tâche même que saint Bernard de Clairvaux s’attardera : dans son Sermon 26, cité par Emmanuel Falque, Bernard opère une conversion de l’éros à l’agapè (p. 243). Pour Bernard, le mode de l’amour de Dieu est un amour « sans mode », remarque E. Falque, plutôt que « sans mesure », non pas au sens de la modalité humaine de l’amour, mais de son intégration dans un mode de l’amour qui ne vient pas seulement de lui. Et ce qui constitue en propre l’agapè divine relativement à l’éros humain est le com-pâtir. Le maintien de la charité en Dieu vient transformer nos affects, mais non pas les diminuer. Dieu n’est pas affecté, il est affection, affirme Bernard dans son Traité De la considération, corrigeant les possibles dérives anthropomorphiques de l’éros empathique divino-humain. De l’affect humain à l’affect divin, ou de l’incarnation humaine à l’Incarnation divine, l’expérience de l’Homme éclaire le mystère de Dieu (analogie de proportion), et le mystère de Dieu dit ce qu’il en est de l’Homme (analogie d’attribution). Ni univocité, ni équivocité, les termes se compénètrent l’un l’autre jusqu’à faire de la charité divine le lieu de conversion de l’amour humain. Dieu est pleinement chair parce qu’il est pleinement charité. Pour le dire, Emmanuel Falque propose le néologique de « cha(i)rité » qui n’est pas sans lien avec « l’encharnellement de Charles Péguy pour dire ce corps à corps de la chair et de la charité » (p. 347). Ce qu’au fond, Emmanuel Falque nous apprend à revivre dans notre nature humaine c’est le mystère de la grâce, de cet arbre de vie divine enraciné profond dans notre chair : « pas de corps ressuscité donc, qui ne soit aussi notre corps, dans un véritable corps-à-corps. Tel est le mystère central du christianisme, parfois aussi oublié qu’il est faussement devenu éthéré. » (p. 11).
Le lecteur peut ainsi saisir tout le soubassement trinitaire de la métaphysique falquienne : en se donnant à l’Homme, cette passion trinitaire du désir de l’autre en Dieu se mue en pathos de Dieu pour l’humanité, faisant de leur « commune affection » le lieu même de leur rencontre comme de leur possible conversion de l’un par l’autre. Mais reprenant les développements d’Origène, E. Falque va plus loin : le pathos constitutif et originaire par lequel le Père « souffre » d’une altérité s’enracine dans l’acte de la création plus que dans toute autre passion. Donc ce n’est pas seulement l’Incarnation qui a précédé la Passion, mais, d’une certaine manière, la Passion, qui a précédé l’Incarnation. Le pâtir originaire du Père précède donc lui-même la « chair de Dieu ». Et tel est bien pour notre auteur le paradoxe de l’agapè divine. Et ce qui est vrai du Père l’est aussi du Fils : « L’empathie divino-humaine, remarque très justement E. Falque, s’étend alors du Fils à l’Homme, aux saints et aux défunts qui en partagent avec lui l’affect. Si Origène va jusqu’au bout du chemin de l’univocité de l’éros à l’agapè. Si la philanthropie chrétienne de l’Alexandrin corrige l’apathie stoïcienne, Emmanuel Falque nous rappelle la nécessité de la penser trinitairement, faute de pleinement et profondément l’envisager. C’est à cette tâche même que saint Bernard de Clairvaux s’attardera : dans son Sermon 26, cité par Emmanuel Falque, Bernard opère une conversion de l’éros à l’agapè (p. 243). Pour Bernard, le mode de l’amour de Dieu est un amour « sans mode », remarque E. Falque, plutôt que « sans mesure », non pas au sens de la modalité humaine de l’amour, mais de son intégration dans un mode de l’amour qui ne vient pas seulement de lui. Et ce qui constitue en propre l’agapè divine relativement à l’éros humain est le com-pâtir. Le maintien de la charité en Dieu vient transformer nos affects, mais non pas les diminuer. Dieu n’est pas affecté, il est affection, affirme Bernard dans son Traité De la considération, corrigeant les possibles dérives anthropomorphiques de l’éros empathique divino-humain. De l’affect humain à l’affect divin, ou de l’incarnation humaine à l’Incarnation divine, l’expérience de l’Homme éclaire le mystère de Dieu (analogie de proportion), et le mystère de Dieu dit ce qu’il en est de l’Homme (analogie d’attribution). Ni univocité, ni équivocité, les termes se compénètrent l’un l’autre jusqu’à faire de la charité divine le lieu de conversion de l’amour humain. Dieu est pleinement chair parce qu’il est pleinement charité. Pour le dire, Emmanuel Falque propose le néologique de « cha(i)rité » qui n’est pas sans lien avec « l’encharnellement de Charles Péguy pour dire ce corps à corps de la chair et de la charité » (p. 347). Ce qu’au fond, Emmanuel Falque nous apprend à revivre dans notre nature humaine c’est le mystère de la grâce, de cet arbre de vie divine enraciné profond dans notre chair : « pas de corps ressuscité donc, qui ne soit aussi notre corps, dans un véritable corps-à-corps. Tel est le mystère central du christianisme, parfois aussi oublié qu’il est faussement devenu éthéré. » (p. 11).







