Raphaël Ehrsam appartient à cette nouvelle génération de chercheurs très brillants qui, notamment avec Antoine Grandjean, proposent de nouvelles et fécondes perspectives sur la philosophie kantienne. Auteur d’articles remarqués et de préfaces de grande qualité pour certains classiques publiés chez GF, de La Boétie à Bergson, il a publié en 2016 chez Vrin la réécriture de sa thèse consacrée à la question du langage chez Kant1. Le thème peut surprendre car, ainsi que le rappelle l’auteur dans sa substantielle introduction, bien des commentateurs ont jugé que le kantisme était incompatible avec une réflexion sur le langage, la thématisation de l’a priori excluant toute place pour l’acquisition des concepts et, partant, pour une dimension génétique de ces derniers, portée par le langage.
Pourtant, loin de congédier le langage, Raphaël Ehrsam montre que ce dernier joue un rôle crucial dans la philosophie kantienne et que, loin de contredire l’édifice transcendantal, il en révèle au contraire le sens de manière affinée. Pour ce faire, l’auteur creuse tout au long de l’ouvrage la différence entre l’a priori et l’inné, ce qui lui permet d’ouvrir un espace pour la notion d’acquisition des concepts, donc pour une description génétique, sans pour autant remettre en question la notion d’a priori. En d’autres termes, la distinction cruciale de l’inné et de l’a priori, distinction qui, par ailleurs, n’est pas une thèse de l’auteur mais un fait textuel incontestable, devient dans l’ouvrage de R. Ehrsam l’objet d’une investigation serrée en vue de révéler la nécessité du langage comme moyen d’acquisition des concepts a priori, tout le problème étant donc de déterminer ce que peut bien signifier dans un tel cadre « acquisition » car si celle-ci revêt une dimension a posteriori, on voit mal comment elle pourrait se concilier avec le formalisme a priori des catégories et de la loi morale analysé par Kant. Autrement dit, toute la gageure du livre consiste à montrer que l’affirmation d’une acquisition des catégories et de la loi morale n’implique aucunement que le contenu de celles-ci soit lui-même empirique, ni que leur signification soit réductible à leur condition d’acquisition.
A : L’interlocuteur absent : Hegel et la critique de la découverte empirique des catégories
Avant même d’entrer plus avant dans l’analyse de ce remarquable ouvrage, peut-être peut-on poser un étonnement : le programme de ce dernier semblait faire écho à un certain nombre de remarques hégéliennes consacrées à la découverte kantienne des catégories, et au problème de l’articulation entre l’affirmation a priori de leur production et la découverte empirique de leur présence dans l’entendement. On sait en effet que Hegel a toujours voulu montrer que Kant demeurait dogmatique dans son rapport à l’expérience et que, s’il avait reconnu le fait intellectuel dans l’expérience, il n’en avait pas compris la signification authentique ; plus précisément, Kant serait resté aux yeux de Hegel prisonnier d’un point de vue empiriste quant à l’origine des concepts, situation pour le moins paradoxale puisque cette rencontre empirique des catégories se serait accompagnée d’une absence de réflexion génétique quant à leur provenance ; en d’autres termes, Hegel disjoint empiricité et enquête génétique, et accuse Kant d’avoir succombé à l’empirisme pour mieux justifier l’absence d’une réflexion génétique, comme si la présence factuelle des catégories excluait de s’interroger sur leur provenance : elles sont « là » et cela suffit.
A cet égard, comme le rappelle Olivier Tinland, chez Kant, « l’expérience y est appréhendée de façon statique comme un ensemble de phénomènes, et les catégories y sont saisies comme des concepts simplement trouvés en nous qui n’ont de sens et de consistance que lorsqu’ils se trouvent appliqués à l’expérience. »[Olivier Tinland, L’idéalisme hégélien, Paris, CNRS-éditions, 2013, p. 43. On peut consulter notre recension à [cette adresse.[/efn_note] Cette analyse fait écho au reproche hégélien développé à de nombreuses reprises à l’endroit de la philosophie kantienne d’être restée une philosophie perceptive, appliquant des « instruments » à l’expérience extérieure, instruments eux-mêmes découverts presque fortuitement, et manquant donc la logique interne de la conceptualité. Il ne s’agit donc pas tant de « trouver » les catégories, pour Hegel, que de concevoir la conceptualité elle-même :
« Mais accueillir la pluralité des catégories, d’une quelconque manière, derechef, comme un objet trouvé, par exemple à travers les jugements, et s’en accommoder ainsi, doit en réalité être regardé comme un outrage à la science ; où l’entendement pourrait-il encore montrer une nécessité s’il ne le pouvait pas en lui-même, qui est la nécessité pure ? »2
Autrement dit, Hegel reproche au kantisme de maintenir un écart béant au sein même de la réalité entre, d’un côté, un sujet qui dispose de concepts, et, de l’autre, le champ de l’expérience auquel s’applique cette conceptualité, le problème étant justement que celle-ci soit appliquée de l’extérieur à celui-là. Réduite à sa dimension sensible, spatio-temporelle, l’expérience kantienne se trouve ainsi séparée du sujet et, du même geste, absolutisée, tandis que celui-ci ne peut rendre compte de sa propre conceptualité, du fait même que les catégories sont découvertes comme une chose présente.
Pourquoi convoquons-nous ici la figure hégélienne pour rendre compte de l’ouvrage de Raphaël Ehrsam ? Deux raisons concourent à ce choix : la première procède d’un étonnement et tient au fait que Hegel ne constitue pas l’interlocuteur de l’auteur, et que, jamais, dans l’ouvrage, ce dernier ne croise l’objection hégélienne d’une empiricité des catégories pourtant privée d’investigation génétique. Cela peut surprendre car il nous semble que la position de l’auteur est l’exact inverse de celle de Hegel : Kant aurait, au contraire de ce que dit Hegel, parfaitement investigué la question génétique sans jamais réduire celle-ci à une provenance purement empirique. D’où une interrogation : pour quelle raison, alors même qu’il renverse Hegel, R. Ehrsam ne le cite-t-il pas ?
Une deuxième raison concourt à convoquer Hegel : le problème de la portée objective des catégories. Hegel reconnaît bien des mérites à la pensée kantienne, notamment la transformation de la métaphysique en logique de la subjectivité. Et s’il condamne la réification des catégories, il n’en salue pas moins la construction d’une subjectivité transcendantale digne de ce nom, dont le défaut est d’avoir pensé le rapport entre le concept et l’expérience en termes d’extériorité et d’application instrumentale :
« si la déduction métaphysique chosifie la catégorie, c’est qu’elle est subordonnée à une déduction transcendantale qui vise à fonder l’adéquation, la « correspondance » de la catégorie et du perçu. Dès lors, la détermination de cette problématique transcendantale qui est le fondement de l’autre déduction compromet d’emblée cette dernière : l’adéquation invite sournoisement mais impérieusement à considérer le concept comme une chose adaptée à une autre ; mise au service d’un problème de la vérité posé de cette manière, où forme et matière sont comme deux choses adaptables l’une à l’autre en leur mutuelle extériorité, la déduction métaphysique ne peut que ramener à une philosophie transcendantale audacieusement engagée dans la considération de la pensée productrice de son propre contenu à une pensée qui manipule des concepts à la manière des choses ou de « tableaux ».»3
Or, cela est très proche de la réflexion de R. Ehrsam puisque celui-ci, à plusieurs reprises, justifie de manière plus que convaincante le refus de l’innéisme kantien par le problème de l’application objective des catégories : en effet, si les concepts étaient innés, ils seraient uniquement subjectifs et l’on ne comprendrait plus leur validité objective. Pourquoi alors, dans ce cas, et à rebours du précédent, ne pas prendre appui sur Hegel pour justifier sa propre thèse ?
Reposons donc la question initiale : pourquoi Hegel n’est-il jamais convoqué dans ce cadre et pourquoi n’est-il pas l’interlocuteur fondamental de R. Ehrsam ? Il nous semble que son absence constitue un indice fondamental permettant de comprendre la volonté de l’auteur : Hegel s’intéresse à la définition des concepts kantiens et se demande si les notions d’expérience, de catégories, ou encore de sujets sont bien posées et déterminées. A cet égard, l’horizon hégélien est celui de la vérité et de la pertinence du kantisme à partir d’un concept d’expérience pensé comme totalité. En revanche – et nous pensons que c’est de cela dont l’absence de la référence à Hegel est l’indice –, Raphaël Ehrsam ne se demande pas tant si Kant a raison d’écrire ce qu’il écrit, mais se préoccupe d’une chose, à savoir garantir que Kant est étranger à toute forme de pensée innéiste, tant et si bien qu’il ne s’agit plus tant de déterminer si Kant est cohérent que de démontrer qu’il y a place pour une certaine réflexion sur la genèse des éléments fondamentaux, place assumée par le langage. Le problème n’est donc plus de se demander si cette dimension génétique mènerait à l’empirisme, ni et encore moins si l’empirisme est une position défendable, mais il devient tout entier de garantir que cette place existe. Cela est par exemple très sensible dans la réflexion sur la surdité qui, chez Kant, interdit le développement de la conceptualité : d’une certaine manière, peu importe que Kant ait raison ou tort, l’important est que cette thèse prouve la place du langage – en l’occurrence de l’oralité – dans l’acquisition d’une conceptualité opérante du point de vue de l’économie de la pensée kantienne.
B : Le modèle interprétatif de l’épigénèse
Tout au long de l’ouvrage, R. Ehrsam propose un modèle de lecture qui tient en un mot, l’épigénèse. Refusant donc la préformation des catégories et de la loi morale qu’il n’y aurait qu’à développer ou à « actualiser » selon une logique par exemple leibnizienne, l’auteur montre de manière convaincante et même souvent incontestable que c’est par la rencontre avec le langage, et par cette rencontre seulement, que pourront se développer la complexité des concepts et celle de la vie morale.
A cet égard, un des textes les plus signifiants que convoque l’auteur est celui de la Réponse à Eberhard dans lequel Kant conteste tout à la fois toute forme d’innéité des concepts et, plus généralement, des représentations, et évoque donc le caractère universel de l’acquisition de celles-ci :
« La Critique, écrit Kant, n’accorde absolument aucune représentation innée par création ou innée ; qu’elles appartiennent à l’intuition ou aux concepts de l’entendement, elles les tient toutes ensemble pour acquises. Mais il y a également une acquisition originaire (selon l’expression des théoriciens du droit naturel), par conséquent aussi une acquisition de ce qui n’existe pas encore auparavant, donc de ce qui n’a appartenu à aucune chose avant cette action. Telle est, comme l’affirme la Critique, premièrement la forme des choses dans l’espace et dans le temps, deuxièmement l’unité synthétique du divers dans des concepts ; car notre pouvoir de connaissance ne tire aucune des deux des objets, comme si elles étaient données dans ceux-ci pris en eux-mêmes, mais il y parvient de lui-même a priori. Il faut cependant qu’il y ait pour ce faire un fondement dans le sujet, fondement par lequel il est possible que les représentations en question naissent ainsi et non pas autrement, et qu’en outre elles puissent être rapportées à des objets qui ne sont pas encore donnés ; ce fondement, du moins, est inné. »4
Plusieurs remarques peuvent ici être avancées. D’une part, en raison de la dernière phrase, on comprend que Kant ne renonce pas à toute forme d’innéisme : il ne fait porter son refus que sur les représentations ; qu’aucune représentation ne soit innée n’implique pas que rien ne soit inné. Or qu’est-ce qui est « inné » selon Kant ? précisément le « fondement » subjectif par lequel soit garantie la puissance du transcendantal : en d’autres termes, parce que le transcendantal n’est pas en tant que tel une représentation, il est inné et ne s’acquiert aucunement ; en revanche, les représentations comme telles doivent faire l’objet d’une acquisition qui, pourtant, n’est pas empirique au sens propre puisqu’elles n’existent pas avant que d’être acquises. Comment comprendre ce paradoxe ?
Les explications de l’auteur sont à cet égard fort intéressantes : menant l’analogie avec la possession mue en propriété, la propriété n’existant pas en tant que propriété avant l’acte civil de sorte que l’acquisition ne se fonde pas sur une possession antérieure, il en déduit que « l’acquisition originaire d’une représentation ou d’un concept signifie qu’elle est acquise en première personne sans qu’il y ait l’intervention décisive d’une transmission, d’une tradition ou d’une médiation divine. Le concept fortifie donc la théorie épigénétique et les développements sur le concept de « réflexion ». »5 L’auteur ajoute même que l’acquisition originaire n’implique pas seulement le caractère initial d’une possession mais également son caractère provisoire, la possession se muant en propriété dans le cadre d’un état civil réalisé ; ce qui se produit lors des premières perceptions n’est donc pas encore une acquisition véritable des concepts et représentations a priori ; percevoir de façon spatio-temporelle et lier synthétiquement ses premières sensations constitue une étape nécessaire au sein du processus conduisant à la constitution systématique d’une expérience et à l’expression discursive des articulations de celle-ci ; mais de même que toute occupation factuelle d’un terrain peut revêtir le statut d’acquisition originaire, de même les formes de toute perception et de toute réflexion minimale sur nos perceptions peuvent être réfléchies dans des concepts et des intuitions pures une fois que l’individu articulera au sein de jugements des relations rationnelles. De là cette conclusion introduisant le langage :
« L’acquisition originaire ne signifie pas une acquisition de concepts et représentations pures dès le premier âge, mais bien, dès ce moment, l’horizon d’une reprise des formes de la sensibilité et des formes de la réflexion dans des concepts dont la validité, elle, est a priori. (…). De même que l’état civil ne consiste pas seulement à actualiser une répartition des propriétés déjà virtuelles dans les acquisitions originaires, mais redéfinit les acquisitions brutes comme originaires en leur conférant le statut de propriété, de même le fait de formuler des jugements au sein d’un langage ne fait pas qu’actualiser des représentations a priori déjà virtuelles dans les premières perceptions, il produit l’organisation des perceptions comme le lieu d’une acquisition originaire, en réfléchissant cette organisation de façon explicite. »6
A nos yeux, c’est ici que tout se joue ; le refus radical de l’innéisme kantien amène au fond R. Ehrsam à chercher ce qui pourrait être un milieu au sein duquel la notion d’épigénèse pourrait avoir un sens dans la lecture très stimulante qu’il propose de Kant ; à n’en pas douter, c’est le langage qui joue le rôle de milieu et c’est donc en lui que se joue l’acquisition, bien que le milieu ne contienne pas, à proprement parler, la conceptualité comme telle. Il en est autrement dit une condition d’acquisition nécessaire mais non suffisante, ce sans quoi la notion d’a priori ne se comprendrait plus, ce qui est une autre manière de dire, au fond, que la notion d’a priori ne suffit pas, chez Kant, à rendre compte de l’outillage conceptuel et moral dont disposent les sujets.
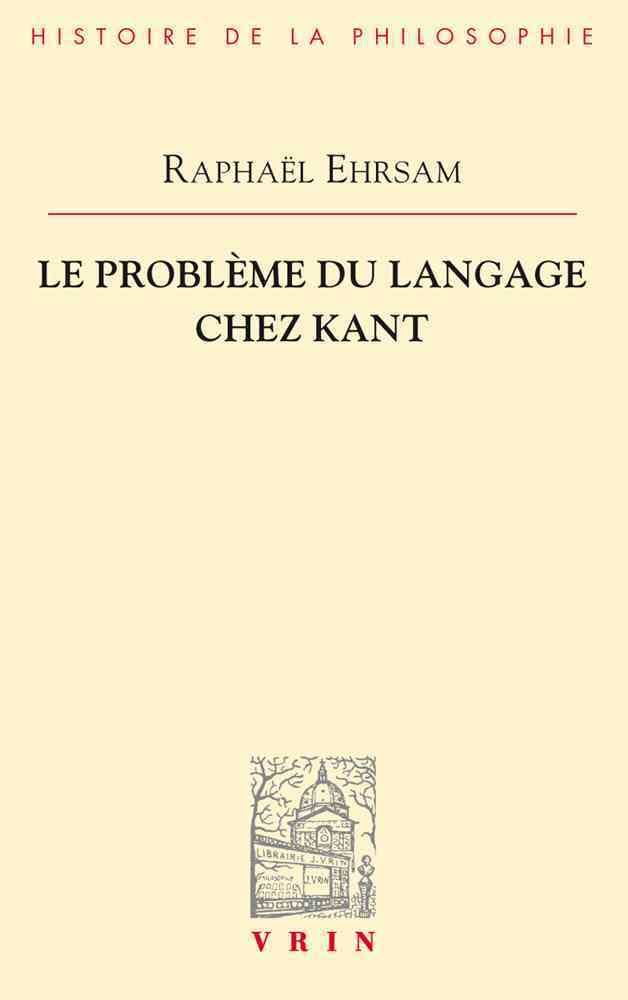
Il faut néanmoins ici distinguer ce que dit Kant de ce qu’interprète l’auteur : Kant nous semble dire de manière explicite qu’aucune représentation n’est innée dans le sujet, mais que ce dernier est en revanche capable par une puissance propre d’engendrer certaines représentations conceptuelles ou spatio-temporelles, ce qui revient à dire que le sujet se donne à lui-même des formes a priori, que ce soient l’espace et le temps, ou les catégories. L’acquisition nous semble donc désigner le procès de donation à soi de ces différentes formes, de sorte que ces formes ne sont pas innées puisque le sujet doit se les donner à lui-même du fait même qu’elles n’existent pas comme telles dans l’objet, mais en même temps la possibilité de former ces formes est innée puisque le « fondement » de cette donation est présente dans le sujet. A nos yeux, Kant ne dit rien de plus que cela, à savoir considérer que les formes ne sont pas dans les objets, ne sont pas tirées de ceux-ci, mais ne sont pas tirées non plus du sujet : elles sont bien plutôt formées par le sujet, de sorte que les formes a priori ne sont pas des choses inaperçues dont on prendrait conscience par réflexion mais bien plutôt ce que le sujet se donne à lui-même en le formant du geste même de l’auto-donation, raison pour laquelle il s’agit d’une acquisition « originaire ».
C’est là qu’intervient la réflexion proprement dite de R. Ehrsam qui ajoute à ce que propose Kant une sorte de condition : cette donation à soi des formes a priori semble requérir un milieu linguistique pour être effective ; Kant, à notre connaissance, dans les textes invoqués, ne dit pas cela, si bien que R. Ehrsam doit croiser plusieurs textes d’années très différentes pour justifier la nécessité d’une telle condition. Et c’est à la recherche de la justification de cette condition que sont consacrés les chapitres suivants.
En d’autres termes, la notion d’épigénèse que convoque R. Ehrsam impose de chercher un milieu pour rendre compte de sa thèse ; dans les textes convoqués, au sens littéral, Kant se contente de refuser le caractère inné des représentations, mais à aucun moment il ne considère que ce refus de l’innéisme des représentations condamne toute forme d’innéisme et à aucun moment il ne considère que la donation à soi des formes a priori requière un quelconque milieu linguistique ; c’est toute la force de l’auteur que de chercher à montrer que, de manière éparse, c’est pourtant bien ce milieu linguistique qui rend intelligible la donation à soi des formes a priori.
C : Concept et grammaire
1°) L’argument de la surdité de naissance
Pour que l’interprétation épigénétique de R. Ehrsam soit fondée, il lui faut montrer que les formes a priori nécessitent une condition linguistique pour en accomplir l’acquisition. C’est la raison pour laquelle, le second chapitre, passionnant à bien des égards, analyse le cas de la surdité : un sourd serait-il capable de disposer d’une conceptualité opérante ?
Proposant un panorama très clair du problème de la surdité depuis Descartes, R. Ehrsam montre que Kant n’écrit pas sur ce sujet à partir d’une tabula rasa mais s’inscrit dans la continuité de la réflexion de Condillac brisant le modèle cartésien de la préexistence des pensées à leur expression linguistique. Condillac, analyse finement l’auteur, avait opéré la transition d’un modèle de la secondarité des signes vers un modèle corrélationnel où les signes ne font pas que traduire un contenu mais sont impliqués dans la formation de ceux-ci. Aucun signe n’influe par sa nature particulière sur les capacités cognitives ; dès lors chez Kant, se trouvent pensés les effets cognitifs spéciaux du support sémiotique oral.
Cela amène à repenser à nouveaux frais la question des signes notamment à partir les propriétés structurelles de la matière phonique : le § 18 de l’Anthropologie fait à cet égard l’objet d’une analyse précise, notamment en raison de cette déclaration kantienne :
« La forme de l’objet n’est pas donnée par l’ouïe, et les sons du langage ne conduisent pas immédiatement à sa représentation ; cependant, pour cette raison, et parce qu’ils ne signifient rien par eux-mêmes, du moins pas sous le rapport des objets, tout au plus sous celui des seuls sentiments intérieurs, ce sont les moyens les plus aptes [« adaptés à », traduit Foucault] à désigner [« caractériser » traduit Foucault] les concepts ; les sourds de naissance, condamnés par-là même à rester également muets, ne peuvent jamais accéder plus qu’à un analogon de la raison. »7
Voici la lecture historique et analytique qu’en propose alors R. Ehrsam : pour l’abbé de l’Épée, l’arbitraire est le défaut des langues orales alors que Kant y voit un fait essentiel de la normativité conceptuelle. On a ainsi un syllogisme chez Kant : l’arbitraire du signe est essentiel à la normativité des concepts, du fait qu’il est une condition nécessaire de la pensée comme pouvoir d’ordonner les représentations selon des règles ; or cet arbitraire ne peut naître que sur le terrain de l’oralité ; donc l’ouïe et les paroles seules peuvent rendre possible la pensée. On en déduit que la thèse de Kant sur les sourds est cohérente : ils sont condamnés à rester sans langage et donc sans pensée. « La raison plus fondamentale de son verdict tient dans l’idée qu’une communication par gestes, aussi détaillée et riche soit-elle, ne constitue pas authentiquement un langage, du fait qu’elle ne met en jeu que l’imagination et ne permet pas à l’entendement ou à la raison de s’affranchir des associations sensibles. »8
Si nous revenons à la thèse générale de l’ouvrage, il est vrai que nous avons là un argument assez fort : tout se passe comme s’il était nécessaire de pouvoir se formuler les choses afin de pouvoir les penser, de sorte qu’un sourd de naissance, privé de toute formulation, ne pouvant donc rien se formuler, ne pourrait pas penser. A cet égard, le toucher ne permettrait pas de pallier l’infirmité de la surdité, le milieu linguistique devenant dès lors la condition sine qua non de la pensée, donc de l’acquisition originaire des formes a priori.
Pourtant, le passage nous semble bien moins univoque que ne le veut l’interprétation de l’auteur et ce pour trois raisons :
1) A aucun moment, Kant ne mobilise la question des formes a priori et, partant, le problème de l’acquisition originaire. La perspective anthropologique exclut de fait cet angle.
2) Puisque la question des formes a priori n’est pas explicitement en jeu, disparaît la question de l’espace et du temps en tant qu’intuitions pures a priori, pourtant évoquée dans la Réponse à Eberhard ; cela tient selon nous au fait que Kant ne parle tout simplement pas de la même chose : dans l’anthropologie, il ne parle que des concepts empiriques, en aucun cas des formes a priori. C’est pourquoi nous ne considérons pas que l’argument de la surdité dise quoi que ce soit des formes a priori et nous y voyons plutôt l’affirmation du fait que le sourd n’a rien à penser ; à cet égard, le déficit de formulation porte selon nous sur la matière et non sur la forme de la pensée, la réflexion sur la déficience empirique jouant sur les concepts eux-mêmes empiriques.
3) Un argument qui nous paraît jouer en faveur de notre lecture est paradoxalement celui de la fin de la citation, à savoir le fait que le sourd se trouve condamné à disposer d’un analogon rationis ; liée à Baumgarten, cette expression signifie qu’un équivalent exact de la raison, donc une organisation structurelle similaire, se joue à un niveau qui est, lui, infra-rationnel. Or de quel domaine infra-rationnel s’agit-il ? Il ne peut s’agir, bien évidemment, du domaine auditif, puisque le sourd en est privé ; il s’agit donc de l’ensemble des sensations, exception faite du domaine auditif. Or, comment rendre compte du fait que l’on ait justement affaire à un analogon de la raison, donc à quelque chose de structuré, et non à un chaos perceptif ? Précisément parce que ce domaine est ordonné par la puissance a priori d’ordonnancement qui justifie le terme d’analogon.
Nous n’interprétons donc pas le passage de la même manière que l’auteur : celui-ci juge que Kant évoque l’impossibilité d’une donation à soi des formes a priori singulièrement réduites à la seule conceptualité à cause d’une saisie déficiente du milieu linguistique ; nous y voyons plutôt une absence de matière qui ne corrompt pas la donation à soi des formes a priori, laquelle permet analogiquement d’organiser l’expérience, organisation analogique qui serait incompréhensible sans la donation à soi des formes a priori ; néanmoins, privé des mots empiriquement acquis, donc privé de matière dans ses raisonnements, le sourd raisonne à vide, et n’a plus aucune matière à laquelle appliquer sa conceptualité.
Nous en voulons pour preuve le § 22 de la même Anthropologie dont, là encore, nous ne faisons pas la même lecture que l’auteur. Kant y analyse le handicap de la surdité, jugé plus grand que celui de la cécité, et analysé dans le cadre d’une surdité de naissance.
« Pour un sourd de naissance, écrit Kant, le sens de la vue doit, d’après le mouvement des organes de la parole, convertir les sons obtenus de lui dans son éducation en un sentir du mouvement de ses propres muscles de la phonation ; encore qu’il ne parvienne par à créer de réels concepts, car les signes dont il a besoin à cet usage ne sont susceptibles d’aucune universalité. […].
Quel est, de l’ouïe ou de la vue, le sens dont l’absence ou la perte est la plus importante ? La privation du premier, si elle était de naissance, est la plus difficile à compenser. »9
Tout l’enjeu est de déterminer ce que veut dire ici « concepts » et il nous semble que l’auteur commet ici une inéluctable pétition de principe : le problème est de démontrer que la donation à soi des formes a priori suppose de manière nécessaire un milieu linguistique ; or, on ne peut pas ici présupposer que le « concept » dont il est question équivaille aux formes a priori en général : il faut au contraire le démontrer. Or il nous semble que si l’auteur ne le démontre pas, c’est que c’est indémontrable car les concepts dont parle Kant sont les concepts empiriques et non les catégories : l’universalité n’est pas ici un argument en faveur des catégories, car tout concept, quel qu’il soit, est universel, chacun entendant par exemple par « chat » la même chose que son voisin.
C’est la raison pour laquelle, non seulement, Kant n’évoque jamais la question de la pensée dans le texte, ni celle du jugement : si véritablement étaient en jeu ici les catégories, Kant devrait à un moment ou à un autre noter l’inaptitude du sourd de naissance au jugement, ce qui n’est jamais dit, ni de près ni de loin. Mais c’est aussi la raison pour laquelle – parce qu’il évoque ici selon nous les concepts acquis empiriquement – il n’est jamais question des formes a priori, ni des intuitions pures a priori ni de la loi morale ni explicitement des concepts a priori.
Enfin, supposons que nous accordions à l’auteur qu’il s’agisse des catégories, nous nous verrions encore obligé de contester la dimension nécessaire du milieu linguistique quant à la formation desdites catégories et, partant, du jugement, car Kant ne dit pas qu’il serait impossible de le pallier : il indique simplement que cette situation est « la plus difficile » à compenser, ce qui n’implique pas l’impossibilité d’une éventuelle compensation ; la nécessité du milieu linguistique n’est donc pas affirmée comme telle.
Exemplifions notre lecture : supposons qu’un sourd de naissance voie une pierre tomber sur un œuf, et l’œuf se briser ; la thèse de R. Ehrsam consisterait à dire que, privé de langage, le sourd de naissance ne pourrait ni percevoir l’unité des objets, ni percevoir leur existence, ni percevoir un lien de causalité entre la chute de la pierre et la brisure de l’œuf. De notre point de vue, au contraire, nous considérons que si Kant affirme qu’il est « très difficile » d’acquérir pour un sourd de naissance des concepts empiriques précis et que, faute de ceux-ci, il perçoit le monde non comme anormal mais comme innommable, il n’en demeure pas moins que le sourd de naissance perçoit la normalité du monde, c’est-à-dire le catégorise. Précisément parce que l’argument de la surdité ne porte que sur les concepts a posteriori et non sur la question de l’a priori, Kant ne juge bon nulle part dans les passages cités d’évoquer les formes a priori en général, contrairement à la Réponse à Eberhard, ni ne prive le sourd de quelque forme de jugement que ce soit.
2°) Comment le droit pourrait-il naître du fait ? Grammaire et logique transcendantale
Néanmoins, malgré nos réserves – dont nous percevons évidemment la dimension contestable –, il nous faut poursuivre dans la lecture – partielle – de cet ouvrage si riche, et, par ailleurs, plus que stimulant. Une des difficultés auxquelles se heurte la thèse de l’auteur est que si le milieu linguistique conditionne nécessairement l’acquisition des concepts, alors un problème logique se poserait : le fait conditionnerait le droit, situation strictement incompatible avec la lettre autant que l’esprit du kantisme. En effet, la nécessité de passer par le langage pour acquérir les formes a priori de la pensée risque de faire dépendre la législation perceptive d’un fait linguistique, et, partant, de perturber l’ensemble du kantisme.
Pour éviter cette difficulté considérable, qui n’est pas présentée en ces termes dans l’ouvrage, l’auteur est obligé de refuser l’idée selon laquelle la langue et, plus précisément la grammaire, soient de purs faits contingents ; il lui faut trouver en elles quelque chose de plus qu’un fait, et ainsi sonder la manière dont l’a priori se retrouve, si l’on peut dire, en lui-même, afin d’éviter de faire dépendre le droit du fait. Nous le redisons, ce n’est pas ainsi que l’auteur présente son cheminement, mais il nous semble que c’est là la difficulté qu’il rencontre et qui l’amène à adopter cette direction.
Le chapitre III présente donc une interrogation méticuleuse sur ce dont la grammaire est porteuse, à partir d’une distinction entre grammaire générale et grammaire particulière d’une langue ; là encore, de salutaires rappels historiques sont proposés, notamment autour de la Logique de « ces messieurs » de Port-Royal. Très riche, le chapitre ne peut faire ici d’un compte-rendu exhaustif ; néanmoins, nous aimerions nous focaliser sur la fin de celui-ci. L’auteur montre de manière remarquable que la logique générale ne peut rendre compte de la grammaire générale, en tant qu’elle ne prend pas en compte le rapport à l’objet. Il faut donc convoquer la logique transcendantale, et comprendre le sens du renversement kantien à l’œuvre : il tient au fait que la forme logique des jugements n’a pas, comme à Port-Royal, la charge de signifier l’unité subjective de nos pensées, mais de rendre possible leur portée objective.
Il en découle une relativisation du lexique, donc des concepts empiriques, à l’égard de la grammaire philosophique : les concepts n’existent que comme prédicats pour des jugements et donc le lexique n’a pas de sens hors de la grammaire. « La dépendance de la grammaire philosophique à l’égard de la logique transcendantale signifie que les catégories grammaticales, loin d’être secondes à l’égard du lexique, donnent au contraire les relations d’ordre par lesquels le lexique des langues en général peut revêtir un sens objectif. »10
Pour ce faire, l’auteur cite des textes peu connus, mais captivants, notamment les Leçons de Métaphysique (AK 28, 576) ou encore les textes de 1783-1784 associés à Metaphysik Mrongovius montrant que la maîtrise des règles grammaticales peut être telle qu’on les applique sans en avoir une claire conscience.
D : La question de la temporalisation
Surgit néanmoins à ce stade de notre lecture une question d’ordre général : l’auteur veut prouver que l’acquisition des formes a priori suppose nécessairement un milieu linguistique, l’analyse de la grammaire conduisant à neutraliser le risque que faire courir une déduction du droit à partir du fait. Mais s’il y a véritablement acquisition de ces formes, alors dans quel temps s’effectue cette acquisition ? Celle-ci présuppose en effet que quelque chose qui ne relève en rien de l’ordre du phénoménal se donne au sujet, précisément parce que les formes a priori ne sont pas innées ; mais de quelle manière la temporalité autorise-t-elle la donation de telles formes qui, en tant que telles, ne sont pas phénoménales ?
R. Ehrsam n’affronte pas cette question, tout du moins directement. Cela tient au fait qu’il médiatise le problème par le langage et qu’il distingue la possession des connaissances de la déduction des concepts a priori. Or, dans la mesure où l’ouvrage vise à montrer que le milieu linguistique est une condition sine qua non de l’acquisition des formes a priori, c’est donc que l’apparition du phénomène linguistique, en sa dimension temporelle, revêt un caractère de nécessité pour l’acquisition de quelque chose qui n’est pas phénoménal.
D’une certaine manière, on peut dire que l’esprit opère une sorte de conversion des représentations en quelque chose d’autre par la puissance propre (a priori) du sujet ; mais même si l’on admettait la thèse de l’auteur, à savoir que le langage est indispensable à pareille conversion, alors quel serait le temps de cette conversion ? La thèse du langage comme milieu ne résout pas le problème, elle ne fait que le repousser d’un cran.
Il est d’autant plus curieux que le sujet ne soit pas traité que l’introduction l’aborde de manière problématique. Alors que l’auteur se demande s’il y a une perspective génétique à propos des concepts, il se demande aussitôt si ne serait pas contradictoire :
« Affirmer que le langage vaut comme condition de la pensée et de la vie morale, n’est-ce pas temporaliser l’a priori, lui ôter son caractère de nécessité et d’universalité, jusqu’à le dissoudre dans l’empirie ? Cette objection peut d’abord paraître puissante et incontournable, fragilisant la lecture de Kant que nous souhaitons défendre. »11
Le problème est qu’à cette question, la distinction entre possession d’une connaissance et déduction a priori ne fournit pas une réponse suffisante puisque l’auteur conditionne celle-ci à celle-là de manière nécessaire. En d’autres termes, de manière transitive, le problème de la temporalisation de l’a priori se trouve maintenu, la distinction proposée étant loin de le neutraliser. Le fait que le corps de l’ouvrage n’affronte pas la difficulté peut surprendre d’autant plus que le chapitre V, consacré à l’éducation morale, ambitionne de défendre la nécessité de penser la conscience morale comme voix :
« La conscience morale peut être pleinement pensée comme voix, et ce sans contradiction, si on conçoit cette voix non comme écho d’une autre voix, simple répétition ou résonance d’un dehors mais comme voix signant son acte de naissance – au terme d’une écoute de voix préalables – dans la possibilité conjointe de la reprise et de la critique. C’est parce que nous avons la capacité de prendre des distances par rapport à ce qui nous est dit, de nous opposer ou au contraire d’assentir, d’approuver ou non, et en général d’examiner, que les voix de nos semblables suscitent notre voix propre. Ainsi, il devient possible de comprendre pourquoi la voix de la conscience semble dans le même temps être nôtre et nous arriver de l’extérieur, mais dans le même temps elle peut devenir proprement conscience du devoir dans un acte de ré-assomption où nous nous faisons sa source. »12
Mais alors, quelle est la temporalité de cette conscience morale comme voix ? Pourquoi l’auteur n’affronte-t-il pas la difficulté relevée en son temps par Philonenko, pour d’autres raisons certes, d’une « temporalité pratique » ou de la « temporalité de la liberté »13 ? Nous touchons là peut-être à notre réserve la plus importante. L’auteur considère que la distinction entre possession et déduction des concepts suffit à se prémunir contre la tentation de donner une signification empirique à l’a priori et c’est d’ailleurs ainsi qu’il conclut son ouvrage :
« Les rôles respectifs de l’audition des signes, de la grammaire, du pronom personnel « je », jusqu’aux énoncés moraux et aux dialogues ne mettent jamais en jeu la tentation de construire une analyse empirique de la signification de certains concepts a priori. »14
Autrement dit, qu’il y ait place pour une perspective génétique n’implique pas la temporalisation de l’a priori mais conjure le risque innéiste ; mais dans ce cas, que signifie l’idée de nécessité d’un passage par le langage pour acquérir les formes a priori ? Transitivement, si le langage permet d’obtenir des connaissances par lesquelles seules devient possible la déduction a priori, alors le langage comme mode temporel est indispensable à la déduction, puisque celle-ci en dépend ; dans ces conditions, nous ne voyons pas du tout comment il serait possible de faire l’économie d’une réflexion sur la temporalisation nécessaire de l’a priori.
Il est vrai que R. Ehrsam propose une courte réflexion sur le temps ou, plus précisément sur le sens interne, essentiellement en vue de cerner le sens de l’aperception. Le sens interne, explique l’auteur, ne me donne rien de l’ordre de l’unité d’un moi, Kant prenant acte de la thèse de Hume et refusant donc que nous ayons quelque chose comme l’idée précise du moi. Refusant donc de faire du temps l’outil d’une introspection, R. Ehrsam affirme qu’ « il n’est au départ rien d’autre que le caractère conscient des représentations externes elles-mêmes. »15 En d’autres termes, le sens interne n’est rien d’autre que l’état conscient du flux de la conscience, soit par le sentiment, soit par les perceptions. Saluons cette manière originale de le présenter qui a le mérite de reformuler l’idée d’un sens interne qui serait la faculté pour le sujet de percevoir ses propres modifications conscientes et qui nous semble tout à fait compatible avec l’idée d’une intuition de l’esprit de son propre état intérieur décrit en AK III, 52, mais aussi avec l’affirmation kantienne selon laquelle la matière propre de l’intuition interne est constituée par les représentations du sens externe. Or, ce qui frappe est le fait qu’à ce moment de son analyse, l’auteur n’ouvre pas la réflexion au temps et la referme au contraire sur la question de l’aperception : il nous semble qu’il eût été fécond de prendre appui sur l’idée d’une conscience de l’affection extérieure du langage pour penser quelque chose l’éveil de l’a priori, et ainsi thématiser la temporalisation de ce dernier.
Conclusion : la question de la spontanéité et de la pureté de la raison
L’ouvrage de Raphaël Ehrsam est brillant, stimulant et riche de questions ; partant d’une idée incontestable, à savoir que l’a priori n’est pas l’inné, il cherche à en accuser la différence et à établir de manière épigénétique le milieu linguistique à partir duquel se forment les formes a priori du sujet. L’auteur se déplace dans l’œuvre avec une impressionnante agilité et une maîtrise admirable des textes canoniques autant que des textes moins connus ; loin d’être la redite d’une thèse mille fois vue et revue, le livre déploie une série de réflexions originales, argumentées et, quoique contestables, donnant toutes matière à réflexion ; rien qu’à cet égard, il s’agit d’un livre en tout point remarquable dont la modeste recension ne rend pas compte de l’infinie richesse.
Nonobstant notre admiration, nous avons soulevé un certain nombre de réserves, tant dans le choix interprétatif de certains passages que dans la décision de ne pas traiter certains problèmes, celui du temps étant à nos yeux le plus regrettable. Quelle est la temporalité de l’acquisition originaire des formes a priori, voilà une question qui nous semblait décisive ; peut-on penser une acquisition non temporalisée, purement logique ? Peut-on penser une donation à soi des formes a priori qui ne nécessite pas le temps ? Peut-on penser une voix morale en-dehors de la question de la temporalisation ?
Au-delà de ces réserves, peut-être pourrions-nous indiquer l’aspect synthétique de celles-ci : elles portent toutes autour de la question de la spontanéité, telle qu’elle est définie dans la logique transcendantale (AK III, 74/75). La spontanéité est « le pouvoir de produire soi-même des représentations »16 : au fond, toute la thèse de l’auteur consiste à dire que la spontanéité ne suffit pas à rendre compte du jugement et que, partant, il faut compléter celle-ci par le recours au langage, celui-ci étant « nécessaire » selon l’auteur à l’accomplissement de celui-là. C’est peut-être là-dessus que se cristallise la matrice de nos réserves : la spontanéité, en sa puissance propre, nous semble à la fois nécessaire et suffisante pour rendre compte des catégories, de la liberté en son sens cosmologique, de l’ordre de la raison dans le devoir, voire de l’ensemble des idées.
Mais allons plus loin encore. Au fond, et peut-être même plus en amont que la question de la spontanéité, il nous apparaît désormais, après avoir lu d’autres articles de Raphaël Ehrsam, notamment « Les intentions morales au croisement de l’universel et du singulier »17, que l’auteur propose une lecture de Kant débarrassée de toute idée de pureté : il introduit sans cesse des éléments matériels, tant du point de vue théorique que pratique, comme si cette idée d’une raison pure lui paraissait contraire à toute défense du kantisme ; le langage est ainsi le milieu matériel qui vient réduire les prétentions d’une analyse de la raison en sa pureté et, partant, la possibilité d’une spontanéité qui fût suffisante pour rendre compte du jugement ; or, nous faisons pour notre part la lecture exactement inverse, voyant dans la pureté de la raison la singularité absolue du kantisme, notamment dans le cadre moral, qui vise à faire abstraction de manière radicale de toute particularité matérielle du sujet empirique18. Gageons que cette divergence de lecture n’occulte en rien, pour le lecteur, l’admiration que nous éprouvons à l’égard de l’auteur et ses publications.
- Raphaël Ehrsam, Le problème du langage chez Kant, Paris, Vrin, 2016
- Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Certitude et vérité de la raison, Traduction B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2006, p. 239-240
- André Stanguennec, Hegel critique de Kant, Paris, PUF, 1985, p. 90
- Kant, Réponse à Eberhard, AK VIII, 221-222, Traduction française dans Kant, Œuvres philosophiques, Tome II, Paris, Gallimard, Pléiade, 1985, p. 1351
- Le problème du langage chez Kant, op. cit., p. 54
- Ibid., p. 56
- Kant, Anthropologie, § 18, AK VII, 155, Traduction Pléiade, p. 973-974
- Le problème du langage… op. cit.,, p. 86
- Anthropologie, § 22, Pléiade, p. 977-978
- Le problème du langage chez Kant, op. cit.,, p. 135
- Le problème du langage chez Kant, op. cit., p. 25
- Ibid., p. 211
- cf. Alexis Philonenko, L’œuvre de Kant, tome II, §§ 41-43, Paris, Vrin, 1972
- Ibid., p. 262
- Ibid., p. 160
- Critique de la raison pure, AK III, 74
- cf. Philosophie, n° 121, printemps 2014
- Nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, La philosophie au risque de la question extraterrestre, Paris, Vrin, p. 93-155







