Lire Heidegger, c’est relire autrement tout ce que nous lisons. Les questions les plus rebattues se changent en questions encore jamais entendues. Retraduisant, auscultant mot à mot le texte de la tradition, comme si le moindre de ses mots n’avait jamais été écouté auparavant, la méthode heideggérienne repense le déjà pensé comme jamais encore pensé. Elle découvre le nom encore pensé dans le plus qu’ancien, l’inouï dans ce qui passe pour évident. Par un prodigieux élargissement, l’étonnement séculaire des philosophes se voit métamorphosé dans le pur émerveillement de la présence, leur soupçon dans la réponse à une revendication silencieuse de l’être sur l’homme.
Michel Haar[1]
- Introduction : comprendre Heidegger, une double tâche
Comprendre Heidegger requiert de dévoiler le sens de sa question fondamentale : le concept de l’être. Il s’agit de saisir à la fois pourquoi ce thème est obstinément ressuscité par le philosophe de Sein und Zeit et comment il prévaut constamment dans sa pensée. Comprendre Heidegger consiste également à élucider les raisons de son choix politique. Jean Grondin, en soutenant l’interdépendance entre ces deux prémisses, développe les dix essais recueillis dans son nouvel ouvrage : Comprendre Heidegger – L’espoir d’une autre conception de l’être, publié le 29 mai 2019 chez Hermann, dans la collection « Le Bel Aujourd’hui », fondée et dirigée par Danielle Cohen-Levinas.
Il convient d’emblée de préciser, avant de spécifier les possibles relations entre les fondements de la problématique de l’être dans la philosophie de Heidegger et les motivations de sa conduite politique, que l’homme n’était considéré ni ne se positionnait comme un penseur politique. Grondin souligne très justement :
Il semble ignorer les grandes théories politiques de la modernité et quand il aborde Platon, Aristote, Kant ou Hegel, ce n’est jamais pour discuter de leur importante pensée politique, mais de leur métaphysique, c’est-à-dire de leur thèse sur l’être (p. 6).
Grondin défend que les faits et les circonstances qui ont conduit Heidegger à délibérément adhérer au national-socialisme sont à la fois politiques et philosophiques. Politiques, car, à l’instar de tant d’autres de sa génération, Heidegger projetait dans la figure d’Hitler un leader capable de redresser l’Allemagne après l’humiliation infligée par le Traité de Versailles. Philosophiques (surtout philosophiques, soulignons-le), car, en principe, il devinait dans le mouvement national-socialiste la perspective d’une révolution historique de notre rapport avec l’être. Heidegger a néanmoins reconnu très tôt (déjà en 1938) sa méprise d’avoir considéré ce contexte d’émergence du nazisme comme une transformation viable de notre attitude à l’égard de la prévalence de l’être.[2] Le national-socialisme, saturé par une vision de l’être qu’il cherchait à surpasser, représentait précisément le contraire de cette révolution attendue de l’être.[3]

Néanmoins, ce désenchantement à l’égard du nazisme n’a en rien ébranlé la conviction de Heidegger quant à une future concrétisation de la transformation de l’être.
Il conçut alors sa propre tâche, observe Grondin, comme celle d’un prophète dans le désert, de l’oubli de l’être, dont le seul espoir était de préparer une autre pensée et un tournant de l’être lui-même, tout en sachant qu’il ne pourrait se produire que dans plusieurs siècles (et encore) (p. 7).
Dans ses Cahiers noirs (Schwarze Hefte), Heidegger conjecture ce tournant dans trois siècles[4]. « Peut-être en 2327 ? », présume-t-il dans un écrit daté de 1941[5]. Cette projection, convient-il de noter, coïncide avec l’anniversaire des 400 ans de la publication de Sein und Zeit : « Son idée, complète Grondin, était que l’espoir, aujourd’hui inconcevable, d’un tournant dans l’être pourrait alors être mieux entendu qu’il ne pouvait l’être dans la nuit profonde de l’oubli de l’être, en 1941 » (p. 7).
Eu égard à ces considérations, saisir la dimension de la politique chez Heidegger suppose de comprendre tout d’abord la problématique complexe de l’être dans sa philosophie :
Comprendre Heidegger, c’est comprendre cette perspective qui l’a amené à appeler de ses vœux une métamorphose, une Kehre, de l’être et de notre rapport à lui, car l’un ne va jamais sans l’autre pour Heidegger : l’être n’est que dans son rapport à nous et vice versa, comme le marque le concept central d’Être et temps pour penser la réalité humaine, le Dasein, l’étant qui est là où il y a de l’être et qui est concerné par lui. Dans ce terme, l’accent ne doit pas seulement porter sur l’étant que nous sommes, et qui de fait n’y est pas nommé, mais sur l’être (Sein, Heidegger écrira plus tard Seyn), qui est « là » et qui nous interpelle d’une manière particulière parce que tout l’être qui est le nôtre tient dans son rapport à l’être (p. 7).
Nous sommes assurément en présence d’une œuvre qui s’est prodigieusement étoffée au fil du temps : rappelons que 102 tomes sont prévus pour l’édition des Œuvres complètes (!), considérées par Heidegger, dans un projet de préface, comme « des chemins et non des œuvres » (Wege, nicht Werke), lesdits chemins suscitant de multiples interrogations. Serait-il possible de définir ou au moins de décrire l’essence de ces nombreux chemins ? Grondin estime la tâche réalisable. Lorsque le philosophe canadien établit la question de l’être comme le centre de toute la philosophie heideggérienne, il affirme catégoriquement que seule une lecture exempte de jargon idéologique serait à même de dimensionner le défi posé par cette question, d’éclairer son intention et les problèmes sous-jacents. Afin d’accomplir au mieux cette tâche, Grondin a stratégiquement organisé ses essais en trois parties : I. « L’urgence de dépasser la conception dominante de l’être » ; II. « Dépasser la métaphysique pour mieux poser sa question » ; III. « La tragédie politique ». Ces noyaux thématiques – au cœur de la philosophie heideggérienne et du débat qui l’entoure – se fondent sur quatre hypothèses qui s’entrecroisent au gré des essais dans un mouvement spiralé et graduel.
La thématique de l’être, quoiqu’elle ne s’affiche pas comme l’unique objet des travaux d’Heidegger, pourrait tout de même être perçue comme l’axe central de sa philosophie. Telle est la première hypothèse défendue par Grondin. Sans ignorer que ce problème surgit tardivement dans les réflexions de Heidegger et qu’il se couple à une certaine « autostylisation » chez le philosophe, qui incorpore le rôle du « penseur solitaire de l’être » (p. 8), l’argument que l’intérêt et la portée de la pensée heideggérienne sont liés à cette question demeure.
Heidegger soutient à bon droit qu’elle est sa question essentielle, voire sa seule question (au sens où tout dépend d’elle), mais aussi la question fondamentale de la pensée occidentale, voire de la pensée tout court, et qu’elle est tombée dans un oubli dont il est opportun de la tirer. C’est du moins la perspective de Sein und Zeit (p. 8).
La lecture du passage de GA 97 cité et traduit par Grondin montre que le dernier Heidegger considèrera cet oubli comme un trait inhérent à l’être, qui est lui-même oublié :
L’expérience fondamentale de ma pensée depuis la préparation de Sein und Zeit (1921) est l’expérience que l’être demeure lui-même dans l’oubli, que ce demeurer est d’une certaine manière propre à l’être lui-même, sa non-pensée par l’homme n’en étant que la conséquence[6].
C’est précisément cet oubli de la question de l’être qui amène Heidegger à la récupérer :
Quand il affirme que la question de l’être est tombée dans l’oubli, il sait que c’est au nom, tacitement, d’une conception de l’être qui justifie ce refoulement. C’est ce qui l’amène à reprendre la question d’Aristote sur les sens multiples de l’être et à s’interroger sur le sens de l’être (p. 9).
La deuxième hypothèse est que la nécessité de reprendre cette question se justifie par le fait que notre conception de l’être reste dominée par une intelligence d’une certaine façon problématique et potentiellement dangereuse. Heidegger estime que l’intelligence actuelle de l’être est négligée en raison d’un oubli spontané de soi. Or, l’être ne saurait être restreint à ce qui est montré à notre regard objectivant et dominant. « En quoi consiste cette intelligence de l’être que Heidegger veut porter à la conscience et, disons-le, surmonter ? », questionne Grondin (p. 9). La conception usuelle de l’être, nommée par Heidegger l’étant subsistant (Vorhandenheit), dans Sein und Zeit, et l’étant techniquement disponible, dans sa philosophie plus tardive, constitue un héritage spécifique de la tradition de la pensée occidentale définie par les Grecs et plus spécifiquement par Platon. Une telle conception ne saurait effectivement pénétrer ce que Heidegger désigne comme le sens (ou la vérité) de l’être. Pour sa part, la compréhension dominante de l’être est problématique, car elle n’est pas nécessairement l’unique.
La compréhension objectivante de l’être – « conception nominaliste », telle que la nomme Grondin – serait, au dire de Heidegger, en grande partie responsable du nihilisme et de l’athéisme dans la contemporanéité. Comme elle s’accompagne de l’illusion de l’homme sur lui-même et de l’être en général, la conception dominante de l’être, déjà problématique et unilatérale, s’avère également hasardeuse.
À propos de lui-même d’abord parce qu’en envisageant l’être comme ce qui se laisse dominer par mon regard et manipuler à l’infini, l’homme se considère et s’autopromeut comme le maître et le possesseur de la nature, en commençant par la sienne. Il a le sentiment qu’il peut tout faire, se méprenant ainsi sur sa finitude essentielle que viendrait refouler le rapport techniciste au monde. L’être se trouve ainsi transformé en ce qui est infiniment utilisable, exploitable et programmable, ouvrant la voie à une dévastation complète qui est aussi écologique, car elle pourrait finir par détruire la terre sur laquelle habitent les mortels (p. 12).
Par la suite, Grondin avance sa troisième hypothèse : la compréhension de la philosophie de Heidegger constitue un processus qui doit impérativement garder en vue ce « combat héroïque et parfois pathétique » contre la conception dominante de l’être, objectivante, technique et nominaliste (p. 14).
Ce combat justifierait dans une certaine mesure l’enthousiasme aveugle qui anime Heidegger lorsqu’il adhère au mouvement national-socialiste. Comme susmentionné, outre l’association de ce mouvement au redressement de l’Allemagne, Heidegger y a projeté, contre toute évidence, une révolution totale de la conception de l’être par l’homme. Grondin affirme :
Tout son questionnement cherchait à explorer les possibilités d’un autre rapport à l’être que celui qui ensorcelle notre époque technique, il a au moins eu le mérite de nous le faire voir, et c’est une révolution de cet ordre qu’il a eu la cécité de pressentir dans le mouvement nazi (p. 14).
Le choix politique de Heidegger, étayé sur un total contresens, représenterait sa grande tragédie métaphysique. D’une certaine façon, la question heideggérienne sur le sens de l’être et sur le sens qu’il a acquis à notre époque – une question métaphysique légitime – est entachée par son association au nazisme.
Peut-on séparer, sauver, cette question de cette compromission ? C’est assurément une tâche difficile dans le climat actuel, mais nous croyons qu’il est possible de sauvegarder la teneur métaphysique de cette question en y voyant une issue possible à l’impasse du nominalisme triste auquel semble aboutir notre civilisation (p. 15).
D’où la formulation de la quatrième et dernière hypothèse : le débat de fond concernant les motivations de Heidegger pour son soutien au national-socialisme doit davantage se situer sur le plan métaphysique que politique. La philosophie de Heidegger s’est forgée au sein d’une tradition métaphysique. Toutes ses questions majeures procèdent de cette tradition : l’être, l’existence, l’essence, la vérité, la raison, voire l’histoire, dans la mesure où elle enquête sur la nécessité d’une vérité absolue convoitée par la métaphysique. Les ouvrages, les conférences, les cours et les écrits inédits de Heidegger entretiennent un débat sur le concept de l’être avec des interlocuteurs qui s’insèrent dans la tradition métaphysique : Anaximandre, Parménide, Héraclite, Platon, Aristote, Augustin, Thomas d’Aquin, Duns Scot, Thomas d’Erfurt, Maître Eckhart, Suarez, Descartes, Leibniz, Kant, Fichte, Hölderlin, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Dilthey, Nietzsche et Husserl. En revanche, Heidegger ne recourt que parcimonieusement aux classiques de la théorie politique : Cicéron, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith et Tocqueville éveillent effectivement un moindre intérêt chez le philosophe allemand.
Le milieu des années 1930 – plus précisément, et peut-être paradoxalement, le cours proposé en 1935 : « Introduction à la Métaphysique » – marquerait une prise de distance de Heidegger à l’égard de la pensée métaphysique.
C’est que la métaphysique aurait été, estimait Heidegger, une pensée non pas de l’être, et de son mystère gratuit, mais de l’étant envisagé à partir de ses raisons. Loin d’être une pensée de l’être [idée contestée par Grondin], la métaphysique aurait au contraire installé un régime de pensée qui aurait étouffé la question de l’être et qui, par son insistance sur un étant dont on puisse rendre raison, aurait conduit à l’émergence de la technique moderne et au nihilisme contemporain (p. 16).
Heidegger cherche ainsi à élaborer une autre pensée ou une autre conception de l’être, qui soit indépendante de la philosophie, car la philosophie et la métaphysique constitueraient des désignations du même type de non-pensée de l’être.
C’est à ce titre, souligne Grondin, que Heidegger demeure un redoutable penseur métaphysique et d’autant qu’il se nourrit continuellement de la tradition métaphysique, laquelle lui fournit non seulement tous ses concepts et ses principaux interlocuteurs, mais aussi ses espoirs fondamentaux, dont celui de la transcendance et d’une vie guidée par un sens supérieur, par-delà le nihilisme ambiant (p. 17).
En contradiction avec Heidegger, la pensée de l’être et la métaphysique ne constitueraient donc pas l’origine du nihilisme, mais ses plus efficaces antidotes, ce qui se manifeste d’ailleurs par le désir heideggérien de « réveiller la question de l’être ». La précieuse contribution de Heidegger à la pensée métaphysique – un point hélas rarement mis en valeur, et qui pourtant mériterait de l’être, soulignons-nous avec Grondin – résiderait donc dans la tentative de penser l’être au-delà de la conception nominaliste, laquelle est effectivement responsable du nihilisme ambiant et de la « désolation spirituelle » qui affectent l’époque actuelle et la philosophie (p. 17).
Afin de présenter les principaux problèmes abordés dans l’ouvrage de Jean Grondin et de discuter ses présuppositions, aussi bien théoriques que méthodologiques, il nous semble approprié d’adopter la progression définie par le propre auteur. Compte tenu de la séquence des différentes sections qui composent le volume, cette recension s’organise en deux parties publiées séparément. Nous espérons – au terme d’une exposition, dans la mesure du possible, prudente et minutieuse – être à même de rapporter des considérations critiques sur les axes qui sous-tendent la lecture proposée par l’auteur, en tenant compte particulièrement de la construction et de l’articulation des arguments mobilisés, de façon à évaluer dans quelle mesure ils inaugurent de nouvelles perspectives et interprétations à propos de la pensée de Heidegger.
- Seinsfrage
L’impératif de surmonter la conception dominante de l’être
« Pourquoi réveiller la question de l’être ? » : c’est par cet essai originellement publié en 2004, et au titre inquisiteur, que Jean Grondin ouvre la première partie de son ouvrage : « l’urgence de dépasser la conception dominante de l’être ».
La question de l’être (Seinsfrage) – ou plus précisément la question du sens de l’être en général – figure au cœur non seulement de la philosophie, mais aussi de l’existence, telle est la thèse audacieuse défendue par Heidegger et que Grondin énonce en ces termes : « la question de l’être en est une devant laquelle et l’homme et la philosophie tendent à se défiler, tant il s’agit d’une question déstabilisante qui vient ébranler toutes les certitudes » (p. 21, soulignés par l’auteur).
L’oubli de l’être, que le philosophe de Sein und Zeit semble imputer à une forme inauthentique de l’existence, aurait amplement dominé la pensée occidentale. Le dernier Heidegger y verra le déploiement du destin historique de la métaphysique.
Il n’empêche, défend Grondin, que ce soit sous la forme de la répétition expresse de la question de l’être dans Sein und Zeit ou celle de l’Andenken (du « souvenir pensant ») de la dernière philosophie, il s’agit toujours de rappeler la pensée et l’existence à leur question essentielle, celle de l’être (p. 21-22).
En passant en revue la réception de cette question primordiale pour la philosophie heideggérienne, Grondin note que la problématique de l’être acquiert, peu après une première réaction plutôt philontologique (Sartre, Jaspers, Marcel, etc.) et aujourd’hui oubliée, une sorte de statut superfétatoire chez la plupart des héritiers de Heidegger. Les lecteurs de l’ouvrage de 1927, fascinés par la puissance des réflexions du philosophe allemand sur les expériences radicales de la finitude, du temps, de la mort, de l’angoisse et du « on », auraient été désarçonnés par l’ampleur et la simplicité du dernier Heidegger, dont la pensée leur semblait résolument antimétaphysique.
Tout se passe un peu, allègue Grondin, comme si le tout dernier Heidegger (celui du « es gibt » et de sa donation sans raison) se trouvait alors retourné contre celui qui aurait maintenu la primauté, encore trop métaphysique, de la question de l’être et de son sens (p. 23).
Cette réception déconcertante – ou cette « irritation des lecteurs », écrit Grondin – procèderait de la difficulté, chez beaucoup, de saisir promptement l’impératif de reprendre une question déjà extrêmement discutée dans la tradition philosophique occidentale, et définie par Aristote comme le concept « le plus universel » : τὸ ὄνἐστι καθόλου μάλιστα πάντων[7]. De surcroît, la plupart des phénoménologues, souhaitant approfondir la pensée heideggérienne, ont explicitement contesté la primauté octroyée par le philosophe au thème de l’être. Lévinas s’est opposé de bonne heure à l’argument que l’ontologie serait la discipline fondamentale de la philosophie, et s’est élevé contre l’ambition ontologique totalisante – ou totalitaire, à ses dires – chez Heidegger (nous traiterons ce point dans la deuxième partie de la recension de cet ouvrage, lorsque nous aborderons la dimension politique de Heidegger). À ces critiques se succédèrent celles de Derrida, dont la pensée incluait également la déconstruction de la question de l’être. Grondin réplique pertinemment :
Si Heidegger nous apprend merveilleusement bien à décoder le langage de la métaphysique, n’est-ce pas la question de l’être elle-même – et le rêve d’une présence enfin pleine du sens ou de la vérité de l’être (comme aletheia ou Ereignis), que n’aurait pas encore abandonné Heidegger – qu’il nous oblige à déconstruire ? (p. 22).
En dépit d’une certaine pluralité des sources d’inspiration, la critique adressée à Heidegger par la phénoménologie française à propos de la primauté de l’ontologie reproduirait un soupçon formulé en Allemagne. Dans des articles publiés à la fin des années 1920, Georg Misch (Lebensphilosophie und Phänomenologie, 1930) entrevoyait dans la relance heideggérienne de la question de l’être une rechute métaphysique, ce qui représentait pour sa part un recul par rapport à l’historicisme diltheyen. À son tour, Gadamer, influencé par l’analyse heideggérienne de la compréhension et du langage, et non par la primauté de la question de l’être, a défendu, dans Vérité et méthode (1960), un « tournant ontologique » de l’herméneutique afin de renforcer la nature langagière de notre expérience du monde. Par ailleurs, Klaus Held (Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie) parle d’une question dont l’évidence ne s’imposerait pas à un regard phénoménologique – « l’être n’étant jamais donné comme tel dans l’intuition », résume Grondin (p. 23) –, et qui mettrait en lumière, chez Heidegger, l’influence particulière de la pensée du Stagirite, voire de la scolastique. Adorno, fidèle à l’argument hégélien selon lequel l’être équivaudrait au vide absolu et à une absence totale de pensée, a élaboré une critique résolument pamphlétaire. Sa Dialectique négative (1966) n’a eu de cesse de condamner le jargon heideggérien de la question de l’être : « futile question crypto-mystique qui trahirait surtout une fuite face à la réalité sociale » (p. 24), selon les termes de Grondin. Enfin, Ernst Tugendhat (Heideggers Seinsfrage), ancré sur la philosophie analytique, a décrété que la question de l’être était dépourvue d’objet et de pertinence philosophique.
Un tel paradoxe – une question de l’être primordiale pour Heiddeger, superficielle pour la plupart de ses héritiers – ne manque pas de soulever chez Grondin les interrogations suivantes : « La question de l’être est-elle, oui ou non, essentielle à la phénoménologie et à la philosophie ? S’agit-il, plus fondamentalement encore, de la question la plus urgente de l’existence humaine ? » (p. 24).
Du point de vue heideggérien, ces critiques témoignent seulement que la question de l’être « est aujourd’hui tombée en oubli » : in gekommen Vergessenheit[8]. Dans les faits, compte tenu de la nécessité d’une investigation approfondie de cette question, Heidegger, au cours de son parcours de réflexion, semble avoir différé sa réponse. Une telle « différance », note Grondin, se manifeste d’emblée par la non-publication de la troisième partie de Sein und Zeit, « Temps et être », dans laquelle Heidegger aurait dû apporter, comme il l’avait annoncé, une « réponse concrète » à la question du sens de l’être[9].
Heidegger souhaitait que les écrits contenus dans les Cahiers noirs, dont la publication a débuté en 2014, parachèvent l’édition de ses œuvres. Naturellement, l’attention générale des médias s’est promptement fixée sur les rares textes affichant un certain antisémitisme. Indéniablement, cet aspect politique pèsera constamment sur le philosophe allemand, mais il ne devrait pas assombrir les réflexions de teneur plus personnelle, précisément les plus révélatrices de ses intentions philosophiques fondamentales.
Or, les inquiétudes viscérales de Heidegger – aux dires de Gadamer, qui suppose que « l’orientation de Heidegger, qui l’amène à donner un contenu attestable à la question de l’être, ne soit rien d’autre que l’évocation romantique de mondes disparus ou en voie de disparition[10] » – étaient pour une large part religieuses.
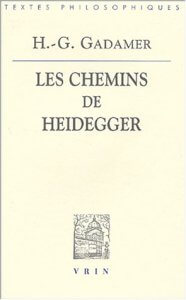
Cela est vrai, écrit Grondin, dans la mesure où tous les espoirs de Heidegger semblent être dirigés vers la préparation d’une autre pensée de l’être, aujourd’hui devenue invraisemblable tant l’intelligence nominaliste règne sans partage, et qui pourrait rendre possible un nouvel apparaître du divin (p. 26).
Selon Grondin, l’intitulé en latin du centième tome prévu dans la GA, Vigiliae, « vigiles » d’une autre pensée, nourrirait de telles spéculations. Ce titre suggèrerait que l’espace de la pensée, chez un Heidegger plus intime, ne serait pas exclusivement occupé par les Grecs et les Allemands.
Un court texte autobiographique de 1937-1938, « Mon chemin de pensée jusqu’ici », inclus dans le tome 66 de la GA, cité et traduit par Grondin, et que nous reproduisons ici, en témoigne :
Non, mais qui voudrait nier que tout le parcours suivi jusqu’à maintenant s’accompagnait, silencieusement (verschwiegen), d’une explication avec le christianisme – une explication qui n’était pas et qui n’est pas un « problème » happé au hasard, mais qui concernait la sauvegarde de l’origine la plus intime – celle de la maison familiale, de la patrie et de mon enfance – et qui était en même temps un détachement douloureux par rapport à cette origine. Seul celui dont les racines ont été aussi profondément marquées par un monde catholique intensément vécu peut deviner quelque chose des contraintes qui ont agi sur le parcours emprunté jusqu’ici par mon questionnement comme des vagues sismiques souterraines[11].
Sans prétendre approfondir le sens possible des « vagues sismiques souterraines », nous pourrions au moins tenter de comprendre, conclut Grondin, comment et dans quelle mesure ces origines ont pu conduire Heidegger à réanimer la question de l’être.
Ancré sur la prémisse que la Seinsfrage charpente l’existence et l’histoire de notre civilisation, Heidegger justifie parfois expressément cette primordialité, comme dans l’introduction magistrale de Sein und Zeit (§ 1-4), précisément intitulée « Nécessité, structure et primauté de la question de l’être ». Doublement inspiré par la scolastique et la philosophie transcendantale ambiante, Heidegger justifie la nécessité de reprendre formellement la question de l’être. Selon le philosophe allemand, trois préceptes enracinés dans la scolastique sont responsables de l’omission de cette question : a) l’être est le concept le plus universel, b) il est indéfinissable et c) il est si évident que chacun le comprend spontanément. Heidegger suit ici la logique classique de la définition : definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Toutefois, Grondin observe pertinemment que nous ne saurions déterminer si le geste du philosophe est ironique ou sérieux, car il prend soin d’énumérer et d’examiner en profondeur cette logique pour ensuite la déconstruire.
C’est précisément sur le troisième précepte de la scolastique – l’évidence alléguée de la conception de l’être, qui, à vrai dire, n’a rien évident – que Heidegger semble fonder la nécessité de relancer la question de l’être. « Que toujours déjà nous vivions dans une compréhension de l’être et qu’en même temps le sens de l’être soit enveloppé dans l’obscurité, écrit-il, voilà qui prouve la nécessité fondamentale de répéter la question du sens de l’“être”[12]. » Cette conclusion marquante est récupérée plus loin par la constatation suivante : « ce n’est pas seulement la réponse qui manque à la question de l’être, mais encore que la question elle-même est obscure et dépourvue d’orientation[13] ». Indéniablement, la conclusion est forte, car elle embrasse plusieurs de nos concepts fondamentaux, voire la totalité, dont le sens s’obscurcit en effet, sans que le recours à un questionnement philosophique formel et prééminent ne soit cependant indispensable. D’où une double interrogation chez Grondin : « Pourquoi distinguer ici le thème de l’être parmi tant d’autres ? La question reste donc entière : pour quelle raison faut-il relancer coûte que coûte la question de l’être ? (p. 29, souligné par l’auteur).
À la lecture des pages ultérieures, nous découvrons que Heidegger plaide en faveur de la nécessité absolue de relancer cette question en ces termes :
Jusqu’ici, la nécessité d’une répétition de la question a été motivée par la noblesse de sa provenance, et surtout par l’absence d’une réponse déterminée, ou même par le défaut d’une position suffisante de cette question[14].
Or, réplique Grondin,
La nécessité d’une reprise de la question de l’être n’est que suggérée par là, d’autant que la noblesse d’une descendance peut elle-même être soumise à une destruction. Jusqu’à nouvel ordre, on ne peut donc parler que d’une nécessité faible, mais que les développements sur la structure et la primauté de la question de l’être viendront renforcer (p. 29-30).
Afin de montrer que la Seinsfrage est la question « tour à tour la plus principielle et la plus concrète[15] », Heidegger cherche à la cerner en termes effectifs. Une fois appliqués à la question de l’être les trois moments qui structurent formellement l’analyse phénoménologique du questionnement (§ 2) – un Gefragtes (un questionné), un Befragtes (un interrogé), un Erfragtes (un demandé, dans la traduction de Martineau, ou un intenté, dans la traduction de Grondin[16]) –,Heidegger conclut que le Dasein est contraint de s’interroger sur le sens de l’être, une interrogation avec laquelle il se confond : « l’étant qui a le caractère du Dasein est lui-même en rapport – et peut-être même en un rapport insigne – à la question de l’être[17] ». Nous verrons que le § 4 traite l’essence de cette relation.
En dépit de l’élucidation de la structure formelle de la question de l’être, le sens de cette enquête minutieuse menée par Grondin – pourquoi relancer la question de l’être ? – reste en suspens. Heidegger laisse entendre que l’être est lui-même affecté par la question. « On devine que la question est pressante pour le Dasein lui-même, s’il est vrai, comme on l’apprendra sous peu, que le Dasein est l’être pour lequel il y va en son être de cet être même » (p. 32). En quoi consiste ce sentiment oppressant qui affecte le Dasein ? La question reste encore sans réponse. Heidegger poursuit sa justification de la primordialité de la Seinsfrage et aborde sa primauté ontique au § 4 ; néanmoins, avant d’aborder la primauté ontique, en vue de distinguer cette primauté entre toutes, il traitera la primauté ontologique de la question de l’être (§ 3).
Lorsque Heidegger indique que les ontologies régionales des divers domaines de l’étant (la nature, la conscience, l’histoire, etc.) se fondent sur l’ontologie fondamentale – responsable du sens de l’être – et qu’elles fondent à leur tour les sciences positives, il reconnaît le rôle scientifique dispensé à la question de l’être. Cependant, son éclairage ontologique ne repose aucunement sur les sciences, mais sur la philosophie, entendue comme une « logique productive » des sciences. Toute ontologie régionale, si utile qu’elle soit face au questionnement ontique des sciences, serait en soi insuffisante. « Pour pouvoir déterminer l’être d’un étant déterminé, chacune a besoin de l’éclairage préalable du sens de l’être. Élucider celui-ci est la tâche réservée à l’ontologie fondamentale »[18].
Quoique Heidegger soupçonne une déduction généalogique, annonce Grondin, il est clair qu’il défend la primauté de la question de l’être moyennant « une réduction à des niveaux de réflexion toujours plus élémentaires » (p. 34). Schématiquement, nous aurions trois niveaux de réflexion, aux tâches bien déterminées : les sciences ontiques → l’exploration d’un domaine d’étant ; les ontologies → l’élucidation des concepts fondamentaux qui circonscrivent le mode d’être de cet étant ; l’ontologie fondamentale → la clarification du sens de l’être comme la condition apriorique de ces ontologies. La primauté ontologique de la question de l’être vise ce dernier niveau de réflexion, qui, dans l’ordre philosophique des raisons, est conçu comme le plus fondamental.
La primauté ontique signifie que la question du sens de l’être est prioritaire non seulement pour la hiérarchie des savoirs, mais aussi pour le Dasein. Constitutive de chaque Dasein, elle aboutit au souci (Sorge[19]), que tout individu est pour lui-même, souci qui résumera tout l’être du Dasein au § 41 de Sein und Zeit.
C’est une inquiétude qui non seulement caractérise le Dasein en propre, explique Grondin, mais qui le traque, au plus intime de son être, à telle enseigne que l’un de ses plus grands soucis sera de s’en décharger, donc de se soustraite à la question trop déstabilisante qu’il est pour lui-même. D’où la fuite du Dasein vis-à-vis de la question de son être. Le Dasein sera donc le plus souvent là sur le mode de l’absence à soi. Heidegger a parfois parlé à cet égard d’un Wegsein, d’un être-ailleurs, d’un être loin de soi, bref, d’un Dasein qui se défile ou qui n’est pas tout à fait « là » (p. 36).
L’oubli de soi du Dasein constituerait une échappatoire lui permettant d’esquiver sa temporalité, ou sa mortalité. « Fuite dans l’inauthentique, estime Heidegger, puisqu’elle ferme les yeux sur la condition qui est celle de tout Dasein et à partir de laquelle pourraient se déterminer tous ses projets » (p. 36). L’authentique Dasein – authentiquement là au lieu d’être ailleurs – sera un Dasein entschlossen (résolu ou déterminé, selon la traduction française, cependant, comme le souligne Grondin, le terme ent-scholossen, lu à la Heidegger, veut surtout dire « non verrouillé »). Autrement dit, le Dasein authentique est résolument ouvert à son propre être. Ce sera en outre la forme privilégiée de la conscience de soi (p. 36).
Jusqu’à présent, notre sentiment est que Heidegger ne cherchait qu’à clarifier ce que l’on entend par le terme être (§ 2) ou à élucider les conditions ontologiques de la démarche scientifique (§ 3). Serait-il possible d’identifier la question du sens de l’être en général à celle du souci qui caractérise le Dasein ?
Afin de répondre à cette question, nous partons de la distinction entre les perspectives de Sein und Zeit et la philosophie heideggérienne plus tardive. Le dernier Heidegger était en effet enclin à atténuer la question du souci du Dasein, préférant mettre l’accent sur l’événement de l’être lui-même. Or, Sein und Zeit était sur ce point tout à fait explicite. Récapitulons : la primauté ontique n’apparaît qu’au § 4 (donc après la primauté ontologique). Cette priorité était celle du souci que représente l’être pour tout Dasein. Chaque Dasein, dans son « être-possible » (Seinkönnen), est en attente d’une « ouverture » (Ent-schlossenheit au sens de Heidegger).
Le souci de l’être temporel du Dasein détermine toute compréhension de l’être, essentiellement habité par la mort. Il convient de rappeler que cette indissociabilité entre l’être et la mort confère du sens au concept heideggérien de Sein zum Tode. Comme Heidegger l’exprime dans un cours de 1925[20], le sum moribundus incorpore la plus intime conviction du Dasein. Selon Françoise Dastur,
La certitude du devoir-mourir est le fondement de la certitude que le Dasein a de lui-même, de sorte que ce n’est pas le cogito sum, le « je pense, je suis », qui constitue la véritable définition de l’être du Dasein, mais bien sum moribundus, « je suis mourant », le « destiné à mourir » donnant seul son sens au « je suis »[21].
C’est dans ce sens que
La mort ne peut plus alors apparaître comme l’interruption de l’existence, comme ce qui déterminerait la fin de celle-ci de manière externe, poursuit Dastur, mais comme ce qui constitue essentiellement ce rapport du Dasein à son propre être que Heidegger nomme existence[22].
Cependant, les analyses heideggériennes montrent que la conception de l’être intemporel domine toute l’histoire de l’ontologie, depuis l’être éternellement présent de Parménide, en passant par l’idée toujours identique de Platon, par la substance d’Aristote, par le ipsum esse subsistens du Dieu de Thomas d’Aquin, jusqu’au cogito hyperbolique fondé par les modernes. En ultime instance, suppose Heidegger, la récurrence de la lecture de l’être comme « permanence dans la présence » repose sur un certain refus insistant de la temporalité intrinsèque au Dasein.

Réveiller la question de l’être, conclut Grondin, c’est mettre en lumière ce rapport, oublié, refoulé, entre l’être et l’intemporalité et se demander si le lien entre l’être véritable et le temps ne peut pas être pensé d’une manière plus radicale encore (p. 38).
La justification formelle – et en quelque sorte formaliste, selon Grondin – à laquelle Heidegger recourt dans l’ouverture de Sein und Zeit afin d’argumenter en faveur de la priorité de la question de l’être ne révèlerait pas tout, car une question de fond demeure :
Pourquoi est-il vital de ressusciter la question de l’être ? Afin de tirer au clair le sens d’un vocable polysémique ? Dans le but de jeter les assises d’une ontologie fondamentale qui serait à même de fonder les ontologies régionales, qui viendraient à leur tour fonder les sciences positives ? Pour repenser l’être de l’homme à partir des expériences-limite de la mort, de l’angoisse et de l’appel à la conscience qui en résulte ? (p. 38).
Dans ce chapitre, le dernier topique « Et l’expérience fondamentale pour Heidegger ? » s’ouvre ainsi par cette problématique. Son objectif est de pointer le lien étroit entre les deux topiques traités antérieurement, à savoir l’expérience religieuse chez Heidegger et la justification de la question de l’être.
Très tôt s’est imposée à Heidegger une expérience de l’être comme surgissement (phusis), présence (Anwesenheit), éclosion (aletheia) et pur advenir (Ereignis). Selon Heidegger, cette expérience en est une qui s’offre à l’homme de manière insigne et qui a même besoin de lui, car sans lui, cette ouverture, cette échappée de l’être ne serait pas. Simplement, l’homme ne contrôle pas cette échappée. Il y est (d’où son nom de Da-sein), il en est, étant lui-même brusque surgissement, in-quiète éclosion dans l’ouvert du présent (p. 39).
Il s’agit d’une intelligence de l’être comme temps, mais d’un temps qui n’est pas celui des horloges. Chez Heidegger, le temps de l’être serait plutôt un déploiement ou une ouverture de soi, un advenir, que le philosophe allemand marque par le terme essence (Wesen, au sens verbal ; « l’essence » comme ouverture) de façon à connoter un certain caractère processuel. « Heidegger reconnaît volontiers que l’émergence de l’être est nécessairement aussi éclosion de quelque chose, donc d’un étant surgissant dans la présence et qui s’offre à un regard » (p. 40, souligné par l’auteur).
La consolidation d’une intelligence un tant soit peu technique de l’étant – qui est caractéristique de notre modernité, mais dont les assises remontent à l’apparition de la métaphysique grecque, avec Platon – serait responsable de l’effacement du mystère et du surgissement originel de l’être (sans l’abolir néanmoins). Heidegger a très tôt exposé cette idée. En s’intéressant à la conception techniciste ou nominaliste de l’être, extrêmement captivante à notre époque, il a développé l’argument selon lequel l’oubli de l’être aurait empreint toute la métaphysique. Le philosophe supposait en effet, sans nourrir aucun grief à l’égard de la technique et du platonisme, que l’élaboration d’un être soumis à une perspective strictement compatible avec la rationalisation pourrait obscurcir « l’expérience du don gratuit de l’être, qui éclot sans pourquoi » (p. 41). Inscrit dans une époque caractérisée par le désenchantement du monde, le drame de l’intelligence technique procéderait du rejet de tout lien à un ordre supérieur. La lecture des manuscrits les plus personnels de Heidegger révèle que penser l’être revient nécessairement à penser un dieu qui soit encore divin : die Not der Gottschaft der Götter[23].
C’est dans cette condition d’affliction – qu’il est possible de qualifier de religieuse, au sens le plus large – que se construit l’idée d’un oubli de l’être. Heidegger ne propose ni solutions ni palliatifs à cette agonie. « Il espère, au contraire, l’attiser, en criant dans le désert de l’absence de détresse que la condition humaine reste en proie à une déréliction que ne peuvent satisfaire les réponses technicistes, les seules qui soient admises aujourd’hui » (p. 43). Comme l’écrit Heidegger dans ce passage remarquable, qui résonne comme un appel :
Interrogez l’Être ! Et dans son silence – entendu comme le lieu de naissance de la parole – répond le dieu. Vous avez beau ratisser tout l’étant, nulle part ne se montre la trace du dieu[24].
Dans un monde où l’anxiété de contrôler l’étant finit par éteindre toute expérience de l’impondérable, seule la construction d’une autre pensée (Andenken) de l’être assurerait « l’espoir de la divinité du divin. Vigile qui a peut-être tout à voir avec le réveil de la question de l’être » (p. 44).
Grondin ouvre son essai subséquent – « Comprendre le défi du nominalisme », d’abord publié en 2008 – en indiquant que l’une des contributions les plus précieuses de Sein und Zeit réside dans le questionnement du privilège de « l’étant subsistant », pensé à la manière d’une res extensa posée face au sujet et qui équivaut quasiment à l’en-soi de Sartre. D’après Heidegger, cette conception de l’être représente la condition de possibilité du développement de la technique, qui définit la modernité, mais dont les fondements renvoient à l’avènement de la métaphysique grecque avec Platon. Si Heidegger s’intéresse particulièrement à la question de l’étant subsistant dans son essai Sein und Zeit, ce n’est que plus tardivement qu’il a démontré, dans sa philosophie, comment la métaphysique plus ancienne avait rendu possible l’appréhension technique de l’étant.
Ce débat autour du concept de l’étant subsistant débouche inévitablement sur la question du sens : « il s’agit de surmonter la conception purement technique de l’être, car celle-ci ne peut répondre à la question, plus fondamentale, du sens de l’existence » (p. 46). En présence d’un contexte strictement balisé par la considération technique et économique, et dans lequel la dissémination de l’étant subsistant – ou des masses d’en-soi, pour reprendre une nouvelle fois l’expression de Sartre – est indéniable, il convient de poser la question suivante : « quel est le sens de l’être et de l’aventure de la vie ? Cette réponse peut-elle relever de la seule technique ? » (p. 46). Assurément non, car son propos est d’envisager quelque chose comme une fin ultime – ou une mesure, répond Grondin, en allusion à la question de Hölderlin reprise par Heidegger : Gibt uns auf Erden de Maß ? (« Y a-t-il sur la Terre quelque mesure ? ») – « qui ne se prête plus à une considération économique, qui renverrait à une autre utilité ».
Il est notoire que c’est sur la base des capacités d’intellection de l’esprit que Platon discerne, dans sa République, les deux grandes sphères de l’être (intelligible et sensible, ou invisible et visible) : le monde visible ou perceptible (oraton) est celui que les sens peuvent voir (oran) ; le monde intelligible (noèton) est celui que mon intelligence (nous) peut penser (noein). Étant donné que la vision provoque les sens ou l’esprit, l’être semble ainsi se réduire à la capacité d’être vu. Cette idée d’un être conduit par la pensée traverse, selon Heidegger, toute l’histoire de la philosophie occidentale. Pourrions-nous affirmer que l’être se réduit de fait à l’image produite par notre pensée ? Heidegger, assurément, ne le croit pas. À vrai dire, c’est la singularité démesurée d’une telle prétention qu’il vise initialement à dénoncer. En somme, il s’agit de détruire cette idole d’un être qui se construirait par notre esprit. C’est cette destruction qui définit d’ailleurs le sens élémentaire de sa phénoménologie : « retournons enfin aux phénomènes pour voir ce qu’il en est de l’être, de son point de vue à lui, si l’on peut dire », résume Grondin. Ce mouvement est possible parce que « nous sommes le lieu où il y a de l’être (Dasein), où l’être se donne et peut être accueilli sans visée de domination. Il est donc possible de parler de l’être lui-même » (p. 47).
Les « médiations », cibles quasi exclusives de la pensée occidentale, constitueraient le moyen par lequel l’être se donne, mais elles ont fini par le transformer en écran : nos représentations, le langage, les signes, la culture, la société, etc. D’où le questionnement suivant : « Faut-il vraiment considérer le langage, et ses médiations, comme l’élément qui nous dépossède d’un accès à l’être, “en soi” ? N’est-il pas plus naturel d’y voir, au contraire, ce qui nous y donne d’abord accès, ce qui nous plonge dans l’être ? » Or, le Dasein est aussi cela, répond Grondin, « un retour à l’être, par-delà toutes les mailles du filet dans lequel on s’obstine à l’enserrer (le vécu psychique, les représentations, le langage, la vision du monde, la culture) » (p. 48).
L’urgence de réveiller la question de l’être résulte du fait que la réduction de l’être à l’étant semble aujourd’hui assurée. Or, cette conception nominaliste de l’être est non seulement partagée par le commun des mortels, mais aussi par la science et la philosophie moderne, en raison d’une carence de réflexion autour du terme être : « être, conclut Grondin, c’est exister plutôt que ne pas exister, c’est-à-dire survenir réellement dans l’espace, existence qui se laisse attester par nos sens » (p. 49).
L’existence d’entités individuelles et matérielles définit la modernité. Connaître de telles réalités n’est plus connaître une essence – vu que celle-ci se trouve en franc processus d’effondrement –, mais identifier plutôt, au cœur des réalités individuelles, les régularités ou les lois considérées comme premières. La conception nominaliste de l’existence ayant pénétré toute la modernité, il n’est guère surprenant qu’elle ait prévalu sur la pensée qui peut être caractérisée comme « politique », lorsque la prééminence de l’individu s’impose comme l’unique réalité fondamentale.
Avec l’avènement de la modernité, les humanités assimilent une conception de l’être strictement marquée par les sciences de la réalité physique. Or, sans mésestimer l’effectivité du développement de la science moderne, l’empire de la conception nominaliste impose une indéfinition intégrale à tout le sens de l’être : « Quel est le sens de notre existence, et du cosmos, si le monde se résume à un ensemble de masses en mouvement régies par les seules lois de la mécanique ? », interroge Grondin, qui poursuit de façon à reprendre l’ontothéologie heideggérienne abordée plus haut :
Dans une telle construction, il va de soi que la question de l’existence de Dieu, qui n’a jamais cessé de tourmenter Heidegger, ne peut vraiment se poser. C’est une lapalissade de dire que l’existence de Dieu doive faire problème dans un cadre nominaliste : Dieu existe-t-il comme une pomme ou une table ? Assurément non. Donc Dieu n’existe pas pour la modernité, et s’il existe encore dans les « croyances », ce n’est justement, pense-t-on, que comme la fiction à laquelle certains individus restent attachés, en raison de leurs origines ou de leurs angoisses. La foi n’est plus ici qu’une « attitude » individuelle et subjective, donc problématique (p. 52, souligné par l’auteur).
De fait, Heidegger ne se trompe pas lorsqu’il argumente que la question du nihilisme s’enracine dans ce contexte :
Si toutes les valeurs ne dépendent plus que du sujet, qui est de plus en plus le sujet individuel, quelle étoile, ou quelle mesure, peut encore l’orienter ? Elle ne dépendra plus que du bon vouloir du sujet, qui confirme par là sa toute-puissance, mais au même moment son impuissance radicale : qui est-il pour déterminer ce qui doit donner un sens supérieur à sa vie ? La grandeur de Heidegger est d’avoir reconnu cette aporie du nominalisme (p. 53, nous soulignons).
Étant donné que le philosophe allemand considérait que le nominalisme correspondait à l’oubli de l’être, les questions du sacré, du sens et du divin dépendaient nécessairement, pour sa part, d’une autre intelligence de l’être, qui serait d’ailleurs la seule condition pour nous sauver[25].
À vrai dire, ancré sur la conviction que le nominalisme résumerait « l’intention secrète » de la métaphysique, Heidegger a toujours cherché à surmonter le nominalisme et le monde technique moyennant un dépassement de la métaphysique.
Mais faut-il vraiment dépasser la métaphysique elle-même si l’on veut marquer les limites du nominalisme ? Comment peut-on, en effet, prétendre dépasser la métaphysique si ce qui est recherché, c’est une autre conception de l’être ? Et peut-on sérieusement dire que l’on veut la dépasser si l’être que l’on cherche à penser se veut plus essentiel et plus fondamental encore ? Quant au « dépassement » lui-même, n’est-il pas lui-même rendu possible par le mouvement de transcendance (meta) qui anime depuis toujours la métaphysique ? (p. 57, soulignés par l’auteur).
Grondin s’appuie sur cette séquence de questions pour énoncer ce qui constitue l’une de ses hypothèses fondamentales : ce que Heidegger cherche à surmonter n’est en aucune façon la métaphysique, mais le nominalisme. Le jugement heideggérien catégorique à l’égard de la métaphysique s’est précisément focalisé sur l’essence chez Platon, ce que confirmeraient ses divers écrits sur l’essence de la vérité, du fondement, de la phusis, du logos ou de l’œuvre d’art. En contraste avec l’essence prétendument intemporelle du platonisme, toutes les réflexions de Heidegger sont marquées par l’insistance au sens verbal de Wesen (« essence »).
Il n’empêche, affirme Grondin : lorsqu’il se penche sur le Wesen, c’est bien sur ce qu’il y a de durable, de constant, de permanent, de liant et de rassemblant dans un phénomène, ou une configuration, qu’il porte son regard (!). L’essentia et l’eidos ne visent guère autre chose, et d’autant que la constance qu’ils rendent pensable en est une qui se déploie à travers le sensible et sur la longue durée. La pensée heideggérienne du Wesen serait-elle praticable sans la métaphysique et sans Platon, sans la hauteur de son coup d’œil sur la constance rassemblante, et nécessairement ouverte, car le rassemblement présuppose à l’évidence la différence ? (p. 58).
D’où la conjecture possible que l’attitude de Heidegger à l’égard de la « métaphysique » équivaudrait à ce que le propre philosophe désapprouvait lorsqu’il accusait cette discipline intellectuelle d’avoir promu une conception technique de l’étant, sommairement réduit à sa visibilité et à son utilité :
Ne se construit-il pas lui-même un concept un peu technique, passe-partout, de métaphysique, qu’il applique péremptoirement à l’ensemble de son histoire, mais qui finit par rendre inaudibles les voies de la métaphysique elle-même ? (p. 58-59).
Lorsque Heidegger assume une telle position, il se prive – conclut Grondin – de chemins forcément métaphysiques, qui lui permettraient de surmonter la capture technique de l’être.
Jean Grondin : Comprendre Heidegger – L’espoir d’une autre conception de l’être (Partie 2)
[1] Avant-propos à Heidegger, Cahiers de l’Herne, Paris, Éditions de l’Herne, 1983, p. 13.
* Diplômée en lettres classiques/grec à l’UNESP (2011 – boursière du PIBIC/CNPq), docteure en études littéraires à l’UNESP (2016 – boursière du CNPq) avec un stage à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (2015 – boursière du PDSE/CAPES) et dotée d’une formation disciplinaire en littérature et en philosophie à l’Université de São Paulo (FFLCH/USP). Intéressée par la philosophie française contemporaine, sa recherche actuelle porte sur la temporalité dans la phénoménologie herméneutique de Paul Ricœur.
[2] Cf. GA 97, p. 147 et sq. ; cité par J. Grondin, p. 7.
[3] Cf. GA 96, p. 408 ; cité par J. Grondin, p. 7.
[4] Cf. GA 97, p. 116, 150, 185, 506, 512 et passim.
[5] M. Heidegger, Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1930-1941), GA 96, p. 196 ; cité par J. Grondin, p. 7.
[6] Cf. GA 97, p. 22 ; cité par J. Grondin, p. 8-9, n. 5.
[7] Métaphysique, B 4, 1001a 21
[8] M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer, 16e éd., 1986, § 1, p. 2. Noté par la suite SZ ; la traduction française à laquelle nous renvoyons est celle d’E. Martineau, Être et temps, Éd. Authentica, 1985 (hors commerce), p. 22. Disponible en ligne : http://t.m.p.free.fr/textes/Heidegger_etre_et_temps.pdf.
[9] Cf. SZ, § 5, p. 19 ; trad. fr. cit., p. 36-37.
[10] Voir H.-G. Gadamer, Les chemins de Heidegger, traduction, présentation et notes par J. Grondin, Paris, Vrin, 2002, p. 189.
[11] GA 66, p. 415 ; trad. et cit. par J. Grondin, p. 27.
[12] SZ, § 1, p. 4 ; trad. fr. cit., p. 26 (nous soulignons).
[13] SZ, § 1, p. 4 ; trad. fr. cit., p. 26 (souligné par l’auteur).
[14] SZ, § 3, p. 9 ; trad. fr. cit., p. 29.
[15] SZ, § 3, p. 9 ; trad. fr. cit., p. 29.
[16]À propos de l’application de cette distinction triadique à la question de l’être, voir J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de Sein und Zeit, 3e éd., Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2003, p. 76 sq.
[17] SZ, § 2, p. 8 ; trad. fr. cit., p. 29 ; voir aussi GA 20, p. 200 (cité par J. Grondin, p. 32).
[18] Cf. J. Greisch, op. cit., p. 83 (souligné par l’auteur) ; voir aussi SZ, § 3, p. 11 ; trad. fr. cit., p. 31.
[19] Il convient de rappeler avec F. Dastur que « le mot allemand Sorge a, tout comme le latin cura, le double sens de soin et de souci et il a été choisi par Heidegger pour désigner, en dehors de toute connotation morale ou existentielle, l’être même du Dasein. Mais parce que le Dasein ne se rapporte pas seulement à lui-même mais aussi à l’autre étant, Heidegger distingue deux modes du souci qui sont la préoccupation (Besorgen) et la sollicitude (Fürsorge) ». Voir F. Dastur, Heidegger et la question du temps. Paris, PUF, 2011, p. 123.
[20]Voir M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Sommersemester 1925), Gesamtausgabe, Band 20, Klostermann, 1979, p. 437.
[21] F. Dastur, La Mort. Essai sur la finitude, PUF, Paris, 2007, p. 22.
[22] Ibid., p. 23.
[23] Cf. GA 66, p. 255-256 ; cité par J. Grondin, p. 42.
[24] Passage cité et traduit par J. Grondin, p. 43. Texte original : „Frage das Seyn ! Und in dessen Stille, als dem Anfang des Wortes, antwortet der Gott. Alles Seiende mögt ihr durchstreifen, nirgends zeigt sich die Spur des Gottes“ ; cf. GA 66, p. 353.
[25] Sans ignorer la pertinence du sujet, nous précisons qu’une discussion approfondie sur la relation, chez Heidegger, entre la question de l’être et le divin excède les limites de ce travail. Voir, sur ce sujet, le débat que J.-L. Marion établit avec Heidegger dans son ouvrage magistral Dieu sans l’être, Paris, PUF, « Quadrige », réed., 2013.








