Après avoir traduit le Traité Du Béryl de Nicolas de Cues dont nous avions rendu compte ici, Maude Corrieras en a proposé un commentaire1 ce qui en fait la première présentation en français et contribue encore un peu plus à répandre la pensée du Cusain dans notre langue, après les efforts d’Hervé Pasqua, Jean-Marie Nicolle et Jean-Michel Counet. Habituellement peu étudié et peu commenté, le traité du Béryl reçoit ici sous la forme de « quelques notes » de nombreuses et précieuses précisions quant aux intentions de l’auteur, mais aussi quant à ses interlocuteurs et aux ruptures qu’il introduit vis-à-vis d’Aristote, précipitant la fin de la scolastique et ouvrant grande la porte à une nouvelle manière de philosopher où le principe de non-contradiction se voit destitué de sa position absolue et où la raison se trouve transcendée par l’intellect, dont Nicolas de Cues analyse la capacité inouïe de connaissance.
Redisons, avant même d’en aborder le contenu, l’extrême plaisir que procure la qualité du papier glacé, et le soin accordé à la qualité de l’ouvrage.
A : Un Discours de la Méthode
Rappelons pour commencer que le béryl désigne une pierre hexagonale à faces prismatiques grâce à laquelle on fabriquait des lunettes permettant de voir ce que l’œil ne voyait pas ou plus ; à cet égard, parler du béryl pour le Cusain, c’est parler d’un outil permettant d’améliorer la connaissance, c’est-à-dire de proposer une méthode de connaissance rendant la vue à l’esprit, lui permettant de comprendre ce qu’il ne comprenait pas.
D’une certaine manière, tout le propos du Béryl visera à tirer les conséquences pratiques et concrètes de la trinité des facultés humaines déjà exposées dans le traité de La docte ignorance, au fameux § 215 : « Il n’y a pas de doute que l’être humain est constitué d’une sensibilité, d’un intellect et d’une raison comme intermédiaire unissant la première au second. L’ordre veut que les sens soient soumis à la raison et la raison à l’intellect. L’intellect n’appartient ni au temps ni au monde, il en est détaché ; les sens sont assujettis au monde, au temps et au mouvement ; la raison est à l’horizon de l’intellect, pour ainsi dire, et au sommet des sens, de sorte que les sens qui sont au-dessous du temps et l’intellect qui est au-dessus coïncident en elle. »2 Si La docte ignorance date de 1440, le Béryl lui est postérieur de 18 ans, et envisage en 1458 de creuser le sens de cette distinction entre intellect et raison, dont l’on peut d’ailleurs constater qu’elle sera reprise, sous une forme inversée, chez Kant et Hegel.
Dans la Docte ignorance, Nicolas de Cues se contente, si l’on peut dire, de poser le primat de l’intellect sur la raison au sens où « l’intellect domine la raison, afin que, par-delà la raison éclairée par la foi formée, il adhère au Médiateur et qu’il puisse ainsi être attiré par la gloire de Dieu le Père. »3 Un ou deux ans plus tard, Nicolas précisait dans le De coniecturis ce qu’il entendait par « intelligence », et la dissociait de toute spatialité ou de toute régionalité. « l’intelligence n’est ni en arrêt ni en mouvement ni en repos : elle n’est pas dans un lieu [neque in loco est], bien plus elle n’est ni forme, ni substance, ni accident selon ce que ces termes signifient lorsqu’ils sont posés par la raison. Comme l’intellect est la racine de la raison, les termes intellectuels sont racines des termes rationnels. Dès lors le verbe de l’intellect est la raison, en laquelle l’intelligence brille comme dans une image. »4 Et un peu plus loin : « Donc l’intelligence n’est rien de ce qui peut être dit ou nommé, mais elle est le principe de toutes les raisons [principium rationis omnium], comme Dieu est le principe de l’intelligence. Il faut méditer ces réalités avec une assiduité pleine de zèle et quand tu pénétreras par l’esprit ces choses profondes, des vérités peu accessibles au grand nombre te seront manifestées avec la douceur caractéristique du plaisir intellectuel qui surpasse incomparablement tout agrément sensible. »5
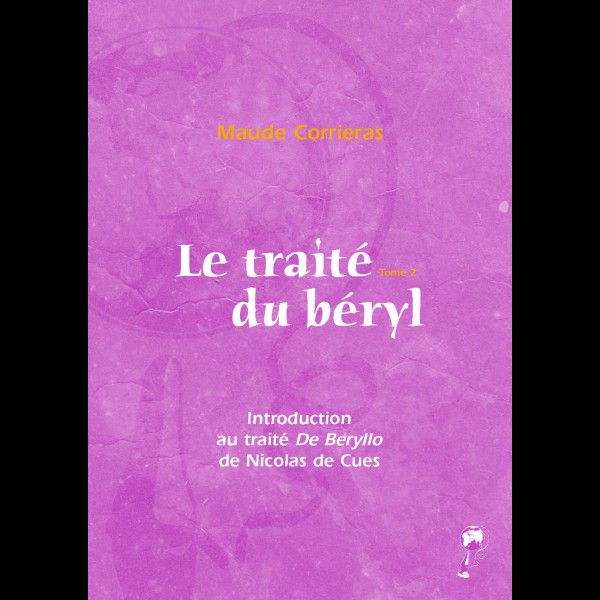
C’est d’ailleurs là où nous émettrons une petite réserve à l’endroit du commentaire de M. Corrieras ; il n’est pas tout à fait certain qu’avant 1458, « l’intellectus doi[ve] être entendu comme une regio, un lieu, où coïncident les opposés, et comme le principe, ou la racine, de la raison. La raison quant à elle, domine le monde des sensibles en l’ordonnant selon des règles et règle le langage : sa puissance se manifeste dans la science et la dialectique. »6 L’intellect ne nous semble justement pas localisable ni et encore moins spatialisable, sinon en un sens extrêmement métaphorique qui pourrait égarer le lecteur car ce dont il permet la conciliation ne relève en aucun cas d’un cadre local.
Quoi qu’il en soit, ce que le béryl propose, dans la continuité des œuvres précédentes, c’est de trouver un outil pour penser au mieux in concreto cet intellect qui dépasse toutes choses et dont la raison même est un produit partiel. « Au-delà de la signification purement formelle de l’utilisation de métaphores par Nicolas de Cues pour se dégager de l’aspect usuel du langage, la métaphore même du béryl a une signification intrinsèque fondamentale : bien davantage encore que toute métaphore, elle fonde le principe de la connaissance comme vision. En effet, si elle désigne par sa forme un détournement de la connaissance rationnelle pour un mode de connaissance particulier, la métaphore du béryl désigne également cette nouvelle méthode de par son fond. »7 Mais s’il y a « nouvelle méthode », encore faut-il comprendre d’où procède sa nécessité, et examiner à quel problème philosophique elle répond. C’est précisément à cela que sert le commentaire de Maude Corrieras, en ceci qu’il indique tous les points précis qui justifient la rédaction de ce nouveau traité, à partir des problématiques non résolues – ou imparfaitement résolues – des textes anciens. Le commentaire crée ainsi un réseau de correspondance entre les différents ouvrages permettant de comprendre en quoi le traité Du Béryl ne se contente pas de répéter les traités antérieurs et comment il résout à nouveaux frais des difficultés qui ont émergé en amont du texte.
Maude Corrieras propose ainsi de convoquer le De Idiota (1450) afin de revenir aux sources du problème ; dans ce dialogue enlevé et vif, le Cusain rappelle que l’intellect « qui ne goûte pas à la claire sagesse est comme l’œil dans les ténèbres. Il est en effet œil, mais il ne voit pas, parce qu’il n’est pas dans la lumière. Et puisqu’il est privé de la vie qui réjouit, qui consiste à voir, il est dans la tristesse et le tourment, et cela est plutôt une mort qu’une vie. Ainsi, l’intellect qui se tourne vers tout autre nourriture que la sagesse éternelle se retrouve en dehors de la vie comme enveloppé dans les ténèbres de l’ignorance [tenebris ignorantiae], plutôt mort que vivant. Et c’est un tourment sans que d’avoir l’être intellectuel et de ne jamais intelliger. Tout intellect, en effet, ne peut intelliger que dans la sagesse éternelle. »8 Là réside le problème central auquel fait face Nicolas : l’intellect n’intellige pas nécessairement, il peut être désœuvré ou, pis encore, dérouté, au sens propre. A cet égard, il devient impérieux d’imaginer une méthode permettant à l’intellect de se consacrer à sa destination initiale et naturelle, celle d’intelliger, donc d’aider l’intellect à intelliger dans la sagesse éternelle. Et c’est en cela que le traité Du Béryl est moins un énième traité métaphysique qu’un traité de méthode concrète destiné à apporter des solutions pour pallier le risque de mésusage de l’intellect. « Le traité Du Beryl dont l’intention est d’aider le lecteur à se fixer dans la coïncidence des opposés ne peut le faire que par l’exposé de la méthode, et par l’exemple du cheminement de la pensée vers la coïncidence des opposés. »9 Voilà ce que le commentaire de Maude Corrieras permet initialement de parfaitement saisir.
B : La question du reflet
La seconde vertu du commentaire de Maude Corrieras réside dans la grande clarté qu’elle introduit dans la théorie cusanienne du reflet et de la similitude. Cheval de bataille d’Hervé Pasqua depuis plusieurs années, la question du reflet ne cesse de mobiliser l’intelligence des commentateurs car elle se situe au centre de la pensée du Cusain. « D’un côté, écrit H. Pasqua, l’Être est participé mais ne participe pas, de l’autre, l’Un n’est pas participé et participe : il se « prête » en se reflétant dans chaque étant, qui est parce qu’il est un et qui n’est pas un parce qu’il est. Dans la pensée cusaine, il n’est pas question d’un Être divin participé par les étants créées qui recevraient par la création ex nihilo un acte d’être propre qui n’était pas « avant d’être ». Il s’agit d’un prêt, par lequel Dieu advient comme vision en même temps que tout le créé apparaît comme vu au sein de l’Un. L’Un s’anime, pour ainsi dire, en tant qu’Intellect et Forme des formes. »10 Dans ce texte de 1453, qui est peut-être le plus célèbre de Nicolas avec la Docte ignorance, l’auteur élabore une théorie très personnelle du reflet de l’Un où l’être vient perturber l’unité, où l’être titille l’Un et rend impossible l’unité de l’étant. Chaque étant reflète non pas sa cause créatrice mais bien plutôt l’Un qui, en tant que tel, ne peut pas être car, s’il était, il cesserait aussitôt d’être Un puisqu’il subirait en son sein la prédication qui en briserait l’unité.
Une fois compris que tout est jeu de reflets dans le cosmos du Cusain, il devient possible de penser l’ordre des choses selon un jeu de similitude. L’âme est la première similitude de l’intellect en l’homme ; c’est par elle que l’intellect se communique à la nature. L’âme a une double fonction : puissance d’animation du corps et connaissance sensible des choses. L’intellect humain ne peut rien connaître sans la puissance sensitive de l’âme mais c’est l’intellect qui est cause de toutes les choses dont il est le principe, donc des concepts qu’il se fait des choses. Une fois encore, Kant n’est pas loin. « Le « connais-toi toi-même » du temple de Delphes prend tout son sens ici. Il ne s’agit pas seulement de se connaître soi-même pour se connaître soi-même. De la connaissance de soi dépend la connaissance tout entière : celle des choses, celles de l’univers et celle de Dieu. »11 Cette importance cruciale du reflet génère une série d’analogies extrêmement ordonnées : « de même que l’intellect humain veille sur son corps en tant que similitude de lui-même, de même l’intellect fondateur veille sur l’univers en tant que similitude de lui-même. »12
Maude Corrieras explique fort bien également l’usage que propose le Cusain des Mathématiques, dont la vérité a son lieu en l’intellect humain – pour autant que l’on puisse qualifier l’intellect de lieu – puisque c’est l’intellect humain qui les crée ; les vérités mathématiques, chez Nicolas, ne sont donc pas éternelles mais produites par l’intellect humain, ce qui n’est pas inintéressant si l’on replace cela dans l’histoire de la pensée, notamment au regard de la pensée hégélienne. Mais quel est le statut de telles vérités créées par l’homme ? Ce dernier étant la similitude de Dieu, les vérités qu’il crée sont des similitudes de similitudes. Les mathématiques deviennent ainsi des « énigmes de la vérité »13 et la figure mathématique permet de sortir du monde purement rationnel régi par le principe de non-contradiction car on peut saisir, en particulier dans la ligne, que celle-ci est le principe unique de tous les angles formables ; on voit dans la ligne l’angle maximal en même temps que minimal. La figure de la ligne condense le mouvement par lequel la vérité se communique à l’être sous la forme de la similitude. « A travers la simplicité de la figure de la ligne, l’esprit attentif peut saisir l’infinie possibilité de déploiement des similitudes de la vérité dans l’être. »14 En clair, la ligne est le miroir énigmatique de la vérité. Sachons gré à M. Corrieras de rendre parfaitement intelligibles les spéculations parfois ardues du Cusain en matière mathématique, et d’en établir avec force le lien avec le fameux exemple du jeu du miroir où se démultiplie le visage. « Il s’agit ici d’une unité infinie qui doit se trouver dans une pluralité finie. Le rapport ne se fait pas entre une quantité et d’autres quantités, entre semblables et semblables, mais entre une unité indivisible non quantitative et sa présence dans la quantité, entre l’Un et ses images. Le rapport concerne la relation entre un principe et ses principiés. »15 Le principié voit dans le reflet non une image de lui-même mais la réalité dont il n’est qu’une image. En d’autres termes, à partir d’une image, il devient possible de connaître le principe de toutes les formes, ce que l’on pourrait appeler la Forme des formes puisque le principe infini se trouve dans chaque chose finie. « En intégrant la possibilité de la différence au sein d’un même genre, l’esprit humain accède à l’ensemble du genre dans sa multiplicité de formes. Chaque chose particulière se rattachant à un genre particulier de forme sera donc comprise dans l’intégralité de son être au moyen de la différence. »16
C : Aristote et Platon dans l’économie du texte
L’ultime vertu du commentaire de Maude Corrieras est de situer le propos de Nicolas de Cues au regard des thèses de Platon et d’Aristote. Ce dernier fait évidemment l’objet d’une réfutation lorsqu’il est question du principe de non-contradiction ; celui-ci ne peut être principiel que pour la raison et en aucun cas pour l’intellect qui le transcende en dépit d’un mésusage toujours possible. Non seulement cette critique n’est pas sans préfigurer Hegel – il faudrait à ce sujet creuser le rapport de la raison hégélienne à l’intellect cusanien afin de cerner ce qui peut être, sous certaines conditions, un approfondissement du refus de faire du principe de non-contradiction l’alpha et l’oméga de la pensée philosophique – mais elle s’enracine de surcroît dans les textes de Denys l’Aréopagite chez qui il trouve cette coïncidence des contradictoires qui rend caduc, pour l’intellect, le principe aristotélicien. Mieux encore, Maude Corrieras explique très bien le nerf de la critique générale adressée par le Cusain à Aristote autour de la notion même de principe : non seulement ce qui n’est pas toujours valable ne peut demeurer un principe, mais de surcroît la confusion que commet Aristote entre principe et forme est permanente. Par exemple, lorsque ce dernier explique que le courbe et le linéaire procèdent de deux principes différents, il commet une erreur majeure, celle de confondre la divergence formelle avec la distinction principielle. Du point de vue du principe, le courbe et le linéaire ne sauraient être distingués, une telle distinction n’ayant de sens qu’au niveau formel, puisque la ligne peut devenir courbe par incurvation. En somme Aristote se révèle incapable de s’élever au principe même des choses.
Plus fondamentalement encore, Aristote n’a pas compris les correspondances au sein de l’étant : la chaleur la plus petite est est la froideur la plus grande ; le froid n’est pas une privation de chaleur, la catégorie de privation est une aberration que déconstruit Nicolas patiemment, à partir de sa critique de la raison au profit de l’intellect comprenant seul les correspondances structurant l’étant. Aristote est ainsi voué à l’échec parce qu’il méconnaît la quiddité véritable des choses, il n’a pas vu que chaque être est dit être tel en raison de l’intention de l’intellect fondateur et non par la chose elle-même qui n’est qu’une configuration sensible d’un pincipe indivisible. « C’est, finalement, moins l’étude des choses elles-mêmes qui importe que l’étude de la façon dont on atteint le principe, même si la vision du principe est le stade ultime des différents degrés de la connaissance. »17 La quiddité ne se trouve pas dans la chose elle-même, elle ne s’y trouve qu’en tant qu’intention du créateur.
Il ne faudrait pas pour autant croire que Nicolas est un platonicien intégral ; il critique Platon qui croit que la nature de l’univers est nécessaire ; il ne voit pas la liberté de la création et s’illusionne en développant l’idée d’une Ame du Monde. Sur ce point très précis, il aurait peut-être intéressant que M. Corrieras développe davantage le rapport à Ficin ou, plus exactement, compare le rapport de Ficin et Nicolas à l’Ame du Monde, afin d’évaluer la pénétration d’un certain néoplatonisme dans leurs œuvres respectives. Cette absence n’enlève toutefois rien à l’intelligibilité du texte que propose le commentaire quant à la question de la participation : c’est à cause de cette dernière que Platon a cru que le Principe incommunicable pouvait être participé par toutes les âmes, alors même que Nicolas s’oppose très fermement à la participation au Principe divin par les êtres créés.
Conclusion
Ce commentaire constitue l’indispensable complément de la traduction proposée par Maude Corrieras du Béryl ; éclairant, limpide et précis, il donne de nombreuses clés aidant à l’intelligibilité de ce petit traité dont on eût pu, sans cela, se demander quelle était sa réelle utilité. La modernité du texte s’y révèle époustouflante, éblouissante même, souvent plus avancée que celle d’un Ficin ou même d’un Pic, notamment dans la critique menée d’Aristote, tandis que l’influence d’Eckhart se révèle à chaque instant et ouvre grande la voie grandiose de l’idéalisme allemand. En outre, ce texte si souvent apparenté au monde médiéval finissant apparaît déjà renaissant par sa liberté, sa fraîcheur, son audace, et la singularité de son entreprise. Laissons le mot de la fin à Maude Corrieras : « Dans cette technique de pensée pour atteindre le « bien connaître », Nicolas de Cues montre un optimisme inégalé à son époque dans la vision de l’homme et de ses pouvoirs de connaissance. C’est cette reconsidération de la place de l’homme au centre de la Création associée à la découverte de la coïncidence comme procédé universel pour la connaissance du monde, qui, ancrées au sein d’une technique de pensée « antique » – sous forme d’exercice spirituel – font précisément du De Beryllo une porte vers la Renaissance. »18
- Maude Corrieras, Le Traité du béryl, Tome II, Introduction au traité De Beryllo de Nicolas de Cues, Ipagine, 2012
- Nicolas de Cues, De la docte ignorance, III, 6, § 215, Traduction H. Pasqua, Payot, coll. Rivages poche, 2011, p. 249
- Ibid., § 217, p. 251
- Nicolas de Cues, Les conjectures, VI, § 25, Traduction Jean-Michel Counet, Les Belles Lettres, 2011, p. 22
- Ibid., VI, § 26, p. 24
- Maude Corrieras, op. cit., p. 20
- Ibid., p. 29
- Nicolas de Cues, Idiota de saptientia, § 13, Traduction Hervé Pasqua, PUF, coll. Epiméthée, 2011, p. 55
- Maude Corrieras, op. cit., p. 34
- Hervé Pasqua, Introduction au De visione dei, ICR, 2010, p. 16
- Maude Corrieras, op. cit., p. 59
- Ibid., p. 60
- Ibid., p. 63
- Ibid., p. 67
- Ibid., p. 73
- Ibid., p. 79
- Ibid., p. 111
- Ibid., p. 119








