Bacon est une figure décisive pour la modernité et pourtant, assez curieusement, il existe peu d’ouvrages en France le concernant. Il était donc grand temps que cette lacune soit comblée. Mickaël Popelard lui consacre une étude à la fois érudite et très agréable à lire1. Si tous les aspects de la pensée du philosophe anglais ne sont pas traités (en particulier, le rapport à l’expérience est un peu minoré par rapport à d’autres points eu égard à l’importance de la réflexion baconienne sur le sujet), l’ouvrage n’en constitue pas moins un contrepoint bienvenu à une certaine vision que l’on a du chancelier. En France en effet, le regard porté sur Bacon demeure marqué par la critique – injuste – de Koyré qui le présentait comme un « attardé » n’ayant pas saisi l’importance des mathématiques ainsi que le ferait après lui Galilée, et chose plus injuste encore comme un pur empiriste. Le livre de Mickaël Popelard propose une vision plus nuancée et plus exacte.
C’est d’ailleurs à la représentation que nous nous faisons de Bacon qu’est consacrée l’introduction. Popelard y note fort justement que celle-ci est cyclique et excessive : ainsi le 17ème siècle se revendique de Bacon et lui attribue toutes les qualités alors que la contemporanéité va plutôt le dévaluer. L’ouvrage est scindé en deux parties : la première est contextuelle et présente le paysage intellectuel de l’époque à commencer par la place accordée à la notion de science. La seconde a plus particulièrement trait à la pensée de Bacon et est essentiellement consacrée à La Nouvelle Atlantide dont l’auteur fait l’hypothèse qu’elle vient mettre en récit les préceptes quelque peu arides du Novum Organum.
A : Refonder le savoir
La première partie est véritablement passionnante. Parce que Bacon affirme la nécessité de refonder tout l’édifice du savoir étant donné qu’à ses yeux on a négligé les sens et l’expérience, Popelard entreprend de se livrer à un examen de la place de la science dans l’Angleterre de l’époque. Dans le premier chapitre, on y voit que l’humanisme s’y affirme au détriment de la science dont certains fustigent l’inutilité lors de la « bataille des arts » ; en effet, pour des auteurs comme Roger Ascham, héritier en cela de Pétrarque, la science est inutile voire néfaste ; elle ne libère pas et ne rend pas meilleur au contraire des humanités. On voit ainsi que le scientisme qui conclura un progrès moral du progrès scientifique a été précédé d’une autre idéologie qui faisait du latin, du grec, de la poésie ou de l’histoire l’alpha et l’oméga de l’humanité. En réalité ainsi que le note Popelard, cette critique de la science est l’effet de la concurrence que celle-ci commençait à jouer dans l’enseignement. En réaction, on verra ultérieurement certains disciples de Bacon louer les arts mécaniques et récuser la vaine philosophie alors que Bacon réévaluait les premiers sans dénigrer la seconde.
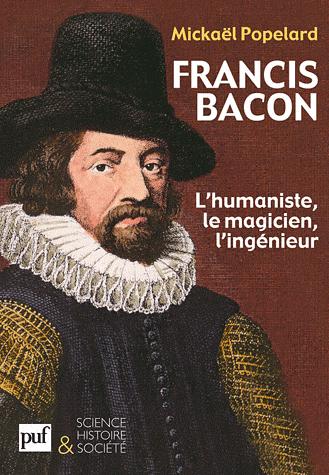
Le chapitre suivant revient sur les rapports complexes entre théorie et pratique. Popelard y défend l’idée d’un apport des praticiens aux savants. Il récuse ainsi le schéma descendant qui irait uniquement des savants vers les profanes ce qu’il qualifie de préjugé condescendant et de contresens rationaliste. Il est vrai que, précisément depuis Bacon et Descartes, on a tendance à faire de la technique la simple application de la science, ce qui laisse penser une primauté de la seconde sur la première. Mais ce faisant, on confond allègrement technique et technologie.2 Popelard nous rappelle que jusqu’alors prévalut une césure entre théorie et pratique en nous livrant quelques citations qui manifestent le mépris dans lequel tout ce qui relevait de la technique était tenu par les savants et inversement le peu de considération que les gens des métiers avaient pour les spéculations théoriques. Toutes choses qui occasionnaient un rejet de toute application pratique de la science, ce qui n’était pas sans poser de graves problèmes dans les domaines de la navigation et de l’arpentage. L’époque de Bacon va voir se jouer un rapprochement entre science, notamment mathématiques et artisanat ou négoce. De ce point de vue, il faut noter l’importance des travaux de vulgarisation qui permettent à cette frange de la population qui n’avait pas accès aux études savantes de pouvoir néanmoins s’y adonner. Avec succès et profit aussi bien pour eux-mêmes que pour l’avancée de la science.3 Car comme le note Popelard : « non seulement les ingénieurs, les arpenteurs, les marins sont capables d’améliorer leurs instruments, mais ils le font selon un ordre de raisons qui n’a rien du bricolage empirique et aveugle. »4
Le chapitre suivant dénonce un autre préjugé rationaliste : celui selon lequel la révolution scientifique constituerait un triomphe de la rationalité sur la superstition. De manière convaincante, Popelard montre que, d’une part, les deux ont cohabité et d’autre part que la magie n’est pas la négation de la rationalité ; en réalité les deux ne sont pas sans lien, il n’y a donc pas eu de césure brutale.5 La magie est en effet fondée à la fois sur le goût du merveilleux mais aussi sur des exigences philosophiques d’unité et de nécessité : « Il y a dans l’entreprise magique un désir de soumettre l’ensemble du monde aux règles de la raison : la magie n’est pas la négation du déterminisme mais plutôt son exacerbation. »6 Il faut au contraire noter la place importante de la magie qui imprègne toute la société, tant les classes populaires que les élites à la Renaissance. A cet effet, Popelard rappelle que les sciences et notamment les mathématiques furent souvent assimilées à de la magie voire de la sorcellerie.7 La véritable fracture ne porte donc pas sur la rationalité mais sur la légalité : « une ligne de partage oppose, non pas la science à la magie, mais les pratiques licites aux activités illicites. »8 On objectera quand même que qualifier Bacon de « magicien » est quelque peu osé car ce dernier se montre extraordinairement critique envers la magie. En effet, il faut préciser que si Bacon accepte de parler de magie, c’est à condition de la « purger de l’arrogance et de la superstition », c’est-à-dire qu’il l’entend dans le sens très restreint de « productions des effets » c’est-à-dire dans la mesure où nous pouvons l’identifier à la technologie. La magie fait appel aux forces naturelles et promeut un idéal de maîtrise. Or c’est très exactement ce que souligne Bacon dans l’introduction du Novum Organum avec sa fameuse formule « On ne commande à la nature qu’en lui obéissant. » Il s’agit de détourner à son profit les lois qui régissent la nature d’où l’intérêt de la connaissance de celles-ci. La technique (qui veut les effets et vise l’utilité) doit s’allier à la science (qui connaît les causes).
B : La nouvelle Atlantide
La deuxième partie intitulée « La Nouvelle Atlantide et l’idée baconienne de la science » s’ouvre avec un quatrième chapitre qui peut paraître plus descriptif que critique. Par exemple, il ne remet pas en cause ce qui nous paraît le plus inacceptable : l’identification de la supériorité intellectuelle à la supériorité morale. Popelard y insiste sur la distance et le changement de perspective entre le Novum Organum et la Nouvelle Atlantide, le premier apparaissant plus démocratique que le second dans la mesure où chacun peut s’y livrer à la démarche scientifique. Le point crucial est donc la tension entre démocratie et aristocratie. Cette thématique des rapports entre savoir et pouvoir dont Bacon est l’un des principaux penseurs prend la forme de l’opposition entre démocratie et technocratie, la seconde tendant constamment à se substituer à la première.9
Le chapitre 5 porte sur le concept d’expérience dont il n’est pas exagéré de dire que Bacon a été le principal rénovateur. La Nouvelle Atlantide illustre l’opposition entre expérience active et expérience passive. On sait que Bacon est le premier à dénoncer l’empirisme pur qui consisterait à recueillir passivement des faits et qu’au contraire, il souhaite mettre la nature à la question selon une démarche systématique et ordonnée : l’histoire naturelle consiste à enregistrer les faits connus dans la nature aussi bien qu’à en susciter de nouveaux dans le cadre de ce que Bacon appelle la « Chasse de Pan ». Il y a donc deux étapes : celle de l’experientia vaga où le savant se fie au hasard et à son flair (sans que d’ailleurs Bacon précise clairement ce qu’il faut entendre par là) pour collecter des faits ; mais aussi celle de l’experientia literata (ou expérience guidée) où ce sont un certain nombre de procédés qui guident la recherche. Or curieusement, de nombreux auteurs continuent à faire de Bacon le promoteur d’une expérience qui ne résiderait que dans la cueillette de faits. Alors qu’il est fréquemment présenté comme un pur empiriste, Bacon prône tout au contraire l’union de la raison et de l’expérience tout au long de la démarche scientifique. Avec l’appellation de baconien pour désigner la collecte passive des faits, la postérité n’aura finalement retenu de Bacon que le moment de l’experientia vaga. Pourtant, s’il n’y a certes pas chez lui cet aspect pour ainsi dire subjectif des faits (ils sont bien découverts et non construits), il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont été décelés qu’à la suite d’une méthodologie qui interroge la nature en la considérant comme problématique. Popelard lui rend justice en quelques pages très éclairantes.
Le chapitre 6 porte sur les rapports entre action et compréhension en nous rappelant que chez le chancelier, l’horizon de connaissance demeure l’amélioration du sort de l’homme. La fin de l’ouvrage revient en effet sur la vocation de la science chez le chancelier anglais. On a souvent opposé la finalité pratique et la finalité théorique. Heidegger et quelques-uns de ses épigones en ont tiré profit pour condamner la science moderne. Heidegger par exemple conteste le caractère désintéressé de la science moderne qui se distingue par là de l’épistémè antique. Heidegger ne conteste pas la possibilité d’une contemplation désintéressée puisqu’il la reconnaît au savoir antique mais il la dénie à la science moderne. Les sciences de la nature ne visent plus un idéal théorétique mais sont dérivées d’une volonté de maîtrise technologique et d’appropriation de la nature : c’est le fameux « ar-raisonnement ». Mickaël Popelard en propose une vision plus complexe mais aussi sans doute plus correcte qu’il résume dans la formule suivante : « la science baconienne vise à agir sur le monde pour le comprendre et à le comprendre pour agir sur lui. »10 En effet, si la science a indéniablement chez Bacon une finalité pratique, il serait sans doute exagéré de la réduire à celle-ci. Lorsque Bacon dénonce les expériences fructueuses au profit des expériences lumineuses, ce n’est pas seulement parce que ces dernières en fin de compte se révèleront plus profitables11 mais aussi parce qu’il y a une certaine noblesse dans la pure compréhension. La capacité à agir n’est que la preuve que l’on a compris. En ce sens l’action est autant moyen que fin. Il n’est donc pas inopportun de parler d’un certain désintéressement.
Au total, on a là un ouvrage à la fois riche et agréable dont l’un des principaux mérites est de rendre manifeste les tensions qui pétrissent la pensée du chancelier philosophe : tension entre secret et transparence, entre démocratie et aristocratie, entre l’action et la compréhension. Et plus généralement un contrepoint bienvenu à une historiographie simplificatrice avide de révolution et de césure. L’ouvrage de Popelard restitue une vision plus nuancée, plus complexe. On pourra peut-être déplorer qu’il fasse quelque peu l’impasse sur la dimension politique du chancelier, lequel fut quand même bien avant Locke ou Bayle le promoteur d’une tolérance annonciatrice du libéralisme politique12 mais il est vrai qu’on ne peut pas tout traiter.
- Mickaël Popelard, Francis Bacon. L’humaniste, le magicien, l’ingénieur, PUF, 2010
- Voir par exemple Dominique Lecourt, Humain, post humain, Paris, P.U.F., 2003, pp. 40-44 pour une dénonciation de cette confusion.
- Pour l’importance de ces mathématiques pratiques, on se reportera aux travaux de Maryvonne Spiesser.
- Mickaël Popelard, Francis Bacon. L’humaniste, le magicien, l’ingénieur, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 89.
- C’est cette idée d’une césure que l’on retrouve par exemple dans la conception de « pensée magique » d’un Lévy-Bruhl, conception dont Raymond Boudon a montré les limites dans L’art de se persuader. Il y a une certaine paresse à disqualifier une pensée comme « magique » parce qu’elle n’obéit à nos canons. Les gens ont bien souvent des raisons objectivement bonnes de se tromper.
- Mickaël Popelard, op. cit. p. 140.
- On peut par exemple rappeler la violente diatribe du père Caccini à l’encontre de Galilée dans laquelle le peu subtil dominicain dénonçait « l’art diabolique des mathématiques. »
- Mickaël Popelard, op. cit. p. 108.
- On pourra sur ce point se reporter au récent petit essai de Jacques Rancière, La haine de la démocratie. L’actualité ayant montré de manière cinglante qu’un gouvernement qui souhaite faire passer une mesure la parera des atours de la nécessité scientifique (fût-elle aussi fragile qu’en économie) puisque, selon le mot d’Aristote, on ne délibère que du contingent. On parlera donc de « pédagogie », d’« explication » des mesures mais non de leur discussion.
- Mickaël Popelard, op. cit. p. 215 n1.
- Ce qui est d’ailleurs parfaitement exact. L’un des arguments avancés pour défendre la recherche fondamentale contre la seule recherche appliquée est en effet que certains travaux dont on ne voit pas l’intérêt immédiat se révèleront finalement d’une grande utilité. C’est donc même d’un point de vue pragmatique véritable myopie que de délaisser la première au profit de la seule seconde, oubli du long terme pour le court terme. Les exemples de cette utilité de la recherche fondamentale abondent. On peut par exemple rappeler la réponse humoristique de Faraday au premier ministre Robert Peel lui demandant à quoi servaient ses recherches sur l’électricité : « Je ne sais pas, mais je parie qu’un jour votre gouvernement percevra des taxes dessus ».
- Cf. ses Essais et notamment « De la superstition ».








