Introduction
Cette réédition du livre Pour l’homme (1968) est introduite par Frédéric Fruteau de Laclos avec en clôture de l’ouvrage une étude sur l’œuvre de son auteur Mikel Dufrenne (1910-1995) par Circé Furtwengler. Dans la postface, Dufrenne résume l’objectif de son essai qu’il présente comme étant une esquisse à une philosophie « qui fasse encore place à l’idée d’homme », malgré le constat suivant :
« le génocide s’expédie aujourd’hui au Vietnam comme une affaire courante, et avec la bonne conscience d’une nation dont la puissance est simplement écrasante. Mais l’homme rencontre ou s’invente aujourd’hui une autre mort encore : là où le meurtre n’est pas consommé, il semble qu’on observe un suicide, ou d’une moins une abdication ; l’homme renonce à être homme (…) l’humanité qui a pris possession du monde naturel à force de consommer des hommes par la violence et le travail va-t-elle disparaître, ou va-t-elle se sauver en sauvant l’individu ? » (p 295 sq)
On le voit avec ce cri d’alarme – même si ce livre n’a pas de visée ou d’orientation politique explicitement déclarée – l’enjeu n’est pas celui d’une simple joute théorico-universitaire ; et faisant fond sur ce contexte, Dufrenne décide d’en décrypter les soubassements philosophiques et pratiques, et d’ouvrir ainsi à ce qu’il appelle de ses vœux de « nouvelles chances » humaines.
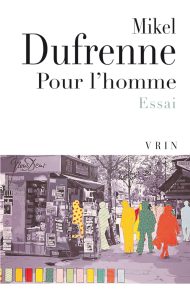 Selon ces perspectives, l’ouvrage se compose donc de deux parties : l’une critique dans laquelle il dénonce les philosophies excluant l’homme dans lesquelles Dufrenne inclut celles de Heidegger, Foucault, les formalistes analytiques anglo-saxon, les structuralistes, Althusser, Levi-Strauss ou encore Lacan. Puis s’ouvre une seconde partie dans laquelle Dufrenne développe les principaux éléments de sa philosophie – pensée que l’on peut qualifier de « naturaliste » – dont l’homme serait le point de réflexion essentiel, l’articulation indispensable et nécessaire.
Selon ces perspectives, l’ouvrage se compose donc de deux parties : l’une critique dans laquelle il dénonce les philosophies excluant l’homme dans lesquelles Dufrenne inclut celles de Heidegger, Foucault, les formalistes analytiques anglo-saxon, les structuralistes, Althusser, Levi-Strauss ou encore Lacan. Puis s’ouvre une seconde partie dans laquelle Dufrenne développe les principaux éléments de sa philosophie – pensée que l’on peut qualifier de « naturaliste » – dont l’homme serait le point de réflexion essentiel, l’articulation indispensable et nécessaire.
Mais avant cela, nous sommes introduit à cet auteur un peu oublié selon l’horizon dans lequel s’inscrivait alors sa pensée à l’époque. Mikel Dufrenne n’était pas réduit à la seule phénoménologie française, mais également à des recherches plus personnelles issues de ses amitiés avec des auteurs aussi éloignés que Ricoeur ou Deleuze. On retrouve aussi, notamment dans les derniers chapitres de cet essai, un motif fortement nietzschéen ayant prétention à « proposer des solutions conceptuelles pour les temps à venir » (p 9). Quand par ailleurs Frédéric Fruteau de Laclos parle de concept dans une perspective nietzschéenne, il pense aussi à l’influence probable de Deleuze et ce qu’il appelle le « vitalisme » de Dufrenne, pour lequel « la négation n’est pas première », tout en prenant dans l’ouvrage Pour l’homme la forme d’une réaction et opposition au structuralisme sous toutes ses formes.
Ainsi, étant donné les imprégnations monistes merleau-ponciennes et le dualisme sartrien qu’il veut « conjuguer » (cf. note 2 p 202) ou mettre en synergie dans sa pensée, Dufrenne veut échapper d’un côté au « règne de la structure », tout en critiquant également, dès le premier chapitre, les dépassements heideggeriens :
« les perspectives convergent et se recoupent dans un rejet partagé du vécu des pensées de l’existence qui sont fondamentalement des philosophies de l’homme : le Dasein heideggerien est plus profond que toute conscience, le concept scientifique plus essentiel que toute détermination vécue. » (p 16).
Avec ce genre de présentation qui revient très souvent sous la plume de Dufrenne, se posent alors pratiquement sur le même plan la recherche d’une origine du Logos avec celle d’une épistémologie logique qui pourrait « accrocher sa charrue à cette étoile » (p 16), rejetant alors « l’histoire concrète des hommes » (p 17) : les deux démarches si apparemment étrangères deviennent ainsi solidaires par leurs dépassements et mises au second plan de l’homme. Mais si Dufrenne dénonce ces conséquences, il n’interdit cependant pas les dépassements s’ils sont corrélatifs d’un retour de l’homme à l’homme puisque pour Dufrenne, la ligne directrice de ce retour serait celle du « poétique ». Ce poétique n’est cependant pas un vague élan pseudo-romantique, mais une reprise du fond de la Nature même – et ici l’apport de Schelling est revendiqué par Dufrenne – par un approfondissement du transcendantal apte à « sauter » au transcendant (p 18sq). On atteint alors par la poïetique de la Nature en l’homme l’expression « lourde d’un monde » (p 19). Ainsi, l’humanisme qu’appelle Dufrenne est un « naturalisme achevé » (p 20), c’est-à-dire une forme de prolongation nietzschéenne qui affirme la pluralité et la multiplicité (p 23) – mais aussi, en un sens, il reconfigure la réflexion husserlienne sur la « Mannigfaltigkeitslehre », la théorie des multiplicités – chère à Deleuze -, cette « théorie des théories ». Alors, l’homme est surmonté en tant que fin (p 23) qui découvre en soi le tout Autre – et ici Frédéric Fruteau de Laclos souligne l’influence de Lévinas mais aussi évidemment Kant comme nous en aurons d’ailleurs la preuve à la lecture des derniers chapitre de ce livre – avec l’étrangeté intense des vies des vivants dans un Devenir deleuzien que Dufrenne veut cependant équilibrer par la responsabilité morale lévinassienne.
L’introduction s’achève sur la lecture que fit Dufrenne de cette ouverture vers l’élan créateur néo-bergsonien d’un Canguilhem en épistémologie, mais aussi de André Leroi-Gourham, ce « défenseur d’une « archéologie » autrement plus concrète et consistante que celle inventée par Foucault » (p 26).
Nous avons donc à présent à entrer dans cet essai de Dufrenne, cet auteur « à tous égards « atypiques » » (p 27), et d’évaluer à froid la teneur des critiques et la promesse de ses réflexions.
- Partie critique sur Althusser
 L’avant-propos de Dufrenne commence ainsi : « cet essai se propose d’évoquer l’anti-humanisme propre à la philosophie contemporaine, et de défendre contre elle l’idée d’une philosophie qui aurait souci de l’homme » (p 31). Là-dessus, Dufrenne indique que « le mot » anti-humanisme apparaît chez Althusser, auteur qui reviendra à la toute fin de la partie critique et dans les premiers chapitres de sa partie « positive ». On nous permettra ici d’effectuer une petite incise historique.
L’avant-propos de Dufrenne commence ainsi : « cet essai se propose d’évoquer l’anti-humanisme propre à la philosophie contemporaine, et de défendre contre elle l’idée d’une philosophie qui aurait souci de l’homme » (p 31). Là-dessus, Dufrenne indique que « le mot » anti-humanisme apparaît chez Althusser, auteur qui reviendra à la toute fin de la partie critique et dans les premiers chapitres de sa partie « positive ». On nous permettra ici d’effectuer une petite incise historique.
Si Althusser évoque effectivement le problème de l’humanisme d’un point de vue marxiste dans son ouvrage parut en 1963, Pour Marx, – dont le titre choisi par Dufrenne semble en écho direct – ce ce fut lorsque la propagande politique de l’URSS se déclara faite « au nom de l’homme » (Cf. Pour Marx, les éditions sociales, p 227). A cela Althusser confirme que si ce concept apparaît effectivement dans les œuvres du jeune de Marx, notamment le Manuscrit de 1844, il est ensuite reconfiguré en tant que concept idéologique, lequel, s’il a sa nécessité sociale et une fonction pratique, n’a pas de valeur théorique, c’est-à-dire de fonction pour « connaître quelque chose de l’Homme » (Ibid., p 236).
Ainsi, l’humanisme repose sur deux postulats dénoncés par Marx dans la sixième Thèse sur Feuerbach que Althusser résume de la façon suivante : « 1. qu’il existe une essence universelle de l’homme ; 2. que cette essence est l’attribut des « individus pris isolément » qui en sont les sujets réels » (p 234). Marx critique alors ces positions à l’aide de nouvelles conceptions dites « matérialistes », c’est-à-dire « une théorie des différents niveaux spécifiques de la pratique humaine dans leurs articulations propres, fondées sur les articulations spécifiques de l’unité de la société humaine » (p 235sq), où la compréhension se joue non plus sur les concepts de sujet-objet, mais les rapports et les forces de productions. L’humanisme perd ainsi ses prétentions théoriques, mais pas sa force idéologique et ses fonctions sociales en tant que représentation du monde : ainsi, « dans l’idéologie, les hommes expriment, en effet, non pas leurs rapports à leurs conditions d’existence, mais la façon dont ils vivent leur rapport à leurs conditions d’existence » (p 240). Ce rapport est idéologique parce qu’il est une surdétermination du réel qui ne modifie le réel qu’en tant que vécu, comme pure justification imaginaire se rapportant au réel, qui cependant reste inadéquat et ne permet pas de connaître le réel : c’est là le fond de l’anti-humanisme de Marx selon Althusser.
Si donc la critique de Dufrenne peut porter, c’est qu’elle prétend parvenir à montrer la valeur théorique des concepts que dénonce le commentaire de Althusser sur Marx, c’est-à-dire la valeur de la « conception empiriste-idéaliste du monde » (p 234) ; mais là-dessus, après la partie critique de Pour l’homme, Dufrenne fonde pourtant son propos positif selon les mêmes positions conceptuelles dénoncées par Althusser en énonçant les principes suivants : « l’homme est au monde comme partie du monde, et comme corrélat du monde, comme sujet empirique et comme sujet transcendantal » (p 171).
Certes, on peut faire la distinction entre « essence » et « nature » comme l’indique avec pertinence l’étude de Circé Furtwangler (cf. p 331), mais les ressorts et les positions nous semblent ne pas pouvoir réellement faire pièce aux conséquences d’un humanisme que Althusser dénonçait essentiellement contre les idéologues de la politique de l’URSS. Le point que reconstruit Dufrenne dans sa critique de Althusser est ce qu’on pourrait nommer une sorte de clôture théorique, laquelle résume pratiquement tout l’ensemble des critiques faites par ailleurs aux autres auteurs :
« Il semble que pour Althusser, quand « on est dans la connaissance », on n’en puisse sortir, pas plus qu’on ne franchit jamais la clôture du langage selon une certaine philosophie ; en sortir, ce serait « précipiter la théorie de l’histoire dans l’histoire réelle…, confondre donc l’objet de connaissance avec l’objet réel… : chute dans l’idéologie empiriste » (Cf. Lire le Capital, II, p 94). Ainsi, de même que le concept efface en quelque sorte l’objet, le logique oblitère le chronologique. En condamnant l’historicisme, Althusser nous semble refuser l’histoire ; il jette le bébé avec l’eau du bain » (p 159).
On peut sur ce point répondre facilement avec ce qui est indiqué ci-dessus, puisqu’il est question des types de rapports et de la façon dont ils sont réellement vécus. Mais Dufrenne préfère y voir une exclusion par le théorique, ou du moins une mise à l’écart, une mise au second plan déjà risquée et suffisamment condamnable dans ses conséquences ; et il constate et resume des points de rencontre de divers auteurs de son temps « qui porte en bref sur la mise à l’écart du sens vécu et la dissolution de l’homme » (p 32) puis il s’en interroge systématiquement sur leurs raisons, ou plus exactement leurs énoncés.
- La critique de Foucault et du structuralisme
Nous en avons esquissé le motif avec Althusser, mais c’est avec Les mots et les choses que Dufrenne en trouve et en développe plus systématiquement les éléments paradigmatiques, lorsque l’homme devient un problème et un objet d’étude daté, « un événement dans l’ordre du savoir » au XIXème siècle (p 33). A cela, Dufrenne annonce ne pas vouloir répondre sur le terrain de l’histoire, bien qu’il indique tout de même en passant que depuis Pascal et Descartes, l’homme s’affirme à la fois corrélat du monde, tout en étant pris par ce même monde qui vient à la pensée, laquelle s’épanouira avec la conception critique kantienne d’un sujet se connaissant comme objet, la finitude étant alors simplement rapportée à elle-même comme le dit Foucault (p 34 sq). Dufrenne conclut ici :
« Quel que soit l’élément dans lequel elle se meut, la pensée de l’homme affronte toujours cette tâche épuisante d’avoir à revenir de la pensée au penseur ; tout ce qu’elle dit de l’homme, c’est un homme qui le dit ; et cet homme n’est homme que par ce qui n’est pas lui, par la vie en lui et la culture autour de lui » (p 35).
Dufrenne accepte donc ce déchirement, mais nous invite cependant à ne pas tomber dans l’évincement de cette pensée de « la relation de l’homme au monde » (p 37) qui, loin d’être un psychologisme, est la raison même de tous ces systèmes qui « prennent congé de l’homme ».
 Ici, qu’on nous permette là encore d’exposer rapidement quelques éléments de la démarche de Foucault pour mieux évaluer la portée des critiques de Dufrenne. La tentative foucaldienne nous semble être pourtant de retrouver les pratiques discursive et les modes d’implication du sujet dans les discours. Le style de cette recherche, Foucault le mentionne lui-même pendant un temps, est en partie structuraliste puisqu’il synchronise en ensemble différentes relations pratiques ou théoriques, assignant alors à l’activité philosophique d’effectuer le « diagnostique » de l’actualité. Il est évidemment probable qu’à travers le style même de cette méthode d’analyse, le problème de l’homme en tant que libre sujet conscient et auto-producteur est déplacé, voir gommé par ces ensembles, ou du moins effectivement mis à distance, puisque le point de vue élaboré n’est plus celui du « Je », mais du « Il y a » dans le système du Savoir (Cf. Dits et écrits I, p 543). Et ce n’est qu’à partir de cela que Foucault dénonce comme une illusion deux types d’humanisme : celui d’un Camus ou d’un Theilard de Chardin qui selon Foucault feignent de construire l’homme en tant qu’objet de savoir possible sans cependant affronter de problématique apte à se résoudre comme savoir ; et par ailleurs celui de l’humanisme dialectique de Hegel à Sartre, que Foucault cerne comme « philosophie du retour à soi-même, la dialectique promet en quelque sorte à l’être humain qu’il deviendra un homme authentique et vrai. Elle promet l’homme à l’homme et, dans cette mesure, elle n’est pas dissociable d’une morale humaniste. » (ibid. p 569).
Ici, qu’on nous permette là encore d’exposer rapidement quelques éléments de la démarche de Foucault pour mieux évaluer la portée des critiques de Dufrenne. La tentative foucaldienne nous semble être pourtant de retrouver les pratiques discursive et les modes d’implication du sujet dans les discours. Le style de cette recherche, Foucault le mentionne lui-même pendant un temps, est en partie structuraliste puisqu’il synchronise en ensemble différentes relations pratiques ou théoriques, assignant alors à l’activité philosophique d’effectuer le « diagnostique » de l’actualité. Il est évidemment probable qu’à travers le style même de cette méthode d’analyse, le problème de l’homme en tant que libre sujet conscient et auto-producteur est déplacé, voir gommé par ces ensembles, ou du moins effectivement mis à distance, puisque le point de vue élaboré n’est plus celui du « Je », mais du « Il y a » dans le système du Savoir (Cf. Dits et écrits I, p 543). Et ce n’est qu’à partir de cela que Foucault dénonce comme une illusion deux types d’humanisme : celui d’un Camus ou d’un Theilard de Chardin qui selon Foucault feignent de construire l’homme en tant qu’objet de savoir possible sans cependant affronter de problématique apte à se résoudre comme savoir ; et par ailleurs celui de l’humanisme dialectique de Hegel à Sartre, que Foucault cerne comme « philosophie du retour à soi-même, la dialectique promet en quelque sorte à l’être humain qu’il deviendra un homme authentique et vrai. Elle promet l’homme à l’homme et, dans cette mesure, elle n’est pas dissociable d’une morale humaniste. » (ibid. p 569).
Foucault s’ouvre alors à un horizon qu’il déclare « anti-humaniste » – bien que pour des motifs très différents de ceux de son maître Althusser – après un examen de l’apparition problématique de l’homme au XIXème, puis de ce que sa nécessaire disparition ouvre philosophiquement :
« il est moins séduisant de parler du savoir et de ses isomorphismes que de l’existence et de son destin, moins consolant de parler des rapports entre savoir et non-savoirs que de parler de la réconciliation de l’homme avec lui-même dans une illumination totale. Mais après tout, le rôle de la philosophie n’est pas forcément d’adoucir l’existence des hommes et de leur promettre quelque chose comme un bonheur » (ibid. p 571).
A cela, Dufrenne répond que Foucault est victime d’un mélange entre « réalité du savoir » et « objet du savoir », de même, sa « passion du système et la passion tout court » (p 76) offre à l’homme une apothéose, certes, mais pour le faire mourir de finitude ; en réalité, selon Dufrenne, « ce qui anime le philosophe, ce n’est pas la passion de savoir, c’est la passion de la vérité : il ne sait rien de plus que ce que tout le monde sait, mais il s’étonne de le savoir, il se demande comment c’est possible » (p. 165). Et c’est dans cette distinction que Dufrenne souhaite placer son propos après sa longue partie critique.
- Une réflexion sur l’homme possible
Nous indiquions plus haut que Dufrenne articule sa philosophie de l’homme en ses limites et possibilités avec le corrélat du transcendantal et de l’empirique (p 171) que Althusser lisant Marx dénonce. Pour Dufrenne, il s’agit cependant moins de principe que de pôles dont l’objectif est de « matérialiser le transcendantal » (p. 328 cité par Circé Furtwengler), et cela en conjuguant la forme dualiste et moniste d’un Sartre et d’un Merleau-Ponty comme mentionné plus haut. Ainsi, la réponse que Dufrenne fait à Althusser qui identifie réel à un « concret de la pensée », annexant l’objet au concept est de « dire que le concept, au lieu d’être l’objet, est dans l’objet : il ne le produit pas, ni ne l’aliène ; il est plutôt appelé par l’objet parce qu’il y est en quelque sorte déjà : l’a priori objectif, l’espèce l’individu, le genre la chose. » (p 176). Et Dufrenne de conclure plus loin, fort de sa distinction savoir/vérité :
« la connaissance ne trouve que ce qu’elle cherche, mais il arrive précisément qu’elle le trouve. Ainsi peut-on dire que le concept est dans la chose. Au reste, tout ce qu’on veut indiquer par là, c’est que le monde est tel que l’homme puisse être dans la vérité. Mais de ce rapport à la vérité, l’homme n’a pas toute l’initiative : il ne fait pas la vérité, il est dans la vérité, d’une part parce que le monde s’y prête, d’autre part parce qu’il est aussi dans l’erreur. » (p 182).
Ce que veut dire Dufrenne à partir de sa réexposition du transcendantal, c’est que la finitude humaine n’en est pas le fondement ou l’horizon, mais génère une expérience radicale qui révèle la conjugaison d’un être au monde tout en s’en extirpant essentiellement pour fonder l’activité même cette expérience en tant que Sujet.
Voici donc sur ce nœud que Dufrenne décide de parler du vécu de l’être au monde de l’homme. Et à partir de là, nous assistons à une série de reprises de Merleau-Ponty, Sartre et Lévinas avec lesquelles Dufrenne décrit et explicite l’idée de l’homme comme sujet libre mais corrélat du monde (p 204), rencontrant l’Autre dans cet imprévisible infinité, renvoyant elle-même à la transcendance humaine inaliénable. Le Sujet parlant qu’est l’homme oscille donc entre inscription de sens tout en participant à « l’inépuisable générosité de la Nature » (p 223).
L’enjeu étant simplement pour Dufrenne d’esquisser une philosophie de l’homme comme philosophie de la volonté qui se donne l’homme pour fin, ce qui signifie « vouloir les moyens de cette fin, qui ne sont pas donnés ; c’est vouloir tout ce qui permet à l’homme de s’accomplir. » (p 248 sq) mais également combattre l’inhumain.
Et c’est ici que s’ouvre l’important avant dernier chapitre de l’ouvrage de Dufrenne, « Philosophie et Éthique », dans lequel il dénonce à nouveau l’indifférence des philosophies du système comme le scientisme pour les questions morales.
A cela Dufrenne ré-expose rapidement les éléments déjà développés sur la reconnaissance de l’universalité, de l’Autre comme appel à l’infinité lévinassienne, ou bien encore, si l’on reprend Nietzsche, que l’homme a l’aptitude à « créer au-delà de nous-même » (p 258). L’universalité dont prétend parler Dufrenne n’est donc pas la creuse paralysie de belle âme, la tension d’un devoir-être jamais réalisée que comme l’interminable ascèse d’une attente, ou le réalisme prudent et calculateur qui se satisfait de ses limites et de ses traditions ossifiées ; au contraire s’ouvre, selon Dufrenne, une éthique de l’homme moins à la recherche de ses limites que de sa dé-finition en tant que capacité à se surmonter dans « l’infini horizon de ses actions » (p 261), et qui alors se défait de l’inhumain en affirmant son inconditionnelle condition.
Comme l’indique en commentaire Circé Furtwengler, il n’y a donc pas là de « téléologie » puisque rien n’est prédéterminé (p 345). L’homme lutte contre la dénaturation et en cela, il affirme sa dignité par son indépendance créatrice de possible : ainsi, la philosophie naturaliste de Dufrenne est-elle une philosophie de l’action, c’est-à-dire comme indiqué plus haut, une réelle poëtique, non pas re-production mais plongée originaire concrète selon la production de la Nature en l’homme avec l’espoir que, « pour le citoyen d’un nouveau monde, peut encore rayonner le feu divin de la beauté » (p 323).
Conclusion :
Si nous restons sceptique sur la portée réelle de certaines critiques sur le plan théorique et de certaines accusations de Dufrenne sur les conséquences de ces même théories ou pratiques théoriques, nous saluons cependant la force stylistique de ses reprises dans sa seconde partie, ainsi que sa profonde postface, « Les chances de l’homme aujourd’hui », sur l’état du monde, notamment ses réflexions sur la technocratie (p 297 sq), et surtout sur le pouvoir des machines sur le savoir et le non-savoir ; nous pensons notamment à ce passage : « Honneur à qui invente la machine à penser! Mais une fois fabriquée et programmée, il semble à l’ignorant que la machine pense toute seule. Et par une sorte d’étonnant feedback, cette machine qui d’abord mime la pensée en vient à servir de modèle pour l’explication de la pensée… » (p 300).
Mais là où nous restons circonspect est précisément sur son interprétation de ce transfert : « … car le fonctionnement de la pensée est réduit par certains philosophes au jeu anonyme de certaines structures qui, dans la matière même du cerveau, obéissent à des lois qu’elles finissent par représenter » (ibid.).








