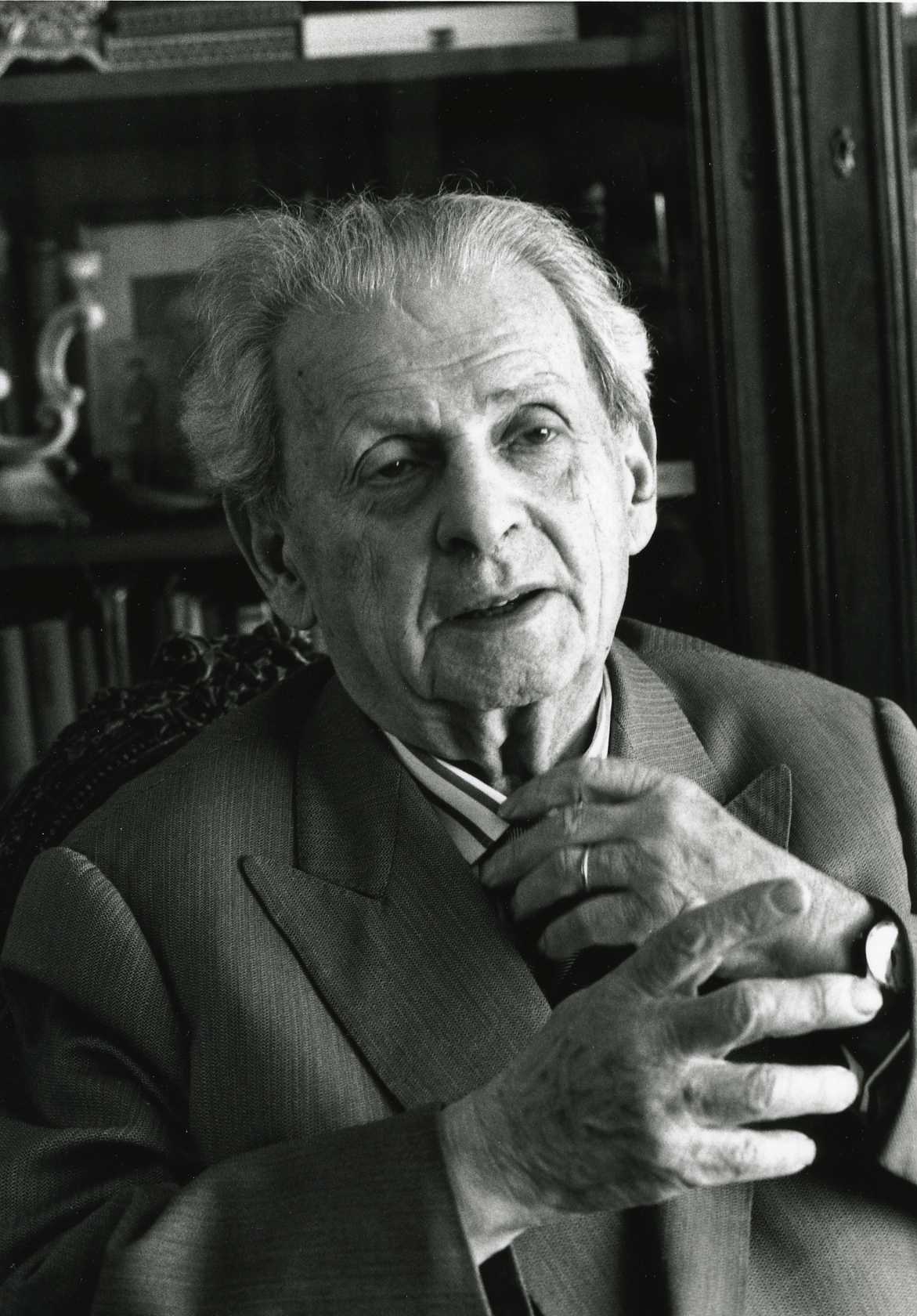Avec Arrachement et évasion : Levinas et Arendt face à l’histoire1, les auteurs proposent un recueil de contributions diverses, inégales en rigueur, mais toujours nourries de lectures sérieuses, ayant pour thème les notions d’arrachement et d’évasion mises en rapport avec l’histoire, dans la pensée de Levinas et d’Arendt.
I) L’introduction
L’introduction, rédigée par Mylène Botbol-Baum, émet une hypothèse pour éclairer le sens du titre du recueil, Arrachement et évasion : Levinas et Arendt face l’histoire : « le temps de la natalité et de la maternalité répond chez nos auteurs au temps de l’évasion et de l’arrachement de leur œuvre de jeunesse (1935-1940). Au-delà du débat entre lumières (arrachement, évasion, retrait) et anti-lumières (héritage, nation, identité) se construit à travers leur pensée une ontologie alternative du temps et de l’action. » (p. 7)
Cependant les termes, s’ils évoquent un détachement, une rupture, d’une condition, d’un lieu ou d’un objet à un autre, ne sont jamais clairement définis. D’autre part, l’introduction ne prend pas le soin d’indiquer le statut de ces termes. L’évasion, chez Levinas, a d’abord, dans l’ouvrage éponyme2, une définition et une fonction précise, elle est ce qui s’impose à celui qui fait l’expérience de l’être pur ; dans ce sens, l’évasion désigne un des premiers modes, une des premières façons pensées par Levinas pour sortir de l’être, et on peut effectivement envisager que d’autres formes de sorties (ou de tentatives pour sortir de l’être) soient associées à l’idée d’évasion, comme par exemple l’hypostase décrite dans De l’Existence à l’existant 3 comme arrachement à l’il y a. Aussi peut-on bien penser la légitimité et la nécessité de questionner ce geste lévinassien de sortie de l’être et de l’ontologie, à l’aide de ces deux mots, mais encore faut-il mettre au jour le lien entre cette quête d’un arrachement à l’être et l’histoire. Il en va de même pour la pensée d’H. Arendt, dont on voit bien qu’elle peut se donner à lire au moyen d’une réflexion sur l’arrachement et l’évasion. La natalité, à laquelle on pense d’abord, peut se penser comme un arrachement au déterminisme et à la nécessité pour introduire du nouveau, de l’imprévisible et de l’inouï. Mais à quoi, face à l’histoire, la pensée arendtienne requiert-elle que nous nous arrachions ? De quoi d’historique devrions-nous, pour elle, nous évader ? Autrement dit, si on voit bien que l’arrachement et l’évasion peuvent être des termes ou des motifs par lesquels on peut analyser la pensée de ces auteurs et mettre en perspective leur commune tentative de s’arracher à la reproduction du même, en faisant réfléchir sur l’Autre (Levinas) ou la pluralité (Arendt), c’est le rapport à l’histoire qui peut poser problème et que l’introduction n’éclaire et ne justifie que trop peu.
En effet, quelques jalons sont posés pour rapprocher la pensée de ces deux auteurs : l’idée, d’abord, d’un arrachement à une certaine compréhension du temps que Mylène Botbol-Baum discerne à travers un commun rapport au temps chez Proust, conçu comme permettant de rendre compte du « désir d’évasion du temps parménidien » (p. 9). Et en effet, la remarque est intéressante : « C’est dans la rupture avec une temporalité sans autrui que naît la nécessité de l’arrachement au temps perdu, dans « des relations où autrui demeure à jamais autre » qui crée une empathie entre la pensée des deux auteurs. Ils dénoncent un temps où l’on ne naît pas. » (p. 10). Et effectivement, la natalité ou la fécondité (chez Levinas) peuvent être mises en relation avec le temps 5 atteste d’une réflexion de Levinas sur le temps à partir de l’Eros, d’autrui, de la fécondité et de la paternité.[/efn_note]. Comme le remarque avec justesse Mylène Botbol-Baum, « la vision de la fécondité chez Levinas est en tension avec le besoin d’évasion, car si la naissance est pure passivité la fécondité, elle, est ouverture à autrui, alors que le visage, lui, n’est pas expérience mais « sortie de soi ». Ce mouvement est contraire au mouvement de compréhension et de connaissance qui suppose un mouvement vers soi. » (p. 11). Parménide est aussi évoqué comme l’initiateur d’une dialectique avec laquelle il faudrait rompre, par un geste d’arrachement et d’évasion. Sans doute faut-il comprendre qu’Arendt et Levinas s’inscrivent tous deux contre une tradition philosophique privilégiant le même et l’Un sur l’autre et la pluralité. Dès lors, leur pensée aurait en commun de vouloir battre en brèche « la pensée de la clôture d’Heidegger » (p. 7). Parménide et Heidegger seraient ainsi les deux termes d’une tradition qui emprisonnerait d’une certaine façon la pensée dans l’un et le même et, il faudrait, pour libérer la pensée, s’arracher à cette identité – pour penser véritablement par exemple la pluralité et l’altérité.
Là encore, la perspective est pertinente, mais qu’en est-il de l’histoire ? La mention de l’histoire ne renverrait-elle alors qu’à l’histoire de la philosophie et de la pensée ?
Il est aussi fait mention du fait qu’ils ont tous deux suivi l’enseignement de Husserl, et qu’ils critiquent l’ontologie heideggérienne qui les avait marqués. D’Auschwitz il est également fait mention, mais il nous semble que la principale lacune de l’introduction, par ailleurs réussie, c’est de ne pas faire un point plus précis sur le rapport entre leur judaïsme (ou leur judaïté) et leur contemporanéité avec la Shoah 6 et les termes choisis pour guider la réflexion (évasion et arrachement), car il semble difficile d’envisager avec rigueur leur rapport à l’histoire sans examiner ces dimensions. Or l’auteur ne consacre que quelques lignes à cette question. L’introduction se contente ainsi de juxtaposer une réflexion sur l’arrachement à l’ontologie et à la tradition philosophique de l’identité et la factualité historique, sans peut-être assez chercher à penser le lien idéel qui justifierait que s’arracher à l’ontologie et au modèle de l’unité/identité est une façon de s’évader d’une manière de penser qui a laissé survenir Auschwitz. Autrement dit, il aurait peut-être été souhaitable de questionner le lien entre fait historique et idée d’arrachement.
II) « la vraie vie est absente »
Dans la première contribution, « « la vraie vie est absente » 7Levinas, l’être au monde et la question du sens », Fabio Ciaramelli remarque que Levinas cite Rimbaud tout de suite après la préface pour le corriger. Alors que Rimbaud dit que « nous ne sommes pas au monde », Levinas soutient le contraire « Mais nous sommes au monde ». Chez Rimbaud, remarque l’auteur, la phrase renvoie à une perte du monde dans le délire. En revanche, chez Levinas, nous sommes au monde et c’est pour cette raison que la vraie vie est absente. Le « désir métaphysique », cette « tension inapaisable visant l’altérité radicale » qui est l’un des thèmes majeurs de Totalité et infini « naît précisément de ce décalage ou de cet écart entre « l’être-au-monde » et l’absence de la « vraie vie » », comme l’écrit Fabio Ciaramelli (p. 14). Dans ce décalage, remarque encore l’auteur, naît l’altérité radicale dont vit le désir humain, dans sa différence irréductible d’avec les besoins.
F. Ciaramelli reconstruit minutieusement la présentation lévinassienne de la pensée de Heidegger. Contre l’idée d’un monde conditionné par l’existence du Dasein, il faut penser le monde comme un « espace d’extériorité à partir duquel seulement peut avoir lieu, au sein de l’existence en général, la position de l’existant singulier chaque fois déterminé » (p. 18). Levinas montre que l’existence est antérieure au monde dans la mesure où quand le monde s’écroule, ne reste ni la mort ni un hypothétique moi, mais le « fait anonyme de l’être »8. F. Ciaramelli montre ainsi que « l’existant humain émerge d’un flux verbal anonyme – l’être ou l’existence en général – qui l’entoure et l’accable, mais dont il lui est toutefois possible de s’arracher de par l’assomption personnelle de l’acte d’être. Dans cette possibilité d’arrachement, le monde joue un rôle fondamental. » (pp. 18-19).
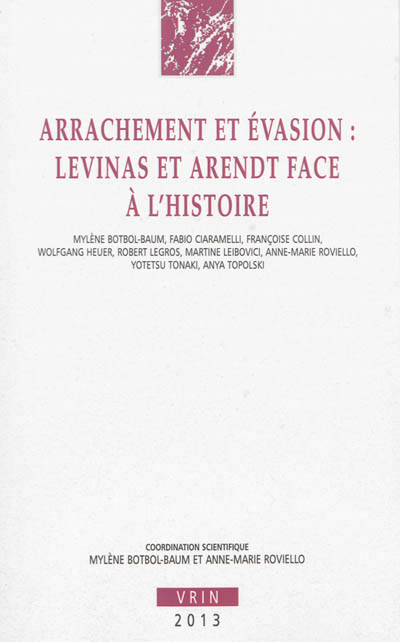
En effet, pour Levinas, c’est par le monde que l’existence peut s’arracher à l’absurde, c’est-à-dire à l’écoulement de l’il y a, de déroulement impersonnel de l’être. Quelque chose de l’ordre de l’intention lie l’existant au monde ; le monde n’apparaît donc pas comme quelque chose de toujours déjà là, mais comme ce que l’existant doit conquérir pour rendre possible le sens, pour sortir de l’absurdité du règne de l’il y a. L’auteur tire de cette analyse du rapport de l’existant au monde la conséquence que « l’absurde demeure toujours une possibilité ou un risque qui entoure l’existence » (p. 22), ce qu’il illustre avec pertinence en rappelant le « nous n’étions plus au monde » 9 prononcé par le prisonnier que le regard des autres hommes, des « hommes libres » déshumanisait. L’auteur met en avant l’idée que « l’arrachement au monde » est la menace qui plane au-dessus de l’humanité dans la mesure où cette dernière est irréductible à une simple survie ou à une existence quasi-animale. Sans le monde, l’existant reste rivé à l’être, insensé et absurde et manque, semble-t-il à sa vocation proprement humaine. Aussi si la vraie vie est absente quand nous sommes au monde et que nous sommes capables de nous arracher à l’il y a, cela ne veut pas dire pour Levinas que notre vie serait une diminution ou une déchéance de l’être, mais bien plutôt que c’est à un en-dehors de l’être qu’il faut mesurer l’existence.
III) « Liberté justifiée et juste pluralité »
Martine Leibovici invite à ne pas minimiser le politique chez Levinas au profit de l’éthique, ni l’éthique chez Arendt au profit du politique. Selon J. Taminiaux 10, comme le rappelle l’auteur, Levinas et Arendt, reformulent tous deux le sens qu’ils accordent à la liberté, contre ce que l’auteur identifie comme le libéralisme hobbesien et ont aussi en commun une « interrogation sur le totalitarisme nazi ».
Une première réflexion sur l’arrachement prend pour point de départ la sortie de l’être et l’individuation dans la pensée lévinassienne, pour laquelle existe un « besoin profond de sortir de l’être » 11. La première tentative, avortée, est une sortie vers le soi. Mais devant cet échec, Levinas essaye une nouvelle tentative de sortie en débordant le moi vers autrui. De l’évasion apparaît ainsi comme une réponse à l’hitlérisme caractérisé comme « être-rivé », comme un enchaînement de l’homme à son corps biologique, comme impossibilité de se soustraire à une représentation. Dès lors, l’hitlérisme est compris comme ce qui met en question les principes de la civilisation occidentale. Pour lutter contre cela, il faut « désamorcer » toute forme d’enchaînement, en tenant l’enchaînement pour réduction d’un mouvement qui va vers l’autre à un retour à soi. Il nous faut donc nous évader de l’être qui nous étouffe ou nous angoisse. Comme l’écrit Levinas dans De l’évasion : « l’être n’apparaît pas seulement comme l’obstacle que la pensée libre aurait à franchir (…) mais comme un emprisonnement dont il s’agit de sortir. » 12 Aussi l’auteur lit-elle, par rapport à l’il y a, l’avènement de la conscience ou du moi comme une première forme d’arrachement à l’être. Par exemple, face à insomnie comme veille de l’être, l’endormissement est « évasion en soi » 13, séparation de l’être vers une intériorité. Dans Totalité et infini, l’individuation qui arrache à l’anonymat de l’être se trouve dans l’indépendance du soi. Se penchant plus précisément sur cette indépendance du moi et sur la liberté qu’elle semble rendre possible, l’auteur établit que Levinas comprend la liberté comme fragile et menacée, menacée non pas d’abord par les autres, mais par la politique, comme l’illustre la société totalitaire. Il faut des droits comme les droits de l’homme, qui « excluent par définition toute totalisation puisque, de leur point de vue, la multiplicité des personnes est « une multiplicité non additionnable d’êtres uniques » 14. Mais, souligne l’auteur, « cette « multiplicité non additionnable » ne suffit pas pour Levinas, car elle ne permet pas de penser la relation entre les êtres uniques. De là découle une critique du libéralisme : si les personnes sont des moi’s, elles sont aussi sans relation les unes avec les autres, elles peuvent se juxtaposer mais se pose alors la question de la nature du lien qu’elles peuvent nouer entre elles. S’évader en soi, c’est par exemple, rentrer chez soi pour satisfaire ses besoins et éprouver du contentement. Lorsque l’auteur parle du « libéralisme », qu’elle associe au nom de Hobbes, sans doute faut-il le voir comme la tendance politique à protéger les individus les uns des autres au moyen d’un Etat.
Certes, un tel modèle permet de désamorcer la crainte d’autrui, et, si les lois sont justes, de vivre replié dans son chez soi. A ce titre, on pourrait penser que ce « libéralisme » offre des garanties, des droits, aux individus, en particulier celui de disposer librement de leur vie privée, mais ce qui manque à un tel type de société, c’est qu’il ne fait pas droit à l’importance des relations entre des individus toujours uniques, qu’il se contente de juxtaposer des individus les uns avec les autres, soumis à une même loi, sans penser le rapport et les interactions entre ces individus, qui sont pour Arendt et Levinas constitutifs d’une existence authentique.
L’auteur montre alors la commune opposition des deux auteurs à Hobbes. D’après Levinas, contre Hobbes, en plus de la nécessaire protection de la liberté, l’Etat doit s’ordonner à la fraternité, formulation politique du thème éthique de la « non-in-différence » à autrui. Arendt pense la protection et la reconnaissance des libertés civiles comme une condition nécessaire, mais non suffisante de la liberté politique. Elle reproche à Hobbes de se contenter de construire la notion d’homme dont le Léviathan a besoin et qui traduit les attentes de la bourgeoisie de son époque. En faisant en sorte que les affaires publiques soient réglées par l’Etat pour que la compétition entre les hommes puisse se déployer, Hobbes ne laisse aucune place pour les notions de solidarité et de responsabilité qui lient les hommes à leur prochain. Levinas et Arendt partagent ainsi l’exigence de ne pas réduire la politique à une solution au problème : comment vivre en paix en ayant la possibilité de faire chez moi le plus chose possible sans être menacé par autrui ? (autrui étant alors celui qui n’aurait pour la pensée politique que le rôle de l’agresseur, voire du partenaire de l’échange).
Une objection semble alors poindre : si on considère que les totalitarismes sont une forme intense de la politique et qu’ils ne reconnaissent pas les droits de l’homme, on risque de penser que moins il y a de politique, plus il y a de liberté. Et donc, de faire du libéralisme une chose très bonne. Mais en réalité, les totalitarismes visent à éliminer la liberté humaine et la spontanéité qu’Arendt considère comme l’ « individualité (…) le pouvoir qu’a l’homme de commencer quelque chose de neuf à partir de ses propres ressources. » 15. Du coup, pour Arendt, la liberté est autre chose que la poursuite de l’intérêt, donc on ne peut pas penser le libéralisme comme la seule façon de s’opposer au totalitarisme. Arendt peut ainsi reconstruire légitimement une autre généalogie de la liberté que celle défendue par les tenants du libéralisme, dans laquelle « la spontanéité est d’emblée orientée vers les autres. » (p. 38). Cette réélaboration de la liberté peut être lue comme une tentative d’arracher la politique à l’alternative entre totalitarisme et libéralisme.
Cette reconstruction de la liberté passe par deux phases 16. Dans la première, la liberté est vue comme possibilité de sortir, et cette sortie ne prend tout son sens que comme sortie vers les autres. Chez Homère, celui qui veut commencer une action, le chef, a besoin des autres. Mais un danger de la spontanéité subsiste dans la mesure où cette spontanéité peut aussi devenir un commandement sur les autres ou un acte arbitraire confinant au crime. C’est la cité en tant qu’organisation politique qui modifie le sens de la spontanéité. Ainsi conçue, la liberté n’est plus réductible à une spontanéité individuelle et solipsiste, mais se donne comme initiative polyphonique, émergeant de plusieurs voix. Ce qui rend possible cette spontanéité, c’est que les hommes n’ont pas seulement le commencement comme une faculté, mais qu’ils sont cette nouveauté. La liberté provient ainsi de la spontanéité, elle-même rendue possible par la naissance et la nouveauté qu’elle apporte, en droit sinon en fait, au monde. Cette naissance n’est pas pensée à partir d’une intériorité, elle n’est pas le début de ma conscience, mais elle est pensée comme « le début d’un apparaître aux autres. » (p. 42)
Le « Qui » n’est pas un moi tourné vers lui-même, s’évertuant plus ou moins heureusement à sortir du solipsisme, mais il se manifeste essentiellement aux autres. Finalement, chez Arendt comme chez Levinas, la pluralité ou la politique n’est absolument pas réductible à une multiplicité additionnable. L’analyse de M. Leibovici montre implicitement un arrachement au cadre heideggérien sous une double forme. Un arrachement, d’abord, à la pensée de Heidegger, arrachement par lequel les deux penseurs quittent une perspective dans laquelle le moi et sa liberté sont pensés de telle façon qu’on ne peut penser qu’improprement la place de l’autre sans la réduire à son rapport avec le moi (non-indifférence, pluralité). Mais cet arrachement qui décentre le moi de l’être, et la liberté du moi, ouvre à une nouvelle façon de penser la politique, qui dépasse l’alternative entre le totalitarisme et le libéralisme et rend possible une liberté politique proprement humaine.
IV) « au-delà de l’arrachement et de l’évasion de l’être »
Après des remarques générales sur Levinas et Arendt, M. Botbol-Baum montre que Levinas et Arendt partagent l’idée que la condition humaine ne s’identifie pas à la nature humaine, ainsi qu’un refus du chapitre 53 d’Être et Temps. Reconstruisant la problématique commune à l’œuvre des deux philosophes, elle la formule ainsi : « comment faire renaître un monde qui, s’arrachant à la totalité, révèle l’infini en termes d’une responsabilité compatible avec la liberté ? » (p. 52) et l’interprète comme une tentative de lutter contre le totalitarisme en formulant l’exigence d’un monde qui l’accueille véritablement l’autre. L’auteur remarque aussi qu’avec la notion de natalité, Arendt dénaturalise l’homme en faisant de l’inscription ou de l’insertion dans le monde le critère de l’humanité, humanité qui n’est dès lors évidemment plus réductible à une nature (biologique). Il ne s’agit plus de penser une nature humaine, mais une appartenance à l’humanité. Un tel geste philosophique vise à arracher l’homme à l’être, tel que le pense en particulier Heidegger, à le désinscrire, pourrait-on presque dire, d’une filiation à l’être. Heidegger attache la liberté à l’être et au temps et défend la thèse que l’attitude naturelle n’est pas proprement, authentiquement humaine, que l’homme doit s’en évader, s’en arracher, car il est encore dans l’ordre de la représentation figée dans la tradition naturalisée l’empêchant d’être véritablement ce qu’il a à être. Heidegger inviterait alors lui-même à une forme d’arrachement, sans que celle-ci soit jugée pertinente par Arendt et Levinas, qui lui reprochent de ne pas faire droit à l’exigence de passer par une intersubjectivité dans l’élaboration du monde commun, une subjectivité telle qu’elle permette au nouveau d’advenir, c’est-à-dire finalement, que Levinas et Arendt s’efforcent de penser un monde dans lequel l’altérité soit possible (sous la forme du nouveau dans la natalité, ou de l’Autre pour Levinas). Jusqu’ici, la réflexion est pertinente.
Mais suit une série de remarques brèves, sans articulation claire les unes avec les autres qui laisse ensuite le lecteur errer entre des thèmes (la morale, la vie, l’échec de la pensée de Heidegger, la praxis, etc.) sans trop savoir où le mènent ces analyses hétérogènes, plus affirmées que justifiées. L’auteur défend l’idée que Levinas s’essaye à construire une tentative d’évasion pour échapper au diagnostic de Heidegger. Cette évasion serait constituée de différents moments. Le premier, l’éros, essaie de briser les formes de l’être dans lequel on se sent prisonnier. Cette tentative n’aboutit pas : le plaisir ne permet pas de se libérer du corps. L’auteur évoque ensuite, sans réelle analyse de textes particuliers, un certain nombre d’aspects de l’itinéraire de la pensée de Levinas, qu’elle rapproche ou oppose, de façon trop allusive pour être complètement claire et convaincante, de la position d’un certain nombre d’auteurs (sont cités sur un peu plus d’une page Husserl, Heidegger, Bergson, Pouchkine, Hegel et Sartre, sans compter Arendt). On a vraiment du mal à voir quel est le cœur du propos et son rapport avec ce qui prétend devoir être démontré. Par ailleurs, méthodologiquement, il serait souhaitable que toute citation soit accompagnée de sa provenance. Se dégage de ce passage l’idée que Levinas essaie de sortir d’apories propres à la pensée heideggérienne, puisque l’évasion est pensée comme réponse à « l’être-rivé » dans le nazisme. A cela succède alors une lecture de la naissance de la subjectivité, qui prend, elle aussi, la forme de l’évasion, évasion vers un autrement qu’être. L’auteur annonce alors l’étude de la « dénaturalisation de l’il y a » (p. 66), mais cette séquence, elle aussi composée de brèves remarques juxtaposées, évoquant des croisements (éthique et politique, « rive juive » et « rive grecque », « désir métaphysique d’altérité » et « concept de natalité ») passe totalement sous silence la notion même d’il y a et le but qu’elle s’était fixée dans le titre.
Ce qui est dit dans les remarques est juste, et parfois intéressant, mais ne semble pas en rapport avec la progression d’une argumentation visant à défendre une thèse. Après ce passage sur Levinas, l’auteur aborde la natalité chez Arendt. Mais si ce terme est mis en rapport avec la Geworfenheit heideggérienne, ce qui semble tout à fait judicieux, l’auteur ne réfléchit jamais vraiment ici sur ce concept et sur la façon dont il est lié au temps ou aux thèmes de l’arrachement et de l’évasion. Quel type d’évasion ou d’arrachement la natalité nous permet-elle de penser ? En quoi cette notion intervient-elle dans la conception du temps ? Voilà des questions, qui nous semblent légitimes, étant donné l’argumentation proposée, et auxquelles on ne donne pas l’ébauche d’une réponse argumentée. On saisit indirectement que la natalité permet de sortir du cadre dans lequel Heidegger semble avoir fait prisonnier l’homme, en mettant au cœur de son analyse sa mortalité, mais sans qu’on conçoive clairement quels problèmes sont afférents à cette centralité de la mortalité. La communication se finit par une série de rappels, à propos de la pensée d’Arendt (p. 74).
V) « au-delà du monde ou souci du monde »
La communication de Yotetsu Tonaki, « au-delà du monde ou souci du monde : croisement de l’éthique d’Emmanuel Levinas et du politique d’Hannah Arendt » interroge le rapport au monde chez les deux penseurs. Si Arendt veut réhabiliter le monde, Levinas semble dans un premier temps mettre à l’écart le monde pour autant qu’il y voit une sorte d’inévitable trahison à l’égard de l’altérité d’autrui, pour ensuite revenir au monde de la pluralité en y admettant la justice. Arendt commence en effet la Condition de l’homme moderne17 par évoquer Spoutnik qui symbolise l’évasion des hommes hors de la terre. C’est bien un aspect fondamental de la condition humaine qui est en jeu. De son côté, Levinas voit dans exploit de Gagarine quelque d’ « admirable » parce qu’il « a quitté le lieu » 18. L’auteur propose de lire cette admiration moins comme l’apologie de la technique que comme la correspondance avec la pensée juive qui « a toujours été libre à l’égard des lieux » 19 et il l’analyse également comme une critique de Heidegger. Il convient alors de remarquer que si la question du monde est posée par Levinas comme par Arendt qui traite du monde acosmique dans le totalitarisme, de la désolation, etc., ce souci ne les emmène pas au même endroit.
Arendt tente de réhabiliter le monde contre le totalitarisme, c’est-à-dire vise, selon les mots de l’auteur « l’instauration d’un monde commun en tant qu’horizon de l’agir politique » (p. 80). Le monde a besoin de l’action et de la parole et pas seulement d’objets ; La réduction du monde à l’œuvre en ferait une instrumentalisation du monde. Ce qui fait l’irréductibilité du monde à des artefacts et des objets, c’est l’action et la parole grâce auxquelles l’homme s’inscrit dans le monde. La suite de l’analyse de l’auteur est brillante puisqu’il convoque des textes moins cités pour éclairer la pensée d’Arendt sur le rapport du monde au soi, qui se donne sous la forme du « qui ». Or le monde, pour Arendt, est le lieu où j’apparais à autrui. L’action et la parole révèlent le « qui » qui constitue l’homme, la parole chez Arendt ne vise pas la communication ou l’information, mais la révélation du « qui », par opposition au « ce que » des qualités, dons, talents, etc. En effet, le monde arendtien doit permettre à l’homme de se dévoiler en agissant et en parlant avec les autres. C’est qui le caractérise et l’oppose à Heidegger ; le monde politique pour Arendt n’est pas dans le lieu, mais dans l’organisation du peuple qui agit et parle ensemble.
Après avoir montré comment Arendt met au jour l’importance du monde et son lien à la fois avec mon identité – « qui » je suis – et son nécessaire rapport aux autres, Yotetsu Tonaki examine la façon dont Levinas conçoit le monde. A la différence de ce que propose Arendt, ce qu’envisage Levinas n’est pas la réhabilitation du monde, mais exigence de le quitter, et il fait même de cette exigence le geste principal de la métaphysique qui « consiste à tendre vers tout autre chose, vers l’absolument autre »20. L’auteur fait remarquer que Levinas conçoit le monde, comme Arendt, « comme une sorte d’espace d’apparence. » (p. 84), rapprochement qu’il prend comme point de départ pour une étude féconde qui vise à montrer que, dans les textes de Levinas, le monde est lié à la lumière, à la visibilité et à la connaissance, ce qui interdit tout rapport authentique à autrui, puisque connaître autrui serait réduire son altérité radicale à du connaissable. Si Autrui apparaît dans cet espace éclairé ou lumineux, il perd son altérité radicale pour Levinas, ce qui interdit au monde, pour Levinas, d’être le lieu de la « vraie vie », puisque cette vraie vie est caractérisée par une sorte de relation avec autrui, telle qu’elle laisse le plus possible place à son altérité Cette critique du monde comme lieu dans lequel n’est pas possible la « vraie vie » est à lire, pour l’auteur, comme une critique du concept heideggérien de monde : Être et temps thématise la mondanéité du monde à partir du Da du Dasein. Il s’identifie avec l’espace ouvert et éclairé, ce qui permet non seulement la compréhension des choses mondaines mais aussi celle d‘autrui. Aussi, là où Heidegger prend l’horizon éclairé du Da pour la condition de la compréhension, Levinas affirme que cette perspective interdit de saisir l’étant dans sa singularité, puisque pour lui, la rencontre avec le visage d’autrui, c’est-à-dire avec autrui dans toute sa radicale altérité ne peut avoir lieu que sur fond d’obscurité ou de refus de la lumière, ce qui donne lieu à un excellent paragraphe de l’auteur.
Si les avis de Levinas et Arendt divergent sur le rôle et l’importance du monde dans le rapport à l’autre homme et à la « vraie vie », l’auteur remarque néanmoins une commune mise en avant de la parole, présentée comme faculté de manifester le « qui ». Comme il l’écrit, « ni moyen de communication, ni dévoilement de quelque chose de caché, la parole est considérée chez lui aussi comme un moyen de présenter le visage lui-même. » (p. 86) Mais apparaît alors une divergence entre les deux auteurs, puisque pour Arendt, la présentation du « qui » par la parole, qui a autrui pour destinataire, a lieu dans le monde commun et politique, qu’on a vu être un espace d’apparence, tandis que pour Levinas, cette parole semble ne pouvoir avoir lieu que dans le face-à-face, dans lequel autrui se donne comme absolument autre, dans une altérité qui échappe à toute forme d’apparence, sous peine d’être en quelque sorte « déformée ». Ainsi, dans Totalité et infini, la politique est considérée comme une institution qui accomplit la déformation de la singularité de l’autre, la politique est tyrannique parce qu’elle réduit la pluralité des hommes au profit de l’Un. Idée qu’on retrouve dans la dénonciation du « penchant tyrannique » 21 de la politique par Arendt ainsi que dans ce qu’elle dit de la tradition philosophique qui ne se saisit de la politique que sous le modèle de la fabrication. Le problème du tiers dans Autrement qu’Etre rejoint, rappelle l’auteur, le souci arendtien de l’organisation de la pluralité humaine ; même si l’auteur met au jour que l’entrée du tiers requiert l’horizon de l’apparence et que le tiers apparaît dans cet horizon de la phénoménalité pour que la comparaison des incomparables soit possible. Il conclut l’analyse avec une formule très pertinente : « Même si l’Autre échappe à tout ordre ontologique de l’apparaître, le problème de la pluralité humaine doit être abordé en s’appuyant sur la phénoménalité dès que se pose la question de la justice ». (pp. 88-89)
La suite de l’article se trouve à cette adresse.
- Mylène Botbol-Baum et Anne-Marie Roviello (coord.), Arrachement et évasion : Levinas et Arendt face à l’histoire, Vrin, 2013
- E. Levinas, De l’Evasion, 1935, Montpellier, Fata Morgana
- E. Levinas, De l’Existence à l’existant, 1947, Paris, Vrin 1982
- Ainsi, par exemple, le troisième volume de ses Œuvres4E. Levinas, Œuvres 3, Eros, littérature et philosophie, 2013, Imec Grasset
- Voire peut-être même avec la naissance de l’Etat d’Israël, qui a été un sujet de réflexion pour ces deux auteurs
- Citation d’A. Rimbaud, « Délires I, vierge folle, l’époux infernal », dans Une saison en enfer,Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 2009, p. 229, reprise par Levinas au début de Totalité et infini (E. Levinas,Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Nijhoff, La Haye, 1961, p. 3).
- l’auteur indique que cette citation se trouve dans E. levinas, De l’existence à l’existant, op. cit., sans citer la page
- Dans E. Levinas, « nom d’un chien ou du droit naturel », Difficile Liberté. Essai sur le judaïsme Albin Michel, Paris 1976 (cité d’après sa réédition, Paris, le Livre de poche, 1984) p. 215.
- J.Taminiaux, « Arendt et Levinas, convergence impossible ? », dans Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour, A. Kupiec et E. Tassin (ed.), Paris, Sens et Tonka, 2006
- E. Levinas,De l’évasion, Paris, Fata Morgana, 1982, p. 97
- Ibid. p. 73
- E. Levinas,De l’existence à l’existant, op. cit.
- E. Levinas,Hors sujet, Paris, Le Livre de poche, 1997, pp. 159-160
- H. Arendt, Les origines du totalitarisme. Troisième partie,dans Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem trad. fr. par M. Pouteau, M. Leiris, J. L. Bourget, révisée par H. Frappat, Paris. Gallimard, 2002 p. 806-807
- évoquées dans H. Arendt, « qu’est-ce que la liberté ? », La crise de la culture trad. fr. par A. Faure et P. lévy, Paris, Idées-Gallimard, 1972,
- H. Arendt, la condition de l’homme moderne, Paris, Agora, 1983
- E. Levinas, « Heidegger, Gagarine et nous », Difficile Liberté, op. cit.,pp. 301-302
- Ibid.
- E. Levinas,Totalité et infini, op. cit.p. 3
- H. Arendt, la condition de l’homme moderne, op.cit., p. 263