C’est un livre extrêmement ambitieux que Stanley Rosen a fait paraître en 2002, et que les éditions Vrin ont traduit en 2008 sous le titre La question de l’être, Heidegger renversé1. L’auteur, que les lecteurs français connaissent pour ses magnifiques commentaires platoniciens2 a en effet pour objectif de démontrer la dimension très profondément erratique de l’interprétation heideggérienne de l’histoire de la métaphysique, ce qui suppose d’étudier en profondeur le sens de la métaphysique platonicienne, mais aussi de s’attarder longuement sur les métaphysiques aristotélicienne, cartésienne, kantienne et, bien évidemment nietzschéenne. L’ouvrage, quoique se concluant sur un éloge de Heidegger, constitue toutefois une des attaques les plus virulentes qu’il ait été donné de lire à l’encontre de la lecture heideggérienne de la métaphysique, ce qui comble probablement une lacune importante de la pensée contemporaine. Cela étant, il me faut faire une remarque d’ordre éditorial : les ouvrages hostiles à Heidegger ne manquent pas, et il serait absurde de prétendre que ce livre de Stanley Rosen est original de ce point de vue ; pourtant, à mieux y regarder, il n’existe pratiquement pas de véritable réfutation de la pensée de Heidegger, tant il est vrai que l’hostilité à l’encontre de l’auteur de Sein und Zeit demeure guidée par son adhésion au national-socialisme, et que la majeure partie des textes qui critiquent Heidegger s’en prennent à ce versant-là du personnage, à partir duquel ils délégitiment le reste de sa pensée.
J’ai toujours été convaincu que tous ces ouvrages, dont celui de Faye constitue le dernier en date, raisonnent profondément mal : ils partent tous du principe que c’est parce que Heidegger fut nazi qu’il faut jeter le soupçon sur sa pensée. Ce raisonnement me paraît désigner exactement ce qu’il ne faut pas faire, car il se refuse au fond à véritablement sonder la cohérence du projet interne de Heidegger ; à mes yeux, c’est exactement l’inverse qui serait fécond, à savoir montrer que les lacunes, voire la faiblesse, de la pensée de Heidegger, ont conduit à son adhésion au national-socialisme : en d’autres termes, ce n’est pas parce que Heidegger fut national-socialiste qu’il fut un mauvais philosophe, mais c’est bien parce qu’il fut un philosophe douteux qu’il put adhérer au national-socialisme. Montrer que la pensée de Heidegger est douteuse, indépendamment de l’obsédante question nazie, voilà quelle est la tâche à laquelle s’attelle Stanley Rosen, lequel privilégie particulièrement la conception heideggérienne de l’histoire de la métaphysique, et de la métaphysique elle-même en son concept, dont il se donne pour tâche de révéler les ambiguïtés, les errements, et les erreurs. « Dans cet ouvrage, écrit Rosen,j’ai pour but d’examiner la thèse de Martin Heidegger selon laquelle la philosophie européenne de Platon à Nietzsche est l’histoire de la métaphysique, ou de ce que Heidegger appelle aussi le platonisme. »3 Et, ainsi que nous venons de le laisser entendre, la détermination de la métaphysique comme « platonisme » par Heidegger constitue aux yeux de Rosen l’erreur inaugurale, qui entrave plus qu’elle ne libère une réflexion pertinente sur l’idée même de métaphysique. « L’interprétation que Heidegger donne du platonisme, et donc de la métaphysique, est à mon sens l’obstacle majeur à la compréhension actuelle de ce qu’est la métaphysique, et par conséquent de ce qu’est la philosophie. »4
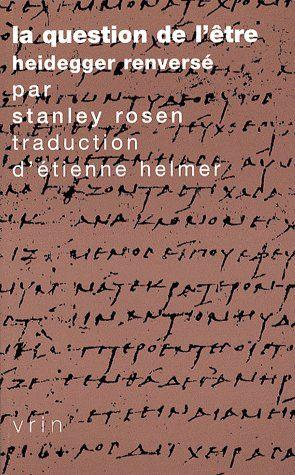
Mais outre l’étude de la pertinence historique de la détermination heideggérienne de la métaphysique, Rosen va apporter de sévères mises au point quant à l’objet même du discours heideggérien : en bon anglo-saxon, soucieux de savoir de quoi il parle, Rosen va reprocher à Heidegger, et ce tout au long du livre, de produire un discours auquel ne correspond nulle réalité, et ainsi de s’enfermer dans un incantatoire dérisoire et même dangereux. Au-delà donc de la détermination de la métaphysique, Rosen pense le problème de l’Evénement, de l’Ereignis, en sonde la cohérence, en révèle l’absurdité, et surtout en dénonce le manque de sens. « D’un côté, il nous exhorte à maintes reprises à dépasser les limites de la pensée métaphysique, c’est-à-dire de la pensée tournée vers les choses, au nom d’une nouvelle manière de penser, à savoir la pensée de l’E-vénement (ou plus simplement, de l’Etre pensé comme processus d’éclosion). D’un autre côté, il semble que la pensée n’ait rien ici « sur quoi » elle puisse s’exercer. Rien d’étonnant à ce que Heidegger insiste toujours sur le fait qu’il est « en chemin vers la parole » ou qu’il prépare la voie à un « autre commencement », au lieu de parler effectivement, au sens de répondre à des questions ou d’élaborer une doctrine. »5 Il pourrait ainsi sembler que deux aspects se trouvent dans l’ouvrage de Stanley Rosen, un aspect d’histoire de la philosophie, interrogeant au fond la pertinence de la lecture heideggérienne de l’histoire de la philosophie, et un autre s’aspect s’attachant à critiquer l’Evénement comme cela même qui dépasserait la métaphysique, prisonnière des étants. Mais à mieux lire Rosen, on comprend que ces deux aspects sont intimement liés au point que chacun donne sens à l’autre : ce qui est véritablement au cœur de l’ouvrage de Stanley Rosen, c’est au fond le problème suivant : Heidegger ne parle de rien. Quand il évoque la métaphysique de Platon, il combat une chimère tout droit sortie de son esprit, à laquelle ne correspond aucune élaboration platonicienne. De même, lorsqu’il évoque l’Evénement – l’E-vénement –, il ne parle de rien, il s’extrait de tout discours possible puisque l’objet de son discours est vide, et est par nature, vide.
A : Platon purifié d’Aristote
Le principal reproche que Rosen adresse à la lecture heideggérienne de la métaphysique platonicienne, c’est de lire Platon avec des lunettes aristotéliciennes : la métaphysique que Heidegger prête à Platon ne désigne en fait aucune réalité présente chez Platon, mais s’appuie sur une sorte de confusion indigeste de platonisme et d’aristotélisme, où les essences se confondent avec les substances sur fond d’une rigueur philologique qui laisse à désirer. Cela se produit d’abord par une ahurissante réduction de la production platonicienne à la seule doctrine des Idées, sans autre forme de justification. « Ce que Heidegger entend principalement par platonisme se ramène presque exclusivement à la doctrine des Idées. »6 Puis, en 1926, avec Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Heidegger met en scène son amalgame de la production, de l’Hupokeiménon, des idées et des essences, l’essence et l’existence étant rattachées à une source commune qu’est la production. « Les différentes déterminations de l’ousia écrit Heidegger, se sont développées en référence à ce qui est pro-duit dans la pro-duction, ou encore à ce qui appartient au produit comme tel. »7 En d’autres termes, Heidegger va essayer de ramener l’ensemble des déterminations essentielles et existentielles à l’œuvre de production, donc à l’œuvre produite par l’artisan, la production posant du reste le primat de la vue qui se retrouve, selon les étymologies heideggériennes, dans les termes de idea et theroein.
Plus fondamentalement, ce que Rosen va reprocher à Heidegger, c’est de subsumer l’Idée platonicienne sous le to ti en einai aristotélicien, et de finalement produire une lecture platonicienne parfaitement déformée par le prisme aristotélicien et, partant, de totalement manquer la réalité de la pensée platonicienne. Pourquoi Heidegger chercherait-il à déformer autant la pensée platonicienne ? Parce qu’il lui faut retrouver chez les auteurs étudiés ses propres présupposés, c’est-à-dire pouvoir retrouver chez Platon un certain sens de la disponibilité : pour ce faire, Heidegger est obligé de ramener l’essence à la production, ce qui ravit évidemment ce dernier puisque, dans le même moment, il rappelle que le «comportement fondamental »8 du Dasein désigne justement…le produire comme Her-stellen. Ainsi Heidegger retrouve-t-il le comportement fondamental du Dasein comme produire au sein même de l’œuvre de Platon qu’il n’hésite pas à déformer pour la rendre conforme à sa propre pensée. « C’est là, écrit Rosen, un parfait exemple de la tendance de Heidegger à insérer ses propres doctrines dans des textes qui, d’après son interprétation, sont en écart par rapport à la manifestation originelle de la vérité. »9
Ce que reproche donc concrètement Rosen à Heidegger, c’est de faire glisser le sens réel des Idées vers un sens aristotélicien, afin d’y retrouver quelque chose de sa propre pensée ; Heidegger introduit ainsi au cœur du platonisme quelque chose qui n’y est pas, à savoir une réflexion unitaire sur l’être en tant qu’être, et écrase la différence des approches de l’Etre auxquelles procède Platon sous une unité factice assurée par la doctrine des Idées, elle-même déformée par des lunettes aristotéliciennes. « Heidegger devrait plutôt soutenir qu’on ne trouve chez Platon nulle doctrine de l’Etre, nulle ontologie d’aucune sorte mais plutôt diverses représentations de choses diversement appelées Idées, formes, genres les plus grands, ou encore natures et puissances, et dont certaines partent d’analyses de l’expérience tandis que d’autres s’expriment dans des mythes sur la destinée de l’âme. »10 Ce que Heidegger appelle métaphysique, et qui est censée être, selon lui, du platonisme, ressemble donc bien plutôt à de l’aristotélisme que Heidegger aurait cru voir chez Platon, au risque d’une déformation spectaculaire de ce dernier. Par conséquent, lorsque Heidegger parle du platonisme, il nous faut entendre aristotélisme, c’est-à-dire ontologie, ou réflexion sur l’être en tant qu’être. De ce fait, « bien que Heidegger et ses épigones désignent la métaphysique comme étant du platonisme, il serait plus juste en réalité de décrire ce qu’ils conçoivent par ce terme – même si ce n’est pas parfait – comme de l’aristotélisme. »11
B : Le retour en grâce de la vérité
La critique produite ci-dessus permet de préciser le reproche essentiel que Rosen adresse à Heidegger : ce dernier a cru lire chez Platon une réflexion sur l’Etre, qui serait distincte des êtres ; l’être en tant qu’être figurerait comme thème réflexif par exemple dans la doctrine des Idées : cela, c’est très exactement ce que refuse Rosen, et en refusant cela, il refuse du même geste toute la détermination heideggérienne de la métaphysique. C’est pourquoi « l’identification postmoderne de la métaphysique au platonisme (…) n’est pas seulement une simplification outrancière ; c’est en grande partie une erreur. »12
Il est inhabituel de lire sous la plume d’un commentateur contemporain une telle virulence à l’encontre d’un auteur pour des motifs philosophiques : cela est dû, me semble-t-il, au fait que nous n’essayons plus de savoir si une pensée est vraie, mais si elle est bien conforme à un certain schéma qu’on lui prête a priori. Il est ainsi courant de lire de savantes études consacrées à Descartes, Suarez, Hegel, Pascal, etc., dont le seul objet est de savoir si la pensée de ces auteurs correspond à la métaphysique telle que Heidegger a pu la définir. En d’autres termes, à aucun moment n’est interrogée la pertinence desdites pensées, et à aucun moment n’est rencontrée la question du vrai ; de la même manière, les pensées dites du soupçon abandonnent la question de la vérité au profit d’une recherche d’auteurs inconscients ou inapparents du discours étudié : mais de vérité, il n’est guère question. L’une des forces plaisantes de ce livre de Rosen, c’est de précisément ramener le problème de la vérité au cœur même de l’interrogation philosophique, et ainsi de sonder la pensée heideggérienne à l’aide de ce questionnement : que dit Heidegger de vrai ? Et la réponse de Rosen est accablante : très peu de choses. C’est donc parce que la vérité se trouve ramenée au centre des préoccupations que la charge contre la pensée même de Heidegger semble si forte, et si violente, et que cette dernière reçoit un certain nombre d’accusations redoutables, auxquelles elle ne pourrait répondre que par l’habituel mépris dont elle fait preuve à l’égard de la détermination traditionnelle de la vérité.
L’ensemble de cet ouvrage se consacre donc à étudier la pensée heideggérienne non sous l’angle d’un thème, mais sous l’angle de la vérité. A cet égard, il n’est pas vrai que de prétendre voir dans les Idées platoniciennes une réflexion ontologique, ou, a fortiori, métaphysique, car les Idées ne prétendent en rien décrire la totalité. Les Idées, affirme Rosen, n’ont nulle prétention explicative de nature métaphysique : elles ne rendent pas compte de la totalité ; c’est même exactement l’inverse : elles ne rendent compte que du singulier, dont elles permettent de comprendre la possibilité même. « Les Idées de Platon ne doivent donc pas être comprises comme des objets dont l’analyse métaphysique ou ontologique nous conduirait à une théorie ou à une explication systématique de la structure du tout. Elles sont une hypothèse – une hypothèse sans nul doute nécessaire aux yeux de Platon – indispensable pour rendre compte de l’ordre et de l’intelligibilité de notre vie quotidienne. »13 On le voit, une telle analyse se situe aux antipodes de la lecture heideggérienne, et reproche à cette dernière d’avoir non pas seulement interprété le texte de Platon, mais d’y avoir introduit des éléments qui n’y figuraient pas, et donc d’avoir voulu introduire de force une métaphysique de type aristotélicien qui n’avait nulle raison d’y figurer.
C : Une magistrale leçon de platonisme
Stanley Rosen, avant d’être un pourfendeur des errances heideggériennes, est d’abord un excellent connaisseur de l’œuvre platonicienne. Cela se ressent tout au long de l’ouvrage, et particulièrement dans la lecture qu’il propose du logos, problème central dans l’herméneutique platonicienne. L’Idée, je l’ai dit, n’est pas une théorie du Tout, mais bien cela même grâce à quoi nous comprenons le singulier ; elle désigne de ce fait moins une métaphysique qu’elle ne permet de rendre compte de l’aspect de l’objet. Mais encore nous faut-il préciser le sens d’un pareil « aspect ».
L’Idée, pour le dire clairement, c’est l’aspect intellectuel, et non physique, de la chose. « L’Idée est l’aspect non au sens de morphè mais en un sens lié au logos. »14 Le logos est présent dans l’intellect, et désigne ce que ce dernier est capable d’appréhender, intellectuellement, de la chose ; le logos n’est pas l’être, il est le moyen d’appréhender intellectuellement l’être, mais en dépit de cette différence, l’être et le logos entretiennent des relations de communauté, ce sans quoi on ne comprendrait comment l’être serait appréhendable par le logos. C’est pourquoi Rosen écrit que « le logos est le rapport d’intelligibilité qui montre l’ « aspect » ou l’Idée d’un être quand il est saisi par l’intellect plutôt que par les sens. »15 C’est là une magistrale élucidation des rapports entre les Idées, le logos et l’être que propose Stanley Rosen, et l’on ne peut qu’être admiratif devant la grande clarté de ses propos. Ce que nous comprenons en lisant les chapitres consacrés à Platon, c’est que le logos est au fond le moyen terme entre l’être et la pensée : nous ne pensons l’être qu’en vertu de ce logos, immanent à la pensée, et révélant l’aspect de l’être sous sa forme idéelle. En d’autres termes, le logos c’est cela même qui assure la possibilité de penser l’être en tant qu’il assure la liaison de l’être et de la pensée. « C’est le logos qui est identique dans l’être et dans la pensée. Pour le dire le plus simplement possible : le rapport des éléments intelligibles est identique dans l’être et dans l’appréhension noétique de cet être. Le rapport des éléments intelligibles est ce par quoi un être est ce qu’il est et est ouvert au fait d’être pensé. »16 Mais une fois dit cela, encore faut-il rappeler une évidence : l’être que permet de penser le logos n’est pas l’être en tant qu’être ; le logos n’ouvre pas à une réflexion de nature ontologique mais bien à une réflexion sur les êtres, en tant qu’ils sont quelque chose, et non en tant qu’ils sont être. En d’autres termes, le logos nous ouvre les êtres dans leur singularité et non dans leur ontologie.
De ce fait, puisque le logos désigne au fond cette apparence de l’être accessible au noûs, puisqu’il est cette apparence qui est moyen terme entre l’être et la pensée, sans être véritablement ni être, ni pensée, alors il rend inopérantes les critiques de Heidegger à l’encontre de Platon. « Contrairement aux reproches formulés par Heidegger, il nous faut penser les êtres en tant qu’ils sont quelque chose. Notre premier mouvement pour comprendre notre expérience quotidienne, c’est de nous tourner directement vers les êtres envisagés comme produits du devenir, aussi bien pour ce qui est du processus de génération que de corruption. »17 Il est flagrant ici que ce qui s’avère irréductible pour Stanley Rosen, c’est en définitive la validité de l’expérience quotidienne : toute philosophie qui déploierait des concepts faisant fi de cette expérience quotidienne ou qui ne pourrait pas en rendre compte se trouve, ipso facto, délégitimée aux yeux de Rosen. Si Platon trouve grâces à ses yeux, et si Heidegger lui apparaît comme profondément épouvantable, c’est d’abord et avant tout en raison de cette expérience quotidienne que Heidegger cherche par tous les moyens, et en dépit de sa revendication phénoménologique, à contourner : l’Ereignis apparaîtra alors comme le summum de la fuite hors de cette expérience, mais Stanley Rosen découvre à chaque instant que c’est en réalité la totalité de la vision de l’histoire de la métaphysique heideggérienne qui prépare cette extraction hors de ce seul terrain qui saurait avoir un sens, celui du quotidien.
Ainsi, et paradoxalement, c’est Platon qui nous aide à comprendre cette expérience quotidienne par sa théorie des Idées et c’est Heidegger, le phénoménologue, qui nous en rend l’accès incompréhensible : les élucubrations de ce dernier sur l’Etre ne sont pas fausses, elles sont simplement dénuées de sens : Heidegger ne parle de rien, il ne parle que de ses propres illuminations, et s’extrait lui-même du champ philosophique qu’il prétend définir. « Je ne veux pas dire que l’Etre n’existe pas, car ce serait une affirmation incompréhensible. Ce que je veux dire, c’est qu’on ne peut pas tenir un discours cohérent sur l’Etre. Même les injonctions qu’on oppose à un tel discours sont incohérentes. La difficulté à laquelle nous confronte le langage de Heidegger, ce n’est pas sa complexité théorique ou sa sophistication technique, c’est qu’il ne parle de rien du tout, comme lui-même y insiste. En d’autres termes, il veut parler du fait que les êtres sont sans se référer à l’être des êtres, et donc sans se référer à aucun ceci ou cela, à aucune chose. Autant essayer de parler de la « poissonnéïté » du poisson sans faire référence au poisson ! »18
D : Portrait de Heidegger en nietzschéen inverti…
On le sait, Heidegger a proposé une lecture de Nietzsche insistant sur le platonisme de ce dernier ; Nietzsche aurait essayé de renverser Platon, mais ce faisant, il serait resté prisonnier du platonisme. Le problème est que si Heidegger mésinterprète le platonisme, alors il mésinterprète aussi le nietzschéisme : si Nietzsche produit un platonisme inversé, et si Heidegger ne comprend pas le platonisme, alors il fait également erreur sur la pensée de Nietzsche. En d’autres termes, l’erreur commise sur Platon rejaillit inéluctablement sur l’interprétation de Nietzsche. « A mon sens, Heidegger a raison de pointer une dimension platonicienne dans la pensée de Nietzsche, mais il se trompe sur les proportions qu’il lui accorde. Cela tient au fait que les défauts de l’interprétation que Heidegger donne de Platon sont à peu près les mêmes que ceux de son interprétation de Nietzsche. »19
Probablement moins à l’aise sur Nietzsche que sur Platon, Stanley Rosen n’en propose pas moins une fulgurante interprétation de Nietzsche qui me semble reposer sur deux piliers majeurs : d’une part, Heidegger se trompe en ramenant la métaphysique nietzschéenne à deux éléments que seraient la volonté de puissance et l’éternel retour parce que ceux-ci doivent être ramenés au chaos qui se situe en amont. D’autre part, Rosen ne cesse de rappeler à quel point il est absurde de faire de la pensée de Nietzsche une pure pensée de l’affirmation dénuée de négation : nous ne pouvons affirmer que parce que nous avons auparavant nié et détruit. « Il en est ainsi parce qu’il faut d’abord détruire pour créer, comme Zarathoustra l’enseigne à ses disciples futurs. »20
Le nietzschéisme, s’il e st une métaphysique, est une métaphysique du chaos. La volonté de puissance comme le chaos doivent être lus dans cette optique, que Rosen assoit en ces termes : « L’éternel retour du même est l’éternel retour des schématisations perspectives du chaos par le chaos. (…). »21 Néanmoins, là où Rosen devient difficile à suivre c’est lorsqu’il reproche à Nietzsche de dessiner les contours d’un projet intenable et, par conséquent, non tenu : la métaphysique du chaos qu’il développe devrait, selon Rosen, aboutir à une oblitération de l’existence humaine, au sens où celle-ci sombrerait dans une nécessité irrationnelle : mais si ce n’est pas le cas, selon Rosen, c’est parce que le chaos ne recèle pas en lui de loi interne, qui déciderait du destin de l’homme, si bien que l’expérience humaine sombrerait dans l’illusion, mais cette réduction de l’existence à l’illusion n’est pas la conséquence du chaos, puisque ce dernier ne possède aucune loi dictant une telle conséquence. Je dois dire que cette lecture de Nietzsche est tout aussi obscure que douteuse : obscure parce que le sens même de l’expérience humaine auquel songe Rosen n’est guère explicité ; et douteuse parce que Rosen nous somme d’admettre qu’il y aurait bien une métaphysique du chaos à la base de la pensée nietzschéenne, ce qui n’est pas, à mon sens, suffisamment démontré.
On l’a compris, le point de désaccord majeur qui oppose Rosen à Heidegger porte sur la loi du chaos : Heidegger est convaincu que le chaos est porteur d’une loi immanente, qui serait ressaisie dans la vie quotidienne ; Rosen est convaincu du contraire, et c’est même cette absence de loi interne au chaos qui rend si délicate la cohérence de la pensée de Nietzsche selon Rosen. En effet, dénué de loi immanente, le chaos peut se développer dans deux directions divergentes, voire même contradictoires : une première qui serait d’ordre hyperboréen où l’homme affirmerait sa volonté comme telle en s’affranchissant de la métaphysique platonicienne, et une seconde qui s’affranchirait de la direction hyperboréenne mais qui révèlerait la facticité de la volonté, en tant qu’elle ne serait jamais que la marque d’un anthropomorphisme.
Cette partie est, quoi qu’on en dise, moins limpide, et moins structurée que celle consacrée à Platon et Aristote ; l’impression d’une juxtaposition de remarques, parfois mal ordonnées, ne parvient pas à se dissiper et si l’on comprend aisément que le nœud du problème réside dans cette immanence de la loi du chaos, il n’en demeure pas moins que l’insistance de Rosen sur l’incohérence de Nietzsche et l’impossibilité de réaliser son projet aurait mérité de plus amples développements et de plus précises justifications.
E : Conclusion : le nihilisme de Heidegger
Ce livre, malgré son caractère quelque peu obscur lorsqu’il est question de Nietzsche, s’avère pourtant indispensable pour qui souhaite approfondir la compréhension du logos, du platonisme, et de la lecture heideggérienne de la philosophie. Une des thèses majeures de cet ouvrage, je l’ai dit, c’est de ridiculiser la lecture heideggérienne de la métaphysique comme platonisme : non seulement, il est absurde de croire qu’une pensée structure un mouvement plurimillénaire, mais de surcroît ladite pensée ne correspond à rien de réel, le platonisme de Heidegger est une chimère dénuée de sens. « Heidegger aboutit à une complète distorsion de Platon et du platonisme, et à son interprétation schématique, outrageusement simplifiée et peu convaincante, de l’histoire de la philosophie occidentale comme platonisme métaphysique. »22
Mais il y a pis que cela : ce que Rosen montre admirablement, et là il redevient d’une clarté remarquable, c’est que le nihilisme tant reproché par Heidegger à la métaphysique et donc à Nietzsche censé l’achever, caractérise en réalité la pensée de Heidegger elle-même : en désolidarisant sa pensée de l’expérience quotidienne, en ne cessant de forger des concepts auxquels nulle expérimentation ne semble répondre, Heidegger s’est précipité dans un nihilisme déplorable, que relève Rosen de manière plus que convaincante. « Qu’on fasse référence à l’Etre ou à quelque autre pseudonyme forgé par le dernier Heidegger, le résultat est le même. L’existence humaine, en tant que don de l’Etre, est nihilisme. Il n’y a pas moyen de traiter ou d’utiliser les choses sous un mode où elles seraient détachées de leur choséité ou de leur utilité. La seule attitude que nous puissions adopter envers elles, qui soit une application directe du détachement que nous leur témoignons, serait de les laisser advenir, donc de n’adopter aucune attitude que ce soit à leur égard, pas même de les aimer (…). »23 Le reproche de Rosen à l’encontre de Heidegger est extrêmement puissant et subtil : dans un premier temps, il identifie le nihilisme heideggérien comme étant ce lâcher-prise de la pensée de l’événement à l’égard de l’expérience quotidienne ; au fond, la pensée heideggérienne revient à solliciter une passivité absolue du Dasein devant les choses dont tout intérêt porté à leur égard procèderait déjà d’une errance métaphysique. De ce point de vue, l’exaltation de Zarathoustra et l’exhortation qui est la sienne face aux choses constitue un remède efficace au nihilisme contenu dans l’attitude heideggérienne de détachement pseudo-philosophique.
Mais ce nihilisme se redouble : à aucun moment au fond Heidegger ne justifie le fait que nous devrions préférer la voie de l’Evénement à celle des choses ; pourquoi préférer l’Ereignis à la métaphysique ? Heidegger est absolument incapable de justifier sa préférence si bien que le cœur même de sa pensée est susceptible d’être délaissé par quiconque souhaiterait recevoir, sinon une justification rationnelle à ce choix, à tout le moins une justification philosophique. « L’une des thèses principales de mon étude est que Heidegger s’écarte très nettement de Platon lorsqu’il sépare la philosophie, ou la pensée authentique, de la vie quotidienne. Il paraît clair désormais que cette séparation équivaut à un double nihilisme : une attitude nihiliste envers le monde des choses, et un détachement nihiliste à l’égard de la clairière et du processus d’apparition. Heidegger ne parvient jamais à expliquer pourquoi on devrait prendre la voie de la pensée philosophique. Sans doute veut-il faire honneur à Aristote pour qui la philosophie n’est en vue de rien d’autre qu’elle-même. Mais en disant cela, Aristote ne veut pas dire que la noblesse fait défaut à la philosophie. »24
On ne saurait conclure ce compte-rendu sans passer par une remarque d’ordre politique : aux yeux de Rosen, et cela me semble très profond, Heidegger a confondu le surhomme avec le penseur philosophe. Heidegger a cru que l’on pouvait transformer une société par une rhétorique philosophique, ce à quoi Platon lui-même ne croyait déjà plus. Mais ce philosophe capable de transformer la société, Heidegger a cru qu’il désignait le surhomme, comme si le surhomme se souciait de la société ou de la transformation des hommes en général. C’est cette confusion du surhomme et du philosophe – ou de l’intellectuel – qui caractérise in fine le projet politique de Heidegger, selon Rosen, confusion qui procède d’ailleurs d’une stupéfiante mécompréhension de ce qu’est le surhomme nietzschéen. Que l’on ne puisse transformer la société que par des idéologues et non par un surhomme, par définition déjà au-delà de la recherche du bien commun, c’est ce que Nietzsche avait entraperçu. « Nietzsche n’avait compris qu’une partie de cette vérité politique ; Heidegger, lui, n’en avait apparemment rien compris du tout. »25
- Stanley Rosen : La question de l’être, Heidegger renversé, Traduction Etienne Helmer, Vrin, 2008
- cf. Stanley Rosen, Le politique de Platon – tisser la cité, Vrin, 2004, et La production platonicienne, thèmes et variations, PUF, 2005
- Rosen, La question de l’être…, p. 13
- Ibid. p. 14
- Ibid. p. 24
- Ibid. p. 33
- Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, traduction Jean-François Courtine, Gallimard, 1985, p. 138
- Ibid. p. 138
- Rosen, La question de l’être…, p. 38
- Ibid. p. 55
- Ibid. p. 59
- Ibid. p. 62
- Ibid. p. 92
- Ibid. p. 93
- Ibid. p. 105
- Ibid. p. 109
- Ibid. pp. 118-119
- Ibid. p. 152
- Ibid. p. 168
- Ibid. p. 184
- Ibid. p. 198
- Ibid. p. 204
- Ibid. p. 315
- Ibid. p. 316
- Ibid. p. 329








