Introduction
Mille&une pages et Flammarion rééditent les œuvres de Philosophie morale de Vladimir Jankélévitch, 20 ans après la première édition en rassemblant les opus suivants : La Mauvaise Conscience, Du mensonge, Le mal, L’Austérité et la vie morale, Le Pur et l’Impur, L’Aventure, l’Ennui, le Sérieux, Le Pardon. On ne trouve pas de différence notoire entre les deux impressions, sinon que l’une a été conçue à Ligugé, et le présent volume à Lonrai ; la couverture initiale présentait un dessin du visage de l’auteur, la nouvelle nous offre une photographie de l’illustre berruyer disparu en 1985, incandescent comme un Greco, par Sophie Bassouls/ Leemage.
En dehors du texte même de Vladimir Jankélévitch, cette édition établie et préfacée par Françoise Schwab, oscille entre le contenu savant et le commun, avec d’un côté les citations grecques et latines souvent sans traduction, et d’un autre côté, des notices introductives à chaque nouvel ouvrage avec des commentaires de vulgarisation tels que « La « pureté du cœur » est morale » (p. 17) ou bien encore : « On peut conclure que l’on connaît le vrai, mais dans une relation à lui qui demeure inconnue » (p. 209).
Ce nouveau tirage s’inscrit par ailleurs dans une série d’événement très bien venus, avec notamment une exposition à la BNF organisée par Guillaume Fau, comprenant 120 pièces, ainsi qu’une édition de textes inédits, Vladimir Jankélévitch : L’esprit de résistance, datant de 1943 à 1983 dont Samuel Auzanneau a d’ailleurs écrit une chronique aussi complète que stimulante.
1. Quelques traits généraux concernant les livres de ce volume
Nous ne pouvons pas ici consacrer une critique développée pour chaque ouvrage de Jankélévitch, mais nous souhaitons tout de même rapidement rappeler certains éléments saillants de sa réflexion sur les problèmes moraux et ses différentes approches.
A l’origine, La mauvaise conscience est une thèse complémentaire de doctorat choisie avec son directeur Brunschvicg. Jankélévitch y étudie les différents phénomènes du remords après l’avoir identifié à la conscience même (p. 75) pour légèrement le nuancer ensuite : « La conscience est pour ainsi dire le remords en veilleuse » (p. 77). A la suite du pragmatisme bergsonisé pour qui d’ailleurs Williams James était « peut-être le plus grand penseur de tous les temps » (Cf. Bergson, Mélanges, 12 mars 1917, p. 1244), Jankélévitch priorise l’action, et étudie les différentes formes de dédoublement conscient qui s’opèrent après une action provoquant regret et remords. Ce dernier état est le symptôme même de notre liberté en tant que l’on peut objectiver l’irréversibilité même et dépasser les déchirements du regret. Constatant que le remords gèle cependant le futur, Jankélévitch examine la consolation thérapeutique de l’oubli puis celle de la passivité, qui, dans son sacrifice, trouve une issue face à l’irréparable. L’ouvrage se conclut sur la magnifique note d’espoir de Leonid Andreiev, « la vie est belle pour les ressuscités » (p. 202).
Avec Du mensonge, rédigé et écrit entre juin et août 1940 puis paru en 1945, Jankélévitch cherche, comme à chaque fois, à penser « jusqu’au moment où la pensée se brise sur des choses difficiles à saisir » (L’humanité, 29 mai 1978) à partir du problème classique du menteur dans l’Hippias mineur de Platon : comment se fait-il que le menteur parte en quelque sorte de l’avantage de savoir la vérité ? De là se distinguent l’erreur, la tromperie, l’omission, et la dissimulation, ce qui fait que, paradoxalement, le mensonge « ne s’apprend pas » (p. 217) mais s’éprouve comme pouvoir de ruse qui tourne le faux en vérité et crée une sorte de communauté des sourds et des aveugles. Ici, Jankélévitch propose là encore la solution du cœur, « l’intellection ou l’amour gnostique » (p. 234). Ce moment de la réflexion s’ouvre sur un second texte consacré au malentendu, cet amalgame de savoir et de non-savoir qui concentre sa séduction sur des équivoques dont Jankélévitch tente de démêler les modalités. La sortie du malentendu est l’innocence du commencement ; mais on ne peut y retourner, faire retour à cet irrémédiable sans recréer le malentendu. Ce n’est que par une certaine confiance au commencement que Jankélévitch offre à sa réflexion finale une ultime « accolade, cette pentecôte des bonnes volontés, le reste viendra par surcroît » (p. 287).
L’essai sur Le Mal, rédigé et publié quelques années plus tard, part de la distinction entre le mal et la méchanceté qui procède de celui-ci comme désordre, mais en cela révèle à travers son scandale et son absurdité la condition même de la liberté humaine. Jankélévitch revisite ainsi habilement ces problèmes (très proches de ceux de Jean Nabert) en les confrontant à ses travaux de jeunesse sur la métaphysique de Schelling. Dans son absurdité constituée par son destin mortel, l’analyse de l’homme rend possible selon Jankélévitch l’étude du « mal de méchanceté dont l’homme est l’auteur » (p. 297). Afin d’expliquer ce qu’est « la vérité et la beauté sans bonté », Jankélévitch interprète ensuite avec une érudition stupéfiante les Écritures saintes, notamment à la lumière de la Genèse et du cumul des tentations (p. 361). Auparavant, Jankélévitch développe une belle analyse de la faute (p. 332) visant à situer et hiérarchiser les plans de conscience sur lesquels se joue le péché à travers les distinctions de la malveillance, la disjonction et l’absence d’amour. L’essai se conclut sur une distinction entre excuse et pardon, la première étant rejetée dans la mesure où son indulgence masque le dédain facile quand le pardon sait accepter la méchanceté et le transfigurer dans l’acte gratuit de l’amour (p. 368sq). Jankélévitch y reviendra ensuite dans le dernier essai du présent volume.
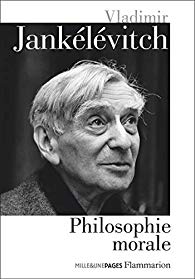
L’austérité de la vie morale aborde des problèmes en apparence plus esthétiques face aux préoccupations morales postérieures à la guerre. Dans ce contexte de reconstruction, Jankélévitch réinterroge le plaisir et ce qu’il rend plaisant face à une société qui refuse la violence tout en se faisant violence – en apparence – pour ne pas céder aux dangereuses compensations d’un plaisir devenu suspect. Cette austérité, dont l’exigence et la revendication viennent généralement dans les périodes de décadence, est dénoncée dans son vide purement violent ; son exigence de privations diverses ne masque que la vacuité des vertus et les valeurs fumeuses. La décadence, en ce qu’elle est une sorte « d’expression à tout prix » (p. 399), retrouve dans son élucidation les problèmes de la « disjonction », et Jankélévitch ne se lasse pas d’en énumérer les exemples, notamment en musique. La décadence n’est cependant pas le mal, mais un moyen de décliner sans s’effondrer, aussi est-ce une sorte de symptôme « d’une civilisation qui se recueille » (p. 414) et qui ouvre ainsi à un nouvel apprentissage, celui d’une nouvelle austérité, cette fois-ci « raisonnable » (p. 419) qui cherche l’apathie ou l’anesthésie – et là-dessus Jankélévitch consacre de superbes pages aux auteurs chrétiens, stoïciens et aux épicuriens -, avant de pouvoir se dépasser dans « l’austérité infinie » (p. 501). Cette dernière cependant ne révèle que la tension entre une austérité morale de défiance et une austérité morale de méfiance (p. 556). Jankélévitch tente de dénouer, expliquer, raccommoder les infinis tours et détours de la conscience pour finir par en constater les « équations approximatives » (p. 557) et trancher à la fin ainsi : « seul l’amour peut avoir le dernier mot dans le débat infini de l’ego voluptueux et de la privation » (p. 580). Car au-delà des dissensions du plaisir et de la douleur, l’amour est cette unité joyeuse, un miracle de coïncidence qui sans repos poursuit sa « satisfaction » (p. 582).
Avec Le pur et l’impur, sans doute l’ouvrage le plus célèbre de Jankélévitch, la plupart des problèmes présents dans les premiers ouvrages sont repris (Cf. sur la mauvaise conscience, p. 685, sq) et portés – si l’on peut dire – à leur quintessence. Il y a une illusion familière de la pureté que Jankélévitch dénonce et déniaise tout au long de cette œuvre, car il y a dans l’homme une sorte de tentative de dédoublement non critique des ambivalences de la conscience ; c’est en fait une conscience de soi à la recherche vaine d’une origine virginale à jamais perdue puisque déflorée dans son intention même, si innocente soit-elle. Mais la condition humaine, loin d’être impure par accident n’est que ce mélange, ce mixte ambivalent. Jankélévitch peut alors dénoncer les attitudes puristes dans toute leur « mauvaise foi », c’est-à-dire leur volonté de liberté qui se la rend impossible : le pur est pur parce qu’impossible (p. 607), c’est le désert normatif de notre impureté structurelle. A partir de là (p. 677), Jankélévitch propose de quitter ces protestations dualistes pour l’acceptation pluraliste qui affirme la complexité – comme Bergson ou Leibniz thématisèrent les « parties totales » (p. 769) – qui se résout ultimement en poésie de l’amour, car « l’amour qui est faire-être retrouve le mouvement fondateur et primordiale de l’initiative créatrice » (p. 808), cette spontanéité innocente qui est la Voie qui se recommence à tout instant, s’improvise dans la conjonction en jeu. Le pur amour en ce sens est un mouvement d’adresse qui dépasse les écueils de l’amour-propre et de l’amour universel informe, il n’est pas un état mais une marche qui se tourne vers l’avant puisqu’il « n’y a pas d’autre pureté que l’amour » (p. 804).
L’Aventure, l’Ennui et le Sérieux, publié en 1963, approfondit encore le temps dans ses trois états en dislocation réciproque. L’aventure tout d’abord, est ce domaine de l’avenir, ce « je-ne-sais-quoi » (p. 829), son mode est l’improvisation qui est cette tentation de son futur qui saisit ses entre-bâillements. Il y a donc des types d’aventure, mortelle, esthétique, amoureuse dans cette épreuve du provisoire qu’est la vie. Viennent ensuite de superbes descriptions de l’ennui, ce vieillissement du virtuel, à travers son angoisse, ce « souci de l’insouciance » (p. 858) – dont on retrouve là encore les dilemmes de la mauvaise conscience avec le remords et le scrupule (p. 860) – qui révèle le vertige devant l’instant (p. 863). Ici Jankélévitch déploie toute sa palette d’érudition littéraire pour décrire les méandres du « Monstre délicat » où les références les plus rares et originales foisonnent non sans délectation afin de faire sentir cet état déboussolé par son absence de cause (p. 904) et son existence indéfiniment ontique. Après s’être efforcé de déployer l’échelle chromatique de ce « mal des calmes plats » (p. 924), Jankélévitch termine sur le sérieux dont les métaphores apparaissent cette fois-ci selon des tonalités étonnamment hégéliennes : mais que les fidèles se rassurent, ce n’est évidemment pas l’écriture du gris sur gris de l’effectivité que Jankélévitch développe ; il ne hisse que l’étendard simple de la positivité qui ne fait que dire sa tautologie, le bégaiement d’une identité (p. 982). Ainsi, le sérieux est-il donc ce « sourire désabusé » et cependant infiniment disponible à l’humour (p. 990).
Avec Le Pardon, publié en 1967, nous abordons le dernier ouvrage proposé dans ce livre qui s’achève sur l’impardonnable et l’équilibre des forces du pardon comme de la méchanceté, fixés en parallèle sans jamais se surmonter. Reprenant les thèmes de L’Austérité de la vie morale et du Pur et l’impur, Jankélévitch dénonce et débusque toutes les formes de pseudo-pardon, d’excuse afin de redonner au pardon toutes ses exigences sans pour autant verser dans le purisme dénoncé plus haut. Là est bien le problème du pardon avec ses formes de clémence pseudo-désintéressées : cette recherche du pardon gratuit doit « dénouer le nœud de la rancune » (p. 1001) et faire justice en remédiant aux « supériorités de fait » (p. 1044) contre les « avocats des brutes
2. Perspectives critiques sur le style de Jankélévitch en philosophie
A l’invite de cette dernière citation, nous aimerions à présent mettre à profit ses « solutions » pour évaluer l’ensemble du contenu proposé.
Lorsque l’on tente de produire la critique d’un livre de philosophie – si celle-ci a la prétention d’être plus qu’une simple fiche de lecture ou note promotionnelle – on s’exerce à pratiquer ses facultés d’appréciation de l’œuvre en fonction de ce qu’elle nous fait percevoir. Et toute grande œuvre nous révèle plus souvent nos impossibilités que nos seules capacités. Un grand philosophe expose donc sa manière de percevoir que le critique apprécie et éventuellement interprète s’il a quelques velléités de dialoguer philosophiquement à travers l’auteur, selon ce qui est perçu et comment l’auteur l’a perçu et exposé. L’appréciation opère donc un jugement de valeur dans ce que lui propose l’auteur, d’abord formellement à partir de la cohérence de l’œuvre elle-même, puis en fonction du thème ou du sujet, et de ce qui a été dit par ailleurs, avant d’éventuellement évoquer un manque ou un aspect peu ou mal développé. En ce sens, le critique est donc dans cette mesure (ou selon cette mesure…) un déficient ou un raté qui se sait raté, ou qui sait ce qu’il a raté par paresse ; il a ainsi acquis la prudence dans ses petits aveuglements et sait en tirer parti pour repérer les zones de ses insuffisances et par là-même, la manière dont un auteur sait éradiquer ou passer ces mêmes zones d’incompétences ou de résistance que la faiblesse du critique constate en lui-même ou dans sa propre copie. L’appréciation du critique ne peut donc jamais prétendre se substituer à la perception de l’auteur sans être injuste, ni même prétendre percevoir avec l’auteur seul sans défigurer celui-ci ou ne faire que de la redite abusive pour se revendiquer de l’œuvre et de son héritage.
Le problème advient cependant lorsque ce que l’on a à critiquer, donc à apprécier, n’est lui-même qu’une simple appréciation dont le jugement de valeur ne fait que simuler un fond perceptif. Avec Vladimir Jankélévitch nous n’avons pas affaire à une stricte perception mais à une appréciation qui thématise le style de celle-ci dans une sorte d’autoévaluation permanente de sa formulation, ou de valorisation exponentielle de son appréciation de certaines qualités perceptives arbitrairement triées sur le volet via la convocation multiples de penseurs conformes et de situations tirées de capricieux plaisirs littéraires.
L’exposition d’une perception en philosophie est la saisie d’une signification qui se détermine dans sa signifiance comme déploiement ou restriction du sens : c’est ce que l’on appelle généralement le concept (ou la raison de la signification elle-même). Lorsque ce concept introduit dans sa réflexion de nouvelles perceptions et l’évaluation de différents domaines de signifiance, on peut considérer que l’exposition philosophique produit un système d’idées ou modes d’évaluations interprétatifs en tant que ceux-ci pensent la relation nécessaire ou le jeu de ces perceptions, ainsi que la cohérence des domaines ou niveaux de sens exposés ou mis en jeu. Un système de penser philosophique intéressant s’évalue donc autant selon ce qu’il embrasse que selon sa puissance à être conséquent dans son développement. Rien n’est pire pour un penseur d’être accusé d’inconséquence et d’incohérence, même si, à l’inverse, notamment avec Heidegger, on peut évaluer aussi la grandeur d’une pensée selon ce devant quoi un penseur a « reculé ». Or, dans un sens comme dans l’autre, on ne peut porter ces accusations sur l’œuvre de Jankélévitch, tout simplement parce qu’elle a dès le départ admis un double discours de cohabitation entre ce qu’il appelle la « conscience » et la « conscience spéculative » (p. 61) et par là, tout n’est ensuite qu’un problème d’expression de cette distance – laquelle ne peut plus être qu’ appréciée – dont toute l’œuvre ne fera que jouer sur toute la gamme et dans tous les domaines.
Mais quand une exposition philosophique n’est que succession descriptive par épuisement constant des déterminations, alors elle n’est pas plus que l’attente du collectionneur, qui se défit de ses passivités dans l’accumulation, la considération multiples d’un objet d’étude jusqu’à l’arlequinade, la fuite foisonnante du divers dans la diversion diverse. Nous croyons reconnaître que tout passe pour un jeu de la variation du penser alors que ce n’est, en fait, pas plus qu’une variété d’opiner.
En lisant Vladimir Jankélévitch, nous apparaît donc le trouble et l’agacement du jeune étudiant de philosophie qui calcule, en même temps que sa moyenne, les effets de son devoir pour valider ses UE semestrielles : il y a là un style qui sait au bon moment poser les questions de ses petits drames personnels en prenant des façons impartiales, avec « le fameux style coulant » qui allie l’apparent concept avec la métaphore, les exclusions subtiles du « on » par les passages élevés au « nous », l’art de la parenthèse noyant la transition réelle d’une idée qui, en réalité, n’est que stylisée, c’est-à-dire luxueusement décorée pour n’être pas développée. On croit voir s’annuler la parade d’opinions mais elles ne font que passer, elles s’évanouissent dans le cours de la discussion – cet art si français indisputé – pour reparaître aussitôt, sans pouvoir s’élucider dans une claire et nette confrontation. Les idées passent à distance, sans distinction, comme par intimidation ou pudique évanescence clair-obscure. Et les prétendus niveaux de sens hiérarchisés ne font que s’étaler dans le scintillement des pages entremêlant les longues dénonciations des reflets de conscience et la recherche permanente du bon mot, du bon aphorisme faussement définitif.
On ne peut de ce point de vue qu’admirer cet art de l’esquive, cette finesse du flou qui sait temporiser dans les références, c’est-à-dire aménager ses rétractations dans l’asile de l’équivoque. Immanquablement, Vladimir Jankélévitch adopte cette stratégie dans la généralité d’une attaque comme par exemple avec Nietzsche : « Nietzsche lui-même qui a l’air de posséder le critérium absolu de la santé, Nietzsche n’a-t-il pas reconnu ailleurs la relativité de ce concept et la vitalité de la déraison ? Nous venons, il est vrai, de comparer la douleur morale à un « raté » de la conscience. Après tout ce n’est peut-être là qu’une façon de parler. Si la vocation de la conscience est cette impartialité idéale qui nous permet d’adhérer aux choses, la conscience morale est assurément une conscience manquée ou incomplète ; mais il peut être plus sage de penser que la conscience morale existe pour elle-même, et non point par rapport à la conscience spéculative – celle qui garde ses distances. » (p. 66).
Dans ce halo de l’aveu de ses vertus, Vladimir Jankélévitch poursuit l’ombre « thèseuse » et propose ensuite de dévoiler à nos yeux les conditions même de « sa façon de parler » : « la conscience morale n’existe pas » (p. 73), puis « la conscience n’est rien en dehors des sentiments cruels qui la manifestent » (p. 73) et enfin « la conscience, tel Janus, a deux visages » (p. 79) et plus tard, dans Du mensonge : « la conscience n’étant pas le clair miroir du monde, mais plutôt le milieu opaque qui altère » (p. 236), ou encore « toute conscience suppose ainsi au-delà d’elle-même une superconscience plus enveloppante qui en serait la conscience. Cette conscience plus qu’odysséenne est la sincérité… j’entends non pas la sincérité « citérieure » de l’innocence, mais la sincérité « ultérieure » pour grands adultes impurs. » (p. 237). Nous étions prévenus dès la couverture du livre sur ces flottements « d’un jeune et brillant universitaire, à la pensée nimbée d’irrationalisme ».
On croit presque entendre du Jules Laforgue :
« Lyres des nerfs, filles des Harpes d’Idéal
Qui vibriez, aux soirs d’exil, sans songer à mal,
Redevenez plasma! Ni Témoin, ni spectacle!
Chut, ultime vibration de la Débâcle,
Et que Jamais soit Tout, bien intrinsèquement,
Très hermétiquement, primordialement! »
Ah! – le long des calvaires de la Conscience,
La Passion des mondes studieux t’encense,
Aux Orgues des Résignations, Idéal,
Ô Galathée aux pommiers de l’Éden-Natal ! »
Et si Vladimir Jankélévitch peut sembler chercher dans ses descriptions une sorte de principe d’individuation des généralités qu’il convoque à travers des exemples littéraires, des bons mots ou expressions toutes faites, on ne voit poindre en réalité que des sensations de situations ou d’ambiances problématiques : c’est en soi déjà extrêmement stimulant ; il est un grand maître en la matière, indéniablement. Jankélévitch atteint ici le type même du chic parisien : s’y opèrent alors les manigances de l’incarnation sans ses modalités, incarnation nue qui perd en chemin ses modes et peut se justifier sans exposer ses raisons dans la mesure où la pseudo-démonstration n’a plus tous les tords puisqu’elle n’a pas donné son prix.
Bien évidemment, face au mensonge, tout ce qui est « technique » devient suspect de collaboration avec lui, et la seule porte de sortie semble s’annoncer dans ce qu’il convient d’appeler là encore la gratuité – ce qui offre à l’autre sans pouvoir payer – le « cœur » : « quelle conscience se fatiguera la première, la frauduleuse qui complique toujours davantage ses logogriphes, ou bien la détective qui les déjoue l’un après l’autre ? ne cherchez pas plus longtemps : il n’y a que l’amour qui puisse avoir le dernier mot ; l’amour seul est capable d’embrasser d’un coup toute la série indéfinie des réductions réflexives et, par une intuition globale, de saisir cette continuité de temps qui définit la personne » (p. 237). Ce fameux « bon cœur » qui dépasse les sophismes de la raison, ce cœur cher à George Sand, car, savez-vous, « tout est simple si le cœur y est, vous avez beau prononcer les paroles de charité, si le cœur n’y est pas, rien n’y est. Si le cœur n’y est pas, tout sonne faux, tout est vicié, faussé, conventionnel et de mauvais aloi, et la componction même que vous y mettez, elle n’est qu’une sécheresse de plus. » (Je ne sais quoi et le presque rien t1, p. 48 cité p. 206)
Si l’on en croit Fontenelle, « Les plaisirs ne sont pas assez solides pour qu’on puisse les approfondir, il faut seulement les effleurer. » : ainsi procède aussi Vladimir Jankélévitch. En permanence, ses propos moraux apparaissent comme une caresse séduisante et allusive, qui sait habilement doser son goût et le sentir sans pouvoir l’approfondir, c’est-à-dire réellement le développer ; au lieu de cela, il s’agit pour Jankélévitch de simplement faire tourner et détailler ses considérations sans chercher la raison de ses modalités. Il sait la faire sentir à travers un art de la fausse question qui s’autovalide dans le style du rassurant « n’est-ce pas ? » où s’étalent les langoureux dialogues soyeux du soi ; ou bien la question truquée qui se nie en invitant une entrée, un approfondissement dont on sent déjà qu’elle est aveugle, en reconnaissant, dans une façon de surprise, un trompe-l’œil pourtant d’emblée pré-aménagé. Et tout au final est justifié, sanctifié dans l’amour, ce commode dépotoir du concept vide, interdisant ainsi par avance toute suspicion sur des résultats qui ne sont, somme toute, que de vastes boursouflures grammaticales injustifiées, un cancer de figure de style hallucinée.
Il y a chez Vladimir Jankélévitch – pour qui Bach était « insincère et inauthentique » et Beethoven « encombré de sociologie et de métaphysique » (Jean-Jacques Lubrina, Vladimir Jankélévitch. Les dernières traces du maître, Félin, 2009, p. 57) – une sorte d’autocommentaire, de dédoublement qui évalue ses mises à distances dans des focalisations d’auteurs convoqués à cette occasion pour diffracter et faire rebondir un soliloque d’intransigeance tout fumant hors de son bouillon de culture d’adjectifs et de faux-semblants. En cela, Jankélévitch se condamne à être plus convaincu que convainquant, et nous n’oserions absolument pas mettre en doute sa sincérité, lui qui disait que « la manière d’être le plus authentique, c’est d’être approximatif » (Cf. Vladimir Jankélévitch, Jean-Jacques Lubrina p. 72).
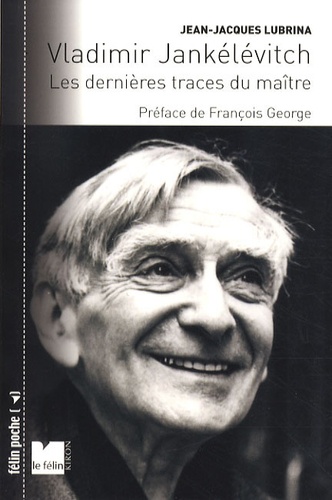
Effectivement, à longueur des 1000 pages de cette compilation, on ne peut que reconnaître, en lisant ces ouvrages de philosophie morale, un art de la variété – de « l’approximation » – qui sait passer pour de la fine modulation ou subtile jeu de la variation puisque, n’est-ce pas, « le but de la morale est de transcender le possible » (Ibid., p. 75), mais nous avouons là, qu’à l’issue de ces mouvements de transcendance amenée par les moyens sûrs de l’approximation, nous n’avons pas aperçu l’ombre d’une nécessité. A la lecture de ces ouvrages de Vladimir Jankélévitch, on constate que s’écrit en contrepoint une sorte de trame industrieuse qui multiplie ses alvéoles melliflues, sait délivrer le brillant culturel qui a su constituer (présenter) sa collection intelligemment, rendre et valoriser son apparent classement, pour que l’invité se glisse dans ce plaisant amoncellement « fluide mais faussement simple » (Cf. Christian Delacampagne, Le Monde, 8 juin 1985) et soit ainsi laissé face à ses impossibilités.








