« Est-il permis de remonter vers sa propre source ? N’est-ce pas comme pénétrer dans un sanctuaire : celui du mystère qui rend muet ? […]
Il y a pourtant une vie, un monde avant la naissance, une préhistoire avant que ne débute notre histoire personnelle[1]. »
Laurence Aubrun
Introduction
Tout part d’un constat : l’enfantement n’appartient pas à la philosophie comme objet propre. Étonnamment, des deux expériences incessibles que chacun est amené à vivre, la naissance et la mort, seule celle-ci a longtemps retenu l’attention des philosophes, jusqu’à ce que la phénoménologie ne s’empare récemment de la première comme thématique philosophique à part entière. Mentionnons ainsi des phénoménologues tels que Claude Romano ou Michel Henry (pour ne citer qu’eux) qui, sous l’angle de l’événementialité ou de la phénoménalité de la vie, ont réfléchi à la question de la naissance et infléchi la vision heideggérienne du Dasein comme « être-pour-la-mort. » Mais pour parler de l’enfantement sans y rester extérieur, il faudrait le point de vue d’une femme, sauf au risque de reconduire au déjà connu cet impensé, en lui faisant perdre sa spécificité. Or, sur le sujet, les femmes hésitent à se hasarder. Pudeur ou tabou ? Toujours est-il que l’obscure question de nos origines intra-utérines se trouve encore trop souvent reléguée dans l’ombre
Il est vrai que parmi les femmes qui ont eu une fécondité de pensée, peu furent mères. Ou bien, frappées du « syndrome Beauvoir », elles se sont censurées sur le sujet[3]. Certes, Hannah Arendt consacre de remarquables passages au fait de la natalité dans son essai La Condition de l’homme moderne. Elle y voit le signe d’une « espérance » porteuse d’une promesse inouïe puisque chaque naissance, en tant que commencement radical, ouvre une infinité de possibles et, par là, initie l’absolument nouveau. La venue au monde d’un petit d’homme déjoue tout fatalisme, fait mentir les prophéties, fausse les pronostics : qui peut dire ce que cet enfant sera ? Personne, pas même le premier concerné. Ainsi l’avenir n’est-il jamais écrit mais toujours à écrire. Parce qu’il est l’imprévisible même, le fait de la natalité est bien ce « miracle qui sauve le monde[4]. »
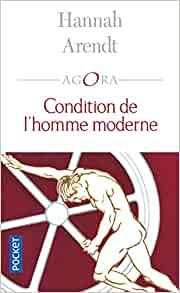
Ces réflexions, ne se focalisent cependant pas sur le processus de l’enfantement mais sur son résultat. Par ailleurs, elles s’insèrent dans une méditation plus large à dimension explicitement politique. La question de la maternité comme vécu, durant la période de grossesse et jusqu’à son terme, reste donc entière en philosophie[5]. Pourtant, la maïeutique, comme art d’accoucher les esprits, est par excellence le paradigme de toute philosophie. Aussi intéressante et parlante que soit cette métaphore, elle ne peut malgré tout rendre compte de la mise au monde que du point de vue de celui qui la facilite du dehors. Or, incommensurable est la différence entre le travail de la femme qui enfante, et celui de la sage-femme qui l’accompagne jusqu’à la délivrance. Auxiliaire du processus, le maïeuticien ne peut le déclencher qu’accidentellement ; il n’a ni le pouvoir de l’interrompre, ni celui de le hâter – sauf à « voler » à la parturiente la joie d’être actrice de la naissance de son enfant. La femme elle-même se trouve relativement impuissante à diriger le cours des choses comme elle l’entendrait, mais elle est pourtant loin de vivre l’événement passivement : c’est par elle et en elle que se joue le tout premier drame de l’existence. Or, la question « qui suis-je ? » peut-elle s’élucider indépendamment de la question : « D’où viens-je ? » Nous avons vécu avant de voir le jour, et bien qu’aucun de nous ne s’en souvienne, cette expérience, gravée à jamais dans les tréfonds de notre inconscient et de notre mémoire somatique, est suffisamment marquante pour qu’on veuille s’y intéresser.
C’est ce qui justifie donc le premier essai de Laurence Aubrun qui, sans avoir la prétention d’épuiser le sujet, relève avec une grande sensibilité le défi d’en dire quelque chose. Mais quels mots trouver pour dépeindre une expérience aussi commune et aussi forte ? Dans cette approche tout à la fois phénoménologique et kinesthésique, la maternité ne nous est pas d’abord présentée comme un droit ou un dû, mais comme un vécu à la limite du dicible. C’est pourquoi, parfois, la poésie le cède aux concepts ; et lorsque le témoignage personnel affleure, c’est sans jamais cesser de tendre à l’universel.
Un monde avant le monde
La remontée vers nos origines va de pair avec la quête du sens à donner à notre existence. Or, parce que celle-ci n’obéit à aucune nécessité, un tel sens ne va pas de soi. L’immanentisme ne peut se satisfaire de la conception théologique de la vie comme don gratuit. Pour recourir à Dieu, une telle conception n’en est pas moins scandaleuse – elle ne le serait même que plus, car le revers de cette gratuité est qu’elle semble bien avoir le visage de l’arbitraire. Mieux vaut au contraire assumer courageusement, avec lucidité, notre facticité ontologique.
L’existentialisme athée d’un Sartre par exemple, nous a habitués à cette conception tragique de l’existence dans laquelle nous voilà « jetés » comme une « passion inutile. » Nous sommes alors que nous aurions pu ne pas être. Sans justification possible. Aussi cette absence de raison d’être frappe-t-elle notre inexplicable contingence au sceau de l’absurde. Ad nauseam. En ce monde, radicalement indifférent à notre condition, ainsi que le découvre Roquentin avec une acuité blessante, rien ne peut racheter l’homme du fait d’être ni même lui assurer qu’il est bon d’être. Serions-nous en trop ?
Or, la réflexion menée par Laurence Aubrun sur l’enfantement permet d’envisager les choses d’un autre point de vue, jusqu’à un renversement de perspective qui sauve en quelque sorte notre venue au monde de l’arbitraire. Il y a quelque chose de juste, sur le plan métaphysique, à penser le délaissement de l’être-dans-le-monde, et l’angoisse qu’un tel délaissement suscite. Sur le plan existentiel en revanche, quant à notre vécu, il en va tout autrement : chacun de nous a connu, avant de naître, une relation fusionnelle, extraordinaire d’intimité, au sein même d’autrui. Chacun est sorti d’une enceinte protectrice. Nous n’avons peut-être pas tous été désirés, mais nous avons tous été portés, enveloppés dans les entrailles maternelles.
« L’humanité prend sa source dans le corps des mères. […] Cette origine nous est commune. La maternité nous dit que nous prenons chair dans le corps d’une autre. La première de toutes les relations que nous vivons, la relation originaire, c’est d’être conçu, enfoui, formé, englobé, porté, ballotté dans le corps d’une femme, puis d’être livré entre ses cuisses et recueilli par des mains, tenu dans des bras, déposé sur un ventre, lové contre un sein. Tout dans cette origine est chair et mélange, chaleur, intimité, caresse. […] Nous sommes tous issus de ce long et puissant corps à corps[6].
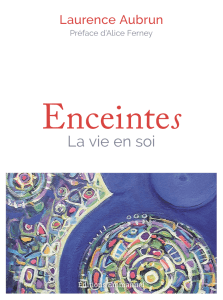
Il en est qui meurent seuls, mais nul ne peut naître seul. Lorsque nous naissons, autrui est toujours déjà donné, précédant notre venue attendue, présent pour nous et avec nous. Considérer que l’esseulement est indépassable et constitutif de notre humaine condition, c’est ne pas voir que tout nouveau-né fédère autour de lui une communauté de parents et de proches qui, à l’annonce de son arrivée, se rassemblent pour le célébrer. Même lorsqu’il est impossible de publier l’événement, il n’en demeure pas moins que pour une personne au moins, celui-ci sera enregistré. Il est pour tout homme une femme qui garde en mémoire le souvenir de sa venue. Plus que cela : dont la chair est la mémoire de celui qu’elle a porté. Ainsi le monde n’est pas notre première demeure : notre habitacle originel, c’est cet autre féminin qui l’a fait de son propre corps et nous a laissés l’assiéger. Aussi nous faut-il chercher ailleurs que dans notre rapport au monde l’archè de toute connaissance – co-naissance ? –, en replongeant à l’aube de notre existence dont notre mère fut le berceau. Comment rendre compte de l’inédit d’une telle relation ?
Je est un autre
Si la philosophie accorde la part belle à autrui – tour à tour envisagé comme prochain, antagoniste, auxiliaire, alter ego, ami, étranger, âme sœur etc. –, elle est restée silencieuse, en revanche, sur cet autre si particulier qu’est l’enfant à naître. Laurence Aubrun consacre la première partie de son essai à tenter de décrire la relation qui le lie à sa mère, relation incomparable à bien des égards parce qu’elle ne peut en rien être reconduite à un autre type de rapport interpersonnel.
En effet, note l’auteure, le schème de l’extériorité ne fonctionne plus ici. Habituellement, l’autre est celui que je rencontre dans le monde, c’est-à-dire, littéralement, que je trouve sur mon chemin. Cette rencontre peut avoir lieu parce qu’existe entre lui et moi une irréductible distance, qui permet le face-à-face, l’échange, l’étreinte ou l’altercation. Mais c’est à cause de cette distance que son intériorité demeure impénétrable à toute investigation. Si je comprends autrui, ce ne peut donc être que par analogie. Dans cette compréhension, le regard joue un rôle primordial : c’est essentiellement grâce à la vue qu’il m’est donné d’interpréter son allure, ses attitudes, ses émotions ou tics d’expression. Dans la rencontre, nous nous laissons mutuellement dévisager.
Rien de tel dans la relation matricielle, que nous appelons ainsi pour mettre en lumière qu’il s’agit bien sûr du lien mère-enfant, mais aussi que ce lien « révèle plus profondément l’archétype d’une autre forme d’altérité[7]. » Cette fois, l’autre dont je ne sais rien hormis qu’il existe, est plus intime à moi-même que moi-même. Nous cohabitons sans nous connaître, nous nous sentons vivre sans nous être jamais vus. Je ne me confonds pas avec lui et pourtant, je le comprends. Nous vivons une communion davantage qu’une fusion stricto sensu, au sens où chacune de nos individualités est maintenue et préservée dans l’imbrication la plus extrême de nos deux chairs. Plus totale et moins éphémère que dans l’union sexuelle, cette rencontre me donne d’accueillir, au cœur de mon être, non pas un autre, mais le tout-autre. Si difficile à imaginer, avec son invisible visage et son corps que je ne pourrai toucher qu’au travers du mien. Il m’échappe radicalement, mais je ne peux y échapper. Que j’y pense ou non, que je le veuille ou non, toujours j’ai affaire à lui :
« Nous sommes l’un pour l’autre une présence invisible et constante, sans distance. Il n’est pas besoin de se chercher pour se trouver : l’autre est le toujours-là, le tout-contre, l’inséparable. Je suis pour lui un monde vivant et singulier, dans lequel il est englobé[8]. »
Quel mot dira l’intensité d’une telle interdépendance ? Assurément, « l’expérience de la maternité vient bousculer la représentation d’un individu fermé sur lui-même, isolé et unifié » : elle nous dévoile au contraire que nous sommes « ouverts, entrelacés, pétris les uns des autres[9]. » De quoi remettre sérieusement en cause le solipsisme et conjurer la tentation de vouloir être causa sui. Selon la formule de Ricoeur, « Je ne me pose pas moi-même, j’ai été posé par d’autres[10]. » C’est pourquoi, contre et Husserl, pour qui l’alter ego est toujours second, réhabilité à grand prix après avoir été « suspendu » de l’horizon du je et même mis en doute quant à son existence, Laurence Aubrun préfère convoquer Mounier qui, à l’instar de Buber, donne la préséance à autrui. Dans Le Personnalisme, voici ce qu’il écrit :
La personne « n’existe que vers autrui, elle ne se connaît que par autrui et ne se trouve qu’en autrui. L’expérience primitive de la personne est l’expérience de la seconde personne. Le tu, et en lui le nous, précède le je, ou au moins l’accompagne[11]. »
Le fait de naître d’autrui contredit donc la conception solipsiste de l’être humain. Nous ne sommes pas des monades inviolables, renfermées chacune dans son quant à soi, juxtaposées les unes aux autres comme autant de « touts » clos qui, accidentellement, se heurteraient sans compénétration possible. Il y a en un espace destiné à l’accueil ; que cet accueil devienne effectif ou demeure un possible toujours ouvert ne change rien au fait qu’existe en elle une disponibilité essentielle à autrui. Même si l’esprit l’élude, le corps le sait et en parle : ses rappels réguliers attestent que la disponibilité dont nous parlons est avant tout charnelle et non pas psychique, inscrite au cœur de l’être féminin comme principe et fin. Ce que nous voulons dire par là, c’est qu’il s’agit de bien plus que d’une simple aspiration, mais d’une disposition profonde, d’une orientation fondamentale de , à devenir réceptacle d’un autre. De là un mode d’être-au-monde bien spécifique que la grossesse vient mettre en lumière.
Attendre et co-naître
L’avènement d’un autre que moi en moi est un événement qui vient enrayer l’éternel retour du même : la ronde de mes cycles se brise soudain au moment où ce qui n’était pas et est encore si peu de chose advient. Incognito. En moi, sans moi. Sans que je le sache, sans que je puisse en prendre conscience. Je peux le pressentir, l’appréhender, l’espérer : toujours est-il que cet instant charnière m’échappe. Tout bascule alors… immanquablement. Il n’y aura pas de retour en arrière possible. Peut-être interruption, spontanée ou provoquée, du cours naturel des choses. Mais pas de statu quo ante. Le processus est enclenché, le compte à rebours déclenché. Je ne serai plus jamais la même…
Déréglée, sans horloge interne : mon rapport au temps s’en trouve aussitôt bouleversé. Je découvre l’arythmie, l’effet que produit le fait de vivre sans marqueur temporel régulier. La roue cesse de tourner, le temps qui, jusqu’alors, s’enroulait sur lui-même, au rythme des lunes et à l’instar des saisons, peut enfin se déployer sur une ligne. Ligne de fuite, qui dessine un horizon avec un « plus un » : « en moi se lève l’aube de l’humanité à venir[12]. »
La grossesse m’installe en outre dans cette temporalité bien particulière qu’est l’attente. Ou plutôt non, je ne suis pas installée mais toute tendue vers ce terme que j’appréhende intuitivement comme une co-naissance. Dans l’attente, mon désir s’attise de rencontrer cet enfant, chair de ma chair, avec qui j’apprends à vivre avant même de le voir, et dont la croissance en moi me révèle sous un jour nouveau. On penserait à tort que l’attente est un temps vide, une période pendant laquelle il ne se passe rien. Bien au contraire : dans l’attente, je tiens déjà ce qui n’est pas encore là. Je n’attends pas un absent qui tarde à venir : j’espère quelqu’un déjà présent, que bientôt je sentirai, avec qui j’entrerai en relation de manière privilégiée. Ses contours sont encore à l’état d’ébauche, frêle est cette forme à peine esquissée. J’essaie de me figurer à quoi, à qui cette fragile humanité pourra ressembler. En vain. Mes mains prennent alors le relai et « voient » l’indiscernable qui se dérobe à mes yeux. Il y a… C’est immensément ténu, mais bien là, incontestablement. Il y a… La perception de ces – ses – mouvements me fait vivre « une épiphanie secrète[13]. » Au creuset de l’attente se forge ma patience, tandis que je m’emplis de la lourde promesse de vie qui se réalise en moi. Sens de la présence de cet être en devenir, le toucher me donne ainsi d’anticiper l’instant de notre premier face-à-face et de (res)sentir l’invisible.
S’ils ne peuvent être repris tels quels pour être calqués sur une expérience incomparable, ces développements offrent néanmoins la possibilité d’éclairer ce qui se joue pendant cette période d’intimité sans pareille : à savoir, la coexistence de deux êtres distincts et irréductibles l’un à l’autre, qui, pour avoir chacun son rythme propre, vivent en même temps en parfaite symbiose. Même si elle est non-verbale, la communication existe bel et bien entre eux. À l’échange de paroles se substitue un autre langage des corps que celui des amants. C’est ce qu’ont confirmé les recherches en haptonomie, discipline qui, au terme de « toucher », préfère celui de « tact », plus à même de rendre compte de la capacité d’un être à entrer en relation. Connoté psychologiquement, le tact est intuition, finesse, délicatesse. C’est donc non seulement le sens de la proximité, mais plus encore, paradoxalement, le sens de la juste distance à tenir pour préserver ce qui, touché, demeure et doit demeurer intouchable. Aussi n’est-il pas anodin que le toucher soit particulièrement sollicité au cours de la vie intra-utérine, s’il est vrai que c’est par lui que nous accédons à la pudeur comme « sens de l’intime » tout autant que « tact de l’âme[14]. »
[1] Laurence Aubrun, Enceintes. La vie en soi, Emmanuel, 2021, p. 21 et 23.
[2] Cela dit, reconnaissons que les récentes études du care tendent à revaloriser la maternité dans leur analyse de la féminité. Cette recension, sans prétendre nullement à l’exhaustivité, n’y fera pas référence – non par désintérêt, mais pour respecter les choix de l’auteure qui a opté pour une autre approche du sujet.
[3] Pour Simone de Beauvoir, la maternité prend une tournure si négative que le fœtus est assimilé à un parasite se nourrissant de la chair de sa mère au point de menacer sa vie propre : « Le fœtus est une partie de son corps, et c’est un parasite qui l’exploite […] Jour après jour un polype né de sa chair et étranger à sa chair va s’engraisser en elle […]. » Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, II, 1949, Gallimard, p. 156-159.
[4] Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, Pocket, 1994, p. 314.
[5] Les différents féminismes n’ignorent certes pas ce fait, mais leur approche est tout autre. La maternité y est souvent décriée comme l’asservissement de la femme par l’homme dans le modèle patriarcal ; elle apparaît rarement choisie mais plutôt subie, et donne ainsi lieu à des revendications pour que la femme se réapproprie son corps comme « choix », en dispose et en jouisse librement. L’essai que nous présentons ici n’entre pas dans l’exposé de ces revendications mais opte pour une approche phénoménologique de l’enfantement. Volontairement, l’auteure se tient à l’écart des polémiques féministes : son propos se veut descriptif et non pas normatif.
[6] Laurence Aubrun, op. cit., p. 28.
[7] Ibidem, p. 25.
[8] Laurence Aubrun, op. cit., p. 163.
[9] Ibidem, p. 26.
[10] Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté, t. I « Le volontaire et l’involontaire », Aubier, 1988, p. 415.
[11] Emmanuel Mounier, Le Personnalisme, 1949 – cité par Aubrun, « Enfanter l’homme », art. cit., p. 4.
[12] Aubrun, op. cit., p. 51.
[13] Ibidem, p. 93.
[14] Nous renvoyons ici aux analyses phénoménologiques et théologiques de Marguerite Léna sur la pudeur (qu’elle appuie sur trois auteurs en particulier : Max Scheler, Vladimir Jankélévitch et Vladimir Soloviev). Cf. art. « La pudeur, « sentinelle de l’invisible » », in Collectif, Revue théologique des Bernardins, n°2, Lethielleux, juin 2011.








