Martin Heidegger : Réflexions XII-XV. Cahiers noirs (1939-1941) (partie 2)
D : La guerre, la guerre totale, la guerre mondiale
Les cahiers noirs des années 39-41 constituent de véritables carnets de guerre. Il s’agit pour Heidegger d’utiliser sa pensée de l’histoire de l’Être, essentiellement sa pensée de la Machenschaft, pour dégager le sens de la guerre en cours. La nouvelle inflexion prise par sa pensée de la Machenschaft vers la question de la puissance, depuis les cours sur Nietzsche, lui permet de comprendre cette guerre comme accomplissement du règne de la puissance, c’est-à-dire d’une puissance qui veut la puissance sans limite : « la puissance est chaque fois volonté de surpuissance qui va vers toujours plus de puissance en se surpassant elle-même » (p. 22), « la puissance passant inconditionnellement à la pleine puissance jusqu’à devenir violence sans limite » (p. 29). Chacun des belligérants est un visage de cette puissance inconditionnée qui lutte pour la domination de la Terre. Heidegger pense la guerre à travers plusieurs concepts, essentiellement le couple conceptuel destruction (Zerstörung)/dévastation (Verwüstung), mais aussi l’anéantissement (Vernichtung) compris comme un auto-anéantissement (Selbstvernichtung), et le bouleversement (Umwälzung et Umbruch).
« La dévastation invisible sera dans cette deuxième guerre mondiale plus grande (elle aura plus d’impact) que les destructions visibles » (p. 166).
« la dévastation invisible pèse d’un plus grand poids que les destructions visibles » (p. 178).
« sache y reconnaître non pas d’abord ni seulement une destruction, mais bel et bien la dévastation, dont les catastrophes de la guerre (Kriegskatastrophen) et les guerres-catastrophes (Katastrophenkriege) n’ébranlent plus le règne mais ne font que le confirmer » (p. 62).
« Les destructions extérieures ne sont que les suites tardives d’une dévastation qui déjà est à l’œuvre » (p. 263)
Qu’est-ce que la Seconde Guerre Mondiale, selon Heidegger ? Voici ce qu’il écrit dans Réflexions XIV : « L’actuelle guerre mondiale est le bouleversement extrême de tout étant, livré au règne inconditionnel de la Machenschaft » (p. 194). C’est la pensée de la Machenschaft qui permet de comprendre la Seconde Guerre Mondiale comme l’accomplissement de cette essence des temps modernes. La Machenschaft est puissance, car elle est puissance de calculer, représenter, de manipuler, de transformer, de produire, d’organiser, de planifier l’étant, et donc aussi de le détruire. Par conséquent, le mot « destruction » signifie pour Heidegger une destruction de l’étant. Seul l’étant peut être détruit. La guerre mondiale est destruction en masse de l’étant (êtres humains, bâtiments, matériel…) par les moyens de la technique contemporaine sous sa forme militaire. Les destructions de l’étant sont « visibles », elles sont ce qui apparaît sur le théâtre de l’histoire du monde, sur le plan ontique des faits dont l’Historie tient le compte. Qu’est-ce alors que la dévastation ? La dévastation est à l’Être ce que la destruction est à l’étant, ce qui apparaît le plus clairement dans ce passage de Réflexions XIII : « « La dévastation invisible de l’essence de l’Être, qui a déjà surpassé toute destruction de l’étant » (p. 175). Si Heidegger appelle à ne pas s’en tenir aux destructions visibles, c’est pour passer sur le plan invisible de l’histoire de l’Être, accessible uniquement à la méditation, où n’a lieu aucune destruction, mais où a lieu la dévastation de l’essence de l’Être, qui est le plan essentiel, celui qui « pèse d’un plus grand poids », qui « aura plus d’impact », car les catastrophes de la guerre, donc les destructions, ne font que la confirmer, c’est-à-dire en procèdent et ne peuvent pas la surmonter : « Guerres et révolutions restent elles aussi des données circonstancielles occupant le plan superficiel » (p. 157). Qu’est-ce alors que cette dévastation de l’essence de l’Être ? C’est le par. 8 des Réflexions XII qui le dit le plus clairement en repartant de Nietzsche et de sa caractérisation du nihilisme par la formule : « Le désert croît ». Il faut entendre le désert (Wüste) dans la dévastation (Verwüstung), et donc l’entendre comme une désertification, un devenir-désert. Dans Die Geschichte des Seyns (Ga 69, p. 48), Heidegger écrit : « L’anéantissement complet est la dévastation au sens de l’installation du désert ». Dans Réflexions XII, il écrit que « Nietzsche, en une pensée devancière, s’est engagé dans le désert de cette dévastation (die Wüste jener Verwüstung) qui intervient quand la Machenschaft prend une forme inconditionnelle » (p. 31). Comme chez Nietzsche, ce désert est l’image du nihilisme, mais cette fois-ci entendu au sens heideggérien comme l’abandon de l’étant par l’Être, l’absence de sens, qui livre l’étant à la Machenschaft. Mais le nihilisme est désert car « le désert est l’enlisement et la dispersion de toutes les possibilités de la décision essentielle » (p. 31). Plus loin il ajoute : « la dévastation du désert (der Verwüstung der Wüste) (de la complète absence de tout besoin d’en venir à une décision) » (p. 32). La dévastation est donc l’abandon de l’étant par l’Être, l’oubli de l’être, mais en tant qu’il laisse l’humanité dans un état de détresse dont elle n’a même pas conscience, c’est la détresse de l’absence de détresse, de sorte qu’elle se satisfait de cet état et s’y embourbe, se refusant à préparer la décision. Ce faisant, « la dévastation ensevelit la possibilité du déploiement d’un commencement » (p. 281), elle est « la dé-vastation (Ver-wüstung) de toute possibilité de l’Être ramenée à ce produit fabriqué de la puissance qu’est l’étant tout de faisabilité – productible et représentable » (p. 72). L’étant est destructible, l’Être est indestructible, mais « la dévastation a le pouvoir d’anéantir l’indestructible » (p. 281). La décision est donc « une lutte dont l’enjeu est de savoir si l’humanité restera esclave de la dévastation » (p. 196).
La Seconde Guerre Mondiale comme destruction extrême de l’étant par la Machenschaft est donc ce qui est visible, sur le plan de l’étant, de cette dévastation invisible de l’essence de l’Être, et elle ne peut rien régler en elle-même, elle ne peut pas surmonter le nihilisme qu’elle ne fait que confirmer, elle n’est pas en elle-même la décision qu’il s’agit de préparer par la méditation, et elle ne fait pas naître par son ébranlement de l’étant la méditation chez les hommes : « De la seule guerre, et surtout de ce genre de guerre qui, dans l’époque du délaissement par l’être, éclate et ne peut éclater que sous le régime de la Machenschaft, une pensée qui médite le sens ne peut jamais prendre essor » (p. 132). Heidegger en voit la confirmation dans le fait que
« la Première Guerre mondiale, malgré le sacrifice le plus sanglant, n’a jamais eu le pouvoir d’éveiller aucune pensée méditante » et il voit en elle « à son paroxysme, le premier cas d’école de la Machenschaft absolue, de ses procédures d’organisation et de dressage ».
Le par. 113 de Réflexions XIII montre en quoi la Machenschaft pousse nécessairement à la guerre. Heidegger voit dans l’époque moderne le triomphe du règne de la vie au sens de l’animalité de l’animal rationnel, et cette vie cherche la croissance de son niveau de vie et défend envers et contre tout ses intérêts vitaux. Il écrit « notre « peuple » » (p. 158), et Heidegger parle ici des Allemands mais met des guillemets au mot peuple car, à l’époque de la modernité triomphante, il n’y a plus de peuple, il n’y a que des masses organisées par la Machenschaft. Ce « peuple », donc, veut alors « disposer d’une étendue, de matériaux, de transports », et les exigences de satisfaction de ces intérêts vitaux deviennent sans limite, conformément à la figure de la puissance qui se veut sa puissance illimitée. Dès lors, ce processus d’illimitation de la puissance la conduit nécessairement à « la confrontation avec les ci-devant titulaires de la « domination mondiale » » (p. 159), et Heidegger pense sans doute ici à l’Angleterre et à la France, qui dominent le monde par leurs empires coloniaux, ce paragraphe étant écrit pendant la drôle de guerre. On pourrait croire que le conflit éclate parce que ces titulaires ont trop, alors que l’Allemagne n’a pas assez, et c’est bien ainsi que Hitler justifie ses invasions. Or, Heidegger refuse cette explication/justification de la guerre, qu’il juge manifestement superficielle. Le conflit éclate nécessairement parce que ces titulaires, les démocraties libérales anglaises et françaises, sont restées à la traîne « au regard de la seule et unique manière dont la puissance inconditionnelle peut être intégralement obtenue en tant que puissance ». Cette manière est « le despotisme qu’impose le socialisme conçu comme métaphysiquement inséparable de la Machenschaft ». Il s’agit là du socialisme autoritaire, donc du national-socialisme, qui constituerait donc une longueur d’avance dans le règne de la puissance sans limite et se sentirait alors suffisamment puissant pour entrer en guerre contre ceux qui restent à la traîne. Le conflit se transforme en guerre, parce que c’est la « guerre qui seule peut satisfait le caractère d’inconditionnalité que revêt la Machenschaft ». On le voit, Heidegger explique la guerre à partir d’un processus impersonnel aveugle et nécessaire, celui de l’accomplissement des temps modernes sous la figure de la puissance sans limite, pas à partir de caractéristiques psychologiques des dirigeants, raison pour laquelle il écrit que la guerre « n’a pas sa cause profonde dans la violence, dans l’avidité et le désir de briller d’individus particulier ». On pourrait voir dans cette manière de penser la guerre un risque de déresponsabiliser les agents qui font l’histoire en considérant qu’ils ne sont que les esclaves d’un processus qui les dépasse et dont ils n’ont pas conscience, comme si Hitler n’était pas réellement coupable de ses crimes contre la paix. Mais le marxisme lui-même explique le déroulement de l’histoire, les actions individuelles des dirigeants, et même le déclenchement des guerres, à partir d’un processus économique et social impersonnel et nécessaire, et il ne s’agit pourtant en aucun cas par-là d’excuser quoi que ce soit. Comme le marxisme considère que l’infrastructure matérielle invisible est plus décisive que ce qui, de l’histoire du monde, est visible, Heidegger considère que c’est le plan invisible de l’histoire de l’Être, celui de la dévastation comme règne de la Machenschaft, qui pèse d’un plus grand poids que celui des destructions visibles sur le plan de l’étant. Cette pensée de la puissance comme processus impersonnel nécessaire dont les individus sont les esclaves n’est pas sans évoquer la pensée du pouvoir de Foucault, et il est vrai que « Macht » pourrait tout aussi bien être traduit par « pouvoir », et que Foucault fut un lecteur des deux volumes du Nietzsche dans lesquels Heidegger élabore sa pensée de la Macht à partir de l’interprétation de la volonté de puissance chez Nietzsche.
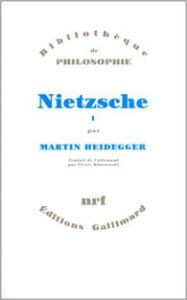

Essentiel est le par. 114 dans lequel Heidegger s’oppose à Clausewitz, qui définit dans Vom Krieg la guerre comme « la simple continuation de la politique par d’autres moyens », soumettant ainsi la guerre à la politique et à ses objectifs. Heidegger affirme que ce n’est plus vrai « quand par « guerre » on entend la « guerre totale (totalen Krieg) » » (p. 160). Heidegger ne forge pas ce concept. Il a été utilisé après la première guerre mondiale pour en montrer la spécificité. Ainsi, Erich Ludendorff, qui fut général en chef des armées allemandes pendant la première guerre mondiale, publie en 1935 Der totale Krieg, et peut-être Heidegger l’a-t-il lu, dans lequel, par le concept de « guerre totale », il remet en cause la primauté du politique sur le militaire qu’on trouve chez Clausewitz, en s’appuyant sur son expérience de la première guerre mondiale. Car quand la guerre est « totale », c’est alors le politique qui est soumis au militaire et aux objectifs militaires, la société toute entière devant être enrégimentée pour l’accomplissement de ces objectifs. Quand Heidegger évoque dans ce par. la guerre totale, il pense sans doute d’abord à la première guerre mondiale, celle dont il a dit plus haut qu’elle fut « à son paroxysme, le premier cas d’école de la Machenschaft absolue, de ses procédures d’organisation et de dressage », et cherche à penser ce que va être la seconde, qui n’en est encore qu’à la phase d’attente de la drôle de guerre. Si, comme Ludendorff, Heidegger conteste la célèbre caractérisation de la guerre par Clausewitz, ce n’est pas seulement pour voir dans la guerre totale la soumission de la politique au militaire, mais pour voir dans la guerre une réalisation de la Machenschaft (« la « guerre totale », autrement dit celle qui a sa source dans la Machenschaft » (p. 160)), et du même coup la mutation de la politique qui révèle qu’elle n’est plus que « la véritable exécutrice de la Machenschaft » (p. 61) qui organise, dresse, planifie les masses dans un accroissement sans limite de la puissance auquel la contraint la guerre totale pour la réalisation de ses objectifs. Heidegger ajoute que cette guerre n’admet plus de vainqueur ni de vaincu, non pas parce que l’un comme l’autre subiraient des destructions trop importantes pour qu’il y ait véritablement une victoire, mais parce que « tous deviennent esclaves de l’histoire de l’Être » (p. 160), autrement dit esclaves de la Machenschaft dont ils ne sont que les exécutants et qu’ils ne surmontent pas dans la décision pour l’autre commencement. Il n’y a ni vainqueur ni vaincu parce que, du point de vue de l’histoire de l’Être, ils demeurent dans l’indécision, dans ce que Heidegger a appelé le désert de la dévastation où l’étant est abandonné par l’Être et prend le visage de la Machenschaft. Heidegger devrait peut-être plutôt dire que s’il y a victoire et défaite sur le plan de l’étant, il n’y a que des vaincus sur le plan de l’histoire de l’Être, car c’est toujours la Machenschaft qui est victorieuse. Heidegger peut donc répéter que la guerre ne fait pas surgir la méditation qui, seule, prépare la décision, ce qui est sans doute une manière aussi de s’opposer à toute glorification philosophique de la guerre (il faudrait ici citer tous ces passages de Ga 96 où Heidegger s’en prend à Jünger et à l’héroïsme, qui sont peut-être aussi encore une manière de s’en prendre à l’idéologie nazie). Il s’oppose alors implicitement à une certaine entente d’Héraclite en soulignant que « la lutte en tant que guerre n’est pas le « père » de toute « chose » » car « elle n’est jamais le producteur et le dominateur de l’Être, mais toujours et seulement de l’étant » (p. 161). Non seulement la guerre totale ne suscite pas la méditation, mais elle exerce même une contrainte qui travaille à l’abattre, dit le par. 121 : « Le cours de la guerre ne réside pas dans les « opérations », dans l’« explosion » des bombes et l’anéantissement d’escadres – mais bien plutôt et uniquement dans la contrainte (Verzwingung) qui sans fracas, imperceptiblement, travaille à couvert de tous côtés par l’entremise de la presse et du bruit de fond de la radio, à abattre toute tentative d’une méditation essentielle interrogeant et prenant la mesure de l’histoire dans son essence » (p. 164-165). Les explosions de bombes et l’anéantissement des escadres, ce sont les destructions visibles de l’étant. La contrainte exercée par la presse et la radio, donc par l’emprise technique de la Machenschaft, qui empêche toute méditation, donc maintient l’indécision, c’est le désert de la dévastation, la dévastation invisible qui, selon le par. 124, « sera dans cette deuxième guerre mondiale plus grande (elle aura plus d’impact) que les destructions visibles » (p. 166). Il était déjà question de cette contrainte à l’absence de méditation dans le par. 128 consacré au « communisme », où Heidegger affirmait qu’il consiste « dans le fait que tous sont soumis à la même contrainte (Verzwingung) qu’exerce sur eux le pouvoir inconditionnel des peu nombreux qui ne sont pas nommés, et que l’absence de toute décision (l’interruption de toute possible croissance d’une décision et de toute prise en charge de cette même décision) devient l’atmosphère que tous respirent » (p. 168). Et la guerre totale exerce cette contrainte en cela qu’elle mobilise tout à son service et « doit nécessairement anéantir et faire cesser tout ce qui ne se met pas » à son service, à savoir la méditation, en considérant qu’il est un « préjudice causé à la nation et à sa capacité défensive » (p. 165).
Le par. 121 se termine sur un passage très important :
« Ce que nous avons apporté aux Tchèques et aux Polonais, l’Angleterre et la France voudraient bien en faire profiter les Allemands ; il reste que, dans une Allemagne détruite, la France pourrait maintenir son absence de toute histoire – l’Angleterre, ce serait dans une gigantesque entreprise commerciale ; cependant que l’Allemand à venir est voué à endurer l’attente d’une autre histoire – car sa pensée est dans la transition vers la pensée qui médite » (p. 165).
Ce que les Allemands (« nous ») ont apporté aux Tchèques et aux Polonais, c’est l’invasion et l’occupation. Heidegger est donc en train d’écrire que l’Angleterre et la France voudraient envahir et occuper l’Allemagne, et en effet ils lui ont déclaré la guerre en septembre 39 suite au déclenchement par l’Allemagne de l’invasion de la Pologne, et ce paragraphe est écrit pendant la Drôle de guerre où l’Europe vit dans l’attente de l’affrontement entre l’Allemagne d’un côté, la France et l’Angleterre de l’autre. Dans quel camp Heidegger se place-t-il ? Tous les belligérants sont réduits par la pensée de l’histoire de l’Être à n’être que des visages identiques de la Machenschaft, des puissances aspirant à la puissance sans limite. Dès lors, Heidegger devrait ne pas prendre parti et considérer que la victoire de telle puissance sur telle autre est indifférente sur le plan de l’histoire de l’Être, car elle ne fait que maintenir le règne de la puissance (la Machenschaft). Or, ce n’est pas ce qui se passe, la préférence de Heidegger va à l’Allemagne contre la France et l’Angleterre. Il faut à tout prix que l’Allemagne ne soit pas détruite, car c’est dans le Deutschtum que réside la possibilité de la transition vers l’autre commencement de l’histoire, donc le surmontement de la dévastation, du fait que le poète de l’autre commencement, Hölderlin, et que le penseur de l’autre commencement, Heidegger, sont allemands, et ce sont eux les Allemands « à venir (zukünftig) », c’est-à-dire tournés vers l’avenir pour le préparer. À l’inverse, l’Angleterre et la France sont caractérisées par « l’absence d’histoire (Gechichtlosigkeit) ». C’est en réalité une caractéristique de la modernité dans son ensemble, et l’Allemagne nazie ou l’URSS sont tout autant dans l’absence d’histoire, raison pour laquelle Heidegger peut écrire que c’est seulement « autour de l’an 2300 au plus tôt, [qu’] il y aura peut-être à nouveau histoire » (p. 246), histoire signifiant nouveau commencement de l’histoire. Mais l’Allemagne nazie (et la Russie bolchevique) tiendrait en réserve une possibilité d’un nouveau commencement de l’histoire, ce qui ne serait pas le cas de la France et de l’Angleterre. La modernité, sous la forme du nazisme et du bolchevisme, sont des défigurations du Deutschtum et du Russentum. À l’inverse, l’accomplissement des temps modernes ne serait pas une défiguration de ce que sont la France et l’Angleterre, il serait bien plutôt la révélation de leur essence. France et Angleterre ne contiendraient donc aucune possibilité de commencement en réserve, car ce serait leur commencement qui est à l’œuvre dans la modernité.
Les passages consacrés à la France sont peu nombreux mais importants. D’abord celui consacré au sens historial de la révolution française :
« « Travail », « prospérité », « culture » et « raison » sont les « idéaux » de la Révolution française. Dans la mesure où ces idéaux sont rendus « totalement » effectifs pour les « masses » comptées en « millions » et où toutes les bornes et distinctions sont tombées, c’est cette révolution qui, avant tout autre, prend forme effective. C’est, dans les temps modernes (Neuzeit), ce qu’il y a de plus nouveau (neu), parce que c’est en eux l’élément premier et, pour cette raison, ultime ». (p. 224-225)
Déjà p. 152, quand Heidegger évoquait une révolution occidentale à venir qui serait le plein accomplissement du règne de la puissance, il affirmait que « dans la révolution occidentale qui s’avance, les premières révolutions des temps modernes (les révolutions anglaise, américaines, françaises et leurs répliques) sont pour la première fois seulement portée dans leur essence ». Les temps modernes sont donc foncièrement français et anglais pour Heidegger, à tel point que si le national-socialisme appartient aux temps modernes, il peut voir en lui quelque chose de non-allemand, et ainsi refuser un peu vite (c’est un euphémisme) au nazisme tout enracinement réel dans le Deutschtum. Dans un par. essentiel de Réflexions XIV, Heidegger affirme que tous les traits essentiellement modernes de la politique nazie viennent en fait de la modernité et d’autres pays que l’Allemagne, y compris ses ennemis :
« La défaite la plus grande, parce que proprement historiale, consiste en ce qu’un peuple se soumette aux étalons de grandeur et aux exigences déjà en vigueur d’un adversaire, et fasse siens ses principes et doctrines (sans le déclarer tout haut, ou en les formulant autrement). Ici se produit le renoncement dont la portée s’étend très loin : on renonce à devenir un commencement où un unique essentiel est fondé.
« Politique de puissance » – anglaise ;
« Politique culturelle » – française ;
« État total autoritaire » – russe-italien ;
« Impérialisme » – propre aux temps modernes. » (p. 209)
Que l’État total autoritaire soit russe-italien avant d’être allemand, on le comprend, il émerge au début des années 20 en URSS et en Italie, et Heidegger a rapproché socialisme autoritaire et bolchevisme dans des paragraphes précédents. Mais pourquoi la politique culturelle serait-elle française ? Il le disait déjà dans Ga 95 :
« La « politique culturelle » se propage à présent comme une épidémie, et – ce sont les Français qui sont à l’origine de cette invention bien étrange au demeurant, et ce n’est qu’ultérieurement que nous avons reconnu tout le profit à tirer de cet instrument « politique » » (p. 328).
La politique culturelle désigne la planification et l’organisation de l’expérience vécue des masses à travers de gigantesques spectacles, et Heidegger s’en prend violemment à Wagner dans les cahiers noirs. « Culture » est un mot moderne et clairement péjoratif sous la plume de Heidegger. Hölderlin, ce n’est justement pas de la culture. Dans Réflexions XIV, il définit ce mot : « Traduction appropriée du mot allogène « culture », tel qu’il est en usage aujourd’hui : entreprise de divertissement (Vergnügungsbetrieb) » (p. 251). Il est difficile de savoir pourquoi Heidegger voit là une invention française. Peut-être pense-t-il aux grands rassemblements populaires organisés par l’État républicain dans les années qui suivent la Révolution française. Pourquoi la politique de puissance serait-elle anglaise ? Le par. 128 de Réflexions XIII le disait : l’installation de la Machenschaft comme puissance qui aspire à la puissance inconditionnée, « cela a lieu dans l’histoire de l’État anglais à l’époque des temps modernes » (p. 173), de sorte que l’État soviétique est le même, mais dépouillé de son masque moral. Heidegger voit dans l’Angleterre, et plus largement dans le monde anglo-saxon, la modernité à l’état pur, de sorte que son commencement est celui des temps modernes : « l’Angleterre a marqué le début du processus par lequel s’installe le monde propre aux temps modernes » (p. 264). Dès lors, il ne peut pas être porteur d’un autre commencement qui en constituerait le dépassement, et c’est pour cette raison que le « bolchevisme » anglais est la forme « la plus lourde de péril », car « sans l’anéantissement de celle-ci, les temps modernes continuent à se maintenir » (p. 173). Dans un par. de Réflexions XIV, Heidegger va jusqu’à comprendre le sens de la guerre entre l’Angleterre et l’Allemagne sur le plan de l’histoire de l’Être[1], comme la guerre entre la puissance qui incarne le commencement qui a trois siècles, et celle qui incarne celui qui pourrait avoir lieu dans trois siècles (mais c’est la lutte spirituelle, non la guerre, qui doit le préparer) :
« Les Anglais ont depuis trois siècle abandonné tout commencement où entre en jeu l’essentiel. Ce qu’ils n’ont plus, les Allemands ne l’ont pas encore, et ils ne l’auront pas dans les prochains siècles. De ce hiatus nait la guerre, qui n’est aucunement lutte affrontant l’essentiel, étant menée en vue du rien de la nullité. Cette guerre naît de l’abandon par l’Être de l’être humain des temps modernes, qui est parvenu à son terme. » (p. 246)
Heidegger tient des propos violemment anti-anglais tout au long de Ga 96. Dans le par. 74 de Réflexions XIII, il affirme que la politique anglaise constitue le modèle de l’état final des temps modernes, et ne parle d’« esprit » britannique qu’avec des guillemets, « cet « esprit » vide de tout esprit » (p. 134), caractérisé qu’il serait par une « incapacité métaphysique », une « nullité métaphysique » dit-il aussi ailleurs. Heidegger en voit la preuve dans le fait que c’est en Angleterre uniquement que sa pensée a été constamment rejetée à tel point qu’une traduction n’a même pas été tentée, remarque qui a quelque chose de comique, car en réalité Heidegger est aujourd’hui beaucoup traduit et commenté dans le monde anglo-saxon, peut-être même est-ce là qu’il l’est le plus. Peut-être Heidegger ignorait-il que Sein und Zeit fut recensé dès 1929 par Gilbert Ryle. Dans un par. de Réflexions XV, Heidegger s’étonne que des Allemands voient un avenir dans le christianisme anglais, et ajoute :
« Du reste – si on se met à faire les comptes : qu’a apporté, hors de la technique et de la préparation métaphysique du socialisme, hors du règne du lieu commun en matière de pensée et de l’absence de goût, l’Angleterre à la « culture » ? » (p. 284).
On se demande, à lire un tel passage, ce que Heidegger savait de Shakespeare, de Purcell, de Keats, de Turner… Peut-être son appréciation de l’Angleterre en termes de moralisme est-elle à mettre en rapport avec sa lecture de Nietzsche, lui qui s’en prend déjà au moralisme anglais dans le par. 228 de Par-delà bien et mal, et aux psychologues anglais au début de la première dissertation de la Généalogie de la morale, et même déjà à Thomas Buckle au par. 4[2].
Dans Réflexions XIV (p. 194-195), Heidegger cite cet historien anglais du 19ème siècle, Henry Thomas Buckle (1821-1862), qui affirme que la locomotive a fait plus pour unifier les hommes que les philosophes et les poètes, et y voit une parfaite illustration de cet « esprit » vide de tout esprit, qui n’est pas capable de comprendre ce qu’est cette unification, à savoir le règne de la puissance, l’organisation, le dressage, la planification, et qui n’a aucune idée de ce que sont dans leur essence penseurs et poètes, c’est-à-dire ceux qui peuvent préparer l’autre commencement de l’histoire et surmonter cette unification. Essentiel est le paragraphe suivant qui évoque à nouveau la possibilité d’une destruction de l’Allemagne, non plus par la France et l’Angleterre, mais par la Russie et l’Angleterre. Il y répète qu’il y a une communauté d’essence entre les formes politiques de l’Angleterre et de l’URSS, mais au lieu d’y voir une possible alliance entre elles, Heidegger croit qu’elles vont inévitablement devenir ennemies. L’Allemagne se tiendrait « entre les deux », prise en étau, dans cette situation que Heidegger évoquait déjà en 1935 dans son cours Introduction à la métaphysique[3]. Il demande alors :
« Serons-nous broyés jusqu’à n’être plus qu’un rien, sur le fond d’une absence de toute décision (qui pourrait précisément être ce « l’un et l’autre » en ses variantes) ? Ou bien pouvons-nous devenir un commencement unique de l’Occident, ce qui suppose que nous sachions la décision ? » (p. 195)
Nous reconnaissons ici le « ou bien » de l’alternative fondamentale entre le règne de la Machenschaft et la fondation de la vérité de l’Être. C’est le « ou bien ou bien » de l’unique décision. Heidegger affirmait que la guerre ne pouvait rien trancher sur le plan de l’Être, qu’elle ne se tient que sur le plan de la destruction de l’étant qui procède de la dévastation de la vérité de l’Être. Et pourtant, si la destruction de l’Allemagne enterre la possibilité de l’autre commencement, donc du dépassement de la dévastation, il semble bien que le plan ontique de l’histoire du monde, celui visible des destructions de l’étant, soit plus essentiel que ne semble le dire Heidegger à travers son opposition entre destructions visibles et dévastation invisible. La destruction visible de l’Allemagne pourrait bien maintenir à tout jamais la dévastation invisible de la vérité de l’Être. La guerre bien pourrait avoir un impact sur la décision entre le triomphe définitif de la Machenschaft de l’étant ou son surmontement dans la fondation de la vérité de l’Être, puisque seule l’Allemagne peut l’autre commencement. Il n’en demeure pas moins qu’une victoire allemande ne serait pas en tant que telle la décision, car l’Allemagne de 1941 est elle aussi un visage du règne de la puissance, et un autre commencement de l’histoire ne serait possible, au mieux, que trois cents ans plus tard. L’enjeu de la Seconde Guerre Mondiale serait donc moins, aux yeux de Heidegger, la décision, que la préservation de la possibilité de la décision à venir. Il l’écrit p. 196 :
« Aujourd’hui, ce qui veut dire pour la venue de ce qui vient, n’a de valeur que ce qui se tient au sein de l’extrême et sait qu’il existe une lutte dont l’enjeu est de savoir si l’humanité restera esclave de la dévastation, ou bien, dans une histoire autrement fondée, si elle en vient à faire écho à la voix du dieu. Tous les autres buts de guerre relèvent de la gesticulation autour de purs simulacres qui se transforment en leur contraire du jour au lendemain, attestant ainsi de leur nullité ».
Ce passage est à rapprocher de celui de la page 246 que nous avons cité plus haut. Heidegger oppose la guerre (Krieg) et la lutte (Kampf), la guerre ayant manifestement lieu sur le plan des destructions de l’étant quand la lutte a lieu sur le plan de la dévastation de l’Être. Il y a guerre entre les puissances, et lutte entre les deux branches de l’alternative entre lesquelles doit avoir lieu la décision. Si, comme le croit Heidegger, la mort des soldats allemands doit permettre de sauver l’Allemagne de la destruction et de préserver la possibilité de la décision à venir, alors, « si n’est pas pris le risque de cette décision spirituelle, où se joue l’histoire occidentale (…), le sang allemand est répandu en vain » (p. 247). Et Heidegger s’assigne à lui-même, en tant que penseur qui médite le commencement à venir, de faire en sorte de sauver ce commencement, et du même coup de faire que les pertes allemandes ne soient pas vaines :
« Nous avons une tâche. Mais la question demeure de savoir si nous-mêmes nous sommes capables d’être cette tâche elle-même : chaque jeune Allemand qui tombe est mort en vain si nous n’œuvrons pas à toute heure pour que, au-delà de la dévastation de soi-même à laquelle il est à présent laissé complètement libre cours et qui est définitive, un commencement où se déploie l’essence allemande est sauvé ». (p. 277)
Intéressant est le premier par. de la page 215 consacré à la question de l’ordre nouveau. Heidegger demande d’abord si la guerre est « un ébranlement de l’essence même de l’humanité occidentale », donc le transport de l’animal rationale dans le Da-sein, et répond : « Cette deuxième guerre mondiale l’est tout aussi peu que la première dont elle est indissociable. Mais la deuxième guerre mondiale va amener un nouvel ordre de la « Terre », c’est-à-dire de l’espace humain organisé techniquement ». Neuordnung et Neuordnung Europas sont des tournures typiques de la LTI qui désignent la réorganisation planifiée du continent européen sous domination allemande. Hitler proclame lors de son discours du 30 janvier 1941 au Palais des sports de Berlin : « L’année de 1941 sera, j’en suis convaincu, l’année historique d’un grand nouvel ordre en Europe ». Ce par. de Réflexions XIV, cahier écrit dans la première moitié de l’année 1941, est peut-être une référence directe à ce discours. Heidegger voit dans cet ordre nouveau l’organisation technique de toute l’humanité européenne, il est l’achèvement de la victoire de la Machenschaft : « L’ordre nouveau est la victoire décisive de la « puissance » en tant qu’essence de l’être, et, comme tel, il est le début du déploiement de cette essence dans la forme de son extrême achèvement ». Mais un tel ordre nouveau, comme accomplissement de la Machenschaft, doit être surmonté dans l’autre commencement, et cela doit passer pour Heidegger par un auto-anéantissement de cette humanité soumise à la technique. C’est là la dimension proprement tragique et apocalyptique de sa pensée à cette époque. Essentielle est la note écrite « en route vers le chalet » dans Réflexions XIV, où Heidegger prévoit ce que sera l’achèvement suprême de la technique :
« Le dernier acte sera la désintégration de la Terre se faisant elle-même sauter, et la disparition de l’actuelle humanité. Ce qui n’est pas en soi un malheur, mais bien au contraire le premier moment où l’être commence à être purifié de sa très profonde dégradation par la prédominance de l’étant » (p. 260)
De tels propos ne sont pas sans rappeler ceux tenus en 1955 dans Gelassenheit à propos des bombes atomiques dont le risque n’est pas qu’elles explosent, mais plutôt qu’elles n’explosent pas, et que le règne de la technique se maintienne[4]. Déjà, au par. 103 de Réflexions XIII, Heidegger affirmait que la condition préalable pour libérer le Russentum en son essence est d’oublier beaucoup de choses, et il ajoutait que « peut-être qu’une destruction de l’Europe des temps modernes, destruction dont on ne peut avoir idée, est-elle une aide pour l’impulsion de cet oubli » (p. 153). Le par. 111 reformulait l’alternative fondamentale de la décision en plaçant à la place de la fondation de la vérité de l’Être « le périssement (Verendung) final brusque et violent » des temps modernes, qui en est la condition : « À l’époque de l’achèvement des temps modernes ne restent que deux possibilités : soit connaître un périssement final brusque et violent (ce qui a l’air d’une « catastrophe », alors que cette fin, dans son inessence décidée par avance est trop insignifiante pour pouvoir être une catastrophe), soit voir l’état actuel d’une Machenschaft devenue inconditionnelle dégénérer en quelque chose qui ne connaît plus de fin » (p. 157). C’est sans doute cette désintégration, ce périssement, que Heidegger appelle « l’auto-anéantissement du « communisme » » (p. 173) en tant qu’essence commune de l’humanité des temps modernes. Sans doute est-ce là ce déclin, et Heidegger pense évidemment à Spengler, qui doit rendre possible la transition : « le déclin (Untergang) est la transition (Übergang) qui mène à l’autre commencement » (p. 273). Mais la forme que prend cet auto-anéantissement de l’humanité des temps modernes n’est pas toujours claire. Si c’est bien la Seconde Guerre Mondiale qui constitue cette « monstrueuse entreprise d’auto-anéantissement » (p. 296), et que l’Allemagne n’est pas détruite parce qu’elle est victorieuse, qu’est-ce qui pourrait bien alors conduire le national-socialisme à l’auto-anéantissement sans lequel la Machenschaft se maintient et l’autre commencement ne peut advenir ? Demeure énigmatique aussi en quoi cet auto-anéantissement de l’humanité des temps modernes n’impliquerait pas du même coup cette destruction de l’Allemagne dans laquelle Heidegger voit pourtant le risque de la destruction même de la possibilité de l’autre commencement.

Conclusion
Le tome 96 de la Gesamtausgabe est donc un volume très riche, très important pour comprendre la manière dont Heidegger comprend les événements politiques des années 39/41. Ce Heidegger « politique » cherche à interpréter les événements politiques à partir de sa pensée de l’histoire de l’Être, donc à en faire un usage politique pour découvrir le sens caché de ces événements, sens qui se tient à l’arrière-plan, l’histoire de l’Être étant en dernière analyse ce qui permet de comprendre l’histoire mondiale telle qu’elle se déroule que le plan de l’étant. Y voyant le règne de la puissance, Heidegger effectue comme une sorte de réduction ontohistoriale qui saisit l’essence commune des puissances politiques qui s’affrontent, leur « communisme », mais il écrase du même coup leurs différences ontiques, celles qui permettraient de porter un jugement moral permettant de distinguer les bons des mauvais, les agresseurs des agressés, les bourreaux des victimes. C’est que la pensée de l’Être n’est pas une pensée morale, elle ne porte aucun jugement moral, elle se situe sur un autre plan. Et pourtant, quand il s’agit des crimes du régime soviétique, Heidegger dit son horreur, et semble bien ne pas respecter cette neutralité éthique qu’imposerait une interprétation de la situation politique à partir de l’histoire de l’Être. Il aurait donc pu, et dû, porter aussi un jugement moral sur les puissances en présence et les différencier, tout en saisissant aussi leur essence commune sur le plan de l’histoire de l’Être, l’un ne devant pas empêcher l’autre. S’il fallait caractériser la pensée politique de Heidegger à cette époque, sans doute faudrait-il dire qu’elle est foncièrement antimoderne (terme qu’il refuserait, puisqu’à ses yeux se déclarer « anti- » c’est se tenir sous la dépendance de ce dont on est l’anti-, et rester sur le même plan que lui, à savoir celui de la métaphysique) et apocalyptique. Antimoderne d’abord : antichrétienne, antisémite, antibolchevique, antifasciste, antinazie, antianglaise, antiaméricaine, antifrançaise, anti-italienne, aucune force en présence ne trouve grâce à ses yeux (ni antiallemande ni antirusse, cependant, précisément parce que ce ne sont pas là des puissances, mais des commencements tenus en réserve, pour autant que l’on distingue l’Allemagne du nazisme et la Russie du bolchevisme). Apocalyptique ensuite : tous ces visages de la modernité doivent s’entre-détruire pour permettre le passage à un autre commencement (allemand, et peut-être aussi russe).
On peut se féliciter de la manière dont les responsables de l’édition de Heidegger chez Gallimard privilégient maintenant les traductions des traités d’histoire de l’Être et des cahiers noirs. Autorisons-nous à espérer une traduction rapide de Ga 69 et de Ga 97.
[1] En 1941, Heidegger interprète aussi sur le plan de l’histoire de l’Être la tentative d’invasion de la Grèce par Mussolini : « La haine des Italiens vis-à-vis des Grecs et leur intention de les anéantir ont leur source dans le savoir inavoué que le monde grec (avec lequel les Grecs d’aujourd’hui n’ont à vrai dire que très peu à voir), et non la romanité, est le fondement de l’histoire de l’Occident ». (p. 226)
[2] Nietzsche, Généalogie de la morale, première dissertation, §4, trad. H. Albert : « Mais pour juger du désordre que ce préjugé, une fois déchaîné jusqu’à la haine, peut jeter en particulier dans la morale et dans l’étude de l’histoire, il suffira d’examiner le cas trop fameux de Buckle ; le plébéisme de l’esprit moderne qui est d’origine anglaise fit éruption une fois encore sur son sol natal, avec la violence d’un volcan de boue et avec cette faconde salée, tapageuse et vulgaire qui a toujours caractérisé les discours des volcans ».
[3] M. Heidegger, Introduction à la métaphysique, Tel, Gallimard, p. 48-49 : « Cette Europe qui, dans un incurable aveuglement, se trouve toujours sur le point de se poignarder elle-même, est prise aujourd’hui dans un étau entre la Russie d’une part et l’Amérique de l’autre. La Russie et l’Amérique sont toutes deux, au point de vue métaphysique, la même chose ; la même frénésie sinistre de la technique déchaînée, et de l’organisation sans racines de l’homme normalisé ».
[4] Heidegger, Question III et IV, tel, Gallimard, p. 143 : « Car c’est précisément si les bombes de ce type n’explosent pas et si l’homme continue à vivre sur la terre que l’âge atomique amènera une inquiétante transformation du monde ». C’est sans doute déjà ce qu’écrit Heidegger en ouverture de Réflexions XV : « Le grand désastre qui partout menace l’humanité des temps modernes et son histoire est qu’un déclin lui reste refusé ». (p. 272)








