Martin Heidegger : Réflexions XII-XV. Cahiers noirs (1939-1941) (partie 1)
C : La Russie et le bolchevisme
L’une des spécificités de ce volume des cahiers noirs est la place toute particulière qu’il réserve à la question du Russentum, qui est traduit de manière élégante par « monde russe », même s’il n’est pas question dans cette notion de « monde » au sens heideggérien, mais de « ce qui est russe », de la russéité, de l’être-russe. Heidegger fut très tôt un lecteur des auteurs russes, tout particulièrement de Dostoïevski, raison pour laquelle il tient à souligner dans le par. 125 de Réflexions XIII que son intérêt pour le Russentum n’a rien à voir avec le rapprochement entre l’Allemagne et l’URSS depuis les accords Molotov-Ribbentrop :
« Ma méditation du monde russe commence en 1908-1909 avec la tentative du lycéen d’alors de concevoir que ce qui fait l’élément proprement russe. Depuis, cette volonté a poursuivi son chemin et n’est déterminée ni par l’apparition du bolchevisme ni par le « développement » politique des rapports entre Russie et Allemagne depuis janvier 1939[1] ». (p. 166)
Or, l’élément essentiel aux yeux de Heidegger est de distinguer à tout prix le Russentum du bolchevisme. Ainsi, au par. 25 de Réflexions XII, il identifie le Russentum au Slaventum, le monde slave, terme qui n’a sous sa plume rien de péjoratif, contrairement à ce qu’il en est dans la propagande nazie qui l’identifie à l’« asiatique ». Il affirme que le bolchevisme n’a rien à voir avec eux car « il a sa source dans la métaphysique occidentale-ouest-européenne, moderne et rationnelle » (p. 64), et peut-être pense-t-il ici à la racine hégélienne du marxisme. De ce point de vue, le bolchevisme est l’un des visages contemporains de la Machenschaft, et même une véritable destruction du Russentum par la Machenschaft, autrement dit par la modernité technique, et peut-être pense-t-il ici à la manière dont le régime soviétique a transformé à grande vitesse un pays rural et agricole traditionnel en une grande puissance industrielle moderne.
Dans le par. 38 sur l’élevage racial comme visage de la Machenschaft qui consiste à organiser, à calculer, à planifier les caractéristiques raciales, Heidegger souligne qu’il réalise une aliénation des peuples vis-à-vis d’eux-mêmes, une perte de leur possibilité d’histoire, c’est-à-dire de commencement, un ensevelissement des possibilités pour les peuples qui ont une force destinale de se tourner l’un vers l’autre et de se rencontrer dans la méditation du sens. Qui sont ces peuples ? Heidegger précise : Deutschtum et Russentum, « monde allemand et monde russe » (p. 74). On le sait, le peuple allemand est aux yeux de Heidegger à l’autre commencement ce que le peuple grec est au premier, mais ce que nous apprennent ces pages étonnantes, c’est que Heidegger semble penser que le peuple russe est lui aussi un peuple qui a une force destinale et qui est capable d’un autre commencement. Mais de même que le national-socialisme est la défiguration du Deutschtum par la Machenschaft, le bolchevisme est la défiguration du Russentum par la Machenschaft. Contre la propagande nazie[2], Heidegger écrit que le bolchevisme n’est pas quelque chose d’« asiatique » qui menace l’Occident, mais tout au contraire qu’il est une forme de la pensée occidentale des temps modernes défigurant le Russentum, de sorte qu’il juge « démentiel » de « vouloir combattre le bolchevisme par le principe racial » (p. 74) ou de « chercher à sauver le Russentum par le fascisme ». Ce serait remplacer une défiguration moderne par une autre, passage où l’on voit que Heidegger n’a pas plus de sympathie pour le fascisme que pour le nazisme.
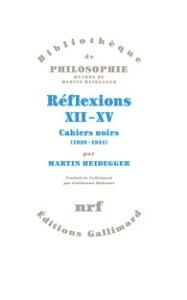
Dans Réflexions XIII, le long par. 73 revient sur le bolchevisme que Heidegger définit comme le « pouvoir des soviets sous sa forme despotique-prolétarienne » (p. 127) pour répéter une fois encore (c’est un véritable leitmotiv de ses considérations sur le bolchevisme), qu’il n’est ni asiatique ni russe, contrairement à ce qu’affirme la propagande nazie, mais qu’il appartient à l’achèvement des temps modernes occidentaux. Or, Heidegger écrit ici de manière explicite que le fascisme et le national-socialisme, qu’il identifie sous le terme « socialisme autoritaire » (et il place le terme « socialisme » entre guillemets pour souligner en note que ce socialisme n’est plus qu’en apparence un socialisme, car il n’a plus rien de social, il ne désigne plus un principe d’entraide sociale mais l’organisation militaire, économique et politique des masses), sont eux aussi des formes de l’achèvement des temps modernes occidentaux. D’où sa conclusion : « le bolchevisme et le socialisme autoritaire sont métaphysiquement le même » (p. 127-128). Non pas politiquement le même, car Heidegger n’est pas aveugle aux différences politiques entre ces régimes, mais bien « métaphysiquement le même » en tant qu’ils sont deux visages de la Machenschaft de l’étant comme organisation et planification du peuple sous le nom dévoyé de « politique », car « la politique n’a plus rien à voir avec la polis » (p. 60) et « la « politique » est la véritable exécutrice de la Machenschaft de l’étant » (p. 61). Contre ces défigurations correspondantes du Deutschtum par le nazisme et du Russentum par le bolchevisme, qui sont l’achèvement de l’histoire de la métaphysique dans le nihilisme, Heidegger espère alors l’autre commencement sous une forme tout à fait originale dans son œuvre, à savoir une médiation entre Allemagne et Russie qui leur permettrait ensemble de libérer le Deutschtum et le Russentum pour que chacun retrouve un rapport à son histoire et que ce soit la rencontre de ces deux histoires qui leur permette ensemble de fonder la vérité de l’Être, donc de surmonter la métaphysique dans l’autre commencement, alors pensé comme commencement germano-russe :
« une libération va-t-elle s’ébaucher par laquelle le monde russe regagne un rapport (qui n’est pas de « race ») à son histoire, et d’autre part un questionnement, qui, se tenant hors de tout fond, fasse que le monde allemand devenu digne de question se mette sur la voie de son histoire, et que ce faisant l’histoire des deux parvienne, à partir du même fondement abrité en retrait, à une vocation destinale : fonder la vérité de l’Être (en tant qu’Er-eignis). (p. 128)
Il est très intéressant de voir que l’explication entre l’Occident et l’Asie à laquelle en appelle le dernier Heidegger – d’où « L’entretien avec un japonais » dans Acheminement vers la parole, la rencontre avec le moine bouddhiste, ou l’intérêt pour la pensée chinoise – est en fait déjà présent dans ces années, mais prenait la forme d’une explication entre le monde allemand et le monde russe (qu’il n’identifie pourtant pas à l’Asie), puisqu’il s’agit dans les deux cas pour l’Occident de s’ouvrir à un autre commencement que son premier commencement, à une autre pensée que sa pensée métaphysique.

Contre la propagande nazie, une fois de plus, Heidegger affirme que « le péril gigantesque n’est pas la « bolchevisation » de l’Europe -, car ce qui est un état de fait, et au sens essentiel un achèvement historial nécessaire, ne peut jamais être un « péril » – » (p. 128). Dans ce passage étonnant, Heidegger renverse la propagande nazie contre elle-même en lui répondant que c’est l’installation partout en Europe du national-socialisme et du fascisme qui est en elle-même déjà la bolchevisation de l’Europe, puisque ces deux visages du socialisme autoritaire sont métaphysiquement la même chose que le bolchévisme, à savoir le règne de la Machenschaft. Le véritable péril est, aux yeux de Heidegger, « que l’achèvement des temps modernes, qui ne se laisse pas juguler comme cela, parvienne à s’imposer comme l’unique fondement de la poursuite de l’« histoire » » (p. 128), autrement dit l’ensevelissement de la possibilité d’un surmontement de la métaphysique dans un autre commencement et le triomphe définitif de la Machenschaft. Page 130, Heidegger répète que « le communisme despotique et le socialisme autoritaire sont le même, non au sens politique, mais bien au plan métaphysique ». Or, ce qui lui permet de les rapprocher, c’est cette fois ci le concept de « Weltanschauung », et Heidegger renvoie alors à sa conférence de 1938, Die Zeit des Weltbildes, ce qui est intéressant, car on voit que l’enjeu implicite de cette conférence est aussi de penser la situation présente comme la lutte entre les visions du monde. Or, plus loin il montre que le rapport entre la politique et la vision du monde qu’elle est censée servir, tant pour le nazisme que pour le bolchevisme, peut aussi s’inverser : « Et du jour au lendemain cela peut devenir une nécessité « politique » de faire « politiquement » cause commune avec l’ennemi mortel – en termes de vision du monde – de la veille » (p. 130). Il s’agit d’une allusion très claire au pacte Molotov-Ribbentrop. Plus loin dans le même paragraphe, Heidegger écrit que « le bolchevisme russe (…) dans sa provenance est de même nature que le monde anglo-américain », ce qui ne signifie pas que Heidegger les identifie politiquement mais que, là encore, ils sont métaphysiquement le même c’est-à-dire des produits de la métaphysique s’achevant dans le règne inconditionnel de la Machenschaft.
Le par. 86 répète que le bolchevisme est foncièrement non-russe et est un péril pour le monde russe qui doit être dépassé, et le par. 90 répète que « le national-socialisme n’est pas le bolchevisme qui n’est pas lui-même un fascisme – mais tous deux sont des victoires de la Machenschaft, où celle-ci impose son régime – formes gigantesques d’achèvement des temps modernes – une manière qui fait des peuples en leur particularité le simple aliment d’un calcul » (p. 145). Le par. 95, conformément à l’idée d’une force destinale du Russentum, affirme que « dans l’essence même du monde russe reposent des trésors : ils sont à l’abri en retrait, dépassant de loin tous les gisements de matières premières » (p. 146), et se demande si sera possible un jour que l’essence du monde russe et ce qui lui est étranger à l’extrême, manifestement celle du monde allemand, donc occidental, « soient en un élan de même origine, portés à l’unité et institués », ce qui renvoie une fois de plus à l’idée d’un autre commencement germano-russe que le par. 125 appelle « l’explication de fond (Auseinandersetzung) entre le monde allemand et le monde russe » (p. 167).
Essentiel est le par. 96 où Heidegger se demande ce qu’est le socialisme et considère que la meilleure définition en a été donnée par Lénine dans sa célèbre formule de 1920 : « le socialisme est le pouvoir des soviets (Sowjetmacht) plus l’électrification ». Il y a là un aveu : on ne trouve dans cette définition ni la prospérité ni l’égalité, mais bien la Macht, le règne de la puissance qui aspire à toujours plus de puissance sur l’étant (autrement dit ce que la métaphysique de Nietzsche a déterminé comme « volonté de puissance »), c’est-à-dire la Machenschaft. Heidegger lit donc dans cette définition « une forme de despotisme qui contraint le peuple entier à la prolétarisation et le tient d’une main de fer » (p. 147), et il ajoute qu’il se transforme selon les circonstances en prenant parfois un virage à cent quatre-vingt degrés, en renvoyant entre parenthèse à la NEP, la « nouvelle politique économique » de 1921 qui introduisait une libéralisation économique et retardait le plein dépassement du capitalisme pour des raisons stratégiques. Ce que semble vouloir dire ici Heidegger, c’est que la NEP et cette définition de Lénine montrent bien que l’essence du socialisme soviétique n’est pas du tout de nature économique (l’abolition de la propriété privée des moyens de production), puisqu’il est capable d’accomplir un virage à cent quatre-vingts degrés dans ce domaine, mais bien de nature politique, un despotisme, et même de nature métaphysique, puisqu’il se définit lui-même comme Macht. Le second élément de la définition n’est pas pour Heidegger l’électrification, mais le « plus », indice sommatif dans lequel il voit l’aveu d’une pensée calculante qui appartient à l’essence du socialisme. Quant au troisième élément, l’électrification, il s’agit de l’aveu de l’essence technique du socialisme, à savoir qu’il est le processus technique moderne comme maîtrise des énergies qui réalise l’accroissement permanent de la puissance du despotisme soviétique. C’est donc de manière métaphysiquement nécessaire que le pouvoir des soviets s’accomplit par l’électrification, et on comprend mieux avec ce paragraphe pourquoi le bolchevisme constitue un visage de la Machenschaft. La technique n’est nullement un complément ou un moyen du pouvoir des soviets, il est le pouvoir des soviets lui-même, il est son essence.
Le par. 103 répète, contre la propagande nazie, que la Russie n’est pas l’Asie et n’est rien d’asiatique, et que le bolchevisme n’est pas le Russentum. Le péril du bolchevisme pèse donc sur le Russentum lui-même, nullement sur l’Europe, à savoir que ce « despotisme qui a sa condition dans l’intelligence technico-industrielle » (p. 153), définition qui est l’acquis du par. 96, empêche l’éveil du monde russe. Étonnante est dans ce paragraphe la définition par Heidegger du bolchevisme comme « le capitalisme d’Etat autoritaire (autoritären Staatskapitalismus) », qui est une définition que l’on trouve habituellement chez les anarchistes et les socialistes antisoviétiques. Il cerne parfaitement la nature de terreur du régime soviétique lorsqu’il affirme au par. 112 qu’elle ne se réduit pas à la « balle dans la nuque », qui n’en est qu’un signe superficiel, mais qu’elle tient à une puissance, une Macht, une fois encore, qui est « une possibilité permanente de menace, menace intégrale de tout et de tous » (p. 158).
Le paragraphe décisif de Heidegger sur la question du bolchevisme et du « communisme » est le par. 128 de ces Réflexions XIII, qui a un statut tout particulier car il est de très loin le plus long du volume 96 (9 pages) et qu’il est intégré par Heidegger à Ga 69, donc à un traité d’histoire de l’Être, ce qui constitue un cas unique. Il détermine la fin des temps modernes comme déploiement du « communisme », et s’il tient à mettre ici des guillemets à ce terme, c’est parce que le mot prend chez lui un sens « seynsgechichtlich » qui n’a plus grand-chose à voir avec le communisme comme mode de production, à savoir avec la mise en commun des moyens de production. Ainsi, il écrit qu’il « ne consiste pas dans le fait que chacun consomme, gagne, travaille, dispose de quoi se divertir à parts égales », mais « dans le fait que tous sont soumis à la même contrainte qu’exerce sur eux le pouvoir inconditionnel de ces peu nombreux qui ne sont pas nommés » (p. 168). Nous reconnaissons là le despotisme des soviets que Heidegger définissait dans une parenthèse p. 148 comme la « puissance dans les mains d’une minorité d’individus qui à proprement parler ne sont personne ». Et c’est cette contrainte commune qui crée cette atmosphère qui empêche toute décision, c’est-à-dire la prise en charge de cette décision par une méditation telle que celle que Heidegger accomplit. Cette contrainte impersonnelle qui pèse sur chacun, Heidegger l’appelle « communisme » car elle est « cet élément commun, qui ramène chacun à tous en lui imprimant la marque du commun » (p. 168), et c’est « quelque chose qui est tout en donnant l’impression de ne pas être ». Nous reconnaissons là ce que le paragraphe 27 de Sein und Zeit appelait la dictature du On, contrainte impersonnelle qui ne s’impose pas au regard, mais qui contraint à ce que chacun soit l’autre et nul ne soit lui-même, plongeant chacun dans le bavardage et l’équivocité où aucune décision authentique n’est possible. L’analytique existentiale de la quotidienneté n’était pas censée être une description phénoménologique de la modernité, mais Heidegger la réinterprète en ce sens dans ces traités d’histoire de l’Être et dans les cahiers noirs, nous le voyons ici. Ce « communisme » rend tout commun, donc il s’oppose à tout ce qui est « propre », à l’authenticité des Wenigen, les peu nombreux qui doivent poétiser et penser l’Être pour faire advenir l’autre commencement. Commun, ce « communisme » l’est aussi parce qu’il est commun à tous les régimes politiques de la modernité technique. De ce point de vue, pour Heidegger, le communisme entendu au sens du bolchevisme ne fait qu’éclater au grand jour le « communisme » qui est l’essence même de la modernité, et de ce point de vue le national-socialisme, le fascisme, et les démocraties libérales relèvent aussi de ce « communisme », raison pour laquelle Heidegger pouvait dire que le socialisme autoritaire et le bolchevisme sont métaphysiquement le même, et que le bolchevisme et le monde anglo-saxons sont aussi métaphysiquement le même, ou encore que la bolchevisation de l’Europe n’est pas une menace puisqu’elle est un état de fait. Heidegger considère que se concentrer sur les différents traits apparents du bolchevisme, comme le fait « que les industries soient étatisées ainsi que les banques, que la grande propriété foncière soit abolie, les monastères supprimés » (p. 168) n’est qu’une vue superficielle sur ce régime, car elle l’interprète « à partir de l’horizon où la bourgeoisie telle qu’elle a régné jusqu’ici avait placé la détention des biens et les bonnes manières, comme une perte véritable et une destruction » (p. 168). Pour Heidegger, l’étatisation n’est pas l’essentiel, car l’État est un instrument du parti et le parti un instrument des peu nombreux qui exercent le pouvoir inconditionnel sur tous. Étonnant est l’usage que Heidegger fait dans ce paragraphe de l’expression « les peu nombreux », qui désigne ici l’exact opposé de ces Wenigen dont il parle partout ailleurs. Les peu nombreux qui exercent le pouvoir inconditionnel sont les exécutants de la Machenschaft, alors que les Wenigen dont il est question partout ailleurs sont les poètes et penseurs qui préparent son surmontement dans l’autre commencement. Heidegger cherche à penser ces peu nombreux qui exercent le pouvoir despotique, et les caractérise d’une manière étonnante : « Il appartient à l’essence même de ces derniers de rester innommés, et de ne tolérer ceux qui sont abondamment nommés (Staline et autres) qu’au titre de personnages destinés à occuper le devant de la tribune » (p. 168). Staline serait ainsi une marionnette entre les mains de ces peu nombreux, les soviets, qui exercent véritablement le pouvoir. Étrange affirmation, quand on sait qu’au contraire Staline jouissait d’un pouvoir absolu, et que c’était bien plutôt tous les fonctionnaires du parti qui étaient des marionnettes entre ses mains dont il pouvait se débarrasser selon son bon plaisir. Une interprétation maximaliste pourrait consister à voir dans ces « peu nombreux » le Judentum, ou le Weltjudentum, qui serait le véritable exécutant du pouvoir derrière les marionnettes que seraient les dirigeants soviétiques, des personnes non-juives comme Staline, mais cette interprétation aura contre elle le fait que lorsque Heidegger veut accuser le Judentum/Weltjudentum, il n’a aucun problème à les nommer, de sorte qu’on ne voit pas bien pourquoi il ne le ferait pas ici aussi, ainsi que le fait que ce despotisme des peu nombreux caractérise à ses yeux tous les régimes politiques modernes, y compris ceux du socialisme autoritaire, à savoir le fascisme et le nazisme, dont on ne voit pas quel rapport il pourrait avoir avec le Judentum/Weltjudentum.
Ce pouvoir des peu nombreux, c’est le « pouvoir des soviets dans sa forme oligarchique » (p. 169). À moins que les soviets ne soient purement identifiés au Weltjudentum, mais Heidegger ne dit rien de tel nulle part et n’utilise jamais la formule « judéo-bolchevisme ». Les passages antisémites sont rares et lapidaires, de sorte qu’il est très difficile de dire précisément où Heidegger situe le Weltjudentum et quel rôle politique précis il lui assigne. L’essentiel aux yeux de Heidegger est de dire que le règne inconditionnel de la puissance sans borne n’est pas le fait de « la soif de pouvoir des « sujets » particuliers » (p. 168), mais que ce sont à l’inverse ces peu nombreux qui ne sont, sans le savoir, que les exécutants de l’accès de la puissance à la pleine puissance, donc les esclaves de la Machenschaft. Cela lui permet de critiquer la superficialité de l’opposition chrétienne (mais sans doute aussi nazie) au bolchevisme qui dénonce en lui un matérialisme alors qu’il est hautement spirituel, puisque ce n’est rien moins que « l’essence spirituelle métaphysique et occidentale » (p. 168-170), la Machenschaft, qui s’accomplit en lui. Il ajoute qu’« un homme comme Lénine savait cela en toute clarté » (p. 170), manifestement parce que c’est lui qui donne la meilleure définition du bolchevisme, celle que Heidegger a analysée au par. 96. Intéressante est l’affirmation suivante d’après laquelle le péril du communisme ne consiste pas dans ses conséquences économiques et sociales, mais dans le fait de ne pas reconnaître son essence spirituelle, à savoir la Machenschaft (« le « communisme » comme agent humain d’exploitation de la Machenschaft » (p. 176)) qui est cela qu’il s’agit de surmonter par la décision, et qui est cela à quoi tous succombent quand bien même ils prétendent s’opposer au communisme, puisqu’ils n’en sont tous que les multiples visages. Intéressante aussi l’affirmation d’après laquelle le surmontement historial du communisme, sans guillemets, donc il s’agit du bolchevisme, peut prendre une multitude de formes différentes, et Heidegger souhaite ce surmontement pour libérer le Russentum, mais il affirme qu’en aucun cas il ne peut s’agit d’une attente « d’un retour à l’état précommuniste et bourgeois d’autrefois » (p. 169-170), et l’on comprend pourquoi, dans la mesure où cet état est lui aussi déjà la Machenschaft et n’en permet pas le surmontement. Communistes et anticommunistes ne sont, une fois de plus, que les deux faces de la même pièce. Intéressant aussi est ce passage où Heidegger affirme de manière très lucide que les buts mis en avant par le régime soviétique, tel le bien-être, la participation au progrès de la culture, l’élimination des distinctions de classe et de profession, la mise à égalité des dirigés et des dirigeants, « ne sont rien d’autre que des paravents pour le « peuple », devant lesquels celui-ci reste fasciné » (p. 170), l’unique but de la puissance étant son accès à une puissance sans limite qui se veut elle-même. La définition la plus précise du « communisme » comme constitution métaphysique commune de l’humanité des temps moderne est donnée p. 171 : « Le « communisme » cependant n’est pas une simple forme étatique, il n’est pas non plus une espèce de vision du monde politique, mais bel et bien la constitution métaphysique dans laquelle se trouve l’homme des temps modernes, dès lors que ceux-ci sont entrés dans leur dernière phase ». Elle est répétée p. 173 : « le « communisme » est bien la constitution métaphysique des peuples, dans la dernière phase des l’achèvement des temps modernes ». Saisir la constitution métaphysique commune des peuples des temps modernes, c’est laisser de côté leurs traits propres pour les rapprocher, ce qui conduit Heidegger a des rapprochements inattendus, qu’on aura évidemment le droit de juger aberrants, car ils supposent de faire abstraction de différences considérables. De même qu’il affirmait que le socialisme autoritaire et le bolchevisme sont métaphysiquement la même chose, il affirmait aussi que « le bolchévisme russe (…) dans sa provenance est de même nature que le monde anglo-américain » (p. 133), et c’est dans ce par. 128 que Heidegger explique ce rapprochement. Le « communisme » est la constitution commune des peuples lorsque les temps modernes s’achèvent, et que le bolchevisme accomplit de la manière la plus pure. Mais s’il est l’accomplissement de l’essence des temps modernes, alors il doit être présent à leur commencement sous la forme d’une préfiguration, et c’est l’Angleterre qui est, aux yeux de Heidegger, la puissance politique du commencement des temps modernes : « Politiquement, cela a lieu dans l’histoire de l’État anglais à l’époque des temps modernes » (p. 173). Heidegger ne s’explique pas, peut-être pense-t-il à l’État-Léviathan de Hobbes, qui est le modèle même d’une puissance inconditionnée. Cela expliquerait pourquoi il considère que, si l’on fait abstraction (mais cela fait beaucoup d’abstractions) « des formes de gouvernement » (la démocratie vs le despotisme), « de société » (libéralisme vs collectivisme), « et de foi » (protestantisme vs athéisme d’État), alors on peut considérer que l’État anglais « est le même que l’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques » (p. 173). Il voit cependant une différence dans le fait que l’État anglais se donnerait encore « l’apparence de la moralité et de l’éducation des peuples » alors que l’État soviétique « tombe le masque ». C’est cette essence commune qui permet à Heidegger de forger cette étrange expression, qu’il est sans doute le seul à avoir jamais utilisée : « la forme bourgeoise-chrétienne du « bolchevisme » anglais » (p. 173). Il prend tout de même soin de mettre ici le mot « bolchevisme » entre guillemets, le mot n’étant pas ici utilisé rigoureusement, mais cherchant à dire la communauté d’essence, le « communisme », entre l’État anglais et l’État soviétique. Contre l’idée d’après laquelle ce serait l’URSS qui constituerait le péril majeur pour l’Europe, Heidegger considère que c’est ce « bolchevisme » anglais qui est le plus lourd de péril, parce que son triomphe sur le bolchevisme soviétique ne ferait que maintenir les temps modernes dans leur essence, mais à nouveau masquée par un vernis moral et religieux (« son rôle de sauveur de la moralité »), au lieu de la surmonter. Dans la mesure où l’Angleterre, au moment où Heidegger écrit ces lignes, est en guerre contre l’Allemagne, on pourrait penser que lorsqu’il écrit que sans l’anéantissement de sa forme de « bolchevisme », le temps modernes continuent à se maintenir, il est en train d’en appeler à la destruction de l’Angleterre par l’Allemagne. Or, ce n’est pas de cela qu’il s’agit car il précise tout de suite : « L’anéantissement définitif ne peut cependant avoir d’autre figure que celle d’un essentiel auto-anéantissement » (p. 173). Il ne s’agit pas tant d’anéantissement de l’Angleterre que d’un auto-anéantissement de ce qu’il appelle « communisme », l’essence commune des temps modernes qui ne concerne pas seulement l’Angleterre, mais en vérité tous les peuples européens. Or, cet auto-anéantissement est aux yeux de Heidegger la guerre mondiale qui vient d’éclater, car cette puissance affamée de puissance qui ne veut que son déploiement illimité conduit nécessairement à l’éclatement du conflit mondial : « L’auto-anéantissement a sa forme première dans la force avec laquelle le « communisme », en ce qu’ont d’irrésistible ses manières de laisser libre cours à la puissance, exerce une pression qui aboutit à l’éclatement d’épisodes militaires » (p. 173). La lecture de ces lignes, si on les sépare des autres paragraphes de Réflexions XIII, ne peut manquer de susciter chez le lecteur un profond malaise, car il n’y est jamais question de l’Allemagne, du nazisme, mais seulement de l’Angleterre et de l’URSS, comme si c’était elles qui avaient déclenché la 2ème guerre mondiale, et comme si le « communisme » désignait l’essence commune des forces alliées qui combattent l’Allemagne, qui aurait alors pour rôle historial d’anéantir le « communisme ». Mais il ne faut pas oublier ces autres paragraphes où Heidegger identifie dans les termes les plus clairs le nazisme et le fascisme au bolchevisme et à l’achèvement des temps modernes. Par conséquent, l’auto-anéantissement que Heidegger voit à l’œuvre dans la Seconde Guerre Mondiale, c’est un auto-anéantissement de l’humanité des temps modernes, donc du « communisme » pris au sens onto-historial, auquel nazisme et fascisme appartiennent pleinement. Cet auto-anéantissement du « communisme », en tant qu’il pousse de lui-même au déclenchement de conflits militaires, Heidegger en trouve une attestation dans la jubilation de Lénine devant l’éclatement de la guerre mondiale en 1914. Il voit une communauté d’essence entre la guerre mondiale et le « communisme », en tant que despotisme des peu nombreux, en ce que les guerres mondiales exigent le regroupement de tous les moyens de la violence guerrière dans la puissance détenue par les peu nombreux, exige la mobilisation totale « exerçant sur chacun son emprise globale », de sorte que la guerre mondiale exigerait de tous les belligérants d’aller plus loin dans le développement de ce « communisme » qui achève les temps modernes. En somme le « communisme » exigerait la guerre qui elle-même exigerait le « communisme ». On aurait affaire à un processus de renforcement du pouvoir qui conduit à une violence croissante jusqu’à son auto-anéantissement. Et Heidegger précise que « tous les peuples de l’Occident sont impliqués dans ce processus » (p. 174), donc les peuples allemands et italiens aussi.
La question de la Russie et du bolchevisme revient dans Réflexions XIV. Page 195, Heidegger affirme à nouveau que « la Russie », mais il s’agit plutôt du bolchevisme, n’est « que la conséquence essentielle » de l’Angleterre, qu’il identifie à la démocratie et à l’univers de la machine, ce qui lui permet de la mettre en regard de la définition de Lénine « pouvoir des soviets + l’électrification ». Sur la même page, Heidegger met en rapport les dates de naissance de Hölderlin et de Lénine : « Hölderlin est né en 1770, et Lénine, en 1870 » (p. 195). Hölderlin indique la possibilité de l’autre commencement quand Lénine est l’accomplissement du premier. Pages 219-220, Heidegger évoque une coïncidence temporelle dans le fait que Molotov vienne à Berlin les 12 et 13 novembre 1940 tandis que lui vient d’achever son interprétation de l’hymne de Hölderlin, « Comme au jour de fête ». Molotov représente l’accomplissement des temps modernes qui est pleinement visible tandis que la possibilité de l’autre commencement que recèle l’hymne demeure voilée. Le paragraphe suivant oppose « Les deux M », celui de Saint-Martin, dont les journaux parlaient jadis le 11 novembre, et celui du Molotov dont elle préfère parler en 1940. Ce premier « M » de Martin est aussi celui du prénom de Heidegger, ce qui est encore une façon d’opposer Molotov, accomplissement des temps modernes, à l’autre commencement pensé par Heidegger.
C’est dans Réflexions XIV, p. 263, que nous trouvons ce passage que nous avons déjà cité à propos de l’impression tenace d’atrocité que procurent les « massacres perpétrés par les bolcheviques dans les sous-sols de leurs prisons ». Heidegger les évoquait déjà p. 258 d’une manière étrangement « humaniste » et « morale », lui qui pourtant tient toujours à laisser de côté toute considération morale lorsqu’il s’agit de l’histoire de l’Être :
« Que les bolcheviques liquident un seul et unique homme sans procès équitable ni enquête, et ce uniquement parce qu’il professe une autre conviction, ou bien qu’ils en liquident des centaines de milliers, cela importe tout autant. Notre temps habitué à la quantité croit que cent mille est « plus » qu’un ; en réalité un seul et unique individu est déjà bien plus que tout ce qui ne peut être saisi qu’à l’aide de nombres. Afin que nous ne sombrions pas dans la confusion quant à l’attitude dans laquelle il convient que les Allemands se maintiennent, il ne nous est pas permis, pas plus ici qu’ailleurs, de succomber à l’ivresse des nombres. » (p. 258)
On le voit, Heidegger a une claire conscience de la nature criminelle du régime soviétique à cette époque. Mais on ne trouve pas dans les cahiers noirs de passages semblables à propos des crimes commis par les nazis en Allemagne, comme si Heidegger n’avait pas une claire conscience de la nature criminelle du régime, même s’il l’identifie pourtant depuis 1934 à l’accomplissement des temps modernes dans le nihilisme et le règne de la technique. Certes, le régime ne se vantait pas de ses crimes à la radio et dans la presse, et Heidegger ne pouvait pas aller constater lui-même dans les sous-sols de la Gestapo qu’on y pratiquait les mêmes massacres que les bolcheviques, mais il ne pouvait pourtant pas tout ignorer des crimes du régime, ne serait-ce que de ceux de la Nuit de Cristal qui eurent lieu aussi à Fribourg. Dans ce passage, Heidegger semble dire que la gravité et la nature du crime ne tient pas au nombre des massacrés, parce que cela serait encore une manière de « compter », d’appréhender le crime de manière « calculante ». La gravité des crimes des bolcheviques ne tiendrait donc pas au nombre des massacrés, car cela laisserait penser que si on ne pouvait pas les compter par centaines de milliers, cela ne serait pas si grave. La vie d’un homme serait quelque chose qui devrait échapper au calcul, à « l’ivresse des nombres ». Surprenante est la manière dont Heidegger justifie la fait de se garder de cette ivresse des nombres : « Sinon pourrait poindre le péril que le massacres de quelques-uns parmi les peu nombreux ne soit pas tenu pour si grave, face à celui de milliers, et que le « règne des sous-hommes » (»Untermenschentum«) ne commence que là où est atteint un nombre suffisamment grand » (p. 258). Penser la gravité des massacres de manière quantitative conduirait à considérer que le massacre en petite quantité serait peu grave, la gravité étant fonction de la quantité, ou la quantité de gravité étant égale à la quantité de massacrés. Heidegger refuse la banalisation et la relativisation du massacre par le biais du nombre. Mais de quel massacre parle-t-il ? Il ajoute qu’il s’agit du massacre de quelques-uns parmi les peu nombreux. S’agit-il des peu nombreux au sens où il l’entend dans l’immense majorité des cas, à savoir ces poètes et penseurs qui préparent l’autre commencement ? Dans ce cas, Heidegger serait en train de dire que tuer un seul homme parmi ces peu nombreux ne doit pas être tenu pour moins grave, ou « pas si grave », face au massacre de milliers d’hommes, alors que l’autre commencement peut dépendre d’un seul de ces peu nombreux. Heidegger pense-t-il ici au fait que les bolcheviques tuent les poètes et penseurs russes non-bolcheviques qui préparent l’autre commencement à partir du Russentum ? Mais Heidegger ne savait sans doute rien du sort de poètes comme Mandelstam, Tsvetaïeva ou Chalamov. Étonnante est l’intervention dans ce contexte du terme »Untermenschentum«, terme de la LTI qui n’appartient pas du tout à la manière dont Heidegger s’exprime habituellement. Le terme est entre-guillemets, précisément pour indiquer cette distance, et le fait qu’il s’agit d’une citation, celle d’une manière courante de s’exprimer dans l’Allemagne nazie de 1941. Si l’Untermensch, c’est le « sous-homme », alors l’Untermenschentum c’est bien le « règne des sous-hommes », comme traduit Guillaume Badoual. Or, ce terme était utilisé par la propagande du régime nazi pour désigner le bolchevisme. En 1941 est paru l’ouvrage Bolschewismus-jüdisches Untermenschentum[3], et peut-être Heidegger y fait-il allusion en reprenant ce terme entre guillemets dans son cahier de 1941. Il serait donc en train de dire dans ce passage que dénoncer les crimes du bolchevisme en le traitant de « règne des sous-hommes » parce qu’il a atteint un nombre suffisamment grand, des milliers, serait supposer que le massacre de quelques-uns ne serait pas si grave. Peut-être est-ce là une manière de ne pas reprendre à son compte la manière dont la propagande nazie dénonce les crimes des bolcheviques. Il y aurait en quelque sorte une hypocrise que pointerait Heidegger dans la manière dont le régime dénonce les crimes des bolcheviques en invoquant la quantité, peut-être pour mieux tenir les siens pour « pas si graves » parce qu’ils seraient quantitativement moindre, alors qu’il serait semblable à ce qu’il dénonce comme « règne des sous-hommes ». C’est pour cela que Heidegger prescrit aux Allemands de ne pas succomber à l’ivresse des nombres. Mais les « peu nombreux » peuvent aussi dans ce passage renvoyer au « despotisme des peu nombreux » dont il était question plus haut, à savoir les soviets. Si c’est le cas, le passage pourrait alors être une allusion à la manière dont les Allemands devraient se comporter dans la guerre contre l’URSS, à savoir que la lutte contre le bolchevisme, qui massacre des milliers d’hommes, n’autorise pas pour autant à considérer que le massacre de quelques-uns parmi les peu nombreux, donc parmi les bolcheviques, par les Allemands, ne serait pas si grave, parce que quantativement moindre que les crimes des bolcheviques. Incontestablement, ce passage reste ambigüe.
Enfin, deux passages de Réflexions XV abordent la question russe et soviétique. Heidegger p. 278 considère que c’est le socialisme soviétique qui a accompli le premier pas en direction de la motorisation inconditionnelle de l’humanité. Il cite à nouveau sa définition par Lénine pour justifier ce lien avec l’accomplissement de la Machenschaft comme technique moderne. C’est Lénine qui a reconnu ce système de la puissance inconditionnelle et en a eu l’audace, et Heidegger ajoute : « Quant aux autres, ce sont des épigones ». Chez eux, « on n’a pas osé faire de la machine l’anti-Dieu » et l’athéisme n’a pas été inconditionnellement réalisé. Qui sont ces épigones du bolchevisme ? Manifestement le fascisme italien, puisque Heidegger ajoute : « L’indigence métaphysique des Italiens, face à la Russie, est de notoriété publique ». Épigone du bolchevisme, le fascisme mussolinien se tiendrait en-deçà de lui parce qu’il n’aurait pas su, tel Lénine, reconnaître son essence technique et l’oser. Mais il considère que la Russie n’est pas encore la forme d’humanité suffisamment forte pour se soumettre à l’essence métaphysique de la technique. C’est l’américanisme qui l’est car il est « absence de toute racine » (p. 279). Le Russentum est aux yeux de Heidegger encore trop enraciné dans sa terre où git une ressource de monde (d’où son espoir d’une explication avec le Deutschtum), alors que l’américanisme est une entreprise qui vise à extraire et à amasser tout étant, donc à le déraciner radicalement. Le Russentum représente encore, malgré le bolchevisme, une force d’enracinement et une hostilité à la pure rationalité du calcul qui ne lui permet pas de prendre en charge, d’assumer la charge de l’oubli de l’être. « Prendre en charge la détermination historiale de la dévastation », « assumer la charge de l’oubli de l’être et l’installer en tant que tel », « entreprise dont la signification est du même coup de déraciner ce qui est été raflé », ces formulations ne sont pas sans évoquer le passage du dernier paragraphe de Réflexions XIV à propos du Weltjudentum où Heidegger posait « la question métaphysique qui s’enquiert du genre d’humanité qui, purement et simplement délié, peut assumer, en tant que « tâche » historiale mondiale, de déraciner tout étant hors de l’être » (p. 264). Il s’agissait d’un paragraphe consacré à l’Angleterre, et c’est à nouveau « les Anglais » (p. 279) qu’évoque ici Heidegger, qui par leur américanisme semblent bien constituer cette « rationalité parvenue au plus haut stade et omni-calculante », ce qui expliquerait aussi pourquoi Heidegger affirmait que « la forme bourgeoise-chrétienne du « bolchevisme » anglais est la plus lourde de péril » (p. 173).
L’ultime paragraphe de Réflexions XV, et de Ga 96, est écrit en septembre ou octobre 1941, alors que l’armée allemande avance vers Moscou. Heidegger revient de manière essentielle sur la possibilité d’une explication de fond entre monde allemand et monde russe. Il souligne que « les Russes savent beaucoup de choses, et des choses très exactes, au sujet des Allemands, de leur métaphysique et de leur poésie » (p. 296), mais regrette qu’à l’inverse les Allemands ne sachent rien des Russes. En somme, c’est l’Allemagne qui ne serait pas au rendez-vous de l’explication de fond. Mais Heidegger reprend en tout fin de volume ce qui a été son leitmotiv : le Russentum n’est pas le communisme, car ce dernier est, comme la technique moderne qu’il accomplit (les soviets + l’électricité), ouest-européen. Cela permet à Heidegger d’interpréter la guerre germano-soviétique qui fait rage comme n’étant pas une guerre de l’Ouest contre l’Est, mais comme une guerre où l’Ouest est en conflit contre lui-même : « c’est en vérité l’Ouest qui déchaîne sa tempête contre l’Ouest, dans une monstrueuse entreprise d’auto-anéantissement » (p. 296). Nous retrouvons ici l’auto-anéantissement du « communisme », la constitution métaphysique commune de l’humanité des temps moderne comme despotisme technique. Le volume se conclut sur un espoir, et même une prédiction. Une fois cet auto-anéantissement achevé et les temps modernes surmontés, l’autre commencement deviendra possible à partir du Russentum : « Dans le monde russe la métaphysique achevée trouve le lieu qui convient à sa renaissance. De là, un jour, elle viendra à la rencontre du commencement, comme un contrecoup » (p. 297).
Martin Heidegger : Réflexions XII-XV. Cahiers noirs (1939-1941) (partie 3)
[1] Le pacte germano-soviétique date de la fin août 39. Il est difficile de savoir pourquoi Heidegger renvoie ici au mois de janvier.
[2] Heidegger est donc bien capable, dans ces années, de prendre le contre-pied de cette propagande. Il est donc d’autant plus coupable de ne pas l’avoir fait quand il s’agissait du Judentum, et non du Russentum.
[3] https://www.barnebys.co.uk/auctions/lot/bolschewismus-juedisches-untermenschentum-ss-hauptamt-Kmjba7uKPc








