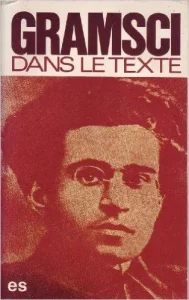Introduction
L’anthologie des Cahiers de prison[1] parue en 2021 au format folio regroupe un choix de textes sélectionnés parmi les vingt-neuf Cahiers de prison rédigés par Antonio Gramsci de 1929 à 1935 ; seuls deux cahiers ne sont pas intégrés ici. Ce volume se compose également d’une large introduction portant sur la méthode de sélection de ces textes ainsi que d’une rapide biographie de Gramsci ; l’ouvrage se clôture avec un vaste appendice proposant de petites biographies des personnes évoquées dans ces Cahiers, une bibliographie, de nombreuses notes, et un index.
Jean-Yves Frétigné apporte donc ici sa pierre aux déjà nombreuses anthologies consacrées à l’œuvre de Gramsci. Il y eut en effet une première anthologie des Cahiers publiée en 1959 aux Éditions sociales préparée par Armand Monjo et Gilbert Moget[2], laquelle sera ensuite remplacée en 1975 aux mêmes éditions par celle de François Ricci[3]. Peu après, Gérard Granel et Robert Paris présentèrent et coordonnèrent de 1978 à 1992 une traduction de l’intégralité des Cahiers de prisons[4]. Pour être exhaustif, nous pouvons citer aussi les travaux de Martin Rueff et Rzmig Keucheyan.
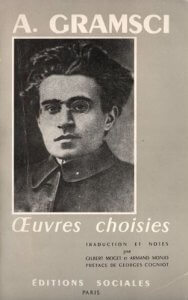
Une grande partie de ces travaux s’inscrivent dans le sillage de Louis Althusser, l’un des premiers introducteurs de la pensée de Gramsci en France, et qui salua particulièrement ses analyses marxistes sur le rapport entre société civile et État, ou encore sa critique du déterminisme dialectique en économie. Althusser prenait aussi ses distances en l’étudiant, critiquant notamment ses perspectives humanistes et surtout son historicisme. Au milieu des années 80, les études françaises sur Gramsci déclinèrent, alors même que partout ailleurs elles continuèrent de croître avec, notamment en 2009, la publication en Italie d’un Dictionnaire Gramsci dirigé par Guido Liguori et Pasquale Vozza[5].

Avec cette anthologie, Jean-Yves Frétigné n’a pas effectué de travail de retraduction des Cahiers et a délibérément écarté les cahiers numéros 18 et 24 : le premier parce qu’il consiste en une série d’essais sur Machiavel (p 37), et le second parce qu’il est consacré à la « typologie des quotidiens et revues italiens » et aurait donc nécessité un trop important appareil critique de recontextualisation. Or, l’objet avoué de cette anthologie est d’offrir une « lecture directe des textes » de Gramsci, et « la plus immédiate possible » : là-dessus, ce livre est fidèle à la chronologie des textes et ne les rassemble pas, ne les regroupe pas sous un thème ou un groupe de notions – à l’instar des Textes choisis par André Tosel[6] par exemple. Cependant chaque texte est redécoupé, présenté par de petites introductions remettant le propos en contexte ; ceux-ci sont longuement annotés ainsi qu’en témoigne le vaste appendice final. Le cahier 10 bénéficie également d’une importante préface de présentation sur Croce.
Quel est l’objectif d’une anthologie sinon une vaste introduction en morceaux choisis, une vue d’ensemble d’une œuvre pour donner ultérieurement quelques motifs d’approfondissement de détail ? L’intérêt principal de cette présentation de Jean-Yves Frétigné est d’abord historique, que ce soit au sujet de Gramsci lui-même qu’à celui des études gramsciennes en France ; aussi cet ouvrage remet-il en perspective, ré-enracine ce que l’on pourrait appeler « l’en-soi » abstrait de la pensée de Gramsci, en développant cette fois-ci les allusions et les enjeux de contextes de ces Cahiers, avec un soin et un scrupule remarquables qui ne l’enveloppent pas dans un système ou un jargon néo-marxiste préalable. Et en effet, on est frappé à la première lecture de ces textes – si on les prend dans l’ordre chronologique – de la tonalité générale du propos dont l’aspect reste digne d’études historiques, cherchant avec une froide intégrité à repérer les phénomènes humains en développement, et cela sans trop les retraduire dans un vocabulaire ou des catégories marxistes – du moins dans leurs premières esquisses et approches. On peut ainsi conclure que l’objectif de cette anthologie est réussi, mais moins en ce qui concerne « l’immédiateté » de l’accès au texte déclaré, que pour ce qui concerne la généralité même du propos de Gramsci ; le compilateur le déclare :
« à la différence de la plupart des autres anthologies proposées des écrits de Gramsci qui ont tendance à mettre en avant ses réflexions générales, le lecteur de cette anthologie se rendra vite compte de l’importance centrale et déterminante qu’y occupe l’Italie » (p 33).
Car bien évidemment, cette approche historique de Gramsci reste liée à une « philosophie de la praxis » qui est la théorie générale des rapports sociaux constituant le monde de l’activité humaine, théorie qui intègre sa propre pratique en description de ces rapports, et donc décrivant aussi simultanément sa propre appartenance à ces mêmes rapports. Gramsci explique ainsi sa méthode :
« L’homme c’est l’ensemble de la succession des rapports sociaux fondamentaux, non pas saisis dans leur en-soi mécaniste, mais dans leurs médiations, comme bloc à la fois économico-corporatif et éthico-politique, qui libère une possibilité de bloc antagoniste[7]. »
Et force est de constater que, grâce à cette anthologie, cette imbrication, cette conjonction des médiations sont évidentes à même l’écrit de ces Cahiers.
Cependant, il semble aussi, et dans cette même mesure, que le propos de cette anthologie des Cahiers de prison reste dans un entre-deux, ou même peut-être demeure dans une certaine retenue, sans doute liée à la censure des autorités fascistes qui interdirent un certain nombre d’ouvrages que tentaient de lui transmettre en prison sa sœur et son ami Piero Sraffa ; mais cette retenue s’incarne également dans la personne même de Gramsci dans ce contexte carcéral qui affecta gravement sa santé déjà fragile, même après sa libération conditionnelle sous surveillance ; apparemment, et d’après ce que nous avons lu sur ce sujet, Gramsci n’a pratiquement plus écrit de 1935 jusqu’à sa mort en 1937 ; il est donc probable qu’après la rédaction des Cahiers de 1929 à 1935, Gramsci ne se soit soucié que de leur conservation et de leur transmission, et qu’il n’ait donc pas eu la force de les remanier. D’où le propos certes très hautement cultivé, mais souvent allusif et général quand il prend des exemples historiques ; et ici, les remarques de Jean-Yves Frétigné sont de précieuses indications pour comprendre la teneur de ces propos et les approfondir.
- Vie et problèmes marxistes de Gramsci
Gramsci est né en 1891 et mort en 1937 des suites d’une maladie tuberculeuse des os qu’il avait depuis sa naissance ; il fut d’abord militant socialiste puis, après octobre 1917, communiste. Dans un texte du 24 novembre 1917, « La révolution contre le Capital », Gramsci passe par l’appropriation de la pensée de Marx tout en conservant des bases intellectuelles ouvertement proches de Croce et Gentile : comme nous le verrons un peu plus loin, la constante inflexion qu’il donnera ensuite – et de façon notable dans les Cahiers – à ces deux premiers inspirateurs libéraux concerneront le primat de l’activité sur l’être, et l’identification partielle de l’être à la connaissance. Ces deux fils conducteurs de la pensée marxiste de Gramsci s’approfondissent clairement dans ses Cahiers. Lors de l’été 1920 au Second congrès de l’Internationale, Lénine cite Gramsci sur « l’utilisation des institutions bourgeoises de gouvernement en vue de leur destruction », grâce aux conseils d’usine et à la participation au jeu politique du régime parlementaire[8].
Le léninisme plus ou moins revendiqué de Gramsci l’amène en 1924 à être invité à Moscou puis à être élu au Parti communiste italien. La mort de Lénine durant cette même année produit la scission entre Staline et Trotski, et Gramsci va de manière complexe et ambiguë tenter de mesurer les dérives de la construction du socialisme stalinien tout en en soutenant le processus. Gramsci est ensuite arrêté le 8 novembre 1926 ; une arrestation intervenant après l’attentat raté contre Mussolini à Bologne le 31 octobre 1926. Un tribunal spécial pour la défense de l’État fasciste est alors créé en 1927, avec la volonté de faire le procès du communisme. Emprisonné, Gramsci enverra en 1926 une lettre au Parti central, mais elle ne sera jamais transmise, étant aux yeux de ses collègues sans doute trop critique du stalinisme et pouvant alors désavouer la direction communiste italienne adoubée.
Dans les premières réflexions de ses Cahiers de prison, Gramsci continue cependant bien de soutenir la forme d’hégémonie soviétique et son césarisme étatique, avant de peu à peu critiquer les dérives structurelles de l’État-Parti stalinien, pour finalement s’intéresser de plus en plus aux problèmes de la « société civile » et de ses influences sur le système des gouvernances via l’éducation (il prolonge ici le premier texte présenté dans cette anthologie sur les universités en Italie).
Le type de Parti révolutionnaire que thématise Gramsci s’inscrit dans cette réflexion sur ces mêmes problèmes, mais ce Parti garde des caractères singuliers car qu’il ne se reconduit pas au stalinisme ou au trotskysme, mais dérive plutôt de son expérience quant à l’échec des conseils ouvriers italiens et des conséquences de la victoire du fascisme. Dans cette anthologie, nous voyons que Gramsci constate que, factuellement, la classe moyenne ne s’est jamais alliée au prolétariat en Italie ; il va alors tenter de répondre à la question de la création d’un parti communiste italien selon ce cadre historique et à partir de lui, continuant l’examen commencé début 1926 ; il fut ainsi amené à rédiger, avec Togliatti, une stratégie antifasciste. Le problème, nonobstant, est que Gramsci, quelles que soient ses subtiles distinctions, observe la nécessité historique pour la classe ouvrière d’imiter son antagoniste dans le déclenchement de crise, la prise de pouvoir et également dans la direction, même si évidemment, l’État doit être adéquat aux forces productrices réelles et ne peut donc pas, dans la vision marxiste de Gramsci, se détacher de la société et devenir une fin en soi.
Au-delà de cela, ce que Gramsci indique est qu’il n’y a pas de garantie téléologique du communisme : il n’est qu’une possibilité dans l’aléatoire de l’Histoire, mais qu’il faut favoriser. Gramsci développe alors une pensée qui dénonce tout autant les cadres de la démocratie représentative que l’impératif révolutionnaire. Ces deux cadres ignorent ou ne prennent pas assez en compte selon Gramsci l’enjeu politique principal : la classe des producteurs est exploitée et soumise à la passivité dans la décision politique. Il faut donc commencer par actualiser une volonté collective capable de transformer les masses ; et cela se joue dès l’université et son organisation entre professeurs, élèves et qualité du savoir, ainsi que le montre le premier texte du Cahier §15 qui ouvre cette anthologie (p. 43, sq).

Gramsci doit ainsi tenter de dépasser deux tendances : soit attendre une rupture heureuse et aléatoire de l’évolution du système capitaliste en contradiction avec les rapports des forces de production, mais alors on s’en remet encore à une forme de passivité ; soit favoriser les mouvements insurrectionnels selon des formes de démocraties directes jusqu’à la grève générale, mais alors les problèmes étatiques ne sont plus interprétés que sous ce prisme social qui dissout toute forme de gouvernance réelle ou la renvoie à une forme future qui en reste au devoir-être.
Comment répondre et donner prise à ces problèmes tout en y étant historiquement pris, et parvenir à en donner une formulation qui ne peut et ne doit pas s’en abstraire ? Selon André Tosel, Gramsci vise une « science-action » qui ne se laisse pas enfermer dans l’attentisme théorique, ou ne s’essouffle pas dans une passion impulsive irrationnelle. Sur la première tendance, Gramsci cherche toujours à penser la prévision d’un ordre nouveau sur des bases historiques, et c’est pourquoi il relit et convoque sans cesse Machiavel et Croce dans ses Cahiers comme nous allons le voir ; sur la seconde, il cherche à en finir avec l’identification des masses exploitées au misérabilisme chrétien du pauvre souffrant, de l’éternelle victime espérant des lendemains meilleurs. Là est par exemple l’expérience de Gramsci suite à l’occupation des usines de 1919-1920 où il lui apparut possible de prendre en charge la division du travail capitaliste sans les déterminations de division sociale en classes. C’est ce qu’on peut appeler le « conseillisme » de Gramsci, lequel n’est ni syndicalisme, ni rouage d’un parti mais « préparation à la réalisation d’un principe étatique nouveau[9] .»
Ceux sont là les principaux problèmes sur lesquels les Cahiers reviennent constamment. Et de ces réflexions permanentes sur l’articulation entre société et état, sur l’éducation et l’instruction, sur la direction et la construction d’un parti, la généralité de cette anthologie peut nous aider à les retraduire à travers les deux auteurs italiens que Gramsci mobilise, cite, admire et critique de façon régulière au fil des pages, à savoir Croce et Machiavel.
- Croce et Machiavel
Comme nous l’avions indiqué plus haut, les extraits du Cahier n°10 sont longuement introduits par Jean-Yves Frétigné parce qu’ils concernent en grande partie un dialogue avec Benedetto Croce (1866-1952), le principal intellectuel italien de la première partie du XXième siècle. Avec Gentile, Gramsci salue en lui l’immense mérite d’avoir introduit la pensée de Hegel en Italie (p. 257) avec pour effet immédiat – à une période où la papauté avait une place prépondérante dans la politique italienne – d’inaugurer une forme de laïcisation des problématiques où « l’histoire est l’expression de la volonté humaine et non la manifestation de la Providence ». La critique de Croce ne verse pas pour autant dans le positivisme qu’il dénonce également dans ses processus de « naturalisation du processus historique », et c’est bien cela in fine sur lequel Gramsci revient souvent, notamment quand il est question de désamorcer le mythe du « choc des civilisations ». Gramsci reproche alors peu à peu à Croce la juxtaposition de son idéal universaliste avec son élitisme intellectuel qui, au fond, n’incarne qu’un cosmopolitisme confortablement abstrait, sans adresse politique réelle, désolidarisant culture et forces économiques. Croce apparaît ainsi aux yeux de Gramsci comme un hégélien inconséquent, détaché de Marx, et qui l’a même explicitement refusé face à Achille Loria, pour mieux embrasser Labriola. Selon Jean-Yves Frétigné, Croce conserve du marxisme « son interprétation historique, mais pas sa philosophie de l’histoire », et va lui préférer des approches de l’économie plus classique, remettant en cause la réduction des activités économiques à la production des biens par le travail. En effet, Croce propose de revenir à des distinctions en quatre grands domaines (l’art, l’économie, la politique et la morale), où l’économie n’est plus le soubassement systématique des forces de la société, mais est simplement restreinte à la recherche de l’utile.
Cette critique crocienne de la conception marxiste de l’économie sera, on s’en doute bien, dénoncée par Gramsci qui y verra même une sorte de fascisme renversé, allant de pair avec un libéralisme où les formes culturelles sont sécularisées dans une « religion de la liberté » (p. 265, sq.) au cœur de l’État éthico-politique effectuant une distinction entre « hégémonisme » et « dictature ». Gramsci y verra là une forme de « révolution passive » face à la menace fasciste, passivité qui a pour simple effet de renforcer les classes dominantes, lesquelles, par ce mécanisme, adoptent une partie des programmes fascistes ou libéraux pour se renouveler et se maintenir dans toutes les sphères quelles que soient les orientations des gouvernements en place.
Face à cela, Gramsci propose une révolution active où les besoins du peuple dépassent les intérêts corporatistes pour s’actualiser politiquement. Car selon Gramsci, seuls les rapports sociaux et leurs confrontations constituent l’histoire ; les distinctions néo-libérales de Croce qui tiennent l’économie pour secondaire et non efficiente n’ont aucune prise réelle ; aussi, la clé de cette conversion des masses dirons-nous, passe-t-elle par « une réforme intellectuelle et morale » du prolétariat pour qu’il prenne conscience des forces réelles des rapports sociaux.
Cette réforme prolétaire s’effectue alors, en miroir de Croce, sous le prisme d’une lecture de Machiavel, une lecture dont le recours fascinera d’ailleurs Althusser. Elle n’est évidemment pas une reprise ou une simple adaptation ; Gramsci intitule de nombreux paragraphes et parties de ses Cahiers avec ce titre, « Machiavel », sans pour autant le commenter directement ou l’utiliser dans des comparaisons ; mais il reste comme une ombre ou une source d’inspiration certaine, un point d’ancrage qui hante certains problèmes qu’aborde Gramsci, parce que Machiavel se situe lui aussi dans un entre-deux, ou plutôt parce qu’il a parcouru l’ensemble de ce qui a constitué les pôles historiques de passages politiques du Discours sur la première décade de Tite-Live jusqu’au Prince : Gramsci voit en Machiavel le témoin, le penseur des transformations politiques sous toutes leurs formes parce qu’il est la « figure de transition entre l’État corporatif républicain et l’État monarchique absolu » (p. 171).
Même si cette anthologie ne retient pas le commentaire direct de Machiavel, la lecture qu’en fait Gramsci devient à ces moments beaucoup plus franche et directe que ses analyses passées aux tamis pour la critique de Croce ; par exemple, Gramsci pose en terme explicite la question de l’organisation du Parti et la réalisation de l’ordre par celui-ci, c’est-à-dire de l’Ordre du Parti. Dans le Cahier 14, Gramsci expose ou stylise le problème ainsi : « Comment la discipline doit-elle être entendue, si par ce mot on entend un rapport continu et permanent entre gouvernants et gouvernés qui réalise une unité collective ? » (p. 452). Apparaissent alors des questions pratiques propres à l’époque, notamment l’opposition entre Staline et Trotski. Le rapport entre gouvernants-gouvernés dans l’unité collective se redistribue selon « la combinaison des forces nationales que la classe internationale devra diriger et développer selon une perspective et des directives internationales » (p. 455). Ici Gramsci se distingue d’un Trotski, lequel selon lui ne voit dans ce « nœud de la question » (p. 456) que du nationalisme, avec une « la révolution permanente qui n’est rien d’autre qu’une prévision générale présentée comme dogme et qui se détruit elle-même du fait qu’elle ne se manifeste pas effectivement » (p 457).
Cependant, Gramsci ne veut pas pour autant verser dans la « révolution passive » crocienne comme on l’a vu plus haut, et il revient sempiternellement comme un équilibriste à ces différents risques théoriques et pratiques (p. 466). Mais loin de dénigrer ces retours, peut-être les faut-il apprécier comme le travail de la pensée même, de son activité de manducation aussi ingrate que nécessaire selon Hegel, puisque « la recherche du leitmotiv, du rythme de la pensée en développement, doit être plus importante que chaque affirmation singulière occasionnelle et que les aphorismes isolés » (p. 484). C’est là le risque même de la forme de toute anthologie dont les morceaux choisis peuvent faire également manquer le développement d’une pensée.
Aussi, plus profondément que ces questions de politiques circonstancielles, si l’on suit André Tosel à nouveau, l’enjeu que semblent faire apparaître les éléments de cette anthologie sur ces sujets, est que Gramsci développe et analyse un champ de variables stratégiques possibles entre l’hégémonie des producteurs et des intellectuels. Il s’agit de construire cette hégémonie à partir des initiatives possibles que le champ des rapports de force, modifié par l’entrée en scène des masses et leur défaite sous le fascisme, permet à l’autre classe antagoniste de jouer. Comment alors sortir du césarisme fasciste – sans verser pour autant dans le césarisme stalinien – qui est, de fait, un équilibre instable entre industriels, agrariens, intellectuels traditionnels ? Comment transformer les groupes sociaux déplacés par le fascisme et fluctuant comme les intellectuels qui acceptent de se constituer en protagonistes du nouveau bloc historique, lequel reste pourtant toujours déterminé sur le terrain des rapports de production ? C’est parce que Gramsci tente d’éclairer ces différents problèmes que Croce et Machiavel deviennent en quelque sorte solidaires de sa réflexion et sont continuellement mobilisés.
Si Gramsci se range dans un premier temps aux perspectives de la politique stalinienne au sein du Parti, c’est que la Révolution d’octobre est le dernier épisode de ce qu’il appelle la « guerre de mouvement », comme attaque frontale de l’État, et que le mode de combat change ensuite : nous sommes à présent (à la veille de la Seconde Guerre Mondiale) dans une « guerre de position ». La classe dominante mène sa guerre de position contre les producteurs, en supprimant l’élément éthico-politique, et en obligeant l’antagoniste à une retraite sur le terrain économico-corporatif. Le fascisme et l’américanisme sont individualisés comme autant de formes de cette révolution passive, et Gramsci est impressionné par la vitesse avec laquelle le gouvernement américain de l’époque ruine et détruit toute forme d’organisation ouvrière. La classe ouvrière doit donc à son tour s’exprimer sur tous les terrains, avec ses besoins, des exigences « démocratiques » qui accusent les contradictions du système de domination et de direction. Or, « la guerre de position en politique est le concept d’hégémonie », d’où l’équilibre permanent que cherche à trouver Gramsci, et la voie étroite qu’il tente de frayer dans les rapports des forces sociales en présence, afin de constituer et penser, comme rapport actif, une forme nouvelle de modification des situations.
D’où l’historicisme très particulier de Gramsci qui invite la philosophie marxiste, et toute forme philosophique, à assumer sa dépendance à l’égard du concept des rapports sociaux de production, ainsi que son appartenance au processus par lequel ces rapports se projettent en un complexe de possibles ; à la lecture de cette anthologie, on constate donc que la philosophie de la praxis de Gramsci est la théorie de la médiation ; elle a pour fonction d’éviter de réduire le réel à la répétition du mouvement historique dans l’identité des rapports de production, et positivement, de construire et favoriser l’émergence de nouveaux rapports. C’est donc un historicisme parce qu’elle objective les contradictions des rapports sociaux non plus simplement logiquement, mais dans leur procès de résolution en acte, toujours dans sa propre prise éthique et économique : aussi, cette philosophie de la praxis est autocritique de ces formes, de ces formes qui ne sont plus alors de simples conditions extérieures, mais apparaissent comme étant les structures qui déterminent les limites du monde d’ici et maintenant, un monde en transformation dont la pensée de Gramsci cherche à rendre visible les tensions vivantes.
Conclusion
Une lecture supposée directe et immédiate de ces Cahiers de Gramsci n’a en réalité de sens que si elle est accompagnée et contextualisée, et c’est bien là le travail de Jean-Yves Frétigné qu’il faut saluer dans son anthologie, parce qu’il prend le temps de rigoureusement reprendre chaque texte et fragment pour les présenter, et développer avec concision leurs caractères souvent allusifs, surtout quand on ne connaît pas l’histoire italienne. Nous découvrons aussi dans cette anthologie que l’écriture même de Gramsci est structurellement mouvante et historiciste, c’est-à-dire, non pas relativiste, mais expérimentale, toujours en quête de l’évaluation des rapports de classes contextualisés que Gramsci retraduit comme rapports de forces sociales en reconfiguration permanente. Pour cela, plus qu’aux grands textes et penseurs traditionnels du marxisme, nous découvrons un Gramsci qui recourt souvent aux analyses des penseurs italiens, pour les reconduire vers d’autres perspectives et les dépasser, non pas dans une critique frontale, mais une réécriture qui fait réellement dialogue dans un mouvement dialectique en constant renouvellement. C’est peut-être même là l’horizon fondamental de Gramsci qui referme ses Cahiers avec un projet de traité sur la langue nationale et la grammaire : le problème politique étant dépendant du dialogue entre humains, que ce soit dans les appréciations théoriques des conceptions – « si l’on veut étudier la naissance d’une conception du monde qui n’a jamais été exposée systématiquement par son fondateur (…) il convient de faire au préalable un travail philologique… » (p 483, sq) – ou que ce soit dans les phases délibératives que le travail politique engage, ce type de dialogue est donc nécessairement lié à des problèmes d’ordres linguistiques et philologiques ; et c’est cela que nous constatons directement et immédiatement dans notre lecture, sans doute aussi parce que ces thématiques constituèrent les études et la formation originelle de Gramsci à Turin en 1911.
[1] Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Anthologie, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2021.
[2] Cf. Antonio Gramsci, Œuvres choisies, traduction et notes de Gilbert Moget et Armand Monjo, Paris, Editions sociales, 1959.
[3] Cf. Gramsci, Gramsci dans le texte. Recueil de textes réalisé sous la direction de François Ricci en collaboration avec Jean Bramant. Textes traduits de l’Italien par Jean Bramant, Gilbert Moget, Armand Monjo et François Ricci, Paris, Éditions sociales, 1975.
[4] Cf. Antonio Gramsci, Cahiers de prison, 5 volumes, Paris, Gallimard, 1978-1992.
[5] Dizionario Gramsciano 1926-1937, a cura di Guido Liguori e Pasquale Vozza, Roma, Carocci, 2009.
[6] Cf. Gramsci, Textes choisis, édition d’André Tosel, Le Temps des Cerises, 2014.
[7] Cité par André Tosel, in. Gramsci, choix de textes, op. cit, p. 46
[8] Voir lien : http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/sem_ppi.pdf
[9] Gramsci, Textes choisis, op. cit., p 18