Depuis toujours, « la médecine est intrinsèquement liée à la philosophie »1 : Anne Fagot-Largeaut, philosophie et psychiatre, désormais professeur au Collège de France, nous le démontre tout au long de son livre passionnant, sobrement intitulé Médecine et Philosophie. Loin de se limiter au champ de la bio-éthique, l’ouvrage ici présent prouve que tout engagement médical implique une pratique philosophique, et ce dans ses fondements mêmes : la médecine lutte en effet, ou du moins essaie de lutter, contre la souffrance, la maladie et la mort; ces notion sont reconnues comme étant un mal à combattre, mais la définition du mal incombe à la philosophie ; plus précisément, c’est la philosophie qui va décider de ce qui motive les soins ; cela signifie que pour soigner il faut définir la notion de mal, ce qui nécessite le recours à la métaphysique ; de la même manière, apporter un remède à ce dernier, appelle une épistémologie et une morale, morale proposée et cadrée par la philosophie. Celle-ci est donc au final implicite dans tout acte médical.
Anne Fagot-Largeault introduit ainsi son livre par cette intime relation de la philosophie et de la médecine, et elle saura montrer tout au long de son ouvrage que la philosophie intervient dans chaque acte médical, pour définir quels maux il faut soigner, comment le faire, et surtout pour aider à savoir à quel moment il faut cesser les soins médicaux, le tout sans oublier le champ offert de nos jours par la médecine d’amélioration, à laquelle j’avais consacré un précédent compte-rendu2
La mise en parallèle des théories philosophiques (Kant et sa critique de la raison étant souvent utilisé pour illustrer) avec les actes concrets du travail de médecin permet de mettre en relief l’importance de l’implication de la philosophie dans la pratique courante de la médecine, et ce de manière non pas artificielle comme cela peut être présenté parfois, mais comme une conséquence logique de tout engagement médical ; Anne Fagot-Largeaut souligne également que les questions principales soulevées de nos jours par les progrès médicaux et traitées par la bio éthique ne sont pas simplement considérées selon la réflexion des philosophes actuels, mais au contraire, la majeure partie de la réflexion qu’elles impliquent est puisée dans la philosophie du passé, qui se trouve ainsi amenée à nourrir comme jamais la réflexion médicale contemporaine.
I : L’introuvable maîtrise du risque
Plusieurs articles expliquent l’origine des stratégies des choix cliniques et la logique décisionnelle du médecin mettant en avant le fait qu’avant tout acte médical, un arbre décisionnel a été tracé et qu’en conséquence rien n’est contingent dans le choix thérapeutique. Chaque thème abordé – l’origine de l’hygiène, la découverte des miasmes, les lois statistiques, la stratégie de décision – devient intéressant en dépit de son apparente difficulté ; l’auteur arrive à les rendre attrayants, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres ouvrages. On peut cependant regretter une certaine longueur dans les chapitres traitant des statistiques et de l’épidémiologie dans la mesure où le matériau positif ne débouche pas toujours sur une réflexion appropriée.
Les rappels sur les lois statistiques expliquent l’origine des stratégies thérapeutiques utilisées en pratique courante ; mais ces choix raisonnés n’apparaissent pas toujours aux yeux des patients comme étant les plus justes, même s’ils offrent ce qui paraît être la meilleure solution, la logique ne pouvant être le seul guide quand il s’agit de médecine et donc de vies humaines (il faut bien sûr ne pas tenir compte de situations d’urgence) ; c’est la raison pour laquelle l’auteur s’interroge en ces termes : « qui peut choisir pour autrui ? On ne saurait affirmer s’il existe, dans toute circonstance, une conduite rationnelle unique. Mais, pour fragile qu’elle soit, notre rationalité fraie des chemins d’ordre dans le désordre des situations qui semblent parfois douloureusement irrationnelles. »3
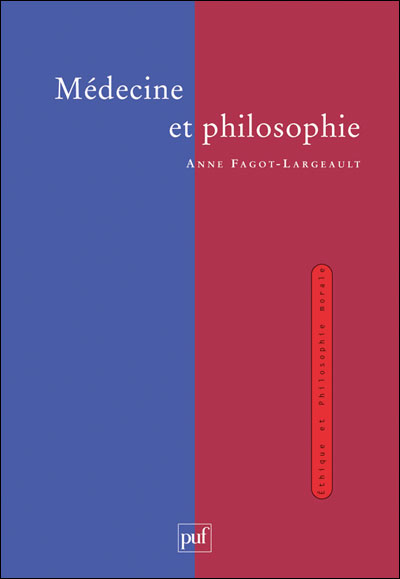
La réflexion philosophique intervient souvent dans les situations médicales les plus délicates ; si les lois statistiques servent de repère à tout médecin, on est amené à une vision plus fine du choix médical : doit on se contenter de ce qui est statistiquement le plus probable ? Un tel choix logique ne tient pas compte des particularités de l’individu. Il n’est pas toujours raisonnable de proposer le même traitement à deux personnes différentes pourtant atteintes de la même maladie au même stade ; de plus les patients veulent et peuvent participer au choix thérapeutique, ce qui peut alors rendre caduque la stratégie décisionnelle initiale… Et jusqu’à quel point peut-on forcer quelqu’un à se soigner ? Le doit-on? Pour répondre à ces questions, l’auteur propose différentes visions offertes par la philosophie et souligne ainsi l’importance de la réflexion philosophique derrière tout choix et acte médicaux.
Une autre thématique, abordée dans les parties les plus scientifiques du livre, se trouve être la recherche de la causalité des maladies. Celle-ci est traitée sous forme d’avertissement car on voit aisément que « la prise de conscience de la complexité des constellations causales induit la tentation de prendre un virage théologique »4, et l’auteur se propose d’étudier à la suite de la première remarque « quelle tournure peut prendre une réflexion téléologique rationnelle »5 Le risque est clair, il est celui du finalisme, que l’auteur traite avec modération, sans jugements excessifs, par une claire exposition des différents recours face à cette tentation permanente.
Parmi les problèmes soulevés par la tentation téléologique, le cancer apparaît comme un cas des plus significatifs ; il est en effet tentant de juger les individus responsables de certains cancers ou, pour le dire avec l’auteur, on peut se demander : « qui n’a jamais songé que les gens contractent les maladies qu’ils méritent, ou qu’ils cherchent ?»6 Pour le dire concrètement, beaucoup pensent que le fumeur se crée son cancer pulmonaire, que l’homme à peau blanche s’exposant au soleil et aux UV se provoque son cancer de la peau, etc., autant de démarches qui semblent finalisées ; un certain bon sens murmure en outre que tous ces gens-là, certes souffrants, demeurent malgré tout responsables de leur maladie… Ici vont s’opposer les points de vue scientifique et philosophique, mettant en oeuvres des stratégies différentes afin de contrer le finalisme, la philosophie ayant tendance à envisager la complexité des causes, la science médicale ramenant la maladie à quelques facteurs précis : « l’éclosion de la maladie (effet) résulte de l’action conjuguée d’agents externes ( facteur « principal », co facteurs) de l’état interne de l’hôte (prédisposition), des circonstances de leur interaction »7, voilà ce que dirait la philosophie, alors que selon Doll et Peto, spécialistes du tabagisme et des cancers qui en résultent, les agents coupables des cancers sont simplement « nature, nurture and luck »8.
En outre, le facteur de risque le plus important du cancer demeure le vieillissement ; or, on ne peut dire à ses patients, comme le suggère avec humour l’auteur, « ne devenez pas vieux »9… A partir de ce constat, il semble parfois déraisonnable de chercher des causes à toutes les maladies, des raisons qui une fois évincées, rendaient l’humain invulnérable. Le désir de trouver le signe, la cause, traduit cette envie de contrôler la nature, mais une nature qui ferait mal son travail et que, grâce à la médecine, l’homme pourrait enfin corriger. Il y a là comme l’éternel retour de la volonté démiurgique de l’homme, refusant d’admettre que la nature – donc la maladie – excède ce qu’il pourra en penser. De ce fait, si dans l’opinion publique le bon médecin est celui qui devine juste en pondérant bien la valeur des signes, la maladie est p171 « un ensemble de signes plus ou moins inconstants »10, et hélas, « Il n’existe pas de signe sensible et spécifique qui garantisse l’absence ou le présence d’une maladie »11. Vouloir prédire les maladies et supprimer tous les facteurs de risques semblent donc un rêve impossible et, à tout le moins, prométhéen.
Anne Fagot-Largeault aura réussi, grâce à ses chapitres sur ce qui, a priori, peut sembler purement logique et mathématique, à démontrer l’implication de la philosophie dès la racine de la médecine ; de plus elle démontre que la médecine moderne se sert de repères philosophiques anciens, la philosophie ayant par le passé déjà traité de sujets rendus scientifiquement possibles seulement de nos jours12. L’ouvrage mêle plusieurs thèmes habilement, variant les points de vue : entre chaque discours purement scientifique sur le concept de la maladie et les choix médicaux, apparaissent des chapitres portant sur la réflexion éthique en abordant des sujets tels que le droit de l’embryon, la fin de vie, autant de questions qui permettent de ne pas décourager le lecteur et ce grâce à un traitement épuré des stratégies diagnostics et statistiques.
II : Délimiter l’humain
Anne Fargot-Largeaut mêle habilement les notions pratiques de la médecine aux réflexions éthiques, sans juger ni prendre partie, mais en laissant chacun libre de choisir parmi les différentes voies qu’elle propose, ce qui n’est pas la cas de tous ceux qui tentent de mener une réflexion sur l’éthique. Elle ne prétend à aucun moment détenir la vérité, mais elle montre au contraire la complexité de la réflexion philosophique et combien, précisément parce que telle est la démarche philosophique, chaque thèse demeure défendable.
Les droits de l’embryon sont un exemple précis et admirablement traité, l’auteur ouvrant plusieurs voies et restituant pour chaque courant de pensé sa logique et son sens, sans imposer au lecteur une pensée toute faite. Ainsi, l’auteur analyse-t-il les différents courants philosophiques qui sont à l’origine des groupes se battant sur les droits – ou les non-droits – de l’embryon, ce qui a le double mérite de traiter un sujet délicat tout en apportant une somme certaine d’informations, et en montrant que, là aussi, la problématisation de ce qu’est un être humain – qui pourrait paraître spécifiquement moderne en raison des avancées médicales – trouve peut-être de plus pertinentes réponses parmi les pensées du passé.
Mais rentrons dans les détails afin d’en évaluer les différences : pour les lois bioéthiques, l’embryon humain est une « personne humaine potentielle »13 bien qu’il n’existe pas de consensus philosophique sur ce sujet précis : doit-on, oui ou non, protéger le fœtus? Cette question, sur laquelle s’opposent essentiellement deux grandes théories, peut ainsi être synthétisée : la réponse de ceux que l’on pourrait appeler les « philo-biologistes » consiste à dire que l’embryon est un être humain à part entière, dans la mesure où il possède les gênes qui font de lui cet individu futur. Si l’homme vient à se substituer à la nature, dans un cas pareil, « il ne peut faire que le mal »14 ; toute intervention humaine visant à permettre ou non la venue au monde du fœtus est donc, par définition, un acte mauvais, puisque il est le plus souvent contraire à la nature. Un embryon ne peut être conçu dans un autre but que celui de la vie, il est inconcevable d’utiliser des embryons pour la recherche scientifique. Cette position mène à d’évidentes extrémités affirmant entre autres que le fœtus n’a le droit d’être conçu que de manière naturelle ; les fécondation in vitro ne seraient alors pas respectueuses de ce droit. Prenons un cas très concret : quid du diagnostic pré natal ; a-t-on le droit de poser un diagnostic qui conduira très certainement à un avortement ? Pour nos philo-biologistes, la réponse est évidemment non, car à leurs yeux, cela signifierait que serait établie une échelle dans la valeur de la vie.
Empêcher la naissance d’un enfant handicapé, à la suite d’un diagnostic prénatal, est donc dans une telle optique mauvais. Mais cette position pose problème : elle ne juge pas de la souffrance physique et psychique potentielle de cet enfant ni encore celles de ses parents ; elle se contente de signaler que la présence de gênes suffit à faire un homme. Mais en pratique, la souffrance infligée est prise en compte et il s’agit alors de choisir un mal pour en éviter un autre jugé pire, ce qui signifie qu’au quotidien, la position philo-biologique est intenable : « c’est une faute morale plus grave de forcer des parents à garder un nouveau-né très handicapé, s’ils préfèrent ne pas le laisser vivre, que d’abandonner ce nouveau-né à son sort. »15. Nous avons là, contre le philobiologisme, les prémisses de ce qui s’apparente donc à son antithèse, et qui, fondée sur Kant, cherche à penser l’autonomie du vouloir afin de définir l’humain. De ce fait, décider d’intervenir sur la vie d’une créature incapable de réflexion et de décision ne peut être condamnable, puisqu’il ne s’agit pas de porter atteinte à une vie humaine. L’homme ne se définit par sa capacité à exister, il doit pour devenir un individu respectable être capable d’autonomie et de volonté car « le respect pour la personnalité en l’homme, est un « respect pour quelque chose qui est tout à fait autre que la vie »16. Pour les néo-kantiens cela n’a donc pas de sens de dire qu’il faut traiter le fœtus comme un être humain puisque le bébé qui vient de naitre n’est pas en soi une personne, mais il le deviendra par ses relations avec le monde. On ne doit pas donc de respect (au sens kantien) pour cet embryon, en tout cas guère plus que celui que l’on doit aux animaux, c’est-à-dire que l’on se contente de ne pas le faire souffrir.
On peut néanmoins aimer ce fœtus, mais on n’a pas à le respecter, ce qui compte demeurant le respect du choix des parents, lesquels choix peuvent prendre divers aspects : faire de lui une personne, avorter (ce qui doit se faire sans que le fœtus ne souffre) ou le laisser à la science dans le cas d’embryons surnuméraires. La position néo-kantienne autorise une grande tolérance dans les différents choix offerts aux parents, et permet l’expérimentation sur l’embryon. Cependant elle ne dit pas à quel moment le petit enfant devient une personne autonome, ni comment décider de l’autonomie effective d’une personne ; afin d’éviter une trop grande permissivité, il faut alors inscrire l’enfant dans une morale sociale et ce dès la naissance afin qu’il possède des droits pour le protéger. On pourrait donc estimer que la mère perd ses droits sur son fœtus à partir du moment où celui-ci est devenu un organisme apte à vivre indépendamment du corps maternel, ce qui reviendrait à condamner les avortements pour maladie génétique. Si l’embryon est une personne potentielle, il s’humanise par « le roman familial »17 dont il est le héros (désir des parents, espoirs, projets ..).
Un point réconcilie néanmoins partiellement ces deux thèses opposées : l’embryon, quel que soit son statut, ne mérite pas qu’on le fasse souffrir.
L’auteur conclut ce chapitre captivant en affirmant qu’une philosophie informée par le travail scientifique est nécessaire pour concevoir enfin le statut de l’embryon et apporter une réponse précise sur ses droits : « ce qui nous manque peut-être le plus, pour concevoir le statut de l’embryon humain, est une pensée philosophique et anthropologique informée par le travail scientifique.»18. Connaître parfaitement le développement de l’embryon dès la conception permettra de définir à partir de quel moment précis il pourra être considéré comme un individu, la perte de sa totipotence19 ne suffisant pas à définir ce moment-là, puisqu’il ne présente pas encore de capacité sensitive ; notons enfin que dans une perspective utilitariste, le droit de ne pas souffrir n’ouvre pas encore le droit de vivre, ce que résume plaisamment l’auteur en ces termes : « en caricaturant quelque peu: le fœtus, comme futur enfant, a droit au patrimoine sans avoir droit à la vie ou à la santé. »20
Conclusion
La philosophie dans le milieu médical n’apparait que dans le champs de l’éthique ; ce livre permet de montrer que, dans la pratique effective, la philosophie apparaît à chaque niveau de la médecine, depuis la définition des maladies, jusqu’aux choix thérapeutiques, en passant par la médecine dite d’amélioration ou la fin de vie. J’ai donc trouvé ce livre passionnant, avec peut-être quelques réserves sur les chapitres axés sur les bio-statistiques, les lois et les calculs. En revanche, tous les passages consacrés aux problèmes éthiques – le fœtus, la qualité de vie, les stratégies des décisions, etc. – sont remarquables et incitent le monde médical à réfléchir sur ses pratiques. Ce livre a également le mérite de présenter différents point de vue, ceux initiés par les courants philosophiques anciens ou modernes, sans que l’auteur ne laisse jamais paraître une préférence personnelle, ce qui rend possible une objectivité certaine, fort rare en matière bio-éthique. En tant que médecin, je puis affirmer qu’un tel ouvrage m’aura ouvert les yeux sur l’importance de l’implication philosophique dans mon métier. La conclusion admet certes que la philosophie n’apporte pas une réponse à tous les problèmes rencontrées en médecine dans la pratique courante, et l’auteur cite à raison Bioethics and the limits of philosophy de Max Charlesworth, ouvrage où il rappelle « que les philosophes ne détiennent pas une sagesse toute prête et directement applicable aux problèmes contemporains »21. Mais c’est avec Anne Fagot-Largeault directement que je souhaite moi-même conclure, en remarquant que « notre morale commune ne se réduit pas à une méthode de délibération collective mais à une véritable discussion mettant en avant les divers arguments permettant de défendre chaque position. Et les progrès de la science iront sans doute plus vite que la réflexion qu’ils appellent. »22
- Anne Fagot-Largeault, Médecine et philosophie, PUF, Paris, 2010, p. 3
- cf. l’article consacré à Enhancement.
- Ibid. p. 59
- Ibid. p. 87
- Ibid.
- Ibid. p 85
- Ibid. p. 97
- Ibid. p 93
- Ibid. p. 94
- Ibid. p. 171
- Ibid. p 146
- Il n’est qu’à songer au concept de vie, défini dès Aristote, mais sérieusement utilisé par la médecine au XVIIème siècle…
- Ibid. p. 124
- Ibid. p. 121
- Ibid. p. 124
- Kant Critique de la raison pratique, I,1,chap 3, cité p.121
- Ibid. p. 135
- Ibid. p. 140
- propriété d’une cellule de se différencier en n’importe quelle cellule spécialisée et de se structurer en être vivant multicellulaire : cela a pour effet qu’avant ses trois semaines, l’embryon peut donner deux organismes distincts
- Ibid. p. 106
- Ibid. cité p. 195
- Ibid. p. 177







