La première partie de l’entretien se trouve à cette adresse.
B : Existe-t-il une réalité de nature capitaliste ? Approche nominaliste du capitalisme
AP : Quand on lit Le Capital que vous venez de publier et que l’on garde en tête les préfaces consacrées à Bastiat, on constate que bien des thèmes et bien des thèses sont présents depuis dix ans dans vos écrits. On lit par exemple en 2009 que le capitalisme, loin de correspondre à une réalité objectivable, est une création que vous qualifiez d’ « opération sociale-conservatrice »1 Le programme même de votre Capital – je dis « votre » Capital pour le distinguer de celui de Marx – me semble établi dès 2009 : « Il reste à comprendre comment la chimère du capitalisme, construction polémique, sans théoricien ni doctrine – puisque les libéraux du XIXe siècle ont toujours refusé d’adopter ce concept conçu par leurs adversaires et a fortiori de défendre le prétendu « système » du même nom – a-t-elle pu (sic) s’imposer comme objet d’étude scientifique. »2. Et dès 2005, vous attaquiez des expressions à vos yeux vides de sens comme « tyrannie du marché ». Deux questions me viennent donc à l’esprit : qu’entendez par « opération sociale-conservatrice » ? Et ne faites-vous pas semblant de ne pas comprendre ce que certains dénoncent sous l’appellation « tyrannie du marché » ? Il me semble – peut-être suis-je naïf – que la plupart de ceux qui manient cette expression veulent dire qu’il y a de moins en moins de marges extérieures par rapport au marché et qu’à ce titre de moins en moins de choses échappent à l’échange marchand ; en clair, cela désigne moins une autorité exercée par les marchés qu’une manière de tout considérer à l’aune de sa valeur marchande, comme si tout pouvait être conçu comme une marchandise.
ML : Le social-conservatisme est la tenaille qui a broyé le libéralisme en Europe lorsqu’avec Mussolini et ses épigones le socialisme a fait alliance avec le nationalisme.
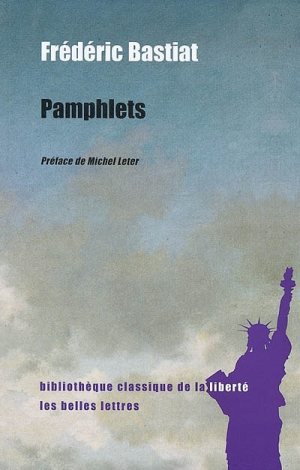
La « tyrannie du capital » est encore un de ces oxymores qui nous empêche de penser le capital dans la mesure où, comme la formation de ce dernier dépend de la liberté individuelle et des valeurs de responsabilité et de solidarité familiales et sociales, il est rebelle à toute tyrannie. Sa sphère est métapolitique. S’il s’oppose au politique ce n’est pas pour détruire la démocratie, au contraire, pour la moraliser. Sans capital, la tyrannie démocratique de la majorité sur la minorité n’a plus de limite.
Je ne comprends pas cette hystérie contemporaine à propos de la marchandisation ou plutôt je la comprends trop bien. Lorsque nos corporations s’inquiètent de la marchandisation de tout, elles songent notamment à l’éducation et à la culture, secteurs largement nationalisés où se nichent la plupart de leurs rentes. Or, ce qui est immoral, ce n’est pas la « marchandisation » de l’éducation et de la culture mais le fait que l’on ne puisse pas librement entrer sur le marché de l’éducation et de la culture pour y vendre librement ses services en raison de la concurrence insoutenable qu’y pratiquent les secteurs monopolistiques et subventionnés. Sur le monopole de l’Université, j’ai écrit une Lettre à Luc Ferry sur la liberté des universités3, qui rappelle comment nous avons inventé les libertés universitaires au XIIe siècle et comment l’État les a confisquées peu à peu (à l’exception de la parenthèse libérale des années 1875-1880 que j’évoque dans mon édition de La liberté de l’enseignement et les projets de M. Jules Ferry d’Édouard Laboulaye, Les Belles Lettres, 2007). Pour ce qui est de la culture, la lutte contre la marchandisation sert d’alibi à des groupes de pression pour imposer leurs préférences esthétiques en s’appuyant sur le ministère de la Culture qui impose par la coercition fiscale (en détruisant le mécénat privé capitaliste fondé sur le goût sur le libre choix des artistes) un véritable art officiel, ce qui même à l’époque de la prétendue « monarchie absolue », celle de Louis XIV, n’était pas le cas. Le sulfureux La Fontaine, par exemple, a pu pratiquer son art sans jamais avoir été pensionné par le roi. Protégé d’abord par Fouquet, dont il partagea la disgrâce, il fut plus tard entretenu successivement par la duchesse de Bouillon, la duchesse douairière d’Orléans et Marguerite de la Sablière. L’art contemporain peut donc être défini comme un non-art anticapitaliste. J’évoque les différentes facettes de cet antilibéralisme culturel dans Tout est culture4, recueil de chroniques des années 90 (publié récemment par mon éditeur les Belles Lettres), période où la gauche socialiste, avec Jack Lang, a fait le choix de déserter le terrain social pour investir le terrain culturel. Ce virage décisif lui permet aujourd’hui de toujours garder un temps d’avance sur la fausse droite dite républicaine.
Ce que j’observe ce n’est pas la tyrannie du capital mais celle de l’anticapitalisme (qui n’est pas un oxymore car c’est bien l’État qui l’exerce). Ce que je vois, c’est qu’il y a de moins en moins de capital, de moins en moins de marché et de plus en plus de réglementations présentées comme des règles. Nous ne sommes toujours pas libres en France de choisir notre école, notre système de protection sociale et de retraite et on nous répète tous les jours que l’ultra-libéralisme rampant détruit notre système de protection sociale ! Là où nos philosophes ne voient que cosmopolitisme, libre-échangisme et libre-circulation des capitaux je n’observe que mondialisme, protectionnisme (notamment américain) et fabrication de fausse monnaie donnée pour capital.
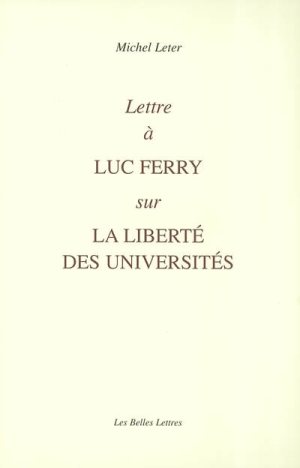
On s’inquiète ces jours-ci de la fuite des capitaux de la Chine vers les Etats-Unis. Or, l’essentiel de ces capitaux, dans ce grand pays communiste, n’ont pas été constitués par l’épargne mais par la monétisation de la dette, qui prend la forme d’obligations d’État (ces mêmes obligations servant au financement du système anticapitaliste, qui repose sur la multiplication ad libitum des programmes sociaux, et ceci indépendamment de la prospérité des pays puisque ce n’est plus le capital qui assure les prévoyants mais la dette qui arrose les clients). Ce que je constate, c’est que les banques ne sont pas libres et son devenues les pompes, non plus du crédit capitaliste, mais du financement d’une double imposition inavouable. La haute finance et le socialisme prennent en étau le libéralisme et je ne crois pas que le méga-krach ou l’apocalypse monétaire sans précédent qui se profile suffira à raisonner nos philosophes altermondialistes car naturellement, le coupable est déjà désigné… le bon vieux capitalisme… c’est dans les vieux pots que nos intellectuels vendent leurs meilleures soupes et comme toujours ils imputeront au capitalisme les maux causés par le socialisme.
AP : Ce premier volume de votre Capital ambitionne de montrer qu’il n’existe pas de réalité correspondant à ce que les socialistes et les marxistes appellent capitalisme et vous déconstruisez donc ce concept, en montrant qu’il s’agit d’une réalité construite et non d’un terme descriptif ; ne décrivant rien d’objectivable, il est une construction idéologique dont ses adversaires ont eu besoin pour avancer leurs propres armes. Ce programme déjà ambitieux ne concerne, si j’ai bien compris, qu’un quart de l’entreprise puisque trois autres volumes devraient suivre : le mythe du capitalisme / Théologie du Capital / Etre et capital. Pourriez-vous nous en dire plus quant au projet général de ces quatre volumes, tant quant à leur unité que quant à la spécificité de chacun des volumes ?
ML : Dans le premier livre, je n’ai encore rien démontré de façon convaincante. J’ai seulement donné des éléments pour retracer la genèse de la fiction capitalisme. Le livre II du Capital, intitulé Le Mythe du capitalisme, qui paraîtra en 2016, sera beaucoup plus factuel. Dans ce volume, je tenterai de retracer l’histoire du système anticapitaliste, qui prend aujourd’hui trois formes principales : la guerre proprement militaire, la guerre sociale et la guerre des monnaies, ce trident étant alimenté par la monnaie-dette émise par les banques centrales.
Dans le troisième livre du Capital, intitulé Théologie du capital, prévu pour 2017, je développerai le concept de monothéisme méthodologique esquissé dans le livre I pour examiner les sources religieuses de l’anticapitalisme et tenter de penser théologiquement le capital afin de mieux le défendre, car c’est bien lui et non pas « la planète » révérée par la religion du citoyen qui est en voie de disparition.
Enfin le quatrième livre, Être et capital, prévu pour 2018, doit nous conduire à réfléchir à la constitution d’une philosophie de l’avoir qui aurait dû être le fleuron de la pensée occidentale si cette dernière n’avait pas été frappée d’immobilisme par l’ontologie, cette philosophie omniprésente de l’être au nom de laquelle sont menées toutes les campagnes anticapitalistes contre l’égoïsme libéral.
AP : Je reviens donc à ce premier volume. Une des questions à mes yeux centrale que vous soulevez est celle de la fortune du terme de capitalisme. Je vous cite : « Le grand paradoxe du capitalisme est qu’il n’a pas été conçu par ceux qui sont censés plaider sa cause. »5 Aucun dictionnaire du XIXème n’atteste le vocable de capitalisme, pas même le Palgrave Dictionary of Economics. En 1867, le dictionnaire de Larousse parle de « néologisme » pour le capitalisme. D’où votre interrogation : « Comment, dès lors qu’il n’y a ni théoricien ni adepte dans le camp libéral au siècle de la révolution industrielle, le capitalisme a-t-il pu être présenté comme un système économique ? C’est ce mystère que tout historien des idées sérieux devrait avoir pour vocation d’éclairer au lieu de prendre le capitalisme pour argent comptant (…). »6 Et je cite à nouveau : « D’où vient que ceux qui sont historiquement censés avoir été les promoteurs d’un système aussi redoutable aient montré si peu d’ardeur à le défendre ? La raison en est pourtant élémentaire : le mot n’a pas été conçu par les libéraux. »7 Il y a ici encore deux ordres de problème : un problème de fait qui tient à ceci qu’un système a été nommé et construit par ses adversaires, et un problème de valeur qui réside dans la pertinence et la légitimité du vocable employé. On pourrait concevoir qu’un nom n’ait pas été forgé par les promoteurs d’un système mais que le nom soit pertinent ; or, si je vous comprends bien, les promoteurs n’ont pas nommé le capitalisme parce qu’ils n’en voient pas la réalité, parce qu’ils ne voient pas l’objet désigné, tout simplement parce que pour un libéral, le capital est une donnée anthropologique qui ne relève pas de la sociologie historique où on l’enferme généralement ; ce n’est pas une doctrine.
ML : Oui, vous avez raison. Par exemple, l’impressionnisme n’a pas été forgé par les peintres de l’école mais par un critique d’art en ironisant sur Impression soleil levant de Claude Monet (1872). Les impressionnistes ne se sont pas ligués, que je sache, pour rejeter ce terme. Ce qui n’est pas le cas des libéraux de l’école française qui n’ont jamais adopté la construction socialiste appelée capitalisme par les socialistes révolutionnaires et par les socialistes de la chaire, promoteurs du socialisme d’État, au sein de la grande Université allemande au début du XXe siècle. En revanche, il est vrai que leurs héritiers ont commis l’erreur, à mes yeux, de reprendre cette arme forgée par l’adversaire (qui me pousse à affirmer mon appartenance à l’école française). C’est le cas notamment de Ludwig von Mises – ce qui n’enlève rien à la grandeur de sa pensée – et surtout de Milton Friedman dans son Capitalism and Freedom, qui explique peut-être les ambiguïtés de son libéralisme et notamment son monétarisme qui va à l’encontre des théories libérales en matière monétaire. On notera que cela ne suffit pas à faire un front commun. Hayek est réticent à employer le mot. Ayn Rand voit le capitalisme comme une utopie dans son recueil Capitalism, the Unknown Ideal (1967). Nos amis « Autrichiens » parlent tout de même volontiers, pour décrire le marasme d’aujourd’hui, d’un « crony capitalism » (capitalisme de copinage) ou d’un « capitalisme sans capital ». Je suis enclin à leur demander en quoi, si ce capitalisme est de copinage – c’est-à-dire que le propriétaire d’un capital n’est plus responsable de sa création – ou que ce capitalisme est dépourvu de capital, le concept de est-il encore pertinent et efficace dans la défense du capital attaqué aujourd’hui de toute part ?
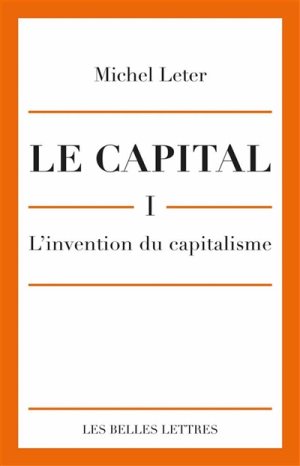
AP : Mais j’aimerais sortir un tout petit peu du livre, pour questionner le monde contemporain. Aujourd’hui, pratiquement tout le monde emploie ce mot, y compris des hommes politiques jugés « de droite » comme Nicolas Sarkozy, ce que, à ma connaissance, le personnel politique de droite ne faisait jamais avant les années 1980, comme si donc le lexique forgé par les penseurs socialistes avait été admis par tous, y compris par les adversaires déclarés du socialisme (génitif objectif et subjectif). Cette fortune du terme même de capitalisme n’est-elle pas une des traces de l’hégémonie intellectuelle de l’anticapitalisme qui non seulement nomme son adversaire mais en plus le construit ?
ML : Oui. Votre résumé est parfait. La classe politique française repose sur une « union sacrée », un « front national » contre le capitalisme, dont Nicolas Sarkozy est un des plus beaux spécimens. Si l’on prive notre classe politique de cette fiction, on lui enlève son principal aliment, la source de sa légitimité.
AP : Cette problématique m’amène à questionner le statut de votre propre ouvrage : s’inscrit-il dans une entreprise scientifique de rappel historique de la naissance des termes ou s’inscrit-il en plus dans une guerre idéologique visant à resémantiser certains mots selon les besoins de votre propre pensée ?
ML : Je récuse l’usage du vocable idéologique dans l’acception marxiste en vogue aujourd’hui, tant chez les marxistes chez les opposants déclarés au marxisme. Je réhabilite l’acception originelle du mot idéologie tel qu’il a été forgé Par Antoine Destutt de Tracy, avec le sens de science de la formation des idées. On comprend aisément pourquoi Marx s’est évertué à détourner le sens premier d’idéologie car le pseudo-socialisme scientifique avait besoin pour se développer de combattre la formation naturelle du capital, qui repose sur les facultés humaines donc sur la liberté de former ses idées et de les diffuser.
Quant à mes ambitions, elles sont modestes. je ne prétends pas faire œuvre d’économiste mais seulement d’honnête homme, au sens que le chevalier de Méré donnait à ce terme à savoir un homme qui n’a point pour métier de penser mais qui est curieux de l’essentiel, de ce qui, à proprement parler, est capital. Le seul titre que je brigue – et ce n’est pas à moi de dire si je le mérite – est celui d’historien, d’historien des idées, discipline presque introuvable en France et qui fait de vous un polymathe et un polygraphe, espèce honnie de tous les spécialistes qui peuplent nos universités d’État.
AP : Un passage brillant est consacré à l’argent. Contre la doxa voulant que nous vivions sous les règles du « capitalisme financier » vous montrez que rien n’est plus éloigné de la réalité des faits. « Les banques centrales ont fait triompher une théorie anticapitaliste de la monnaie selon laquelle cette dernière pourrait exister comme signe indépendamment de la propriété, de l’équivalence et de l’échange. »8 Mais que serait une activité « capitaliste » de la monnaie ? Serait-ce une monnaie outil d’une activité économique ? Pourquoi dans ce cas ne pas parler d’une activité « capitalienne » de la monnaie ?
ML : Oui je suis flatté que vous repreniez mon néologisme « capitalien ». Il n’est jamais heureux d’employer un néologisme si l’on peut s’en passer mais il m’a semblé qu’il convenait de distinguer la compétence que tout homme a de constituer un capital, ce qui en fait un « capitalien », du passage à l’acte, qui fait de lui un « capitaliste ». Il y a donc une conscience capitalienne que tout homme peut développer pourvu qu’il laisse sur une étagère les poèmes socialistes et une pratique capitaliste de plus en plus rare en cette époque où la plupart des grandes entreprises ne sont plus contrôlées par des capitalistes qui y risquent leur capital mais par des employés, qui, si l’on suit encore Marx, sont exploités par le grand capital.
Nous vivons aujourd’hui dans un système où ne circule plus qu’une monnaie dette, qui n’a plus pour vocation de faciliter les échanges mais la croissance exponentielle des États et des organisations internationales qui seront bientôt prêtes à prendre le relai. Cette monnaie-dette rend impossible la pratique d’un crédit capitaliste et donc dans l’inscription des projets dans le temps. Le métier de banquier n’est donc plus pratiqué même si la rhétorique néosocialiste a eu le génie de conserver l’appellation de « banque » pour des organismes qui sont devenus aujourd’hui des outils de captation étatique de l’épargne privée. La marche vers le socialisme ne repose plus sur la spoliation directe brutale mais par la spoliation légale consentie.
Le système anticapitaliste de la guerre mondiale, dont l’engrenage fatal s’est déclenché avec la création de la Banque d’Angleterre en 1694 avant d’être couronné par la création de la Fed Reserve américaine en 1913 rythme la macroéconomie. J’esquisse la description de ce système fatal au capital dans le livre II en précisant qu’il n’est pas le fruit d’un complot mais d’un logique implacable de haine du capital dont je suis loin encore de saisir tous les aspects. C’est une invitation au lecteur à joindre ses efforts aux miens car mes lumières sont bien trop faibles pour en prendre la mesure seul.
AP : Vous menez une longue critique de la situation monétaire contemporaine. « Le faux monnayage légal qui, faute de le réguler, « réglemente » le système monétaire actuel consiste à conférer de la valeur, sous l’effet du cours légal et du cours forcé de la monnaie, à un support qui en est dépourvu. »9 On sent ici poindre la critique adressée à Milton Friedman dont vous dites que le monétarisme est la « la théorie néosocialiste de l’émission monétaire. Cette théorie, qui passe pour néolibérale aux yeux des socialistes, n’est pas capitaliste, car elle repose non pas sur la valeur de la monnaie mais sur sa quantité. »10 Pourriez-vous expliquer en quoi un raisonnement fondé sur la quantité de monnaie et non sur sa valeur définit une approche « néosocialiste », lien que je n’ai pas tout à fait saisi en vous lisant ?
ML : Ma critique, que vous avez la mansuétude de qualifier de longue, n’est ici qu’une esquisse que je développerai dans le deuxième livre. Je conteste avec Maurice Allais (qui n’est pas un économiste libéral) que les États, dès lors que l’émission et circulation monétaire est confiée aux banque centrales, puisse fabriquer autre chose que de la monnaie-dette, donc de la fausse monnaie puisque cette monnaie n’est plus adossée ni sur des effets de commerce (plus l’économie ralentit plus on crée de monnaie pour la relancer alors que ce devrait être l’inverse dans un système capitaliste de banques libres) ni sur un équivalent en valeur depuis la fin de l’étalon-or en 1971. Les « billets de Monopoly » qui sont émis n’ont de valeur que parce que nous voulons bien croire qu’ils en ont.
Les banques centrales ont essentiellement agi ces dernières années par un outil qualifié de « non-conventionnel » par la presse économique, « l’assouplissement quantitatif » (traduction de Quantitative easing), euphémisme pour création ex nihilo débridée. Le dérèglement macroéconomique est tel aujourd’hui que ces « assouplissements » qui devraient générer une inflation galopante ne parviennent même plus à combattre la déflation, ce qui a conduit la Fed à y mettre un terme et à hausser ses taux directeurs récemment en désespoir de cause, sans avoir plus d’impact que naguère sur l’économie réelle (mais le pire en politique économique et de ne rien faire afin de ne pas être suspecté de libéralisme).
Si je qualifie ce régime suivi par l’empire américain et par ses vassaux de néosocialiste c’est parce qu’il s’agit, à mon sens, du stade suprême du socialisme, à savoir d’un socialisme qui ne dit plus son nom et se donne pour capitalisme. Cette mutation géniale permet d’autant plus facilement au socialisme d’imputer au libéralisme les crises financières à répétition qu’il provoque puisque le système financier est défini comme capitaliste.
AP : La situation est compliquée car, en apparence, la monnaie échappe au contrôle des Etats qui ont ainsi perdu un attribut de leur souveraineté. On pourrait donc penser que cela vous réjouit car vous contestez le fait que la monnaie relève de la souveraineté étatique ; mais pourtant vous accusez les banques centrales de délier la monnaie du capital. Pourquoi contestez-vous donc le fait que la monnaie pourrait être un attribut de la souveraineté des États et quel devrait être selon vous le rôle des banques centrales ?
ML : La distinction public/privé a perdu aujourd’hui toute pertinence et notamment dans le cas des banques centrales. Pour ce qui est de la Federal Reserve, je retracerai son histoire dans le livre II en rappelant qu’elle n’est pas une réserve, qu’elle n’a été construite comme fédérale que pour dissimuler sa centralisation. Si elle a été créée par des banques privées, leurs représentants on toujours su concilier leur enrichissement personnel avec les objectifs hégémonique de l’empire américain à partir de Première Guerre mondiale, dont sa création fut, à mes yeux, le signal.
Il est évident que les orientations les plus récentes de Madame Yellen11 sont en phase avec celle de l’administration fédérale engagé dans une guerre des monnaies absurde et suicidaire, censée servir les intérêt géopolitique de Washington.
Quant à la Banque centrale européenne (BCE), qui dans cette partie d’échec, affiche aujourd’hui un politique divergente d’euro faible, après avoir toujours défendu le contraire, elle ne fait que céder aux sirènes des pays du Sud (conduits par la France) dont les opinions publiques adhèrent au sophisme de la balance du commerce selon lequel une monnaie faible est bonne pour les échanges. Dans la réalité, une monnaie faible nuit à la formation du capital et donc ralentit l’investissement en empêchant les structures de production de s’adapter. C’est le mark et l’euro fort qui ont fait de l’Allemagne le premier exportateur de la zone euro et non pas la « dévaluation compétitive ». Les « souverainistes » pensent que c’est le caractère privé des banques qui est à l’origine de tous les maux et donc qu’il suffirait de sortir de l’Euro et de revenir au franc pour que l’onction de la fonctionnarisation fasse couler la vertu. Or, il est évident que si nous revenions au franc, la banque de France, qu’elle soit publique ou privée se lancerait des vagues de « dévaluation compétitives », qui ruinerait les derniers épargnants français qui s’obstinent encore à vivre sur le territoire de leurs ancêtres et ne créeraient pas plus d’emplois car, avec un franc faible, la source de l’emploi qui est le capital serait tarie.
Vous me demandez pourquoi je conteste la monnaie soit un attribut de la souveraineté des États et quel devrait être le rôle des banques centrales. La réponse est simple. Je crois avec Thomas Jefferson (élève de Destutt de Tracy) avec l’école française, particulièrement Charles Coquelin et Jean-Gustave Courcelle-Seneuil et avec Hayek et Rothbard qui ont actualisé leurs travaux, que la banque, comme les autres secteurs de l’économie, et peut-être plus encore que les autres doit être libre. Les banques centrales qui sont aujourd’hui responsables de l’essentiel des perturbations économiques n’ont aucun rôle à jouer. Je suis partisan de leur suppression pure et simple et de la privatisation de l’émission monétaire comme cela a été le cas en Écosse du début du XVIIIe siècle à 1845 avec un succès qui explique en grande partie l’émergence du Royaume-Uni comme première puissance mondiale.
AP : Si l’on vous suit, les banques centrales sont un « paradis anticapitaliste »12 pour les raisons évoquées ci-dessus, le capitalisme est un leurre, un mot vide de réalité ; pourtant, des auteurs comme Georges Lane non seulement reconnaissent l’existence du capitalisme mais de surcroît considèrent que le capitalisme est par nature financier puisque la finance rend possible l’échange des droits de propriété. Que répondre alors à ceux qui disent que le « capitalisme financier » n’est pas un terme vide d’objet mais au contraire un pléonasme ?
ML : Je doute que George Lane, qui prépare un livre important sur le système financier, et avec qui j’ai discuté il y a quelques semaines, soit aussi candide que vous le laissez entendre, La position de Lane est à la fois une position théorique, classique autrichienne chez les économistes français mais son originalité, qu’il partage avec le grand spécialiste français des banques, mon maître Philippe Nataf, est qu’il attribue un rôle important dans la théorie monétaire à Jean-Baptiste Say que les monétariste ont coutume d’accuser de « neutralité » en matière de monnaie.
Le capitalisme financier qui fonctionne en vase clos, entre les banques « privées » et les banques centrales qui les alimentent et donc qui n’irriguent plus le flot de crédit de ce qu’on appelle « l’économie réelle », laquelle ne représente plus au bas mot que 10% des échanges mondiaux, a-t-il encore quelque chose à voir tant avec le capital qu’avec la finance ?
AP : Si vous aviez à caractériser le monde dans lequel nous vivons et le pays dans lequel nous vivons, quels termes emploieriez-vous ?
ML : Nous vivons dans un système anticapitaliste et dans un pays néosocialiste, l’originalité de notre pays, la France, étant d’avoir inventé le socialisme moderne dans les années 1820, présenté comme une réponse au capitalisme alors que les conditions même de l’essor d’un capitalisme n’étaient pas réunies (système bancaire balbutiant paralysé par le monopole de la banque de France, bourse embryonnaire, création de sociétés soumise à l’autorisation administrative, ).
AP : Un point pour finir cette partie. Vous dites que le « capitalisme » est le « mythe fondateur de la poétique socialiste. En effet les partisans du collectivisme ont cette singulière supériorité sur les libéraux d’avoir saisi que l’homme était sensible avant d’être raisonnable. »13 Admettons ce point. Mais justement : cela soulève en creux – et sans doute involontairement – le problème de l’anthropologie libérale qui voit en l’homme un individu rationnel et vous constatez vous-même que finalement cette approche est inefficiente puisqu’elle oublie sa sensibilité. Mais n’y a-t-il pas là quelque chose à réformer dans le libéralisme ? L’homme peut-il vraiment être par nature individué, et sa raison peut-elle être efficiente en-dehors de tout apprentissage empirique ? Je veux dire par là qu’il me semble très artificiel de croire que l’individuation puisse avoir un sens en-dehors justement des conditions sociales, que le raisonnement puisse se développer en-dehors d’une instruction qui apprenne à raisonner, si bien que je me demande si le caractère raisonnable et individué inhérent à l’homme de l’anthropologie libérale n’est pas davantage une potentialité liée aux conditions de développement sociales qu’une actualité stricte et nécessaire. Bref il me semble que Hegel a raison de reprocher à l’anthropologie libérale de ne pas voir que seule la médiation sociale permet à l’être particulier de devenir un être individué, singulier, libre et rationnel.
ML : C’est la sociologie néo-classique d’inspiration anglaise qui voit l’homme comme un être rationnel dans son milieu, avec notamment la fiction de l’homo economicus. L’anthropologie libérale français avec Bastiat, Guyot, Molinari, Courcelle-Seneuil (voire même Gabriel Tarde), insiste plus volontiers sur l’irrationalité des comportement économiques de l’individu en société. Le libéralisme, contrairement à l’idée reçue est social et je ne connais pas de philosophie libérale qui conçoive l’individuation hors de la société.
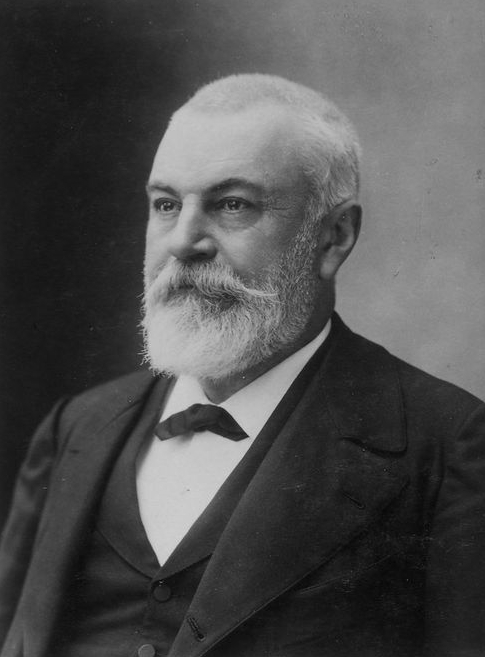
Yves Guyot
Quant à la critique de l’anthropologie libérale qu’aurait élaborée Hegel, je ne vois pas à quel texte vous faites allusion. Je ne peux donc pas vous répondre.
C : Sens et portée du « Capital »
AP : Je faisais référence aux Principes de la Philosophie du droit, notamment au § 182 qui me semble être une critique de l’incomplétude du libéralisme. Mais venons-en à ce thème du capital. Un des points que j’ai trouvé très salutaire dans votre ouvrage est votre insistance sur le fait que personne ne définit clairement cette notion de capital. Il est des termes comme cela en philosophie que chacun utilise comme des évidences mais dont très peu de monde est capable de produire une définition claire ; l’ « intentionnalité » en philosophie me semble faire partie de ces mots-là dont on demande une définition et pour lesquels on reçoit des réponses variables et floues : ainsi l’intentionnalité serait un « éclatement vers », ou « toute conscience serait conscience de quelque chose » ; soit, mais qu’est-ce que tout cela veut réellement dire ? Il en va de même pour le capital : est-il un investissement en vue d’un profit, une richesse immédiate et disponible, un bien matériel ? Tout cela est en effet très obscur et fort mal défini. Vous citez d’ailleurs une définition de Guyot que je trouve pour ma part plus que floue : « Le capital est ce talent qui n’est rien si l’homme n’est pas libre de le cultiver. »14 Comment comprendre une telle définition ?
ML : Je crois comprendre le concept d’intentio chez les scolastiques mais lorsqu’il devient la clé de la mystique phénoménologique chez Brentano, Husserl et Sartre je suis moins disposé à adhérer au credo. Tout ceci me semble relever d’un galimatias pédant qui permet avant tout aux philosophes – qui aiment à parler de sujet pour ne pas prononcer le mot d’individu – de se perdre dans les méandres de l’intentionnalité pour ne pas être obligés de réfléchir à la liberté de constituer ou non un objet.
Quant à la définition de Guyot, elle me semble claire. Il vous suffit de reprendre la parabole des talents et de vous convaincre que si le serviteur auquel le maître confie un talent évoluait dans un régime où il lui serait impossible de le faire fructifier, son talent perd toutes les vertus d’un capital.
« Le capital, c’est l’homme » comme dit Guyot. Il est évident que la démarche du serviteur n’est pas matérielle mais spirituelle. Ce n’est pas en doublant un talent qu’il s’enrichit matériellement. Mais en revanche l’enrichissement spirituel tombe sous le sens, autrement cette histoire n’aurait pas été donnée sous la forme d’une parabole, ce que visiblement la plupart des chrétiens n’ont toujours pas compris puisqu’ils répètent à l’envi le fameux pecunia pecuniam parere non potest, « l’argent ne peut engendrer l’argent » de Thomas d’Aquin. Mais naturellement entre pratiquer un taux d’intérêt de marché et pratiquer un taux usuraire, il y a place pour que la morale, religieuse comme laïque, sévisse. Sans marché financier, les taux sont toujours manipulés frauduleusement même s’ils confinent au taux zéro, voir qu’ils entrent en territoire négatif, ils sont usuraires.
AP : D’ailleurs, je me permets une digression sur la question des définitions. Si j’avais un reproche à vous adresser, il porterait justement sur la notion de « socialisme » ; il me semble être employé comme un strict synonyme de « collectivisme » ; quelle définition donneriez-vous du socialisme d’une part et du collectivisme d’autre part ? Et tout socialisme est-il selon vous collectiviste ?
ML : Le socialisme n’est que la doctrine politique qui prône le collectivisme comme une panacée. Un socialisme qui désignerait l’individualisme comme solution perdrait sa substance de socialisme. De nos jours, on n’emploie plus le mot de collectivisme car ses connotations totalitaires sont trop criantes alors que le socialisme a conservé son prestige et continue à exciter les imaginations.
AP : Je reviens alors à la question du capital. Vous employez le terme de « capitalien », terme que vous me semblez forger et qui désigne ce que l’homme possède en propre, soit initialement son corps. « Tout homme, pourvu qu’il ne soit pas dépossédé de lui-même, est donc capitalien. »15 Est-ce une reprise du Locke du Second Traité du gouvernement civil au sens où il appartiendrait à l’essence humaine d’être propriétaire ?
ML : Naturellement lorsqu’on est, comme moi de sensibilité libérale, on adhère spontanément à Locke. Mais en méditant et surtout en confrontant ses principes à l’histoire du droit, on se rend compte que son anthropologie n’est pas tant libérale qu’utopique car la propriété n’est pas définie en droit dans toutes les sociétés positives. On ne peut poser comme anthropologique un principe s’il fait l’économie de ce qui est au plus proche de l’individu dans certaines sociétés où l’individu n’est pas la valeur cardinale et où priment le groupe, la tribu.
Dans le deuxième livre du capital, j’irai jusqu’à poser la question : Locke s’est-il trompé ? mais à ce stade de mes travaux, je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse.
AP : Une des forces de l’ouvrage est de retracer la généalogie du sens du capital et le moins que l’on puisse dire est que le sens varie. L’etymon de capital ramène à l’homme ; il vient de cheptel et de Caput, tête de bétail, siège de l’esprit. « Etymologiquement, écrivez-vous, le capital est donc saisi comme la métonymie par excellence de l’homme. »16 Le capital est « ce par quoi l’homme devient son propre chef, son propre souverain, d’où l’aversion à l’égard du capital de tout esprit qui, en concevant le prolétaire comme acéphale, entend enrégimenter l’homme. »17
Quant à l’emploi historique, le mot capital est attesté dès 1200, venant de capitalis, dérivé de caput ; en droit cela désigne « ce qui peut couper la tête ». Puis il désigne la partie principale d’une dette puis d’une rente. En 1606, dans le dictionnaire de Nicot, le capital fait son entrée dans l’entreprise : il est décrit comme le « fonds qu’on fait valoir dans une entreprise. » Et en 1767, « les capitaux désignent « l’ensemble des sommes en circulation des valeurs disponibles. » Le capital est donc un bien qui en produit d’autres et inscrit la propriété humaine au bout de la chaîne causale de la création. La monarchie de Juillet rajoute l’idée d’une « richesse considérée comme moyen de production ». D’une certaine manière, si je ne trahis pas votre propos, on a déjà là une confusion puisque le capital était fondamentalement lié au travail et la Monarchie de Juillet le confond avec la richesse qui est un moyen permettant de satisfaire des besoins. Cette confusion entre richesse et capital n’est-elle pas en fait un élément récurrent de la « science » économique ?
ML : Plus précisément pour distinguer capital et richesse, Yves Guyot part de la notion d’utilité « est utilité tout agent naturel approprié par l’homme » ; « toute utilité est un capital » et « le capital d’un individu est l’ensemble des utilités possédées par lui », ce qui distingue la propriété, qui « s’applique à toutes les utilités possédées » par un individu, de la richesse, qui n’a pas de valeur en droit et ne désigne que « la quantité relative des utilités possédées par un individu ».
La confusion entre richesse et capital est un élément récurrent de la politisation de la « science » économique. Au lieu de se contenter de mesurer le taux de capitalisation de nos sociétés et donc de constater sa faiblesse, les commissaires politiques, qui nous tiennent lieu d’économistes, accolent à tout ce qu’ils croient avoir mesuré comme quantité (inégalitaire) de capital, la connotation péjorative de « richesse ».
AP : Un autre point très important de l’ouvrage vise à relier le capital en lien avec le travail avec la notion de valeur ce qui vous amène à la définition suivante : « il est constitué par l’ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation improductive qu’à la production stérile et que le passé a léguées au présent. »18 Pourriez-vous expliquer cette définition qui n’est pas si simple que cela ? Que signifie l’idée selon laquelle le capital doit être décrit par une philosophie de l’avoir et non de l’être, thème central du quatrième volume de votre entreprise ?
ML : Le capital « est constitué par l’ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation improductive qu’à la production stérile et que le passé a léguées au présent. » sous-tend que sans capital l’homme n’a pas de projet. Le capital c’est, en substance, le facteur temps de l’économie. Ce ne sont pas les capitalistes qui font la promotion de la société de consommation mais, au contraire les socialistes, qui y trouve l’alpha et l’oméga de toute « croissance » ou « relance » économique. Le capital s’oppose à la consommation (et à la société qui va avec) car l’épargne ne se forme que par un renoncement à la consommation immédiate. Le capital se forme également par le rejet des « productions stériles », c’est-à-dire des productions protégées, surnuméraire et sisyphiques que nous avons évoquées en conversant sur Bastiat. Enfin, le capital ne se forme et prospère que si « le passé peut léguer au présent », formule que j’emprunte à Charles Coquelin, ce qui suppose la suppression de la spoliation successorale par laquelle l’État empêche aujourd’hui la transmission du capital entre les générations.
AP : Puisque vous reliez le capital à la valeur, vous en proposez une axiologie dont le premier point est le « monothéisme méthodologique ». Aucune connaissance humaine ne peut se substituer à l’omniscience divine. « Le monothéisme méthodologique consiste donc à séparer radicalement l’ordre de ce qui est de l’ordre de ce qui a. »19 Quel est le sens de cette méthode ? Est-ce une manière de dire que si Dieu est, l’homme a, donc que le capital ne peut être qu’humain ? Je ne comprends pas bien à quel problème répond cette méthode à vrai dire.
ML : Ce sera la clé du troisième livre, Théologie du capital. Le concept du monothéisme méthodologique est inspiré de celui d’individualisme méthodologique proposé par l’école autrichienne. Il n’est pas nécessaire d’adhérer au monothéisme pour l’utiliser méthodologiquement. En étudiant le capital, j’ai pris la mesure de l’anticapitalisme qui tire sa force de la multiplicité de ses dimensions. S’il n’était qu’un phénomène économique, il aurait été facilement vaincu par la logique libérale. Or, c’est parce qu’il est également d’ordre poétique – comme je crois l’avoir démontré dans le livre I et surtout d’ordre religieux, comme je tenterai de le démontrer dans le livre trois qu’il est aussi prégnant.
L’histoire du capital correspondant autant à celle de sa formation qu’à celle de sa spoliation, une étude pertinente du capital ne peut se passer de la prise en compte de deux courants qui ne forment pas en soi des écoles de pensée économique mais plutôt des cosmologies et des métaphysiques.
Le premier, qui régit aujourd’hui nos sociétés, est un courant destructeur dont les tenants décrètent que les
richesses existent en soi et peuvent être redistribuées, sans tarir leur source, en vertu de la croyance que la terre est à tous et donc ne doit appartenir à personne. Cette croyance repousse la conception d’une souveraineté capitalienne (qui naissant de la longue durée n’apporte progrès et prospérité que si elle s’enracine dans un sol et une histoire).
Le second – marginal aujourd’hui – est un courant créateur où se reconnaissent les esprits qui observent que la richesse n’est pas une donnée en soi mais un fruit de la liberté humaine. La condition sine qua non de cette liberté est la propriété inaliénable et imprescriptible du capital (qui, hélas, n’est pas un droit naturel mais ne peut être garanti que par les différentes formes de droits positifs ou coutumiers).
Il convient, en outre, de distinguer entre la Création divine et la création humaine, le domaine du capital, comme vous l’avez compris, étant strictement limité à la création humaine. Dieu ne crée pas de capital. La terre qu’il laisse ne devient un capital que lorsque l’homme se l’approprie pour honorer son créateur en la valorisant. Les socialistes croient qu’on peut la mettre en valeur par le simple partage mathématique tandis que les libéraux estiment que la terre n’est écologiquement mise en valeur que si elle donne lieu à des droits de propriété, étant entendu qu’un propriétaire prend davantage soin de ses biens qu’un locataire. Adam est donc le lieutenant de Dieu sur terre. Le Coran emploie le mot de calife (khalifa) pour désigner cette fonction (comme le mot calife existe en français, je préfère traduire par ce mot plutôt que par celui de lieutenant) sans préciser si elle donne lieu à une souveraineté ou à une propriété : « Ton Seigneur dit aux anges : « Je vais instituer un calife sur la terre ». Ils dirent : « Comment ! Tu rendrais tel celui qui y fait tellement de dégâts et qui verse le sang, alors que nous autres célébrons ta transcendance et ta sainteté ? » Il dit : « Moi, je sais que vous ne savez pas » (Coran, Sourate II, 30). On voit que cette confiance du Dieu en la responsabilité de l’homme suscite l’ire des anges (écologistes avant l’heure), qui considèrent l’homme comme un prédateur.
La lexicalisation de la métaphore « État-providence » et surtout l’idée que les gouverneurs des banques centrales peuvent légalement créer de la monnaie ex nihilo, par une manière de fiat électronique, restaurent un ordre païen que les économistes ne peuvent occulter à moins de s’obstiner à faire crédit à la sociologie weberienne du capitalisme.
Dans le paganisme, et notamment le manichéisme qui est une des principales inspirations de l’ésotérisme socialiste, il y a un Dieu pour la destruction comme pour la création. Dans le monothéisme pur, « il n’est de Dieu que Dieu » Lâ ilâha illa-llâh, premier volet de la chahada, la profession de foi musulmane. Mais il n’est pas naturellement nécessaire de faire partie de la communauté des croyants pour comprendre que, méthodologiquement du moins, cette formule circulaire, toute en assonance et en allitération (donc qui n’hésite pas à recourir – en connaissance de cause – aux pouvoirs de la poésie), traduit parfaitement la radicalité de la transcendance monothéiste, sans laquelle toute théorie du capital sort de la chaîne des causes.
J’admets la distinction de Say et de Coquelin entre ce qui relève du « fonds primitif » et du capital, c’est-à-dire entre la Création divine et de la création humaine, étant entendu – que l’on admette ou non la transcendance – que le capital est strictement immanent et que la création ex nihilo est l’apanage du Créateur – que l’on croie ou non en lui. Dieu est celui qui est et l’homme celui qui a. Tandis que la Création divine est une émanation de l’être, la création humaine est impensable sans l’avoir, la propriété qui en est la forme juridique et la liberté, condition sine qua non de son exercice.
Le monothéisme méthodologique se caractérise donc par la séparation radicale de la transcendance et de l’immanence. Puisque la connaissance de l’homme se limite à ce qu’il a, à ce qu’il possède en propre, à son capital, l’être est du domaine de la transcendance. Si les philosophes font l’hypothèse d’un homme sans capital, c’est qu’ils entendent y substituer la fiction d’un être suprême auquel il serait moral de sacrifier l’avoir capitalien.
Autrement dit, dans une société où l’homme a la garantie d’être propriétaire de ses valeurs, aucune omniscience ou omnipotence humaine ne peut se substituer à l’omniscience et à l’omnipotence divine. Par conséquent aucune puissance ne peut se substituer à la prévoyance individuelle et aucun État ne peut s’attribuer les vertus de la Providence. Le monothéisme méthodologique consiste donc à séparer radicalement l’ordre de ce qui est de l’ordre de ce qui a. Méthodologiquement, Dieu est celui qui est et l’homme celui qui a. Ce que l’homme a, ce sont l’ensemble des valeurs qui constituent son capital. Ces biens revêtent une forme tant matérielle qu’immatérielle. Tel homme a les yeux noisette, le nez aquilin et les lèvres gourmandes. On objectera qu’il est généreux, vaillant et prévoyant et donc que ses valeurs morales relèvent de l’être. Mais c’est ici conférer à la copule est, qui n’est qu’un outil grammatical, une valeur ontologique, idée aussi saugrenue que laisser entendre que si le français dit le soleil et l’allemand die Sonne, c’est que la langue de Molière attache à l’astre du jour les attributs de la virilité et la langue de Goethe ceux de la féminité. Si notre homme est généreux, vaillant et prévoyant, c’est tout simplement qu’il a les qualités de générosité, de vaillance et de prévoyance, et que ces valeurs entrent dans son capital. Il peut employer sa prévoyance à épargner ou à investir cette épargne dans une association philanthropique afin de donner libre cours à sa générosité ou enfin mettre sa vaillance au service de la patrie puisque avoir un capital, c’est aussi éprouver son droit de le sacrifier.
La suite, consacrée à Marx, se trouve à cette adresse.
- « Préface des Pamphlets, art. cit., p. 30
- Ibid.
- Michel Leter, Lettre à Luc Ferry sur la liberté des universités, Paris, Les Belles Lettres, 2004
- Michel Leter, Tout est culture, Paris, les Belles Lettres, 2015
- Leter, Le Capital, op. cit., p. 259
- Ibid., p. 260
- Ibid.
- Ibid., p. 250-251
- Ibid., p. 253
- Ibid., p. 254
- Janet Yellen est présidente de la FED depuis janvier 2014
- Ibid., p. 256
- Ibid., p. 265
- Ibid., p. 10
- Ibid., p. 10
- Ibid., p. 20
- Ibid., p. 21
- Ibid., p. 76
- Ibid., p. 85







