Depuis Heidegger et son analyse des souliers de Van Gogh, semble planer le muet impératif adressé à la phénoménologie de rechercher dans l’œuvre peinte, en tant qu’elle se montre, la confirmation des analyses de la phénoménalité qu’élabore chaque auteur. Ainsi en va-t-il de Merleau-Ponty avec Cézanne, de Michel Henry avec Kandinsky, et désormais de Jean-Luc Marion avec Courbet. Celui-là vient en effet de consacrer à celui-ci un bel ouvrage érudit1 où se trouvent mises à l’épreuve un certain nombre d’analyses phénoménologiques – en premier lieu celle de la saturation – tandis que l’auteur nous révèle sa passion pour le peintre d’Ornans à partir d’une description assez intime, voire émouvante, de son enfance. De là d’ailleurs la double dimension de l’ouvrage, à la fois inscrit dans la singularité d’une expérience personnelle et en même temps destiné à tester la notion de saturation à travers le parcours d’une œuvre peinte abondamment méditée.
Si ce livre constitue donc une étude informée concernant Courbet, il se révèlera également infiniment polémique, car le champ réel envisagé par l’ouvrage outrepasse largement le titre annoncé ; c’est en effet à une discussion pour le moins tendue avec les principes classiques de la peinture, notamment développés par l’Italie de la Renaissance, que nous invite Jean-Luc Marion, principes classiques qui, selon l’auteur, auraient totalement manqué la phénoménalité comme telle, et seraient restés prisonniers d’une approche objectivante de l’image dont Courbet aurait su nous libérer. En d’autres termes, loin d’écrire sur Courbet comme tel, Marion propose une réflexion plus vaste sur la corruption picturale initiée par l’Italie et dont Courbet indique la porte de sortie, corruption picturale dont il nous faudra évidemment interroger le sens qui lui est prêté.
Sans que ce ne soit à proprement parler la première fois que J.-L. Marion écrive sur la peinture – nous pouvons songer aux pages sur Caravage dans Etant donné -, c’est la première fois que sort publiquement une analyse aussi poussée de la pratique picturale d’un artiste, mettant à l’épreuve les principes phénoménologiques du philosophe français, sur fond d’une connaissance bienvenue des œuvres du peintre.
A : Une expérience personnelle
Dès la préface de l’ouvrage se trouvent exposés les motifs personnels qui ont guidé Marion vers Courbet à tel point qu’il évoque un « compte personnel »2 à régler avec ce dernier, compte personnel lié à la géographie : il est du pays de Lods, à quelques lieux d’Ornans. Or, écrit Marion, « La Loue, moi, aussi j’ai senti le froid et la puissance de son cours, le ronflement ininterrompu de ses barrages, la majesté jaune de ses crues, la ruse et la beauté de ses truites (et la dissimulation des chavots sous les pierres), la gamme sans fin du gris des rochers qui la surplombent, l’éblouissante variété des verts de tous les arbres qui l’embrassent, les rudes côtes qu’elle a creusés alentour et qui semblent n’offrir jamais de descentes au coureur ou au cycliste (car il y a bien des montagnes sans vallées, contre l’évidence de Descartes), le défilé des nuages à l’automne, la fourrure de la neige en hiver ou le bleu hölderlinien du ciel d’été. »3
La description se veut ici poétique, et fait de la fréquentation de lieux communs, donc de la géographie, l’origine sensible de la dilection vers Courbet ; mais cela ne signifie pas pour autant qu’une telle origine fut décisive ; Marion ajoute un autre élément de l’ordre de la médiation rendant possible l’accès à la grandeur de Courbet ; et cette méditation, ce fut Cézanne. « Courbet a donné lieu à Cézanne, mais Cézanne seul situe le lieu de Courbet. »4 A bien lire cette préface, on comprend que la découverte de Courbet fut indirecte et doublement médiatisée : médiatisée d’abord par Cézanne qui permit de comprendre rétrospectivement la place de Courbet dans l’histoire de la peinture, médiatisée également par ce qui est peint, donc par l’image où résonne l’histoire personnelle du philosophe Académicien : si, en effet, ce sont les lieux peints, donc les images, qui évoquent le passé de Marion, alors par quelle passerelle accède-t-on à une réflexion sur le visible et la visibilité, comme ce sera le cas ? Les souvenirs ici invoqués n’ont de sens qu’iconographique, mais l’auteur souhaite montrer que ces images lui ont révélé ce qu’il avait vu d’une manière plus authentique que sa vision initiale : en d’autres termes, l’image peinte révèle la visibilité réelle de la chose peinte mieux que ne le ferait un regard immédiat, d’où cette idée d’imposer un nouveau visible à la visibilité affirmée dès le début de l’ouvrage.
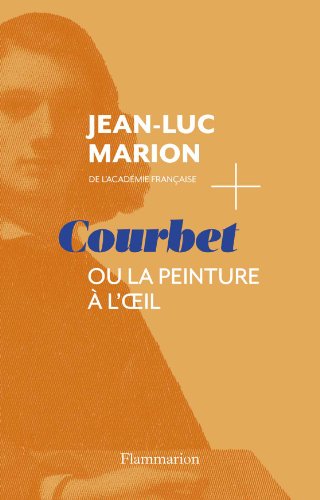
Ainsi se conjuguent trois niveaux : 1) Un niveau très personnel, enraciné dans une fréquentation de lieux spécifiques ; un niveau iconique où l’image peinte éveille un intérêt lié à la fréquentation des lieux communs ; 3) un niveau phénoménologique où se trouve interrogé le rapport de l’image à la chose sous l’angle du visible et de l’invisible avec des accents très merleau-pontiens. La conjugaison de ces trois niveaux crée cet ouvrage singulier, dont nous allons analyser les résultats les plus explicites, et évaluer les attaques plus ou moins claires adressées à la peinture renaissante et classique, sans lesquelles la réévaluation de Courbet ne saurait être intelligible.
B : La donation de l’image
Le titre de l’ouvrage est emprunté à une remarque de Ingres, l’anti-Courbet à bien des titres, pour lequel A en croire Ingres, « Courbet avait l’image toute faite dans son œil. » (cité p. 24) Mais que signifie cette expression ? « être un œil signifie voir en peignant, voir en même temps, dans le même geste et dans la même énergie que l’on peint ; autrement dit, voir en tant que peignant. »5 D’une certaine manière, tout est déjà dit dans cette analyse, en tant que l’ensemble de l’ouvrage de Marion tendra à montrer que s’opposent l’image comme telle et les objets déjà conçus, donc déjà découpés, donc déjà disposés par l’entendement sur la surface plane. Il est d’ailleurs étonnant que Marion n’ait pas davantage thématisé la question du tout et de la partie, car toute sa thèse revient à dire que Courbet est un peintre de l’image prise comme totalité par opposition à une sorte de découpage analytique de chaque objet qu’il s’agirait d’organiser par composition sur une toile ou une fresque. En d’autres termes, l’identification de chaque élément ainsi que l’agencement de l’ensemble des éléments importent moins que le surgissement massif de l’image, ce qui n’a de sens que si l’image est ici saisie comme totalité. « Etre un œil, écrit Marion, veut donc dire que Courbet parvenait à peindre ce qu’il voyait, avant de savoir de quel objet il s’agissait éventuellement, qu’il parvenait à rendre l’apparition sans la pré-voir, sans la pré-concevoir, bref à la rendre comme elle se donne. Remarquons le paradoxe. Spontanément, nous concevons la peinture comme l’activité de peindre ce que l’on voit, à savoir ce que l’on a déjà vu ou plutôt regardé, parce que nous admettons comme allant de soi qu’il faut regarder, garder dans la vision et peindre ensuite ; en sorte que sur le tableau fait l’on puisse revoir « en peinture » ce qu’on avait préalablement vu « en vrai » et gardé sans mégarde « en tête ». »6
Le monde tel que nous le découpons conceptuellement en objets, et tel que nous le reconnaissons par identification de phénomènes n’est pas celui, selon Marion, que peint Courbet ; celui-ci peindrait précisément à l’œil, ce qui revient à dire que Courbet peindrait ce qu’il voit sans que l’œil ne soit ici accompagné de la médiation identifiante du concept. En termes habituels, nous dirions que Courbet peint selon Marion un chaos, en tant que ce chaos se voit et en tant qu’il signifie ce qui n’a pas été organisé par l’ordre du concept. Ainsi, « dans la pratique picturale de Courbet, le tableau surgit de l’œil, par une apparition qui ne présuppose aucune identification préalable d’un objet : le monde visible ne coïncide pas avec le monde connu et identifiable d’un objet prévu et attendu, gardé et regardé. »7
Pourquoi Marion arrache-t-il ainsi Courbet de la pré-conception pour le flanquer dans une sorte de visibilité pure non travaillée par le concept ? Parce que cela lui permet de rattacher l’image de Courbet à la donation, concept phare de sa pensée. Dans Etant donné, ce dernier expliquait en effet qu’il était inutile d’interroger la causalité du phénomène, c’est-à-dire son antériorité puisque le phénomène est « sans généalogie. »8 Cela permettait ainsi de poser le phénomène donné comme m’arrivant de façon originaire, faisant l’économie du sujet transcendantal et de toute préformation ; par analogie, l’image que peint Courbet serait dénuée de toute antériorité conceptuelle, en tant que ce qui est peint ne serait pas initialement reconnu et l’identification des objets ne serait pas un préalable requis pour peindre l’image. Ainsi le phénomène se donne-t-il de lui-même, à l’œil, gratis.
C : Implications du phénomène saturé
Si nous tirons les conséquences de ce qui vient d’être dit, il nous faut comprendre que Marion conteste l’idée que la peinture doive être conçue ; la peinture apparaît bien plutôt comme une sorte d’acte révélateur par lequel l’œil déconceptualisé reproduit ce qu’il y a à voir en formant une image globale, ce qui signifie que l’œil a une perception d’emblée synthétique ou, à tout le moins, qu’il n’analyse pas les éléments composant ce qu’il voit, ce sans quoi l’analyse déterminerait le peintre à concevoir l’organisation de l’espace, donc l’amènerait à composer sa représentation.
C’est précisément là que l’ouvrage devient très discutable, car affirmant une thèse dont les implications nécessiteraient de plus amples arguments : que signifie voir sous une forme d’emblée synthétique ? Qu’est-ce que cela implique quant à la perception ? Qu’est-ce que cela implique quant à la vision ? Tout se passe au fond comme si Marion considérait que l’on pouvait in concreto distinguer l’esthétique transcendantale de l’analytique transcendantale, que l’on pouvait voir sans percevoir, recevoir un phénomène comme chaos pur – au sens de : non organisé – sans aussitôt l’organiser ; cette distinction qui n’est valide que pour l’analyse réfléchie chez Kant semble appliquée concrètement dans la vision par Marion, application dont on se demande précisément en quel sens elle est concrètement possible : voir sans percevoir, comment cela est-il possible ?
Marion répond évidemment à ce problème, en convoquant la saturation : « En ce sens, Courbet (comme tous les peintres dignes de ce nom) s’inscrit au nombre des praticiens du phénomène saturé, de l’apparition d’un phénomène où l’excès et la priorité de l’intuition ne peuvent jamais se laisser régler par un ou plusieurs concepts, significations ou conceptions qui les précéderaient. »9 Pour bien comprendre ce que signifie cette réponse, retournons-voir ce que signifie la saturation chez Marion, notamment au § 21 de Etant donné : « Le phénomène saturé se décrira comme invisable selon la quantité, insupportable selon la quantité, absolu selon la relation, irregardable selon la modalité. »10 Dit autrement : « le phénomène saturé ne peut se viser. »11 Le phénomène saturé est tel que l’intuition déborde l’intention, que ce qui se donne excède largement ce que j’en peux comprendre ou englober par ma visée. Il y a phénomène saturé à chaque fois que je fais face à un phénomène qui s’impose à moi sans que je ne puisse l’identifier ; supposons donc que l’image soit un phénomène saturée, cela signifierait que l’image me donnerait plus que je n’en pourrais comprendre, qu’elle me donne à voir plus que ce que mon esprit peut regarder.
Mais il nous faut interroger une telle thèse, comprendre ce qu’elle signifie concrètement. Premièrement, et c’est primordial, cela ne vaut encore une fois que si l’on raisonne à partir d’une totalité ou, mieux encore, d’une icône d’emblée totale ; si elle était assemblage de parties, elle serait composition, et serait donc conçue. Il faut donc supposer que l’image soit un tout indécomposable à l’intérieur duquel ne se laisserait lire aucune composition, c’est-à-dire aucune maîtrise. Mais se révèle ici une des grandes difficultés de l’ouvrage qui est l’indistinction permanente entre la question iconographique et la question plastique ; Marion passe sans cesse de l’image à la question plastique, puis de celle-ci à celle-là comme s’il s’agissait du même problème ; or cela n’a rien à voir. L’identification des éléments, l’objectivation de ces derniers est un problème iconographique ; la question de leur agencement est un problème plastique. Ainsi pouvons-nous parfaitement concevoir que des éléments soient connus sans qu’ils ne soient organisés clairement dans l’espace tout comme nous pouvons concevoir une organisation rigoureuse d’éléments dans l’espace, sans que l’image formée ne soit cohérente. Certes, l’auteur répondrait sans doute que précisément Courbet ne peint pas des images mais cela serait contradictoire avec son entreprise puisque plusieurs analyses d’images sont menées à la fin de l’ouvrage. Bref, Marion nous semble ne pas dissocier la question de l’image de celle de la forme, et fait le pari d’un écrasement de cette distinction sous le joug infamant de la conceptualité, ce qui ne nous semble tout simplement pas tenable.
En outre, dans la notion même de saturation, demeure une autre ambiguïté : à bien lire la définition qu’en donne Marion, il s’agit d’une relation et non d’une situation qui serait en-soi : il n’y a de saturation que dans le cadre très précis où l’intuition est en excès sur l’intention. En toute logique, cela ne signifie donc pas que l’intention fait défaut absolument parlant, mais qu’elle est en défaut par rapport à l’intuition. Dans ce cas, une image saturée ne peut être présentée comme une image qui ne saurait être conçue ; elle ne peut être présentée que comme une image qui ne saurait être intégralement conçue, ce qui revient à dire que si la saturation est une relation, alors elle introduit un écart tel que la compréhension totale ou parfaite de l’objet est impossible : mais l’impossibilité porte sur la totalité, pas sur la compréhension, ce sans quoi nous ne comprendrions plus en quel sens la saturation se présente comme une relation entre intuition et intention. Par conséquent, dire que l’image est saturée, c’est dire qu’elle n’est que partiellement compréhensible, qu’elle conserve un sens qui outrepasse ce que je peux en viser, sans que cela ne puisse signifier que je n’y comprends rien. Plus étonnant encore, et cela suscite notre perplexité : le sens du phénomène en tant que saturé se révèle intégralement conditionné par le sujet, en tant qu’il n’est de phénomène saturé que pour une relation interne au sujet où l’intuition écrase l’intention ; mais alors, en quel sens peut-on dire que le phénomène saturé ne présuppose pas un sujet transcendantal à partir duquel seul serait conditionné le sens même du phénomène en tant que saturé ?
Enfin, il est une dernière difficulté d’ordre historique : nonobstant l’indistinction que laisse planer Marion entre l’image et la forme, il semble que ce dernier vise essentiellement la question de la forme lorsqu’il s’en prend au dessin et à la composition qui, selon lui, corrompent la représentation lorsqu’ils la précèdent en tant qu’ils relèvent de la conception. Naturellement, cela rend inintelligible la réponse par la saturation car l’on ne voit pas du tout en quel sens l’organisation interne du phénomène (la composition, le dessin) pourrait être du même ordre que l’identification objectivante des éléments. Mais surtout, on ne voit pas bien dans l’histoire de la peinture renaissante, classique et moderne qui aurait renoncé à organiser la représentation à part Courbet ; de ce fait, la parenthèse de Marion prend une tournure pour le moins angoissante car l’on en vient à penser que la peinture, c’est Courbet, et Courbet seulement ! Relisons à cet effet le passage déjà cité : « En ce sens, Courbet (comme tous les peintres dignes de ce nom) s’inscrit au nombre des praticiens du phénomène saturé (…). »12 Que peut bien signifier ici la parenthèse (comme tous les peintres dignes de ce nom) sinon que Courbet est le seul peintre « digne de ce nom » de l’histoire renaissante, classique et moderne de la peinture (exception faite de Cézanne) ?
D : La peinture peut-elle être un phénomène saturé ?
Le résultat précédent (faire de Courbet et de Cézanne les seuls peintres de l’histoire de la peinture) est à nos yeux fort discutable mais il présente un mérite, à savoir mettre en lumière l’extrême difficulté d’associer la peinture à un phénomène saturé. Sans même retenir les traités d’Alberti ou de Piero della Francesca, nous pourrions remonter à l’iconographie médiévale au sujet de laquelle Jérôme Baschet parle avec précision de l’ « image-objet »13 afin d’en montrer la richesse et la profusion de significations rendant possible la visée que nous en avons. Nous ne voyons donc pas bien à quel type d’image pense Marion lorsqu’il parle de phénomène saturé, ce qui nous invite à questionner un thème central de son œuvre, à savoir le rapprochement de la peinture – en général – avec les phénomènes saturés, thèse qui ne nous semble valoir que si l’on expulse précisément de la peinture l’essentiel de son histoire.
Dans un livre crucial quant à l’intelligibilité de son œuvre, Marion livre une analyse de la saturation qu’il met en relation avec la peinture, dont il affirme qu’elle impose son propre visible : il s’agit là d’une réflexion sur la peinture en général, par laquelle s’opposent vue et regard. « La vue captivée devient regard assigné. Ainsi s’accomplit l’idole : le premier visible que la vue ne peut transpercer et abandonner, parce qu’il la sature pour la première fois et en accapare toute l’admiration. »14 La peinture destitue le prestige de la visibilité du monde en imposant un nouveau visible ; mieux encore, il n’y aurait que du visible dans le tableau, tandis que le monde serait parcouru d’une profusion de propriétés phénoménales, le visible lui-même étant parcouru d’autre chose que lui-même. En d’autres termes, dans la peinture le phénoménal est réduit au visible ; sous-entendu : le phénomène se vide de tout ce qui n’est pas visiblement intuitif, donc apparaît en excès d’intuition, si bien que la peinture est par principe un phénomène saturé selon Marion. « L’idole accomplit la réduction phénoménologique du donné visible au vu pur. Elle reconduit ce donné à la surface sans retrait, sans vide ni profondeur. »15 La peinture a donc pour fonction de réduire ce qui se donne à ce qui se montre et à sa visibilité pure. « Voici le tableau : l’espace non physique où le visible seul règne, abolit l’invu (l’invisible par défaut) et réduit le phénomène à la visibilité pure. »16
Cette distinction extrêmement classique, déjà conceptualisée dans les discussions de l’Académie de peinture dans la deuxième partie du XVIIème siècle ne nous semble pourtant pas lever toutes les difficultés, dont la plupart résident dans cette idée d’une réduction de la phénoménalité au visible : la vue serait comme captivée par ce qu’elle voit tandis que le sujet ne pourrait transformer sa vue en regard (objectivant), acculé qu’il serait à subir la loi du visible pur, le visible étant pur du fait même qu’il est purifié d’une pré-conception obectivante. A vrai dire, une telle thèse est assez obscure pour peu que l’on cherche à en cerner le sens concret : qu’un tableau n’apparaisse que par la visibilité est une chose, que la visibilité ne contienne que du visible en est une autre. Autrement dit, remarquer qu’un tableau s’exprime par le mode de la visibilité est une tautologie, mais en déduire qu’il n’est que cette visibilité est problématique et mériterait de recevoir une argumentation serrée. Car de quoi concrètement y a-t-il saturation ? Sur quoi l’intuition prime-t-elle réellement ? Marion répond de manière somme toute assez allusive en prétendant que le primat de l’intuition s’exerce sur l’intention : mais quelle est la visée intentionnelle dans le cas d’une contemplation de tableau ? Est-elle encore une fois iconographique ou formelle ou les deux ? Ma conscience vise-t-elle à reconnaître ce qui est représenté (posant la question : « qu’est-ce que c’est ? ») ou vise-t-elle à organiser l’espace pour mieux voir ce qui est représenté ? Que signifie l’idée selon laquelle la surface du tableau est « sans vide, sans profondeur » ? Evidemment, du point de vue de la perception, cet énoncé est faux : je perçois une représentation picturale avec la profondeur et le vide ; mais du point de vue de la vision, cet énoncé est vrai : si je n’ajoute pas à ma vision l’idée même de profondeur rendue par l’organisation de la représentation, alors au sens propre je ne vois pas la profondeur, je ne vois pas le vide, je ne vois qu’une surface pleine où s’étendent des couleurs. De ce fait, il semblerait que la saturation concerne l’intention formelle : la visibilité pure exclut la visée d’une organisation formelle de la représentation. Toutefois, cela appelle deux remarques : d’une part, il est extrêmement difficile de se représenter à quelle expérience concrète Marion fait appel, car il est impossible in concreto de voir sans percevoir, de ne voir que la surface sans aussitôt l’investir d’une certaine interprétation du regard. D’autre part, si l’intention iconographique n’est pas en jeu, si donc la reconnaissance des images n’est pas en jeu, cela signifie que le tableau peut montrer des images reconnaissables tout en restant un phénomène saturé ; mais dans ce cas, comment comprendre que j’ai reconnu les images si je n’ai pas pu organiser par mon regard la représentation ? Comment ai-je pu délimiter les formes si je n’ai pas interprété par le regard cela même qui se donne ? Et donc comment écrire sur des tableaux pour en décrire le contenu dès lors que celui-ci présuppose pour être identifié un évident investissement conceptuel permettant de le regarder et d’en identifier les délimitations afin d’en reconnaître précisément la portée iconique ?
E : Le retour du refoulé
La thèse que nous aimerions dès lors développer est la suivante : Marion est amené à réintroduire pour les besoins de son analyse les termes proscrits par la logique de la saturation. En d’autres termes, nous pensons que toute peinture « digne de ce nom » est susceptible d’une visée réussie, donc qu’elle ne saurait être un phénomène saturé ; la meilleure preuve en est que Marion lui-même propose une analyse conceptuelle réussie de certains tableaux, rendant intelligibles ces derniers à travers une compréhension reposant sur le sens et les intentions.

Prenons par exemple son analyse de L’atelier du peintre qu’il établit en ces termes : le peintre, dans ce dernier, ne reproduit rien, puisqu’il ne regarde pas le prétendu modèle, et nul paysage ne tombe sous les yeux de sorte que ce qu’il peint n’est pas ce qui est représenté. « Il peint donc directement ce qui ne ressemble à rien de déjà disponible. »17 Le centre réel du tableau ne se trouve pas dans le peintre mais dans le tableau, dans la montée au visible du vrai ciel. Sur ce point, l’analyse est incontestablement subtile et justifiable. « Dans ces conditions, poursuit Marion, on voit très bien ce qu’il s’agit de comprendre et que Courbet veut montrer. »18 Nous avons souligné le verbe « comprendre » car il nous semble très précisément que se révèle ici l’impossibilité de tenir dans le détail l’idée d’une saturation réelle de la peinture : il y a bien quelque chose à comprendre, donc quelque chose doit être visé et peut être visé avec succès. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le peintre dispose d’une volonté, parce qu’il veut montrer quelque chose, bref parce que ce qui se montre ne s’épuise pas dans un visible aconceptuel mais au contraire dans un visible saturé d’intentions qu’il nous faut comprendre, qu’il nous faut apprendre à lire, à déchiffrer ; le visible est ici un chiffre, et si le livre de Marion présente un réel intérêt, c’est précisément en ceci qu’il contribue à déchiffrer l’œuvre de Courbet, l’intention même de l’ouvrage étant au fond contradictoire avec les thèses qui y sont développées. L’œuvre est ici tout sauf « insoutenable », elle est précisément ce qui appelle la conscience du spectateur à comprendre ce qui est représenté autant que les raisons de la forme de la représentation.
Qu’y a-t-il précisément à comprendre lorsque l’on regarde l’Atelier du peintre ? « Le paysage, c’est-à-dire le petit tableau, celui du réel, annule et absorbe le grand, devenu irréel et donc allégorique, alors que dans une allégorie banale (celles de Delacroix ou d’Ingres) le petit tableau devrait servir à comprendre le grand et à s’y référer. »19 Analysons cette interprétation : dans le cas d’Ingres ou de Delacroix, ce qui est dans l’image, donc l’élément, permet de comprendre le tout, car le tout n’est jamais qu’un agencement de parties dont l’analyse révèle le sens global. En revanche, chez Courbet, le tout n’est pas composé de parties, il est un tout qui se donne d’emblée, si bien que le petit tableau ne peut être une partie du grand ; de ce fait, le petit tableau nous amène à comprendre que le grand est irréalisé, donc que la société s’efface face au fond de vallée de la Loue : « le paysage manifeste plus de réel que la société. Il y a donc bien une grâce de la peinture, une trace eucharistique de présence réelle. »20 Le propos est incontestablement très fin mais il n’est pas certain qu’il recoupe les intentions explicites de leur auteur : Marion a raison, nous semble-t-il, de faire primer le petit tableau sur la société, la vallée de la Loue sur l’assemblée humaine, mais que signifie le fait même qu’il ait raison ? Cela signifie qu’il rejoint l’intention de Courbet, qu’il retrouve ce que Courbet voulait montrer, c’est-à-dire en fin de compte ce que Courbet pensait. A cet égard, le tableau ne s’épuise nullement dans une visibilité pure, il présente par le visible une intention, de sorte que le visible se révèle comme n’étant justement jamais pur. Et c’est précisément parce que le visible n’est jamais pur dans un tableau qu’il peut être objet d’analyse, la démarche même de Marion entrant en contradiction avec ses propres thèses. Si d’ailleurs il n’était besoin que de voir dans l’œuvre peinte, quel sens cela aurait-il de se référer à quelque littérature secondaire ou à quelque élément biographique ? La pureté suffirait et rendrait caduque toute information sur l’œuvre ou le peintre ; le fait même que Marion s’y réfère abondamment nous semble prouver par l’absurde que la peinture, y compris celle de Courbet, n’est jamais un phénomène saturé.
Un autre exemple tient dans la très éclairante analyse de l’arbre solitaire dans son œuvre. Marion montre très justement comment Courbet supprime la construction perspective, et pose ses chênes comme massifs et saturants, notamment dans une belle lecture du Chêne de Flagey (Musée Gustave Courbet). Mais là encore, en quel sens y a-t-il saturation ? Il n’y a aucune saturation iconique puisque je puis identifier ce qui est représenté, c’est-à-dire que je puis donner un sens à l’image : c’est un chêne. Est-ce alors une saturation formelle ? Cela signifierait que le chêne (comme image reconnue conceptuellement) apparaîtrait en-dehors d’un dessein, donc en-dehors du dessin, selon la célèbre équivalence italienne du disegno, donc qu’il ne serait pas assujetti à quelque pré-conception humaine : l’arbre surgirait comme tel, « sans généalogie », si bien qu’il n’y aurait plus qu’à se laisser écraser par sa massivité. Mais ce que nous ne comprenons pas, c’est ce que signifierait concrètement une telle thèse : nous ne voyons pas du tout en quel sens le refus de la composition dans le tableau, ou le refus des règles classiques signifierait une rupture avec toute conceptualité ou toute pré-conception de la représentation. Nous ne voyons absolument pas en quoi le choix pictural – au sens formel du terme – de Courbet ne pourrait pas être référé à une décision consciente qui serait tout autant que la composition une pré-conception de l’œuvre. En outre, nous ne voyons aucunement comment le chêne pourrait être reconnu iconiquement comme chêne si la vue ne s’était pas toujours déjà transformée en regard capable de délimiter les formes, et de les interpréter.

Pour toutes ces raisons, nous ne voyons aucunement en quel sens il y aurait saturation même dans les représentations du chêne, et à vrai dire Marion lui-même ne semble pas y croire car il en propose une compréhension toute intellectuelle : « Il faut donc comprendre [nous soulignons] que ce chêne, en tant que si massif, si envahissant et si imposant qu’il sature le regard, confère sa visibilité et sa présence à l’absent par excellence, Vercingétorix. Vercingétorix, l’absent du tableau, se présente sous les traits du chêne, d’autant plus en gloire qu’il n’a pas de traits humains, d’autant plus instant qu’il reste manquant. »21 L’injonction à la compréhension que pose le texte signifie bel et bien qu’il y a quelque chose à comprendre, et ce quelque chose ne peut être compris que si se trouvent sondées les intentions de l’auteur ce qui revient à dire une fois encore que le visible pictural est tout à fait impur puisque toujours déjà travaillé par les intentions du peintre.
F : Ce qu’il y a à voir
L’ouvrage se construit donc sur une opposition étrange entre l’objet conçu « à l’idée », caractérisant somme toute la peinture « indigne de ce nom » et la chose « à l’œil », s’imposant d’elle-même. Nous avons essayé de montrer que le sens de cette distinction était concrètement obscur, et ne semblait pas correspondre à une possibilité picturale effective. Mais il nous faut encore creuser le sens de cette chose s’imposant d’elle-même : que signifie là encore le fait qu’une chose puisse s’imposer d’elle-même sur le tableau ? Il s’agit, répond Marion, de rendre visible dans l’œuvre ce qui était resté invu, donc ce qui aurait dû être vu mais qui ne l’était pas et que seule l’œuvre rend visible. Courbet, note ainsi Marion, ne mérite le nom de « réaliste » qu’en un sens aristotélicien où on donne à la chose ce qui lui manque dans la nature pour qu’elle apparaisse comme ce qu’elle a toujours été. « En ce sens, la chose accède, dans la forme que lui confère enfin le peintre, au statut positif d’idole – d’un phénomène saturé. »22
Là encore, il faut interroger le texte et lui demander ce qu’il peut bien signifier concrètement. Marion affirme que dans la peinture « digne de ce nom », il n’y a rien à composer, il y a juste à accueillir les formes elles-mêmes, à révéler ce qu’elles sont, à révéler ce qu’il y a à voir. Mais quel est alors le critère de ce qu’il y aurait à voir ? Les choses sont-elles en elles-mêmes dotées d’une visibilité à laquelle accèderait le peintre ? Ou est-ce le regard du peintre qui les fait surgir ? A quelle réalité renvoie précisément ce qu’il y a – ou ce qu’il y aurait – à voir ? Marion affirme que c’est la « chose même » qui serait vue à travers la représentation ; mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Est-ce à dire que ce que nous percevons quotidiennement n’est jamais la chose même ? Assurément oui selon l’auteur. « Le tableau accomplit le noème plus que tout autre regard phénoménologique. Donc la chose apparaît plus sur la toile que dans l’attitude naturelle ; elle se montre plus naturellement sur la toile que dans la nature. »23 Le tableau est donc associé au noème comme étant ce qui, de la chose, est finalement le plus perçu. Mais pourquoi en irait-il ainsi ? Si l’on suit la logique de l’ouvrage, une seule solution peut être retenue : la toile (on notera l’étonnante absence de références aux fresques ou aux autres supports de la visibilité picturale, ainsi que l’absence de la photographie) libère la chose du regard objectivant, et la présente comme telle, libre des préconceptions qui l’enfermaient dans une pré-compréhension toujours inhérente au regard et donc la mutilaient quant à sa visibilité. Et qu’est-ce qui se révèle dans pareil cas ? L’infinie variation de la chose, dont le peintre fixerait la saturation. « La lente et patiente saturation du noème (les touches toujours différentes et nouvelles des verts, des ocres et des gris dans le feuillage de l’arbre, dans l’ombre du sous-bois, les rougeurs déclinées des bouquets, les blancheurs toutes teintées de la neige, etc.) constitue la seule voie royale d’accès à la chose et à sa forme intime, en personne. »24
Si nous analysons un tel propos, nous pouvons faire deux remarques : d’une part, la différence entre le peintre et le spectateur réside dans une certaine qualité de la vision, dont le critère est somme toute réaliste en ceci que la réalité de la chose est plus ou moins bien vue par le sujet, le peintre n’étant jamais que celui qui envisage le plus de variations réelles des couleurs ou des formes. Par conséquent, le critère de ce qu’il y a à voir semble résider dans la réalité même de la chose que le regard habituel des spectateurs ne voit pas et que le peintre, lui, voit. Par conséquent, Marion propose un assujettissement du peintre à son objet qui, une fois encore, conteste toute l’élaboration classique du point de vue ; ce n’est pas le peintre qui assigne selon un point de vue déterminé le regard sur les choses, c’est inversement la chose elle-même, en tant qu’elle est indépendante du peintre, qui s’impose à lui. Le peintre semble se laisser pénétrer de la chose, en se soumettant à l’infinité de ses apparitions là où le sujet lambda n’y voit que quelques variations répétées. Cela est assez problématique car se trouve exclue de fait toute forme d’imagination en art : si l’œuvre révèle la chose même, alors l’imagination du spectateur ne peut être sollicitée, en tant qu’elle serait déjà une visée cherchant à contenir cette prétendue saturation. Or il nous semble que cela contrevient une fois encore à l’expérience universelle d’une contemplation de peinture où le sujet regardant cherche précisément à éclairer ce qu’il voit par la lumière de l’imagination. Contre cette idée d’une saturation de la représentation par les variations infinies de la « chose même », il nous semble bien plus fécond, comme le fait entre autres Nicolas Grimaldi, de montrer que l’œuvre s’ouvre à la visée imaginative, qui donne précisément son sens à ce qui est représenté. Ainsi Nicolas Grimaldi, analysant Mars et Vénus de Botticelli, explique-t-il que la mélancolie de la jeune femme exprime le pressentiment du malheur tandis que le bonheur n’est jamais qu’un sursis. Et Grimaldi de remarquer que c’est ce que ce tableau lui fait imaginer qui le rend émouvant. « A la lettre, écrit ce dernier, ce que j’y perçois n’est qu’une partition. Il me faut encore l’interpréter. Je suis donc bien moins ému par ce que je le tableau me fait voir que parce qu’il me fait imaginer. »25 La possibilité même d’imaginer à partir du tableau nous semble prouver à la fois que celui-ci ne peut pas être un phénomène saturé et qu’il ne saurait s’épuiser en sa visibilité, donc qu’il ne saurait être conçu selon la pureté du visible.
D’autre part, à supposer que Marion ait raison dans son analyse du produire pictural en tant que soumission totale à l’infinité des variations de la chose, il faudrait alors se demander de manière réflexive ce que pourrait être un discours sur une œuvre picturale, « digne de ce nom », sous-entendu de Courbet ou de Cézanne. Qu’ai-je à dire d’une œuvre si cette œuvre n’est jamais que le recueil de la chose même ? Le paradoxe très étrange qui apparaît ici est que plus l’œuvre se trouve pensée comme soumise à la chose, comme recueil noématique de la chose même, plus le discours qui portera sur elle sera conceptuel et abstrait car il n’y aura rien de pictural à en dire. En effet, que dire d’une œuvre du point de vue pictural si celle-ci évacue toute pré-formation, toute pré-conception de ce qu’il y a à voir ? Il ne pourra y avoir au fond qu’une lecture ultra-théorique, car une fois que l’on a dit que, dans l’œuvre, la chose apparaît plus qu’à l’état naturel, on n’a strictement rien dit du point de vue pictural. Deux solutions s’offrent alors : soit l’on se met à parler de la chose même, et l’on fait de la peinture un simple moyen permettant d’accéder à une sorte de saisie phénoménologique des choses, soit l’on interprète de manière très théorique ce qui apparaît, et l’on explique que l’arbre qui apparaît est en fait Vercingétorix, ce qui revient à dire que seule une interprétation théorique très poussée permet de comprendre ce qui apparaît.
G : Le cas Cézanne
Parmi les peintres « dignes de ce nom », Marion range Cézanne, à la suite de Merleau-Ponty, dans une démarche toutefois beaucoup plus polémique que ne l’avait fait l’auteur de La prose du monde. Cela pourrait paraître surprenant au regard de la thèse développée en ceci que Cézanne a souvent réclamé que l’objet fût traité par des cylindres, des sphères et des cônes ce qui, en termes de Marion, revient à dire que l’objet est pré-conçu, voire d’emblée assujetti à une conceptualité géométrique qui en interdit le déploiement infini. Comment dans ces conditions rendre les déclarations de Cézanne compatibles avec la thèse générale de l’ouvrage, c’est-à-dire comment faire de Cézanne quelqu’un qui s’assujettit aux variations infinies de la chose même ?
Le chapitre 6 où il est question de Cézanne nous semble tout simplement révéler le fait que la position de Marion est très délicate. Ce dernier cite en effet, page 180, un passage décisif de Cézanne expliquant ceci : « Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici. Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet d’un plan se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue, soit la section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater omnipotens aeterne Deus étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire dans vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air. » Si l’on en reste là, il va de soi que Cézanne ne saurait rentrer dans le cadre que lui assigne Marion, car le propos est trop explicite pour admettre que la peinture de Cézanne se laisse ramener à la saturation. Comment alors résoudre ce dilemme ?
Marion va très curieusement chercher à dire que Cézanne s’est mal exprimé et que le texte est fautif : « Ce texte, sans doute mal ponctué, paraît assez confus : le balancement des deux soit se trouve empêché, sinon contredit par la césure des phrases (les points et tirets après « central » et « profondeur »). »26 L’argument est fort étrange car, de toute évidence, il ne s’agit pas dans le texte de Cézanne d’un « soit » conjonctif mais bien plutôt d’un « soit » permettant l’explicitation de chaque proposition, d’un « c’est-à-dire ». Les deux « soit » signifient ici « c’est-à-dire » et non « ou bien ou bien », la direction vers le point central explicitant la construction géométrique ordonnant la perspective, et la section de la nature explicitant l’étendue qui n’est jamais que ce dans quoi se joue le spectacle que voit le Père divin. Par conséquent, l’interprétation de Marion étant grammaticalement erronée – l’erreur étant toutefois nécessaire à sa démonstration –, elle ne peut en aucun cas servir à faire de Cézanne quelqu’un venant illustrer la thèse de l’ouvrage, et Courbet se retrouve bien seul parmi les peintres « dignes de ce nom ».
Pis encore, Marion cherche à interpréter le texte de Cézanne comme signifiant qu’il faut atteindre par la couleur la profondeur sans perspective linéaire, et prend appui sur Maurice Denis affirmant que chez Cézanne « la perspective aérienne est extrêmement sacrifiée »27 Mais là encore, l’argument est fort étrange puisque la perspective aérienne est précisément une variation chromatique et non linéaire, jouant non pas sur les formes mais sur l’atténuation des teintes, pour creuser la profondeur, selon des préceptes initiés par Léonard de Vinci. On ne voit donc pas du tout en quoi la fin de la perspective linéaire chez Cézanne peut être appuyée par une remarque sur le sacrifice de la perspective aérienne dont Marion dit à la fois qu’elle est absente chez Cézanne et en même temps comme moyen de creuser la profondeur.
Conclusion
Ce livre est extrêmement intéressant et à plus d’un titre. D’abord il donne aux analyses précédentes de Marion portant sur le phénomène saturé une illustration concrète avec l’étude de Courbet ; ensuite, il constitue incontestablement une étude réussie sur les intentions de Courbet et sur le sens de son entreprise picturale. Enfin, il propose une autre voie que celle renaissante, classique et même moderne pour penser la peinture, qui n’est pas sans intérêt.
Néanmoins, l’idée que la peinture « digne de ce nom » soit par principe un phénomène saturé nous semble inintelligible, en ceci qu’elle heurte quatre problèmes que nous aimerions ici synthétiser :
1) si la saturation est une relation, on ne comprend pas en quel sens l’écart entre l’intention et l’intuition pourrait être à ce point irrévocable ; et si elle est absolue, on ne comprend alors plus pourquoi il faut solliciter l’intention.
2) Ce dont il y a saturation dans le cadre pictural n’est pas clair, pas plus que ne l’est ce qui est excédé par la saturation. L’hésitation permanente entre une réflexion sur l’image et une analyse de la forme rend extrêmement difficile la compréhension concrète de ce qui se trouve écrasé par l’intuition.
3) Le fait même que Marion demande que l’œuvre soit « comprise » signifie qu’il y a quelque chose à comprendre ; s’il y a quelque chose à comprendre, on ne comprend précisément plus en quel sens l’œuvre présente un visible pur, puisqu’elle contient au moins les intentions du peintre. A ce titre, les thèses générales sur la peinture nous semblent contradictoires avec l’analyse spécifique des intentions de Courbet que Marion nous semble par ailleurs parfaitement restituer. En d’autres termes, il est étrange de décréter à la fois que les œuvres de Courbet procèdent des phénomènes saturés et de proposer une analyse de certaines œuvres de Courbet selon point de vue qui excède largement le constat de la visibilité.
4) Une peinture qui serait réellement un phénomène saturé ne pourrait faire l’objet d’une analyse picturale et serait soit réduite à un statut médiocre de moyen permettant de comprendre la chose même, soit ferait l’objet d’une approche méta-plastique, infiniment théorique, qui interpréterait sans cesse ce qui se montre comme indiquant plus que ce qui se montre ; c’est la deuxième solution, très paradoxale, que retient Marion, l’entreprise même d’écrire un livre sur Courbet dictant évidemment cette solution.
- Jean-Luc Marion, Courbet ou la peinture à l’œil, Flammarion, 2014
- Ibid., p. 7
- Ibid., pp. 7-8
- Ibid., p. 10
- Ibid., p. 25
- Ibid., p. 27
- Ibid., p. 27
- Jean-Luc Marion, Etant donné, PUF, coll. Epiméthée, 1998², p. 199
- Courbet., p. 29
- Etant donné, p. 280
- Ibid.
- Ibid., p. 29
- Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale, Gallimard, folio-histoire, 2008, p. 33
- Jean-Luc Marion, De surcroît. Etudes sur les phénomènes saturés, PUF, 2001, p. 73
- Ibid., p. 90
- Ibid., p. 81
- Courbet, op. cit., 124
- Ibid., p. 125
- Ibid., p. 125
- Ibid., p. 126
- Ibid., p. 154
- Ibid., p. 135
- Ibid., p. 158
- Ibid., p. 157
- Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, Les petits Platons, 2013, p. 127
- Marion, Courbet, op. cit., pp. 180-181
- note 1, p. 184







