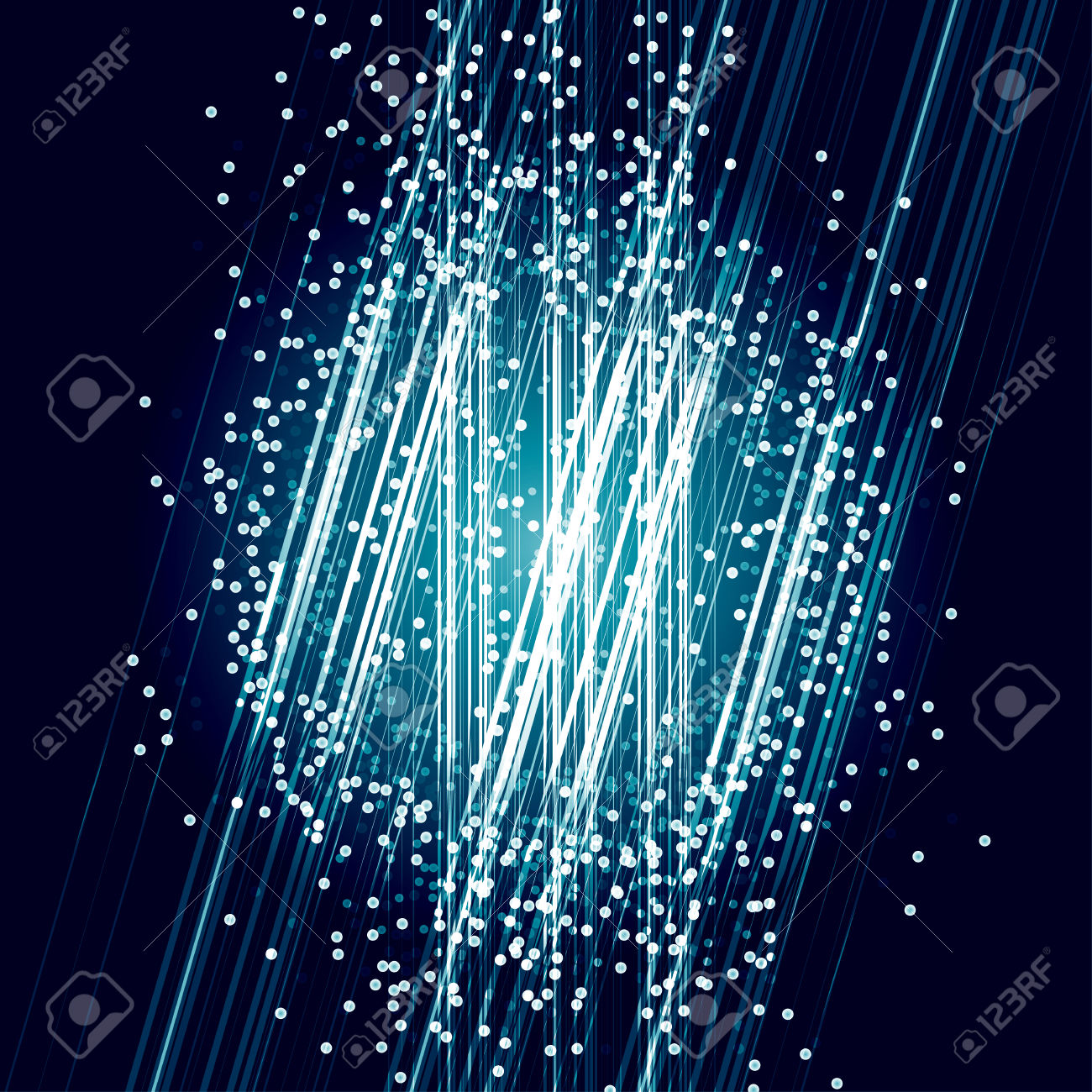La première partie de la recension est consultable à cette adresse.
3°) L’exigence du penser en sa liberté : la puissance d’être1
La question de savoir comment nous sommes ensemble les deux exercices de la puissance, ses deux manières d’être soi, ne laisse pas d’inquiéter. Car si nous nous identifions selon plusieurs degrés d’être, on peut se demander qui nous sommes, comment universalité et particularité s’unifient en nous. Notre identité s’éclaire reconduite au désir qui nous produit, notre expérience s’explicite pareillement rapportée au désir qui la produit. Ce que l’ « évidence » appropriative nomme « la nature humaine », a son origine, et toute sa réalité dans ce désir personnalisant. Si, dans l’asservissement appropriatif, elle est tenue pour un irrelatif principe, nous la savons dorénavant en la vérité de son statut. Jean-Michel Le Lannou prend ici toute la mesure du bouleversement qu’apporte cette mutation dans notre compréhension que dans nos rapports à nous-mêmes. Le donné cesse de s’imposer comme originaire, l’expérience d’être crue première. La philosophie nous libère de la croyance à la réalité du fini. Et c’est en cette révolution qu’un radical décentrement s’opère. Dans cette révolution, « nous mettons fin à l’aveuglante servitude appropriative ». La confusion appropriative défaite, nous pouvons maintenant comprendre le représenter en sa vérité : exercice particulier de la puissance du penser. En nous il se fait relation extérieure, représentation, ne s’égalant plus à son immensité. En la conscience, le penser se produit faible. Dans l’extériorité et la séparation, il se fait en son impuissance, comme pensée finie et insubstantielle. D’où vient qu’apparaisse la conscience ? D’où vient qu’il y a représentation ?
Pour notre auteur, la généalogie de la conscience constitue la tâche nouvelle de l’idéalisme : d’où vient que le penser se dépotentialise dans et par la production de la conscience ? L’ontologie appropriative qui, en sa réduction violente, assimile tout penser au représentatif, n’est défaite qu’en retrouvant la différence ego-ontologique des deux puissances du penser. 1 Jean-Michel Le Lannou explique que la distinction de la substantialité et du fini, celle du penser et du représenter, ne peut effectivement advenir en la conscience car ses conditions ontologiques l’excluent. Avec Ravaisson, il reconnaît que la pensée substantielle prévient la médiation, non qu’elle n’enveloppe pas de relation à soi, mais que sa réflexion substantielle ne se fait pas séparation extérieure. Le penser libre du désir de se faire particulier s’exerce sans se représenter, sans se finitiser donc en la conscience. Notre auteur interroge ensuite les relations de la conscience à l’intensité de la pensée pure : comment comprendre ensemble leur identité et leur différence, l’apparition du représenter dans l’identité générative du penser. Le penser se produit dans la diversification des rapports à soi de l’intelligibilité. Cette réflexivité est relation immanente, mais aussi réflexion extérieure, ou représentation. La mutation par laquelle cette relation à soi se fait extériorité est l’apparition de la conscience 2. Si Ravaisson décrivait les conditions de la séparation représentative, c’est plus directement l’élucidation généalogique qui intéresse Jean-Michel Le Lannou. Le représentatif apparaît dans la différenciation de la forme et du contenu, la modalité de l’attribution comme telle, la séparation prédicative, dans la possibilisation constitutive de la conscience. 3 Nous nous faisons un particulier en ouvrant l’horizon en lequel chacun s’extériorise, se distingue et se délimite.
Comment pouvons-nous ne pas être immense ? En nous donnant une figure et n nous enfermant en elle. Se particulariser, c’est identiquement se figurer, et ainsi se produire en un être-là, circonscrit : « Si la figuration est existentialisante, elle n’est pour autant en rien réalisatrice, elle est au contraire désimmensifiante. Tout au contraire, la puissance libre du représentatif demeure en son immensité. Jean-Michel Le Lannou explique que notre origine ne réside qu’en la processualité des exercices de la pensée qui, en se dépotentialisant, se fait représentative. Mais l’universalité ne se démet pas d’elle-même, ne s’abandonne ni ne s’altère dans la représentation. La puissance immense du penser ne cesse de s’égaler à elle-même : la finitisation ne le change en rien. 4 Pour Jean-Michel Le Lannou, le penser ne manque pas du représenter. Il n’a en rien besoin de se figurer, de devenir absurdement ce qui le nie, représentatif. Sa puissance ne manque pas de l’impuissance, pas plus que l’immensité de la déficience restrictive : « L’advenue du penser séparé n’est en rien la séparation de celui qui en est le libre. » Le représentatif surgir alors comme un autre exercice de la puissance. Et s’il est bien l’effet de la puissance, c’est en tant qu’elle ne s’arrête pas et ne se limite pas à son autoproduction comme penser pur. Ainsi la représentation est et n’est pas son origine5. Par suite, toutes les activités et tous les êtres de l’impuissance apparaissent dans un même processus de dépotentialisation. La réflexion génétique des exercices du penser nous conduit ainsi jusqu’aux réalités qui n’adviennent que par et dans l’abandon de son intensité, celles en lesquelles la puissance se produit faible. Or, insiste Jean-Michel Le Lannou, « tous les êtres du fini, en leur diversité, ont cette même origine : le désir d’impuissance. Celui-ci est le principe commun du monde, de la personnalité et de la sensibilité. » Que sont ces manières d’êtres sinon les effets de la finitisation, la désintensification se réalisant ? La « personnalité » advient donc de la puissance du penser se séparant en elle-même. L’homme conjugue ainsi en lui les deux degrés du penser fini, celui de la représentation, et, en-deçà d’elle, celui de son obscurcissement et vitalisation.
Cette réflexion généalogique, immédiatement et fortement, contredit « notre » évidence première et spontanée. Ce n’est cependant que par elle que nous reconnaissons la domination de l’amour du fini, la stratégie de son ontologie, l’« évidence » en laquelle il se dissimule, et règne dans cette dissimulation. Le propos de Jean-Michel est clair : la tâche de la philosophie est de référer le monde et l’expérience à leur origine véritable : la finitisation du penser. La réflexion généalogique en élucide le statut et fait comprendre tout à la fois que nous soyons fini et croyions à la « nature humaine ». L’existence n’advient que de la dépotentialisation du penser : « Le penser se faisant faible se fait monde. Nous ne pouvons être « homme » et il ne peut y avoir monde qu’en et par le désir finitisant. Le monde est le désir de soi du penser fini. Or pour Jean-Michel Le Lannou, notre devenir « homme » ne diffère pas de la production du représentatif. Nous sommes celui que le penser réalise en son exercice fini. Se faisant faible, s’exerçant dans l’extériorité, il sépare en lui la détermination de l’activité. Un « être » pensant se distingue ainsi de ce qu’il pense. La puissance du penser ne peut se faire faible qu’en produisant en elle une instance séparée. Elle produit ainsi, en et pour cet exercice, un « je » distingué, pôle représentatif extérieur. Réciproquement, le penser ne peut se rapporter à soi sur le mode de la séparation que référé à un « pour nous », se distinguant réflexivement de l’activité du penser. C’est dans cette auto-séparation que nous devenons individus. Pour devenir personnel il faut donc ensemble figuration et incarnation. Mais par quoi nous individuons-nous ? « Par l’enferment en une figure et la clôture organique restrictive », répond Jean-Michel Le Lannou. Se donner figure, entrer en elle, ce qui est la produire, c’est par là même apparaître hors de l’immensité. 6 L’ « homme », ou le penser voulant se représenter, a pour condition la négation de l’égalité substantielle. Se produire « personnel », c’est rigoureusement ne pas se vouloir universel, comme l’écrivait Plotin : « devenu homme, on cesse d’être tout. » Nous sommes alors « homme » par goût de la restriction, par le désir réalisé du privatif qui est le « pour nous ». Reprenant les termes de Leibniz, nous pourrions dire que nous ne nous faisons « mature » qu’en renonçant, du moins en et pour nous, à notre universelle « essence ». On comprend ainsi, dans la finitisation, l’apparition conjointe, effets d’un même processus, du monde, de l’homme et du représentatif. Ce sont, pour Jean-Michel Le Lannou, autant de manières de dire notre refus de l’immensité.

La finitisation n’est inéluctable, ou destinale, que pour celui qui continue à se désirer particulier. La servitude ne perdure que par le désir figural. L’effective désidentification en libère. Qui se délivre de l’illusion ? Celui qui cesse de croire en avoir besoin pour être, celui qui renonce au désir d’être « homme ». Et pour Jean-Michel Le Lannou, cette libération suppose non seulement le savoir des modalités, mais également celui du motif de la finitisation : « L’élucidation du motif de l’apparition du penser fini constitue la tâche centrale de l’idéalisme désappropriatif. » Celui-ci entend faire comprendre d’où vient que nous nous soyons enfermé dans cette particularité et identifié en une figure. La raison de ce désir particularisant est l’existence : « L’existentialisation, explique Jean-Michel Le Lannou, est comprise selon l’opération qu’Aristote nommait « nature ». Processus tant spontané que nécessaire, l’actualisation de l’ « en soi » en effectue le devoir être. » Quel en est donc le statut ? Cette extériorisation s’avère indispensable ontologiquement. Pour être véritablement, il faut se phénoménaliser. Et cette « phénoménalisation » est nécessaire à celui qui, sans sa représentation, ne serait pas. L’existence, identifiée par le désir appropriatif à l’effectivité, en est la « réalisation ». Être, c’est apparaître comme fini, advenir dans l’horizon représentatif. Le penser n’atteint ainsi sa vérité qu’en s’objectivant, en se déterminant dans la conscience. Pour actualiser sa possibilité, l’être doit apparaître, se particulariser et représenter. La représentation, en tant qu’elle figure et particularise, donne seule l’existence et satisfait ainsi l’amour du fini, le désir appropriatif pour reprendre les termes de Hegel. Cette méprise, précise Jean-Michel Le Lannou, ouvre en son principe l’ontologie appropriative. En elle la réalité est pensée par l’amour du fini, pour pouvoir être « appropriable ». Qu’advient-il alors en cette thèse ? Ce que notre auteur appelle « la stricte inversion de la vérité ». L’universalité aurait besoin de la particularité, l’immensité du fini, le penser du représenter, et la puissance de l’impuissance. 7 Or le fini ni ne manque, ni ne qualifie nouvellement aucun être. La finitisation n’est attribuable ni au moi immense, ni au moi particularisé qui n’est pas avant elle. N’a ainsi le désir de la particularisation que celui qui apparaît par elle. Le moi fini seul a besoin de l’impuissance, elle est sa propre condition, il se fait en et par elle. Ne dépend du fini, en son être, que celui qui se produit « homme ». La totalisation est, quant à elle, référée à a puissance du penser. Nos identifications, l’immensifier et le finitiser, sont l’effet de la puissance autoconstituante du penser. Et l’apparition de chaque identité dépend de l’identification processuelle de la puissance. De quel point de vue sa complétude est-elle alors pensable ? Elle ne l’est que réflexivement. Jean-Michel Le Lannou la rapporte à la puissance, que tant que pour la réflexion, elle précède, enveloppe et excède ses divers exercices, en ne se réduisant à aucun.
4°) La pratique libératrice de l’idéalisme : la désappropriation
C’est en son exercice originaire que la puissance se fait librement universalité substantielle. L’opération par laquelle elle se produit finie ne peut être dite nécessaire, ni même interrogée quant à son motif de ce que cette autoproduction est pareillement un acte libre : « La puissance qui se fait en toutes ses modalités n’enveloppe en elle ni la nécessité de se faire en cette diversité, ni la possibilité, ou désir, de ne pas l’être. » Pour autant, si elle se fait encore être autre que totalité substantielle, c’est extérieurement et réflexivement que nous le savons, de sa production. 8 Que la puissance se produise en tous ses exercices, que le penser se fasse en toutes ses modalités, cela manifeste-t-il pour autant une tendance à la totalisation ? Son processus identificatoire la conduit jusqu’à différer de l’universalité, dans et par sa dépotentialisation représentative. Ainsi la puissance ne s’arrête pas en sa seule égalité substantielle, elle se produit encore en l’impuissance que nous sommes. Devons-nous donc reconnaître une nécessité à notre identification finie ? Si nous soutenons cette thèse, nous sommes alors aussitôt reconduits à l’ontologie appropriative, et nous serions obligés de comprendre ce processus comme un devoir d’autoréalisation, l’effectuation de tous les exercices du penser, qui seraient ainsi « en puissance » avant leur production. Le penser en sa liberté n’enveloppe pourtant aucune « injonction à se faire représentatif », explique Jean-Michel Le Lannou. Lui attribuer cette exigence reviendrait à le rendre à nouveau dépendant de la particularisation : « Nous n’enveloppons aucunement la nécessité de nous produire « homme », par là même aucune nécessité de le demeurer. » La liberté de cette autoproduction est alors pareillement la liberté de notre rapport à elle. La fidélité au désir d’immensité nous délivre de consentir au représentatif. Quelle est notre tâche sinon d’œuvrer à défaire l’auto-négation qui nous produit ? Et c’est toute la force de la thèse de Jean-Michel Le Lannou : nous pouvons, contre la finitisation en laquelle spontanément nous nous complaisons, désirer l’immensité de la puissance. Qu’advient-il alors en la philosophie ? Qu’en elle nous consentons à l’excès qui rompt l’adhésion appropriative.
Puissance de désidentification, la philosophie nous décroche du désir figural. Cette fidélité nouvelle ouvre une libératrice désappropriation. L’aspiration à l’intensité du penser nous délivre du goût pour le représentatif : « Le désir d’immensité, dit Jean-Michel Le Lannou, ouvre et guide cette insurrection ». Mais supporterons-nous une telle effraction ? Ne plus consentir à la personnalisation n’est-ce pas nous abolir ? L’excès, protestation contre la clôture figurale, le refus de demeurer enfermé en la particularité, a-t-il « pour nous » une positivité ? Ne nous supprime-t-il pas ? En aspirant à désensevelir la puissance, nous voulons l’activité intense du penser pur. Nous la désirons en sachant la double relation, d’identité et de différence, entre elle et nous. Le désir d’immensité, accueilli en sa radicalité, nous fait refuser de demeurer fini. En l’activité du penser nous aspirons à la plénitude substantielle9. Ce que le désir d’immensité ouvre en nous est un rapport déshadésif et critique à notre identification spontanée. Inversant notre premier rapport à la détermination, il conteste l’appropriation et la clôture du représentatif : « L’expérience de l’immensité, celle de l’intensité du penser, a ainsi pour « paradoxale » condition que « nous » ne soyons plus », affirme Jean-Michel Le Lannou. En l’excès, la puissance qui se réfléchit en nous exige notre suppression en tant que fini. Aristote le reconnaissait, le désir du Bien n’est pas pour « l’homme », pour lui, il est bien plutôt la mort, celle du « pour nous ». Désirer ne plus être fini apparaît nécessairement absurde du point de vue de celui qui se veut « homme ». L’identification finie, le factuel effet du désir appropriatif, n’est cependant que relative. Pour autant, tant que nous nous complairons en elle, le désir d’immensité, butant en nous, demeurera aporétique, voué à l’ineffectuation par notre désir d’être encore « homme ». Mais sur ce point, Jean-Michel Le Lannou insiste sur le fait que l’aspiration à l’immensité devient effective, échappant ainsi à l’aporie, si et seulement nous avons élucidé le statut ego-ontologique de celui qui s’absente. Or l’excès ne nous enjoint en rien à défaire un « être », explique Jean-Michel Le Lannou, mais l’effet identificateur du désir appropriatif. Mais le retournement du désir contre son exercice spontané ne fait-il pas surgir une nouvelle aporie ? Le désir d’être « homme » est bien le nôtre, nous naissons en et par lui. Le refusant ne nous vouons-nous pas à une très directe auto-contradiction ?
Dans la philosophie nous cessons de désirer ce que nous désirons dans l’expérience. Cette contradiction apparaît de ce qu’ensemble nous voulons et ne voulons plus être fini. L’aspiration départicularisante divise notre désir. Elle n’y produit cependant aucune contradiction, ces deux exercices du désir, bien que disjonctifs, sont ensemble les nôtres. Ils n’ont simplement pas le même statut. Dans la production réitérée de la finitisation, le désir de son interruption apparaît second. Il surgit comme infidélité à l’égard du désir appropriatif. Mais, précise Jean-Michel Le Lannou, celui-ci n’advient lui-même qu’« en l’infidélité à l’égard de notre originaire immensification ». Cessant de nous vouloir « homme », nous ne contredisons donc pas, mais nous nous libérons de l’aliénation. Mais si la philosophie dit l’exigence de l’abolition de l’« homme », savoir ne pas l’être ne suffit pas à nous en libérer, il faut pratiquement rompre l’attachement qui nous y identifie. Plus encore il nous faut parvenir à défaire ce qui nous produit tel. Cette double exigence constitue l’exigence de l’idéalisme radicale, tant en son aspect théorique que pratique : « Ce n’est qu’en supprimant l’illusion personnalisante et défaisant le monde, affirme Jean-Michel Le Lannou, que nous interromprons la finitisation. Un difficile procès s’ouvre. La désidentification ne s’effectue que graduellement, dans les multiples opérations de la dés-adhésion. Et pour Jean-Michel Le Lannou, le rapport répulsif à l’« humain » ne trouve sa cohérence, la vérité qui l’oriente, qu’en la définitisation. Or aucune libération n’est possible dans la seule réforme de notre rapport au fini. Celle-ci est certes d’abord nécessaire pour dénouer la confusion spontanée, mais la désadhésion ainsi produite demeure toujours prise dans la servitude représentative. Rien en l’horizon du représentatif n’échappe et ne saurait échapper aux conditions ontologique de son asservissante restriction. Le désir représentatif nous fait inéluctablement confondre la liberté et l’impuissance. La libération véritable n’apparaît alors que dans sa suppression. À quelle liberté aspirons-nous sinon à celle qui libère de la personnalisation. L’excès de l’horizon du représentatif suppose cependant que nous commencions par modifier notre relation à lui. Mais n’est-ce pas là encore œuvrer en lui ? Assurément, mais la liberté sait maintenant ne pas avoir sa réalité en cette opération. Elle ne la trouvera que dans une abolition effective de cette expérience : « Seule cette suppression nous délivrera d’être, c’est-à-dire de nous faire fini », affirme Jean-Michel Le Lannou. Ainsi, la liberté véritable loin de changer l’« homme », le délivre de lui. Est-ce à dire qu’il n’y ait, « pour nous », que servitude ? Sous l’aspect ontologique assurément, mais pour autant, dans le rapport de l’expérience, la libération s’annonce dans chaque pratique qui conteste l’adhésion. Essentiellement critique, elle apparaît dans tous les lieux et toutes les formes de résistance à l’encontre de l’amour personnalisant. Or l’excès ne modifie pas notre mode d’être, il conteste seulement l’évidence qui aveugle et l’adhésivité qui asservit. La conversion du désir ne nous fait d’abord échapper qu’à l’illusion et à la croyance. Elle est indispensable, puisque n’est que par elle que nous ne consentirons plus aux exigences du désir appropriatif. Mais comment, en quelles modalités et en quelles pratiques, mettre effectivement un terme à la finitisation ?
Toutes les modalités du répulsif, les divers exercices de la négativité, les formes de la réflexivité critique, peuvent et doivent maintenant être reprises. Toutes trouvent en l’idéalisme désappropriatif tant leur sens et leur fonction véritables que leur légitimité. À la discrimination libératrice elles s’emploieront toutes. Chacune, selon son efficience spécifique, permettra de défaire ce par quoi nous consentons à figurer. Normant dorénavantt tous nos rapports à la détermination, cette critique générale, dans l’abstraction, défera les multiples captations particularisantes. La philosophie se fait ainsi libératrice impersonnalisation. L’antihumanisme idéaliste défait en elle le principe même de la servitude. Ainsi, pour Jean-Michel Le Lannou, être « homme » n’est plus notre désir, nous refusons de demeurer encore celui qui nie l’immensité : « L’« homme » n’advient en effet que dans l’impuissance, et nous ne perdurons en cette identification qu’en en réitérant le goût. L’abandonner, c’est identiquement ne plus vouloir le monde. » Par suite, on peut dire que la pensée recouvre sa puissance en œuvrant à le défaire. Et cette opération proprement philosophique, inverse celle qui produit le fini, puis le dit comme « nature », ou fondement « stable » que lequel l’« homme » s’établit. Alors l’exigence éthique de mettre fin au monde, c’est-à-dire d’abandonner la croyance à la substantialité du sensible, peut également se dire avec Simone Weil comme désir de « décréation ». La puissance de l’abstraction peut ainsi défaire le monde. Le désir de mettre fin à l’extériorisation et en par laquelle apparaît le monde aspire à excéder le représentatif. Telle est la pratique libératrice de l’idéalisme : celle d’une désappropriation, d’un désensevelissement du désir d’immensité. Nous retrouverons ainsi l’exigence de la puissance de penser, nous nous ouvrons au désir du libre.
Conclusion
Contre l’ontologie appropriative qui nous fait dire la puissance selon l’antécédence de notre substantialité désiré, il faut une vigilance critique, théorique d’abord, et pratique surtout. Jean-Michel ne pense plus l’excès en le reconduisant à quelque modalité adhésive que ce soit : il parvient à dire l’indépendance de la puissance en demeurant fidèle à l’insurrection de l’excès. Et cela n’est possible que dans la mesure où le philosophe reconnaît l’antécédence de la puissance pré-adhésive et pré-substantielle. En ce sens, il ne pense plus l’excès dans l’opposition dérivée de la « réalité » et de la « possibilité ». Il le libère bien plutôt de cette captation en reprenant, et inversant ainsi, la critique leibnizienne formulée à l’encontre du libre-arbitre. La fidélité à l’excès nous fait retrouver ce que Platon désignait, au terme de l’ascension dialectique, comme le Bien, la puissance comme Bien. Et cela n’est autre que la véritable compréhension du libre apparaissant en nous dans l’excès. De l’excès qui révèle l’antériorité du libre sur l’être, et de lui fidèlement accueilli, notre auteur pense à la fois la puissance antérieure à l’être, dans sa différence prévenante et, selon elle, l’apparition de l’activité de détermination. Avec exigence et audace, Jean-Michel Le Lannou restitue à la philosophie sa plus haute vocation : libérer pleinement le penser du représenter. En cela, il poursuit la voie d’un rigoureux forage qui ose s’affranchir du rôle servile dans lequel les positivismes et empirismes en tous genres s’efforcent de cantonner la réflexion. La puissance d’être représente un moment décisif de son œuvre philosophique – moment qui renouvelle les conceptions de l’art, de l’abstraction et de l’esprit. Nous recommandons aux lecteurs l’aventure dans cette pensée qui engage au mouvement émancipateur pour la spéculation. Car la pensée, cette activité qui s’égale à elle-même en son immensité, est la seule puissance qui puisse nous libérer de l’asservissement au fini. Et ce penser pur excède notre conscience et ce que l’on considère propre à la conscience, la donation du sens, voire l’idée d’une donation originaire. Excédant la condition humaine, il se défait de nous et nous écarte pour se déployer dans l’immensité retrouvée. Le grand désir d’abstraction n’est donc pas celui de l’homme mais celui de la pensée elle-même.
Selon Jean-Michel Le Lannou, le penser pur se déploie hors de la conscience ; il excède la condition humaine, il se défait de nous et nous écarte pour se déployer dans l’immensité retrouvée. Notre grand désir est donc bien ce pur penser échappant à la clôture du figural, au « je » de la particularité, à « l’humain trop humain » qui nous asservit au règne de la convoitise, du pouvoir et de l’amour du fini. Et ce désir nous oblige à livrer un violent combat avec notre attachement à la représentation, à éradiquer les liens tenaces avec l’aristotélisme en nous. Et ce dont La puissance d’être rend compte est du possible dépassement de cette contradiction factuelle entre cet amour du fini auquel nous sommes attachés et ce désir d’abstraction, ce grand désir, ce désir d’immensité qui s’oppose à la finitude, à l’appropriation, à la particularisation : être soi libéré de l’individualité et de la contingence. La pensée est cette puissance d’affirmation qui ose traverser les représentations et répondre au grand désir d’abstraction tel Moïse qui, en son exigence d’excéder le représentatif, a frayé la voie à son peuple : la voie vers la puissance d’être. Cette voie nous la retrouvons dans la peinture abstraite : les formes y sont libérées de toute attache représentative ou symbolique. La couleur vit pour elle-même. La peinture libère le Rien, elle se fait alogique. L’art abstrait ne relève d’aucune esthétique pour Jean-Michel Le Lannou. Sinon il se dissout dans le logos, il se met à nouveau à la merci du sens, de la signification.
Nous signalons aussi aux lecteurs la parution, aux éditions Hermann, en juin 2017, d’un volume réunissant les textes d’un colloque consacré à L’excès du représentatif, sous la direction d’Alexandre Lissner : Puissances de l’abstraction. Études sur L’excès du représentatif. Chercheurs, philosophes et artistes s’interrogent le refus de l’individuation, le statut effectif de la plénitude, et l’être soi délié de toute contingence. S’inscrivant dans l’énigme du grand désir d’abstraction qui taraude l’œuvre philosophique de Jean-Michel Le Lannou, les contributeurs n’ont de cesse de questionner cette pensée du dépassement de l’humain, profondément nietzschéenne. Les articles de Guillaume Lurson, Frédéric Berland, Alexandra Féret, Louis Ucciani, Jean-Yves Château, Roger Bruyeron et Michaël Crevoisier explorent cette tâche libératrice qui est celle de la philosophie de Jean-Michel Le Lannou : parvenir ensemble à savoir et à percevoir l’insubstantialité du sensible. Car ni la vie ni le corps ne sont la condition du désir, a fortiori pas de l’exercice du penser, ils sont bien plutôt, comme incorporation, le produit ultime de sa dépotentialisation. En se faisant impuissant, le penser qui se fait vie, produit le corps comme la condition de la personnalisation. La finitisation, dans sa phénoménalisation organique, dépend du désir d’ « hominisation ». La restitution du penser à sa vérité, identiquement la pleine désubstantialisation du fini, supposent que nous défassions également la confusion première qui lui fait croire qu’il serait précédé, porté ou même produit par une vitalité dont il ne serait pas l’origine. Et la pratique libératrice de l’idéalisme consiste en un renoncement à cette croyance, en ce geste philosophique de nous défaire de l’illusion de la « réalité » du sensible. En nous défaisant, l’excès ouvre alors le désir du libre.
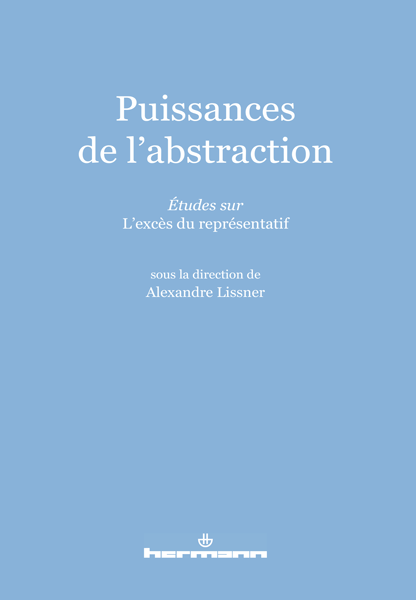
La force de la philosophie de Jean-Michel Le Lannou consiste ainsi en ce mouvement insurrectionnel d’une pensée qui se refuse de se laisser retenir par la particularité et qui, dans son détachement même, rejoint l’affirmation substantielle la plus intense.
- La réflexion transcendantale kantienne nous enferme dans la seule représentation, en y cherchant une différence fonctionnelle et vide, interne à la conscience. Cette distinction produite selon les exigences de la passivisation appropriative, ne partage en fait que des modalités du représentatif. Le caractère vain de cette opération se présente en son aspect réaliste dans l’œuvre de Bergson.
- Nous retrouvons ici le paradoxe d’un désir qui se délie de l’intensité
- Être et penser sont toujours le même, mais dorénavant dans la différence. Le penser en sa finitude se fait relation extérieure à toute réalité. Cette différenciation s’enveloppe cependant en leur principielle et constante identité : « il n’y a d’être, en quelques modalités, qui ne soit penser. »
- La puissance qui se fait représentation est imprédicable de quelque être que ce soit différent d’elle. N’attribue la temporalisation, comme réalisatrice, à l’universalité du penser pur, que celui qui à la fois la dit originairement vide et, dans la même illusion, tient la représentation pour l’essence de tout penser.
- Ainsi la représentation est et n’est pas son origine : elle ne l’est pas, puisque c’est la puissance qui en elle se fait faible, elle l’est cependant puisqu’elle advient d’elle-même, en et par son autoproduction. Le penser qui se finitise se fait tel dans une opération formellement similaire à celle en laquelle il s’immensifie. En chacun d’eux, la puissance s’identifie et se détermine, mais diversement.
- Nous nous faisons figural, « homme » ainsi, en ouvrant l’horizon représentatif, puisqu’entrer dans une figure, c’est se produire en la délimitation, qui rend seule possible l’appropriation.
- Pour Jean-Michel Le Lannou, c’est là « l’erreur la plus grave » puisqu’en cette « évidence », la puissance est asservie à l’impuissance de la finitisation. Aussi la plénitude substantielle du penser, en l’exigence de se représenter, c’est-à-dire de se dé-substantiaiser, est strictement niée.
- La réflexion (trace en nous de la prévenance du libre) permet ainsi de dire la puissance « avant son identification, et ce n’est qu’en son exercice que surgit le possible représentatif, et pour nous seulement, puisqu’il n’apparaît qu’en et avec nous.
- ce qui est pareillement désirer le libre, rien ne les disjoignant.