A mi-chemin entre la philosophie sociale et politique et la sociologie politique, Philippe Urfalino est directeur de recherches au CNRS de même que directeur d’études à l’EHESS (CESPRA). Il s’attache dans ses derniers travaux à mieux comprendre les mécanismes qui sont à l’œuvre au sein des collectifs politiques. Nous pouvons citer par exemple quelques articles parus au cours de ces dernières années : « La décision par consensus apparent. Nature et propriétés » in Revue Européenne des Sciences sociales, Tome XLV, 2007, n°136 ; « Rules and tactics of collective decision : an introduction », Social Science Information, Ed. Sage, vol. 49, n°1, 2010. Il dirige par ailleurs pour la deuxième année consécutive un séminaire intitulé « Rassemblements et corps politiques » à l’EHESS. Il s’agit plus précisément pour ce chercheur de comprendre ce qui distingue un rassemblement d’un corps politique et délibérant au sens strict et ainsi de mettre en lumière en quoi consiste une décision collective.
Au programme de son dernier ouvrage paru aux éditions du Seuil en janvier : la décision collective, comprise comme pratique normative capable en ce sens de produire une obligation collective. C’est en effet ici que réside toute l’originalité de la démarche de l’auteur : si la philosophie politique et la philosophie de l’action se sont déjà penchées sur la notion de décision collective, il n’empêche que la dimension normative de cette dernière reste un angle peu abordé. Aussi la décision collective n’est-elle pas seulement un choix opéré à plusieurs, elle est également la production d’une obligation et la soumission à cette même obligation. La mission principale que se fixe l’ouvrage est de comprendre quels sont les ressorts normatifs, comprendre en quoi une décision collective est en mesure de produire une obligation collective, ceci à l’aune d’un corpus varié puisant aussi bien dans la littérature philosophique que sociologique ainsi que dans des exemples empiriques tirés de divers lieux, époques et sphères sociales. Le lecteur est alors convié à découvrir les mécanismes de la formation de la délibération et de la décision collectives à travers de multiples exemples : du club de lecture au Parlement, du collège électoral de l’Église latine au Conseil de l’Union européenne en passant par le Parti socialiste ou encore le conseil des régents de l’Université de Californie de Berkeley, les mécanismes de ces différentes entités permettent d’esquisser petit à petit les contours de l’aspect normatif de la délibération collective. L’ouvrage s’articule autour de deux grands moments : une première partie est consacrée à la définition de la décision collective, la seconde quant à elle cherche à comprendre sur quoi repose la force normative de ce type de décisions.
- Qu’est-ce qu’une décision collective ?
En introduction, Philippe Urfalino pose les trois grands jalons de sa définition de la décision collective : elles sont tout d’abord le fait d’un groupe d’individus, elles résultent de la prise en compte de la totalité des contributions des participants et, enfin, elles obligent ceux qui les prennent. Partant de cette définition, l’auteur cherche ici à savoir « comment des êtres humains peuvent […] par leurs initiatives produire collectivement une obligation qui vaut pour tous. » (p. 14). La sociologie de la décision collective dans laquelle s’inscrit Urfalino côtoie ici la philosophie politique. Le but de l’ouvrage est de comprendre comment l’obligation collective est produite à partir de la délibération collective. Pour saisir la dimension normative de la décision collective, il faut tout d’abord comprendre ce qui se joue dans un tel type de décisions mais aussi ce qui la distingue d’autres formes de décisions. Pour ce faire, l’auteur reprend à son compte la question de Jean-Jacques Rousseau posée dans le Contrat social : « comment peut-on tirer, à partir de l’expression de la pluralité des volontés, c’est-à-dire de chacun des membres du groupe, la déclaration de la volonté générale ? » (p. 20).
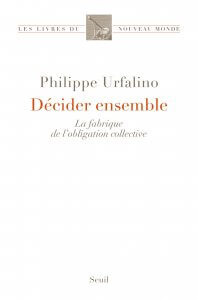
Il faut donner au terme de « décision » un sens plus fort que celui qu’il a dans le langage courant. En effet, on désigne couramment la décision comme un choix effectué après une plus ou moins longue délibération collective ou individuelle. C’est à cette première définition que s’attaque l’auteur afin de façonner une définition proprement conceptuelle de la décision (et a fortiori de la décision collective). Urfalino opère alors une distinction claire entre le choix et la décision. La décision est définie comme « un arrêt de la décision, entendu comme le fait de mettre un terme à la décision et en même temps de produire une obligation, celle de ne pas reprendre la délibération et de mettre en œuvre le contenu de la décision. » (p.22). Le terme d’ « arrêt » est ici à comprendre dans ses deux sens : au sens d’un terme et en son sens juridique de décision. En revanche, le choix quant à lui est réduit à « l’une des facettes de la décision » dans la mesure où « la comparaison des options [le choix] ne touche pas à la dimension normative de la décision […]. La décision oblige. » (p. 27). L’auteur précise quelques pages plus loin sa distinction :
« L’acte de décider renvoie au jugement, à l’acte de trancher, à la détermination ; tandis que choisir renvoie à la sélection d’une option parmi plusieurs. Il apparaît ainsi que le choix peut être une composante de l’exercice de la décision, cette dernière renvoyant à une gamme plus large d’activités. » (p. 31).
En d’autres termes, la notion de choix, bien qu’incluse dans la notion de décision, ne saurait ici recouvrir à elle seule le champ de la décision. Urfalino remarque à cet égard que les sciences sociales ont tendance à confondre sous un même terme la pratique du choix et celle de la décision ; la philosophie contemporaine de l’action, quant à elle, reconnaît bien une spécificité à la décision mais lui accorde peu d’importance. C’est à ces deux manquements que l’ouvrage entend répondre, se situant ainsi au croisement des deux disciplines.
La décision, entendue comme un arrêt, suppose alors une double obligation : décider c’est s’obliger à mettre un terme à la délibération mais aussi s’obliger à mettre en œuvre l’option retenue à la suite de cette délibération. Cependant, c’est en réalité dans le cas d’une décision collective qu’apparaît le plus nettement la dimension normative de la décision. En effet, Urfalino nous rappelle dans ce chapitre que nous savons depuis Hobbes, Rousseau ou encore Kant qu’il est logiquement impossible de s’obliger soi-même à proprement parler : un même sujet ne saurait être commandant et commandé puisqu’il ne peut, si l’on suit le principe du tiers exclu, être A et non A en même temps et sous le même rapport. Autrement dit, l’obligation suppose nécessairement trois termes : celui qui oblige, celui qui est obligé et l’ordre à exécuter. On ne voit pas, alors, comment une décision individuelle pourrait avoir une quelconque valeur normative, si je décide A, il me suffit de, finalement, vouloir B pour ne plus avoir à faire A. La décision collective obéit à d’autres mécanismes que la décision individuelle et elle ne saurait, en ce sens, être résumée à une réunion de décisions individuelles qui se rencontrent dans le même souhait. Urfalino voit la formulation du ressort normatif de la décision collective dans le Contrat social de Rousseau. Au Livre I, chapitre 7, Rousseau écrit :
« L’acte d’association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et […] chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir, comme membre du Souverain envers les particuliers, et comme membre de l’État envers le Souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul n’est tenu aux engagement pris avec lui-même ; car il y a bien de la différence entre s’obliger envers soi, ou envers un tout dont on fait partie »
Rousseau contourne ici l’impossibilité à s’obliger soi-même en distinguant l’agrégation d’individus de l’association d’individus, en distinguant la multitude du tout : tous les contractants, puisqu’ils font partie d’un tout souverain, est à la fois commandant pour le tout et commandé par le tout. La portée normative de la décision collective ne réside donc pas seulement dans le fait que cette décision est prise à plusieurs (et qu’elle aurait potentiellement plus de légitimité), elle réside dans le fait qu’elle est prise par un tout dont chaque partie est obligée précisément parce qu’elle fait partie de ce tout autonome, c’est-à-dire, à la lettre, par un tout qui obéit à la loi qu’il s’est lui-même prescrite. Dès lors, « la décision collective est donc celle d’un collectif, elle ne peut être seulement le fait d’une multiplicité d’individus. » (p. 56). Ici réside le point de départ de l’auteur : la décision collective est normative et sa normativité repose précisément sur le fait qu’elle est le fruit d’un collectif entendu au sens d’un tout, d’un corps délibérant. Ainsi, on peut lire un peu plus loin :
« cela tient à ce que chaque participant a un double statut, celui d’un obligeant et d’un obligé. Chacun est obligeant en tant que membre du souverain et chacun est obligé puisqu’il est également membre de la société soumise aux directives du souverain. » (p. 56).
Cependant, cette formule ne consiste ici qu’en un point de départ puisque, comme le rappelle Urfalino, le but de Rousseau n’est pas de livrer ici la formule de la décision collective, mais plutôt du pacte social entendu comme étant l’origine de l’institution d’un corps politique souverain. Or ce qui intéresse ici l’auteur n’est pas de savoir comment un corps politique et souverain se forme, mais savoir comment une décision prise collectivement au sein d’un tout déjà constitué et institué peut valoir comme obligation pour tous. Urfalino va même plus loin, il refuse tout pouvoir d’institution à la décision collective : « la décision collective ne peut avoir lieu que dans une société déjà donnée ; elle suppose des individus déjà socialisés. » (p. 57).
2. Qu’est-ce qu’un corps délibérant ?
Pour saisir pleinement la notion de décision collective (entendue au sens de décision des collectifs) et rendre parfaitement claire sa dimension normative, il faut savoir de quels collectifs nous parlons ici. L’auteur, soutient l’idée selon laquelle tout rassemblement humain qui prend le titre de collectif ne peut être considéré comme un corps délibérant au sens strict. En effet, il y aurait des différences notables entre un groupe d’amis qui délibère afin de choisir une destination de voyage et un parlement qui délibère afin de voter une loi (ces différences étant supposées situées au-delà de l’aspect trivial de la délibération du premier groupe et de l’aspect solennel du second). Ainsi Urfalino s’intéresse-t-il à partir du troisième chapitre au statut des corps délibérants que sont l’Assemblée, l’Académie, l’État, la Nation, l’Église, etc. Ces entités collectives ne sont-elles que des noms ou bien ont-elles une existence réelle ? La thèse défendue ici s’oppose clairement aux nominalistes : « la visée de ce chapitre est de montrer que ces corps délibérants sont des entités réelles, c’est-à-dire qu’ils sont autre chose et plus qu’une pluralité ou que la collection des individus humains qui la composent. » (p. 110). Urfalino pense contre l’individualisme méthodologique de Boudon qui refuse le statut d’acteur rationnel à des groupes nominaux tels que les classes sociales ou les groupes d’intérêt. Il cite à cet égard un extrait de Raisons, bonnes raisons de Boudon :
« Seuls les individus humains peuvent être le siège de croyances, de désirs, d’intentions […]. C’est seulement métaphoriquement que l’État, un parti politique ou une Église sont le siège d’actions, de désirs, d’attitudes, de comportements, de croyances, etc. Le Parti socialiste ne pense pas. Seuls pensent X, Y ou Z, membres du parti à tel ou tel niveau de responsabilité. Le parti est le contexte dans lequel ses membres émettent telle ou telle action, décision, etc. Si le Parti socialiste ne pense pas, il est capable de décisions ; mais c’est parce qu’il est muni de règles permettant de transformer les opinions individuelles de ses membres en décisions collectives émises en leur nom[1]. »
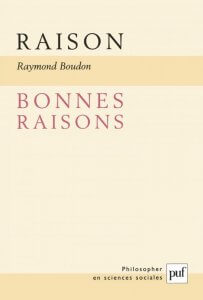
L’auteur admet dans un premier temps le bien fondé de l’argumentation de Boudon mais note cependant un élément à côté duquel passe ce dernier : les entités collectives ne sont pas réductibles à des groupes nominaux : « les groupes nominaux ont pour principe la présence d’une caractéristique commune à tous leurs membres ; rien de tel pour les entités collectives, qui supposent plutôt une différenciation interne. » (p. 112). L’auteur défend notamment, contre les nominalistes, l’idée selon laquelle les entités collectives, les assemblées politiques, ne sont pas réductibles aux individus qui la composent mais sont au contraire « [des] institution[s] dont la nature et l’identité sont d’abord à rapporter à l’histoire et à la structure politique d’une société, et seulement ensuite à [leur] organisation interne. » (p. 115). Autrement dit, pour être qualifié d’ « entité collective », un groupe doit répondre à deux critères, l’un externe et l’autre interne : ce groupe doit d’une part avoir la structure interne d’un tout mais aussi avoir la reconnaissance externe d’une institution, il doit occuper une fonction précise, avoir une histoire, une structure politique, autant de choses qui existent indépendamment des individus qui la composent à un instant t. La critique de Boudon ne s’arrête pas à sa position strictement nominaliste, Urfalino opère également des distinctions conceptuelles qui manquent selon lui à la pensée de Boudon. Ce dernier refuse le titre d’agent rationnel aux entités collectives, ne voyant en réalité dans les entités collectives qu’une coordination de volontés individuelles, tandis que Urfalino, à l’inverse, affirme qu’ils peuvent être qualifiés comme tels, à condition de redéfinir ce que nous entendons par « agent » et donc par « action » : « pour qu’il y ait action il suffit qu’une chose ait le pouvoir d’en transformer une autre. » (p. 125). Aussi Urfalino distingue-t-il deux types d’agents : les agents rationnels qui peuvent décider d’intervenir sur les choses ou non, et les agents naturels qui ne peuvent pas décider de ne pas intervenir (comme par exemple l’eau qui érode la pierre). Ni agent naturel ni totalement rationnel au sens strict, l’entité collective est ici définie comme « un agent artificiel qui a la particularité d’être composé d’agents rationnels. » (p. 125). Pour qu’un groupe d’individus soit une entité collective, un agent, il faut qu’il soit autre chose qu’une collection d’individus. Pour reprendre le vocabulaire de Rousseau dans le Contrat social, le groupe doit passer de l’agrégation à l’association. L’entité collective est un agent dans la mesure où elle est un tout qui s’est donné des fins spécifiques et ses membres ne sont des parties du tout que dès lors qu’ils poursuivent ces fins. Bien plus, les entités collectives sont dotées d’une fonction et de fins particulières qui ne lui sont pas seulement ajoutées mais qui constituent au contraire les motifs et justification de son existence. Dès lors, si les membres du collectif décident de poursuivre d’autres fins, nous assistons alors à la corruption de l’entité ou bien à la création d’une nouvelle entité collective. C’est à ce titre que l’on peut parler d’une décision proprement collective, car il ne s’agit pas de l’addition arbitraire et arithmétique d’une multitude de décisions individuelles mais bel et bien de la rencontre d’un ensemble de volontés en un point fixé par les fins du tout dans lequel naissent ces différentes volontés.
3. La volonté générale
La seconde partie de l’ouvrage est davantage consacrée à la création de la volonté générale et de l’obligation majoritaire. D’un point de vue strictement philosophique, c’est le dernier chapitre (« l’obligation majoritaire ») qui est le plus éclairant. Urfalino résume la question principale du chapitre en ces termes :
« Pourquoi serions-nous obligés de suivre une décision majoritaire ? A quelles conditions cette obligation est-elle valide ou non ? » (p. 303).
Il s’agit ici pour l’auteur de considérer prioritairement notre modèle de délibération et de décision qui pourrait se résumer comme suit : fixation des options, délibération, vote puis application de la règle numérique de majorité. Dans le cadre d’un tel modèle de délibération, la validité d’une décision collective ne peut être mesurée qu’à l’aune du nombre de suffrages que telle ou telle option obtient, cependant, il faut aussi tenir compte du but que vise ladite option. En effet, une entité collective étant un tout à part entière, une association de volontés, il faut – pour que ses membres soient soumis à sa décision – que la décision collective ne mette en cause aucun des éléments constitutifs de l’entité elle-même. En réalité, la puissance normative d’une décision collective ne vient donc pas prioritairement de la règle de majorité mais plutôt de l’appartenance des individus au tout délibérant. La décision collective ne vaut pour obligation que dès lors qu’elle est prise au sein d’un tout dont les rôles des membres et dont les fins sont clairement définis. Les corps délibérants ont cette particularité d’exister par delà les individus et donc par-delà les préférences individuelles. Un corps délibérant existe toujours si l’un des membres le quitte ou le rejoint et, surtout, les décisions collectives ne sont pas prises au noms des individus qui le composent, mais bel et bien au nom du tout. Toutefois, la règle de majorité apparaît comme étant la plus adaptée à une société d’égaux dans la mesure où elle privilégie la formation rationnelle des opinions majoritaires et c’est, précisément, en démocratie, à l’aune de la rationalité des opinions majoritaires qu’on mesure leur autorité. La règle de majorité assure enfin l’égalité des votes et ne privilégie par définition aucune option, elle présente de surcroît l’avantage de permettre de décider à tous les coups. La règle de majorité est en somme un mécanisme de coordination entre une pluralité d’acteurs, mais elle ne saurait résumer à elle seule le phénomène de décision collective. Pour qu’une décision majoritaire puisse être considérée comme une décision collective (qui obligerait ses votants) et, par conséquent, d’une certaine manière, comme l’expression de la volonté générale de ce tout, il est nécessaire qu’elle n’entre pas en contradiction avec les fins que s’est fixé ce groupe. Par exemple, nous pourrions imaginer que, selon la définition proposée ici par l’ouvrage, un Parlement qui voterait à la majorité une disposition qui nuit audit Parlement, qui va à l’encontre de ses missions ou tout simplement qui ne relève pas de ses fonctions, aurait certes acquis la légitimité du nombre, mais n’aurait en aucun cas le pouvoir d’obliger qui que ce soit. Il ne s’agirait pas là, en effet, de la décision d’un collectif, mais d’une collection d’individus qui ne votent pas en tant que membres du Parlement, mais en tant qu’individus isolés.
Conclusion
En somme, Philippe Urfalino tente dans cet ouvrage de penser à nouveaux frais la question de la décision collective depuis la ligne de crête qui sépare la sociologie politique de la philosophie politique. Puisant tantôt dans la littérature philosophique, tantôt dans la littérature sociologique, l’auteur entend décortiquer le processus de la décision collective afin de mettre au jour ses ressorts strictement normatifs. Cette étude doit nécessairement en passer par une définition rigoureuse de la décision collective : décider n’est pas choisir, ce n’est pas partager, ce n’est pas négocier. Décider consiste avant tout à produire une obligation qui vaille pour l’intégralité des membres du collectif, une obligation qui fasse de tous les membres des obligeants et des obligés. La décision collective suppose également un contexte particulier : elle est assurément la décision d’un collectif, d’une entité collective et en ce sens délibérante. Un collectif doit ici être compris comme un tout dont les buts et les fonctions sont fixées à l’avance. En définitive, une décision n’est collective que si elle est prise par un collectif qui se sait et se pense comme tel.
[1] Cité p. 111.







