Se procurer le dernier ouvrage de Pierre Lochak
Pierre Lochak est mathématicien et philosophe. Il mène depuis plusieurs années une réflexion que l’on pourrait résumer en partie dans l’interrogation de chaînes syntaxiques profondément ancrées, souvent jusqu’à notre époque même, dans la culture philosophique. Pour citer les plus prégnantes, dans des versions quelque peu simplifiées : logique-et-mathématiques, science-et-technique, religion-et-science (alias fides-et-ratio, foi-et-raison).
I. BIOGRAPHIE
Florian Forestier : J’aimerais commencer notre entretien de manière chronologique. Tu le dis souvent, tu as baigné, enfant, dans les discussions et débats sur la mécanique quantique et la physique. Pourrais-tu dire quelques mots sur ton histoire personnelle, à la fois familiale, scientifique et intellectuelle, en évoquant l’importance de ces débats dont tu as été très tôt témoin, puis tes propres travaux mathématiques, la façon dont tu t’es intéressé à la philosophie, puis t’y es engagé, jusqu’à en faire une part importante de ton activité ?
Pierre Lochack : Mes quatre grands-parents sont originaires d’Europe Centrale, d’une région en fait assez petite, entre Bulgarie (Sophia), Bessarabie (Kichinev-Chisinau) et l’Empire Russe (Odessa). Aucun d’eux ne connaissait le français à l’âge de vingt ans. Trois d’entre eux étaient russophones, le dernier de langue maternelle bulgare, tous quatre juifs ashkénazes et sépharades, la mer noire figurant un point de rencontre. L’histoire de ma famille est une longue histoire de Révolution, pogroms, armées diverses et variées (rouge, blanche, verte), larges fleuves traversés en radeau (Dniepr, Danube), épidémies (typhus), Grande Guerre, France, crise économique de 29, seconde guerre mondiale, enfants cachés, shoah… on n’en finirait pas.
Mon père était en effet le dernier et peut-être le plus fidèle élève de Louis de Broglie. De ce fait, j’ai côtoyé, enfant, beaucoup parmi les « acteurs » de ce temps en physique quantique, dont A.Aspect, J.Clauser, A.Shimony, B.d’Espagnat, J.-M.Lévy-Leblond, J.-P.Vigier et beaucoup d’autres. J’ai par ailleurs été longtemps bercé par les noms de Bohr, Dirac, Ehrenfest, Heisenberg, Pauli, etc. sans parler d’Einstein et de de Broglie (que j’ai rencontré) tous deux omniprésents.
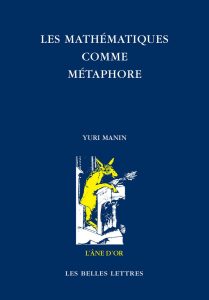 Elève de l’ENS Ulm en mathématiques (1976-1981), je me suis d’abord intéressé à la physique mathématique et en particulier, au début, les mathématiques de la mécaniques quantique, avant de me tourner vers la théorie des « solitons » (alors très présente), puis les systèmes dynamiques, plus particulièrement les perturbations hamiltoniennes de systèmes intégrables (à propos desquels j’ai pu écrire quelques articles encore très lus et cités). Après 1990 je me suis intéressé aux travaux d’Alexandre Grothendieck post-1970 ; avec Leila Schneps et quelques collègues japonais nous avons alors entrepris de développer la théorie dite de Grothendieck-Teichmüller dont on trouve les premiers linéaments dans un texte devenu célèbre dans un certain milieu mathématique, à savoir l’Esquisse d’un programme.
Elève de l’ENS Ulm en mathématiques (1976-1981), je me suis d’abord intéressé à la physique mathématique et en particulier, au début, les mathématiques de la mécaniques quantique, avant de me tourner vers la théorie des « solitons » (alors très présente), puis les systèmes dynamiques, plus particulièrement les perturbations hamiltoniennes de systèmes intégrables (à propos desquels j’ai pu écrire quelques articles encore très lus et cités). Après 1990 je me suis intéressé aux travaux d’Alexandre Grothendieck post-1970 ; avec Leila Schneps et quelques collègues japonais nous avons alors entrepris de développer la théorie dite de Grothendieck-Teichmüller dont on trouve les premiers linéaments dans un texte devenu célèbre dans un certain milieu mathématique, à savoir l’Esquisse d’un programme.
Parallèlement, encore élève à l’ENS, j’avais poursuivi une licence et une maîtrise de philosophie à l’Université Paris IV (1978-1981), où enseignaient entre autres Pierre Boutang et Jacques Rivelaygue. J’ai écrit sous la direction de ce dernier un mémoire de DEA sur la philosophie de la nature chez Schelling. Durant toutes ces années, j’avoue avoir évité ce qui s’apparentait à la philosophie des sciences et l’épistémologie. La philosophie analytique, quant à elle, n’avait pas encore véritablement traversé l’Atlantique, ni même la Manche.
Tu as par ailleurs été un des derniers mathématiciens, voire le dernier, avec ton épouse Leila Schneps, également mathématicienne, à entretenir des relations avec Grothendieck, une véritable correspondance il me semble. Peux-tu en dire quelques mots ?
P.L. :Nous avons effectivement rendu visite à Alexandre Grothendieck, en 1995 et 1996, alors qu’il s’était retiré dans le village de Lasserre, en Ariège, un lieu de résidence qui était alors tenu secret. Pour un récit et un compte-rendu assez fidèle de ces visites et des conversations que nous avons eues avec lui, je me permets de renvoyer au premier chapitre d’un récit-fiction que j’ai écrit récemment, intitulé Alexandre Grothendieck : le roman d’une vie, et dont j’espère qu’il paraîtra fin 2024. Ces visites se sont effectivement prolongées en une correspondance dont il serait difficile de détailler ici le contenu.
II. LA SCIENCE
Venons en au premier élément que tu mets au centre de ta réflexion : le terme de « science ». Tu consacres beaucoup d’efforts et de pages à réfléchir à la science, à ce qui fait qu’il y a à proprement parler science, à distinguer celle-ci du scientisme, aussi. « On défendra l’idée, à titre expérimental et sans provocation excessive, que le mot de science s’apparente aujourd’hui à un vocable quasiment vide », écris-tu dans un de tes ouvrages. « La “science”, ce n’est ni les Analytiques d’Aristote, ni la théologie de Saint Thomas, ni la géométrie de Descartes, ni tout à fait la physique de Newton qui inspire “le vieux Kant”, ni une mécanique quantique dont le positivisme logique prend prétexte, ni l’horizon des Ideen de Husserl, pas même les motifs d’Alexandre Grothendieck, moins encore le fantasme de la philosophie analytique ou bien cette ombre tutélaire qui parrainerait l’entreprise philosophique d’Alain Badiou, sûrement pas ce que le cognitivisme et l’intelligence artificielle véhiculent complaisamment aujourd’hui. » Ni Heidegger, ni le Cercle de Vienne, ni non plus Husserl, ni Cassirer, ni le jeune Habermas, ni d’autres encore ne nous ont véritablement livré une image convaincante et profonde de la “science”. Alors, comme tu l’écris « de quoi est-il question lorsque l’on se réfère à cette fameuse “naissance de la science moderne” ? (…) Qu’est-ce donc qui “naît” ? Qu’advient-il exactement dans le passage entre Buridan et Galilée ? » Pourquoi y a-t-il eu de la science et non pas plutôt « rien » ?
P.L. : Je crois qu’il faut d‘abord et peut-être surtout insister sur ce qui ne se dit presque jamais, à savoir que la véritable science est rare et fragile, comme d’ailleurs on peut le constater tous les jours. C’est un préjugé ou une facilité de notre époque de chercher à voir la science et la scientificité partout. La science à proprement parler est rare. Je ne prétends pas connaître la « recette » qui permet l’éclosion d’une « science » au sens moderne du mot, mais je dirais tout de même qu’il me semble que deux ingrédients sont nécessaires, qui de fait sont très rarement réunis : d’une part une forme d’herméneutique. En ce qui concerne la « science occidentale moderne », à défaut d’une appellation plus précise et plus consensuelle, il s’agira de l’herméneutique biblique dans toutes ses « variantes » (talmud, patristiques grecque et latine, scolastique, etc.) ; est aussi nécessaire une forme d’esthétique, c’est à dire de rapport à l’espace et au temps, d’aucuns diront de maîtrise, de ces formes a priori de la sensibilité. Pour la même science « moderne » c’est sans doute le « calcul infinitésimal » qui fournit cet ingrédient essentiel, où il importe de préciser que ce « calculus » remonte beaucoup plus haut que Leibniz et Newton, souvent cités comme ses précurseurs.
Je vois ce dont tu parles concernant l’herméneutique. En revanche, peux-tu en dire un peu plus sur cette esthétique ? Par exemple, un certain nombre d’auteurs font le lien entre la « découverte » de la profondeur perspective en art (Brunelleschi, Alberti, Piero della Francesca) la théorisation d’un rapport au monde appuyé sur la représentation, de l’objet et de l’objectivité. C’est le cas par exemple de Fausto Fraisopi dans ses travaux sur la phénoménologie et la complexité. Mais est-ce à cela que tu te réfères quand tu évoques l’esthétique ?
P.L. : Un mathématicien d’obédience franchement nazie, malheureusement très compétent comme le furent beaucoup et même la plupart des scientifiques qui participèrent aux efforts entrepris dans les années trente pour cerner les contours d’une science authentiquement « allemande » — sinon « völkisch » — un mathématicien allemand de ce temps donc, pouvait écrire que le calcul infinitésimal n’exprimait rien de moins que « la chair et le sang du peuple allemand ». Au-delà de la revendication nationaliste à dessein naïve (Leibniz plutôt que Newton), on conçoit qu’il y a là un constat très lourd et très fort sur l’abord, la maîtrise, l’arraisonnement de l’espace et du temps, Raum und Zeit. Je m’y suis longuement étendu dans Mathématiques et finitude, à propos d’une dichotomie pour ainsi dire anthropologique, celle du continu et du discontinu ou discret, celle-là même qui va retenir Alexandre Grothendieck (après André Weil) pendant une bonne partie de sa carrière mathématique, peut-être la plus éblouissante, devenue depuis pour ainsi dire « classique ».
Arrêtons–nous donc un moment sur ces infinitésimaux. Pourquoi insister tellement sur eux ? Qu’est-ce qui en eux te semble particulièrement lié à ce qu’on appelle la science, apte à éclairer ce que ce terme a de difficile, de spécifique ?
P.L. : Le calcul infinitésimal est à la base d’une très grande partie de ce qui se donne comme « science » et voudrait décrire, pour certains « arraisonner » voire maîtriser le « monde » au dépens si l’on veut du « monde de la vie », la Lebenswelt. Calcul différentiel, équations aux dérivées partielles, etc. incarnent formellement la relation de causalité et constituent en particulier le socle proprement scientifique de la révolution industrielle, où ici on distinguera nettement « science » de « technique ». On peut citer en exemple la famille Carnot, dont le père, Lazare, actif dans bien d’autres domaines avec des états de service disons très … contrastés, nous livre ses Réflexions sur le calcul infinitésimal, importantes dans la mesure où elles mettent bien en lumière l’importance de leur sujet. Son fils, Sadi, qui doit son prénom à un fameux soufi admiré de Lazare, authentique génie scientifique disparu très jeune, compose, lui, les très importantes Réflexions sur la puissance motrice du feu, un petit — par le volume — livre qui marque les débuts de la thermodynamique comme science et l’introduction du concept très subtil d’entropie, sans doute beaucoup moins intuitif que celui d’énergie, du moins jusqu’aux travaux d’Einstein près d’un siècle plus tard. En un sens le second principe de la thermodynamique a ainsi précédé le premier. Or il est difficile sinon impossible d’imaginer le cycle de Carnot ou bien encore la notion d’adiabaticité sans le calcul infinitésimal. On trouve ici un bel exemple de « synergie » entre la « technique », représentée en l’occurrence par les machines à vapeur et la question économico-industrielle de l’amélioration de leur rendement, la « science », en l’espèce la physique et plus spécifiquement la thermodynamique naissante, et enfin les mathématiques, ici le calcul infinitésimal, déjà entré dans les mœurs, magistralement développé et justifié par Cauchy et quelques autres mathématiciens, qui fournit le support d’intuitions physiques premières (dont le cycle de Carnot est un exemple) et les moyens d’expression formelle de celles-ci. En fin de compte il devient possible d’améliorer grandement toutes sortes de machines, y compris les métiers à tisser, ce qui va naturellement engendrer les problèmes socio-politiques que l’on sait, d’une toute autre nature. La science est bien la source souvent cachée de la technique, voire de la technologie. Autre remarque assez évidente si l’on s’en rapporte à l’expérience historique : à long terme, la science est également la mère de toutes les batailles, autrement dit de la supériorité militaire. Cette constatation avait déjà été faite par les Sultans turcs dès le XVIIIe siècle, sinon même peu après le désastre ottoman à Lépante.
Ces exemples sont passionnants mais renvoient d’avantage aux XVIIIe et XIXe siècle. Or le nœud qui nous importe ici est plus précoce, ce me semble. Il s’agit par ailleurs, dis-tu, de quelque chose de vraiment propre à l’Occident, qu’on ne peut donc lier simplement à l’apparition du calcul infinitésimal, sans le définir d’avantage. Comme tu le notes en effet, il y a une certaine compréhension de la problématique de l’infinitésimal chez les scientifiques persans, en Asie Centrale. Tu écris qu’ « aux alentours de l’an mil, on discutait déjà âprement des mérites et des difficultés de la théorie du lieu d’Aristote, en des termes que Galilée n’aurait pas désapprouvés un demi-millénaire plus tard. »
P.L. : Les scientifiques persans avaient en effet une compréhension pointue des infinitésimaux, ce qui bat largement en brèche l’idée d’une filiation de leur science avec la physique d’Aristote qu’elle se contenterait d’interpréter. Les infinitésimaux, c’est le contraire de la physique conceptuelle d’Aristote. On pourrait d’ailleurs résumer une partie de cette histoire comme une sorte de confrontation à distance entre Archimède et Aristote, laquelle s’est poursuivie depuis l’Antiquité suivant divers canaux et a connu des échos plus tardifs en occident. Comme souvent en matière scientifique, c’est l’Asie Centrale et le domaine d’influence persane qui donne — secrètement ou presque — le la. Il s’y développe, entre le IXe et le XIe siècle, une «mathématique infinitésimale», pour reprendre l’expression de Roshdi Rashed aux travaux duquel je me fais bien évidemment un plaisir de référer le lecteur. Ce corpus très riche s’appuie au départ sur les traductions de certaines œuvres d’Archimède et de quelques autres mathématiciens grecs – Appolonius étant sans doute le plus important en l’occurrence –, traductions entreprises à Bagdad à partir de manuscrits provenant de diverses sources, dont les monastères byzantins. Les mathématiques infinitésimales développées alors par les frères Banū Mūsā, par Thābit Ibn Qurra, Ibn al-Haytham et quelques autres remarquables scientifiques, ces mathématiques peuvent donc être qualifiées de néoarchimédiennes, suivant encore la terminologie de R.Rashed. Il faut tout de suite insister sur le fait que ces mathématiciens ne se contentent nullement de commenter Archimède ; certes ils partent de ce qui dans son œuvre leur a été rendu accessible, ils en retrouvent parfois d’autres parties par eux-mêmes, mais surtout ils développent leurs propres théories, extrêmement riches et impressionnantes. Une théorie riche, sophistiquée et originale donc, qui va déjà déclencher l’opposition féroce des … Aristotéliciens, en l’occurrence un certain Abd al-Latif al-Baghdādi, qui critique sans pitié la théorie de l’espace extrêmement moderne d’Ibn al-Haytham. Il vaut la peine de lire là-dessus les textes mis à notre disposition par R.Rashed dans le quatrième volume de ses Mathématiques infinitésimales ; comme il le note lui-même, nous ne sommes pas si loin des dialogues de Galilée, à la distance temporelle vertigineuse d’un demi-millénaire.
Pour autant, justement, il n’y a pas de science au sens ou tu l’entends chez les Persans. Si je te comprends bien, pour toi, c’est encore et malgré tout la physique galiléenne, qui fournit le meilleur paradigme de ce qu’on peut nommer science. A nouveau, j’aurais deux questions. D’abord, qu’est-ce qui a manqué à cette « science » (je mets des guillemets) arabo-perse ? Et inversement, qu’est-ce qui s’est manifesté de si nouveau avec Galilée ? Qu’est-ce qui, dans son œuvre, est si emblématique, si paradigmatique, de l’idée de science ?
P.L. : C’est une vraie question : qu’est-ce qui a manqué aux scientifiques persans pour faire fond sur leurs développements sur les infinitésimaux et d’autres grands résultats, tel, en optique, la loi de la réfraction, cette loi que nous nommons « loi de Snell-Descartes », mais qui était connue en Perse un demi-millénaire avant Snell et Descartes. Que leur a-t-il fait défaut pour construire une physique et même une physique mathématique au sens moderne de l’expression ? Pour le dire de manière brève et trop simple, pourquoi al-Biruni et ses successeurs ne sont-ils pas devenus Galilée ? Ces gens avaient à leur disposition une très grande physique ainsi que des débats extrêmement avancés sur la signification de l’espace, en particulier sur le fait que la chôra aristotélicienne ne constitue pas une conception de l’espace permettant de fonder une physique effective, fidèle à son nom c’est-à-dire à la « nature », quel que puisse être le sens que l’on donne à ce dernier terme. Tout ceci est admirable et même assez extraordinaire. Et pourtant, si l’on peut l’écrire ainsi naïvement, il n’y a pas eu alors de Galilée.
Galilée, c’est-à-dire entre autres une forme d’idéalisation du monde pour, asymptotiquement et dans l’imaginaire, éliminer si l’on veut le frottement et les caractéristiques du « sublunaire », ce qui permet par exemple d’énoncer le principe d’inertie, de comprendre qu’un corps non soumis à quelque force que ce soit continuera en ligne droite à la vitesse qui était la sienne, quand tout le monde voit bien que dans notre monde, c’est tout simplement faux ! Bien entendu c’est là un seul élément d’une question qui a fait couler beaucoup d’encre et dont il n’est pas sûr qu’elle admette une réponse tranchée. Pourquoi la Florence du début du XVIIe siècle et une forme de néo-platonisme, plutôt que les confins du Khwarezm six siècles plus tôt ? Posée ainsi, de manière trop simple et abrupte, avouons que la question n’a peut-être pas grand sens.
Toujours est-il, autre élément de réponse, qu’il y a au moins deux versions ou deux voies d’accès au calcul infinitésimal, qui pour le coup rappellent d’un côté Leibniz, de l’autre Newton. Une première, pour nous assez paradoxale, fondées sur des « indivisibles », suivant la terminologie de Cavalieri, ami de Galilée, l’autre plutôt tournée vers des quantités « évanouissantes » popularisées et justifiées de main de maître par Cauchy et quelques autres mathématiciens. Rappelons que Pascal explique en particulier que l’existence des indivisibles n’est pas équivalente à celle d’ « atomes » d’espace et de temps. Dans quel but ? Quelle serait la motivation sous-jacente de Pascal ? D’abord la théologie. Le calcul infinitésimal, pour autant qu’il touche à l’esthétique, aux formes premières sinon a priori de l’espace et du temps, va rencontrer, brutalement et durablement le mystère de la transsubstantiation. Il n’est pas sûr qu’Alexandre Koyré ait eu les héritiers qu’il méritait, lorsqu’il repère la théologie comme une compagne nécessaire de la science. En fait, non seulement science et théologie ne se comportent pas comme des « ennemies » mais il me semble que l’on peut même affirmer que la seconde est nécessaire à l’éclosion de la première. Cela dit, attention ! Il ne s’agit manifestement pas de n’importe quelle théologie. J’ajouterai que tout ceci, c’est l’expérience historique qui tend à nous l’enseigner, et non un raisonnement plus ou moins a priori. De fait on constate que certaines théologies (à ne pas confondre évidemment avec « Églises », avec ou sans majuscule) constituent des « alliées objectives » de la science, quand d’autres formes rendent au contraire cette dernière quasiment impossible. Il en est par exemple ainsi lorsque certaines médiations viennent à faire défaut ou à se dérober, et des plus originelles, qui auraient à charge de lier entre elles les parties de l’espace et du temps. Au contraire le calcul infinitésimal, lui, se nourrit de ces médiations qui assurent l’ajointement harmonieux des parties de l’espace et de celles du temps ; il insiste aussi de manière essentielle sur l’idée de variation, ce pourquoi on y peut discerner un accord particulier avec l’âge baroque européen. J’insisterai sur le fait que l’aventure du calcul infinitésimal n’est nullement achevée, avec tout le respect dû à André Weil qui voulait croire le contraire et le proclamait haut et fort. En témoignent par exemple hier la construction de la cohomologie cristalline due à Alexandre Grothendieck, plus récemment la géométrie dite dérivée ou encore le développement de la théorie moderne de la déformation. Ce sont toujours et encore les mêmes intuitions qui demeurent à l’œuvre, jamais cependant dans la simple répétition au sens d’un ressassement, plutôt dans une forme de renouveau où se mêlent l’étonnant et le traditionnel. Comment ces mutations sont-elles possibles au sein d’une mathématique dont l’histoire se déroule au rythme d’un temps long, parfois très long, où les véritables événements s’égrènent parfois au fil des siècles, c’est là l’une des interrogations qui nous retiennent et devraient nous concerner bien au-delà des mathématiques proprement dites.
Tu insistes sur le fait que les intuitions ou gestes intellectuels en amont du calcul infinitésimal sont très vieux et tu évoques « l’opposition ou du moins le contraste entre Aristote et Archimède, quasiment intact vingt trois siècles plus tard. » Tu écris aussi qu’il est« très probable qu’Archimède, avec son immense génie scientifique, ne se souciait guère des Analytiques ». Mais ce contraste est-il si fort ? Si j’ai bien compris, les intuitions qui peuvent renvoyer aux infinitésimaux dans l’Antiquité, chez Euclide, Eudoxe, et Archimède, se gardent justement de prolonger le calcul à l’infini. Dans les méthodes dites d’exhaustion, l’intuition principale est qu’il est possible d’approcher aussi près que l’on veut le diamètre d’un cercle par un polygone régulier. Il y a toute une technique mathématique qui flirte avec les problématiques de l’infini, mais n’en fait pas, disons, la « position théorique » !
P.L. : Il vaut la peine de mieux comprendre tout ce qui est intriqué dans la naissance de la science depuis les XIIIe et XIVe siècles. Quelqu’un comme Nicolas Weill-Parot s’y attache. L’histoire du lieu, de l’espace, du continu, en est une, et de taille, avec sa longue histoire et ses innombrables conséquences dont l’une des plus importantes est justement l’émergence et la lente mise au point du calcul différentiel et intégral. Le terrain n’est pas vierge bien sûr, mais les études n’abondent pas qui allient une solide érudition historique, un point de vue authentiquement philosophico-théologique et une perception aiguë de la science, dépeinte non pas comme un heureux « triomphe de la raison » mais plutôt comme un phénomène historique et culturel, rare et fragile, insistons-y. En occident sans doute convient-il d’explorer ce qui se joue en gros entre le quatorzième et le début du seizième siècle, tenant compte des diverses variantes de la théologie chrétienne, de la Réforme qui s’annonce, etc. Je renverrai — trop globalement — aux travaux récents de Nicolas Weill-Parot pour quantité d’informations et de références en lien avec ces questions, me contentant d’ajouter que non seulement il conviendrait de relire Koyré une fois encore et de creuser le sillon qu’il a brillamment tracé, mais qu’aussi Gilles Châtelet nous offre un autre point de départ avec le seul ouvrage qu’il soit parvenu, douloureusement, à mener à bien, Les enjeux du mobile (Seuil, 1993). Le titre complet précise qu’il y est question de mathématiques, de physique et de philosophie, ce qui est déjà beaucoup. Sans doute cependant manque-t-il la théologie, très présente chez plusieurs des auteurs que l’ouvrage examine d’un œil original. Tout ceci permettrait donc de mieux approcher, sur la question de l’espace au sens large, cette intrication de la science et de la théologie, y compris surtout les spécificités de cette dernière, ici chrétienne, qui peuvent susciter la lente éclosion de la première, fût-ce au titre d’une révolte juvénile et donc forcément bienvenue. Je me permettrai de renvoyer aussi aux dizaines ou centaines de pages que j’ai écrites sur ces sujets, sans du tout prétendre à une érudition, en particulier historique, qui me fait défaut.
Entrons justement quelque peu dans ces pages. Tu insistes en particulier sur le fait que le long processus de transgression des principes millénaires de la Physique d’Aristote, est lui-même suspendu à une transgression plus originelle, celle de la métaphysique, ou plutôt de l’organon et spécifiquement de la doctrine des catégories, entre lesquelles étaient érigées des cloisons en principe étanches (il n’existe pas, il ne peut exister, de communication entre les genres de l’être, qualité et quantité sont rigoureusement séparées). Or, dis-tu, un passage, très lentement, va bien être frayé entre elles, dont l’ouverture se rythme par les noms d’Oresme, Buridan, Henri de Langenstein, Ockham. Je m’arrêterai de mon côté par exemple sur Jean Buridan, qui sous le nom d’impetus, cherche à reformuler la conception de la cause efficiente d’Aristote, pour mieux comprendre comment un projectile continue son mouvement dans les airs alors que rien ne le pousse. En effet, cette notion, pourtant qualifiée de confuse par Koyré, a pu, selon certains, jouer un rôle d’intermédiaire entre la physique aristotélicienne et l’idée d’inertie. Bref, tu répètes souvent que le long et lent cheminement qui durant tout le moyen-âge prélude à l’éclosion ou l’explosion de la « science moderne » n’a sans doute pas été encore assez étudié. Or c’est ce mouvement, dis-tu, qui nous a légué perception de l’espace et du temps (une esthétique très spécifique pour reprendre tes propres termes), laquelle pavera le long chemin vers un calcul infinitésimal effectif.
P.L. : Tout à fait. C’est bien là une tâche à entreprendre ou poursuivre. L’espace, le temps, mais aussi l’infini et quelques autres concepts-clefs, à considérer à la fois sur un temps très long et en ayant en vue les développements les plus récents, les plus significatifs de cette « science moderne », et ce de manière active, détaillée, effective.
Dans ce processus, tu évoques un certain nombre de moments clefs : les condamnations parisiennes de 1277, les condamnations des idées d’Abélard au concile de Sens (1140), etc. À chaque fois, ce qui est en jeu, c’est la question des médiations : l’Église, dis-tu, semble vouloir prévenir la tentation du développement de dangereuses médiations entre le Ciel et la Terre, qui limiteraient entre autres la liberté ou la puissance divine, mais le christianisme lui-même porte en germe la possibilité de ces médiations. Or, insistes-tu, il n’y a justement pas de « science » sans certaines médiations. D’ailleurs, cette question des médiations ouvre aussi, dis-tu, à une réflexion sur ce qui distingue l’herméneutique chrétienne et la tradition de l’islam sunnite (et aussi, d’ailleurs, la tradition chiite). La toute-puissance d’Allah constitue d’après toi un obstacle rédhibitoire au développement ou même à l’assimilation de la science en terre sunnite. Symétriquement d’ailleurs (mais je m’avance sur la suite de l’entretien), il faudrait selon toi étudier les liens entre la crise de la science et la perte de consistance du terme de « science » dans le monde disons occidental (ou judéo-chrétien) et le rapport complexe, de fascination-répulsion, qui s’y noue avec l’Islam, en particulier sunnite, au regard de cette problématique des médiations (et de leur dissolution), et de tout l’édifice symbolique élaboré sur leur base.
P.L. : On a pu rapprocher la naissance de la science moderne de la grammaire des langues indo-européennes, particulièrement riche en médiations en tous genres. C’est sans doute à la fois exagéré et certainement dangereux. Encore une fois la tradition arabo-perse est très riche, mais aussi très ancienne et d’une certaine manière avortée. Je me suis risqué à explorer ce sujet, sensible et aujourd’hui périlleux, à n’en pas douter, dans un livre récent (Incréation, éd. Kimé, 2015). Je m’en tiendrai ici prudemment au monde « occidental ». On peut adopter nombre de points de vue, très variés et contrastés. Tirons un fil : on trouve dans le judaïsme une doctrine des quatre sens de l’Écriture, doctrine officiellement adoptée par l’Église, du moins par les grands scolastiques et jusqu’au jour d’aujourd’hui, doctrine rassemblée en un acronyme qui évoque le Paradis, un mot perse qui désigne le verger et qui a été adopté en hébreu. Paradis, pardes, quatre consonnes, p.r.d.s., quatre sens de l’écriture. Passons sur le premier, le sens littéral, et le dernier, le sens secret, anagogique, comme on voudra. Demeurent les deux sens médians, que Paul de Tarse écrasera en un seul, le sens « spirituel », celui qui va tracer la voie à, puis durcir un dualisme que l’on retrouve évidemment chez Descartes, celui de l’âme et du corps, après la théologie figuriste de l’Écriture, etc., etc. (énormément d’etc. !). Passons. Si l’on traduit en grec le r (remez) et le d (drach), on dira qu’il est à peu près question du sens analogique et du sens métaphorique. On peut retraduire dans la linguistique de Jakobson adoptée par les structuralistes puis par Lacan. Il sera question alors de métonymie et de métaphore, de l’axe paradigmatique et du syntagmatique ; enfin il sera question, pour la psychanalyse lacanienne, de signe et de signifiant. Nous sommes déjà dans les « sciences humaines » (on se souvient que Lacan détestait cette expression !) et je ne développerai pas. Mais oui, il est alors si l’on veut question de médiations. Je ne sais pas si le schématisme est caché au plus profond de l’âme humaine. On peut peut-être préciser un peu aujourd’hui, deux siècles et demi après Kant : quid de la métaphore, autrement dit, très littéralement de la capacité humaine à transporter ou transposer des concepts (via des images ?), à opérer donc, si l’on veut, des sortes de médiations. Presque inopinément, nous voici jetés dans les interrogations actuelles sur les limites intrinsèques de l’intelligence artificielle.
Ce thème des médiations entre toute puissance divine m’amène à un autre penseur, Descartes, dont la situation par rapport à l’institution de la science moderne telle que tu la thématiques semble justement particulière. Je n’entrerai pas ici dans une discussion de la toute puissance divine chez Descartes, et me contenterai de poser la question du rapport de sa métaphysique et de ses mathématiques. Il s’agit pour Descartes de donner un fondement métaphysique à la connaissance, mais celui-ci le conduit à rester en quelque sorte en deçà de son mouvement, en particulier du point de vue des mathématiques. On peut évoquer par exemple son refus des courbes transcendantes, et donc de ce qui peut ouvrir à la notion générale de fonction ; en particulier sa volonté théorique de réduire le champ de ce qui est admissible en mathématiques à ce qui est exprimable par les opérations de base (donc à des polynômes), alors même qu’il se montre capable d’incursions hors de ce champ, hors de ses propres principes, dans ses démonstrations. Descartes aurait sans doute pu théoriser l’intégration et sa relation à la dérivation, par exemple, et a sans doute aussi été retenu par des motivations philosophiques, au contraire de Leibniz. Ne faudrait-il pas interroger plus précisément le statut très particulier de la pensée de Descartes en regard de la problématique de la science ?
P.L. : Cette remarque m’offre d’abord l’occasion d’une mise au point nécessaire et presque évidente. Je me suis mis dans le cas difficile, et même aventureux, de devoir m’exprimer sur des sujets que je connais très peu. Il y a là un risque qui, à notre époque très portée sur le scientisme — c’est même là l’un des thèmes de notre entretien — se révèle rapidement fatal. Et pourtant me voici forcé de l’assumer dans une certaine mesure. Je ne crois guère à l’interdisciplinarité, à moins qu’elle ne se loge dans une seule tête, nourrie bien entendu de toutes sortes de lectures et rencontres. En conséquence, confronté à une question plus ou moins classique et faute d’une véritable « expertise » à son propos, on est bien forcé de se fier à une certaine idée qui s’est formée au fil du temps et a du moins le mérite de s’ajointer pour ainsi dire à un ensemble beaucoup plus vaste. Elle est sans doute partielle, biaisée, éventuellement historiquement fausse. Cette idée n’a pour elle que de présenter une certaine cohérence avec un tableau qui lentement émerge, doublée si possible, osons le mot, d’une certaine poésie. Je n’essaierai pas de la défendre, ni elle, ni ses nombreuses sœurs ; là encore cet art, si c’en est un, est tout d’exécution.
Songeant à Descartes, ses mathématiques, sa physique, si objectivement fausse par bien des côtés, je songe avant tout à deux thèmes, deux interrogations : causalité et infini. En un sens Descartes, en mathématiques, répète un geste antique. Autant les Grecs se sont méfiés de l’irrationnel autant Descartes s’est gardé du transcendant. Attention ! Ces deux mots, « irrationnel » et « transcendant », avec toutes leurs connotations, sont pourtant ici à entendre au sens mathématique, technique, d’ailleurs éminemment leibnizien. Nul, sans doute, ne nous a mieux rendu l’effroi des Grecs devant l’irrationnel qu’Imre Toth ; je me réfèrerai à lui globalement, sans m’y attarder. Les irrationnels défient la théorie grecque des proportions. Descartes parvient en un sens à élargir celle-ci de manière à englober les nombres que nous disons algébriques. Toutes sortes de constructions, graphiques et mécaniques, viennent enrichir chez lui celles qui se font « à la règle et au compas ». Les nombres « transcendants » pourtant, à supposer qu’ils existent, résistent. Ils outrepassent une limite, franchissent la clôture d’un monde assurément plus vaste que le monde des mathématiques grecques, mais non pas « outre mesure ». Ce qui précède n’est rien encore. À suivre le fil des mathématiques, nous serions emmenés beaucoup plus loin. Il faudra près de deux siècles pour que Liouville montre, à l’aide d’une preuve simple et raisonnablement explicite, l’existence effective de nombres « transcendants », un adjectif introduit en ce sens par Leibniz, lui-même très conscient de leur existence pour ainsi dire transgressive à la frontière des mondes. Il faudra longtemps encore pour que Galois (et Abel) formule précisément et démontre l’impossibilité de la quadrature du cercle par une construction à la règle et au compas ; encore sera-ce modulo la transcendance du nombre π, dont la démonstration attendra encore quelques dizaines d’années. Et il faudra pas loin de trois siècles pour que l’on puisse calmement énoncer (avec une démonstration pour le coup très simple) que les nombres algébriques sont dénombrables, et que donc presque tous les nombres sont transcendants où ce « presque tous » aura acquis entretemps lui aussi le sens technique que lui donne la théorie de la mesure. De fait, on pourrait continuer longtemps, très longtemps, presque ad libitum. Une certaine idée de l’infini donc, et ce qui nous garde de ses orages. Une certaine idée de la causalité aussi, qui ne va pas sans une ontologie de la positivité, une idée de la perfection chrétienne qui autorise une preuve de l’existence de Dieu, laquelle certes peut rassurer dans la Troisième Méditation, mais que Pascal juge fameusement inutile et qu’un petit opuscule de Kant, pour introduire en philosophie les grandeurs négatives, mettra à bas un siècle plus tard, presque sans y toucher, comme on allume une mèche en catimini. Oui, tout cela part dans tous les sens et se tient pourtant dans une pelote très serrée, depuis le refus cartésien des fonctions transcendantes jusqu’à la preuve anselmienne de l’existence de Dieu en passant par les animaux machines. Il était une fois, Descartes…
Précisément, arrêtons-nous sur cette question de la causalité. Car un certain nombre de choses se jouent avec elle. D’une part, le primat métaphysique, sensible chez Descartes, de la cause efficiente. Mais d’autre part, tout aussi bien, une remise en question de la lecture métaphysique de la causalité, au regard de son interprétation transcendantale ou structurelle plus tard. Selon Russel, la disparition de la terminologie causale au profit de celle de la dépendance fonctionnelle marque l’entrée d’un domaine scientifique dans sa maturité. Avec la question de la causalité, se joue bien quelque chose du rapport de la physique aux mathématiques – mais aussi de ce qui dans le physique excède ou permet, légitime la mathématisation.
P.L. : Oublions Rusell, c’est toujours un premier pas salutaire. Il y a trop à dire sur cette « icône » ; je l’ai fait, en partie, ailleurs (dans Mathématique et fintitude). René Thom avançait que la causalité était très liée au principe de prolongement analytique. C’est là du moins une jolie idée. La causalité est liée à toutes sortes de choses, aux idées qui sont dans l’entendement en la manière qu’elles ont coutume d’y être, à la notion chrétienne de « perfection » (cf. les Réponses aux Objections aux Méditations), à une certaine forme d’ontologie, etc., etc. Quant au passage du causal au fonctionnel et pourquoi pas au fonctoriel, oui, bien entendu, et là encore il y a énormément à dire. Un jalon récent parmi bien d’autres (voir Mathématique et fintitude pour beaucoup plus de détail) : ce que Felix Klein jugeait nécessaire, vers 1910, d’enseigner aux écoliers allemands. Attention, danger ! Lui est décédé en 1925, la suite est devenue beaucoup plus … problématique.
Je me permets de reposer la question autrement – car il ne s’agit pas seulement dans le tournant qu’on évoque d’une représentation par les mathématique, d’une modélisation, mais d’une recherche de ce qui constitue le propre du physique. Or tu lies la révolution galiléenne au calcul infinitésimal, en rappelant que Galilée a beaucoup réfléchi à la question des infinitésimaux, que qui présupposerait que l’essentiel de la révolution galiléenne soit, sinon à proprement parler dans l’innovation mathématique, du moins dans le statut qui leur est conféré. Ce que personne certes ne niera. Mais n’y-a-t-il pas aussi l’ouverture très concrète d’une autre compréhension du physique ? Je ne parle pas seulement d’une autre métaphysique, mais plus effectivement, de la capacité à déterminer le concept physique pertinent, celui qui a vraiment un sens physique, qui se prête à la mathématisation, par exemple, dans le cas de Galilée, celui de vitesse instantanée, dont la variation ouvre à la compréhension de l’accélération ?
P.L. : Galilée était un ami de Cavalieri et le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus en viendra à interdire l’enseignement de la version du calcul infinitésimal développée par Cavalieri dans les collèges jésuites au motif qu’elle s’opposerait au mystère de la transsubstantiation. C’est dire les enjeux extrascientifiques que recèle le calcul infinitésimal. Mais bien entendu l’œuvre de Galilée ne se limite nullement à la considération de ce calcul auquel il a d’ailleurs sans doute moins apporté que Pascal, Fermat ou … Cavalieri. Nous avons déjà évoqué brièvement cette idée d’un monde « idéal », sans frottement, très éloigné du monde d’Aristote observant les pêcheurs du Pirée qui hâlent leurs barques sur les galets, un monde plus proche assurément de celui d’Archimède, peut-être aussi de ce monde de l’Asie Centrale, plus d’un millénaire après Archimède, un demi-millénaire avant Galilée et qui avait depuis longtemps disparu jusque de la mémoire des Florentins, ou mieux n’y était jamais entré.
« Le livre de la nature est écrit dans la langue des mathématiques » ; certes. Galilée a-t-il vraiment laissé tomber quelque objet que ce soit du haut de la tour de Pise ? On en discute encore. Tout cela a été scruté, a fait l’objet d’innombrables articles savants, thèses, livres, etc. qui ont bien entendu leur raison d’être et dont les conclusions sont depuis longtemps avérées. On a tout dit ou presque, scruté sous tous les angles ces conditions au fond assez obvies du développement de la science moderne : idée d’une nature stable et indépendante de nos observations (la mécanique quantique est encore bien loin), abrogation du supralunaire, nécessité de l’expérience, mathématisation, etc. Tout cela est vrai, et bien d’autres choses encore. Il est par contre, c’est vrai aussi, difficile d’exprimer clairement ce qui pourrait cependant faire défaut à cette impressionnante et, je le répète, nécessaire, panoplie érudite. Pourtant il me semble qu’il y a bel et bien plus ou plutôt autre chose, qui dépasse bien entendu la personne de Galilée, aussi génial celui-ci ait été, et se situe pour ainsi dire « en amont ». Mais si l’on entreprend de traverser l’océan qui sépare l’histoire et la philosophie des sciences d’autres continents, qu’il soit question de théologie, de psychanalyse ou de littérature, nous n’avons d’autre choix que d’embarquer sur un très frêle esquif et de commencer à ramer.
En deçà, se cache une interrogation plus redoutable, concernant le terme science lui-même. J’ai déjà posé la question tout à l’heure, et je suis désolé d’y revenir à nouveau, mais pourquoi lier si fortement le nom de science à sa « version » (si j’ose m’exprimer ainsi) galiléenne ? En quoi celle-ci représente-t-elle une telle révolution ? Et pourquoi, inversement, ne pas voir en celle-ci simplement l’accession à la possibilité de formaliser un nouveau concept physique ? Pourquoi refuser à l’ensemble de la physique et de l’astronomie antiques le nom de science ? Et ne risque-t-on pas, donnant un tel poids au paradigme le modèle galiléen, de refuser aussi d’appeler science tout ce qui ne peut pas s’appuyer sur des éléments suffisamment simples pour être mathématisés, axiomatisés ? De refuser que la biologie soit une science ?
P.L. : J’espère avoir d’une certaine façon déjà répondu. Ce n’est pas au fond le nom de « science » qui importe. Ici un petit rappel étymologique que j’ai d’ailleurs eu l’occasion de développer beaucoup plus amplement ailleurs, sera peut-être de saison. La « science », scientia, a immédiatement à voir avec l’idée de découper, trancher (jusqu’à la racine indo-européenne ∗skei) : le peuple tranche par un plébiscite, les partis, politiques ou non, connaissent de nombreuses scissions, etc. La science découpe le monde et il n’est pas étonnant qu’ainsi elle se fassent haïr ou mépriser de beaucoup, en ce qu’alors elle participe indubitablement à son désenchantement, Entzauberung. Mieux vaut une flûte enchantée qu’un monde désenchanté. Sans parler de ce que la science s’oppose ainsi, en la menaçant, à la fragilité de la Lebenswelt ; c’est la Krisis de Husserl, c’est aussi l’écologie d’aujourd’hui et ses angoisses, en partie sûrement justifiées. Curieusement, Wissenschaft, c’est tout autre chose, littéralement la production d’un savoir, Wissen schaffen. Rien à voir avec le mot de « science » , malgré les traductions courantes. En hébreu, en russe, se racontent encore d’autres histoires. C’est en ce sens que le mot de « science » ne veut au fond rien dire ou du moins est extrêmement ambigu. Alors bien entendu la science antique c’est de la science, la science arabo-perse c’est aussi de la science, la biologie est une science, etc. Et quand on a dit ça, on n’a encore rien dit du tout, même si aujourd’hui, à l’université, le mot et l’adjectif afférent, scientifique, sont devenus une sorte de brevet obligé de bonne conduite. Ce qui là encore, là surtout, ne veut rien dire du tout !
Tu parles de Husserl… Ce qui me permet de faire un pas de côté, concernant la manière des philosophies de considérer la mathématisation de la physique et la nature de la théorie physique. A ce qu’il semble, et tu le note toi-même, à ce sujet, Kant reste vraiment un point d’ancrage inaltérable de l’ “esprit scientifique”, auquel se rattachent encore à leur façon les principaux acteurs de la physique du début du XX siècle. Kant, écris-tu, « justifie si l’on veut les succès de la physique, d’abord newtonienne, et on peut imaginer de lui faire traverser (avec Cassirer) la relativité, voire (plus difficilement) la mécanique quantique. » De fait, les interprétations kantiennes de la théorie scientifique sont encore prégnantes. Michel Bitbol voit par exemple dans la naissance de la physique moderne chez Galilée puis l’axiomatisation de ses principes chez Newton un mouvement de désabsolutisation progressif de ses concepts, en particulier du mouvement, une extension des propriétés relatives au détriment des propriétés absolues, un devenir de plus en plus relationnel de la physique, dont la philosophie transcendantale de Kant donnerait la plus juste lecture. Une conception que partage Jean Petitot, à cela près qu’il entend pour sa part transformer la conception kantienne du schématisme, en invoquante une schématisation mathématique des concepts de cause, de substance, etc. Pour lui, celle-ci est elle-même ancrée dans un mouvement conduisant à délaisser les entités pour fonder la théorie sur la recherche de principes (conservation, forces, interactions), qui eux-mêmes finiront par prendre la forme d’une recherche de symétries. Que penses-tu de ce fond kantien ? Comment l’interprétes-tu ? Pourquoi est-il si séduisant pour les physiciens ? Pourquoi est-il malgré tout important selon toi de ne pas s’y limiter ?
P.L. : Ce que tu viens d’évoquer n’est évidemment pas faux mais me semble trop interne à la physique, néglige tout à fait le versant théologique et pour une part concerne des périodes nettement postérieures (en particulier pour ce qu’il en est de la mise en avant des symétries). Il y a aussi une réflexion sur la causalité, le concept de force, les interactions à distance (ou non), etc. Surtout le récit à faire est pour moi beaucoup plus « large » et moins interne. C’est aussi pourquoi nous aurions besoin d’authentiques successeurs de Koyré, dont on n’oubliera pas qu’il vient « d’ailleurs » (en fait de la zone de résidence instituée par la Grande Catherine pour les Juifs de l’Empire Russe). Il me semble que, pour une part, les choses sont plus claires si on les regarde « d’ailleurs », d’un extérieur cependant lui-même très spécifique. J’ajouterai qu’avoir pratiqué longtemps la recherche (et même la « trouvaille ») dans ces domaines n’est pas non plus innocent, cela devrait aller sans dire. Ceci n’empêche pas que les historiens sont ici très nécessaires, à condition qu’ils soient aussi mathématiciens, physiciens, philosophes, théologiens, historiens de l’art, écrivains, ingénieurs et j’en passe. J’ai dit déjà et répète que je ne crois pas cependant à l’interdisciplinarité sauf lorsqu’elle se rassemble dans une seule tête. Pour prendre un exemple, dans le cas présent il est important de mesurer l’écart entre les carnets tardifs de Léonard et les dialogues de Galilée, au même endroit, des décennies plus tard. Mais une comparaison authentique et fructueuse exige à peu près toutes les compétences que j’ai implicitement énumérées plus haut. Un siècle se passe, le platonisme florentin n’invente pas la science à proprement parler ; pourquoi ? Vinci est fasciné par ce qui est technique mais malgré tout ses carnets sont ceux d’un ingénieur (génial et génial dessinateur, il va sans dire), pas de quelqu’un qui « a soulevé un coin du grand voile » pour reprendre la fameuse appréciation d’Einstein sur la thèse de Louis de Broglie, laquelle a évidemment fait davantage plaisir à ce dernier que tous les autres compliments pris ensemble, y compris le prix Nobel, d’ailleurs apprécié par sa famille dans l’unique mesure où il était décerné dans une monarchie.
Mais, pour y revenir, il faudrait aussi parler d’al-Biruni, des controverses en Asie Centrale sur la chôra aristotélicienne à l’aube de l’an mil de notre ère, etc. Kant est très prégnant et le reste par delà les incertitudes quantiques. Il suffit de lire Bohr et Heisenberg pour s’en assurer. Pourquoi ? Là aussi il y a mille raisons, enracinées très profondément dans le temps long de l’histoire. En particulier Kant recueille en héritage et formalise une très longue tradition qui constitue une doctrine des facultés beaucoup plus spécifique qu’il peut y paraître. La subordination du théorique au pratique par exemple de l’entendement à la volonté, se trouve chez Saint Augustin et avant. La distinction des idées, au sens kantien, pour ainsi dire « asymptotique » du terme, et du phénomène, autrement dit une certaine prise en compte de l’infini, se retrouve … partout, et pas seulement chez Descartes et Leibniz. Etc. Je ne suis pas en train d’interroger le schématisme, notoirement caché au plus profond de l’âme humaine, ou disons que les questions qui m’intéressent sont plus larges et enracinées dans une histoire au plus long cours, comme dans des doctrines scientifiques beaucoup plus spécifiques et éventuellement, elles, beaucoup plus avancées et récentes.
J’aurais pour terminer cette première séquence, une dernière question, peut-être plus spéculative. Au vu de ce qu’on vient d’évoquer, peut-on selon toi envisager plusieurs sciences différentes ? D’autres expressions de la science ?
P.L. : Je ne sais pas si cette question est « plus spéculative ». Toujours est-il que, vu ce qui précède, je répondrais à l’évidence positivement. Il existe d’autres doctrines des facultés (la kabbale par exemple, avec l’édifice complexe des sefirot, en offre une à n’en pas douter), il existe d’autres façons de « découper » le monde. Sont-elles aussi « efficaces » que celle que nous connaissons ? On peut en douter. Je l’ai dit déjà, brutalement : la science, combien de divisions ? Car, qu’on le veuille ou non, la science moderne telle que nous la connaissons est mère de la technique et de la technologie, et elle est aussi, à long terme, la mère de toutes les batailles. Ce qui a, comme chacun d’entre nous a pu le constater, bouleversé le monde — de fond en comble.
III. LES SCIENCES HUMAINES
Ceci nous amène à notre seconde séquence, concernant la question des sciences humaines. l faut peut-être commencer par dire à ce sujet que le terme même de sciences humaines a quelque chose de paradoxal — il constitue une infraction à la distinction dressée jadis par Dilthey des sciences naturelles, dont le mode est l’explication, et des sciences de l’esprit, dont le mode est le comprendre. C’est que les sciences de l’esprit de Dilthey, dans la grande tradition germanique, prennent pour paradigme l’histoire, alors que les sciences humaines, dans la tradition française, s’appuient d’avantage sur des disciplines nouvelles, comme la sociologie, ou les disciplines renouvelées, comme la linguistique. Dans le cadre de la sociologie, on fait généralement remonter à l’œuvre de Durkheim la volonté d’en spécifier la scientificité propre — distincte de celle des sciences naturelles, mais aussi de la vocation des humanités classiques. Pour Durkheim, l’ambition était sans doute plus vaste : il s’agissait de construire une science globale des sociétés et de l’existence sociale, ontologique. Pendant tout le vingtième siècle, les sciences humaines ont oscillé entre ce projet total et celui, plus modeste en apparence, de constituer une troisième voie, une troisième culture. Le projet structuraliste exprime cette ambition qui est, selon J.-C.Milner, d’ « étendre le galiléisme au domaine de la lettre » . J’aurais ici plusieurs questions. D’abord, le fait que ce projet a, dis-tu, échoué. En quel sens ? Les sciences sociales sont-elles vraiment incapables de produire de la cumulativité scientifique et d’énoncer des lois générales du fonctionnement des sociétés ? La question est régulièrement reposée — encore récemment par Bernard Lahire[1]. Mais chaque fois qu’un auteur tente de poser des principes et des méthodes, celles-ci sont contestées, de sorte qu’on a l’impression d’en rester, d’un côté, à une infinie propédeutique, et de l’autre, à une accumulation de résultats vaguement expérimentaux, justifiés par une épistémologie relativiste et nominaliste.
P.L. : Déjà l’expression de « sciences sociales » n’est pas seulement paradoxale, elle est malvenue sinon incompréhensible et controuvée, comme Lacan le notait il y a bien longtemps, et pour bien des raisons. Elle ne traduit nullement, on l’a entrevu plus haut, les Geisteswissenschaften allemandes, tout de même plus recevables, dans lesquelles d’ailleurs une certaine oreille germanique s’empêche difficilement de percevoir des échos lointains de l’Esprit Saint, der Heilige Geist. Ensuite je serai assez rapide, moins ample peut-être que l’énoncé de ta question qui résume fort bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, ces projets étaient naturels en leur temps, ils étaient même pour certains admirables. Et ils ont échoué. Il était naturel, en 1850, de s’enthousiasmer pour l’idée communiste ; il est très difficile de le faire aujourd’hui, sauf à vivre, comme Alain Badiou, à l’envers de ses convictions proclamées. Il était possible en 1970, peut-être souhaitable encore que cela soit contestable, de s’interroger sur la capacité de la théorie des cordes à obtenir des résultats physiques. Un demi-siècle plus tard le doute n’est plus permis : un peu comme l’une de ses grandes devancières en matière de microphysique, la théorie victorienne des nœuds, la théorie des cordes nous laissera quelques belles mathématiques. Mais du point de vue de la physique particules et des hautes énergies, elle a tout simplement échoué. Le plus urgent, aujourd’hui, c’est sans doute pour nous de faire enfin le deuil de bien des projets ou rêves grandioses, légitimes sinon parfois nécessaires en leurs temps, et qui ont tout simplement échoué. On ne peut plus écrire aujourd’hui un livre comme celui de W.Lepenies, Die drei Kulturen, Les trois cultures, qui date du milieu des années quatre-vingt. La sociologie telle qu’elle avait été rêvée depuis deux siècles, d’abord par le protestantisme allemand et quelqu’un comme Schleiermacher, le faiseur de voiles, cette idée de la sociologie, ou si l’on préfère ce projet d’une science globale de la société ne s’est pas, si je puis dire, matérialisé. Je cite souvent la formule de J.-C.Milner, qu’il avance dans un livre excellent, Le parcours structural, comme toujours chez lui extrêmement perspicace encore qu’il ne va naturellement pas jusqu’à désavouer ce qui fut sa jeunesse. Mais qui désavouerait sa jeunesse ? Personne, jamais, n’y est tenu. (Là encore j’ai largement développé ces quelques remarques ailleurs, dans Mathématiques et finitude ainsi que dans un livre en préparation.)
Il y aurait évidement beaucoup à dire sur ce que libèrerait l’assomption de cet échec – ce avec quoi nous pourrions renouer, et qui n’est d’ailleurs selon toi pas sans lien avec la science au sens réel cette fois, un certain rapport à la rhétorique, à l’imaginaire, au « tact des impondérables » des disciples d’Isocrate. Je m’en tiendrai à un point seulement : le lien que tu fais entre cet « échec » des sciences humaines et le primat du langage, de la lettre, que tu ramènes ultimement au tournant linguistique. Ta réflexion générale sur le scientisme, la façon dont celui-ci a totalement pénétré les sciences humaines, s’appuie sur une certaine généalogie. Tu vois dans de multiples tentatives – et selon toi dérives actuelles – un héritage du tournant langagier, en particulier des travaux du Cercle de Vienne, pour lequel tu n’as pas de mots assez durs, à travers divers avatars. Il est clair que le structuralisme (c’était déjà au centre de la critique d’auteurs comme Deleuze) et d’une façon plus vaste, les sciences cognitives ont en commun, sinon un paradigme, du moins un primat du langage. Mais peut-on pour autant dire que le structuralisme (dont, soit dit au passage, tu estimes la tentative) est l’héritier du Cercle de Vienne ? Et que le cognitivisme contemporain est lui-même l’héritier du structuralisme ?
P.L. : Là encore je serai trop bref et renverrai à M&F pour de beaucoup plus amples développements, pourtant encore insuffisants. Que le structuralisme se situe, à un demi-siècle de distance, au sein du même courant intellectuel que le Cercle de Vienne, à savoir participe du « tournant langagier » (linguistic turn), c’est presque une évidence sur laquelle je ne m’étendrai pas ici. Je n’emploierais d’ailleurs pas à ce propos le terme d’ « héritier », pas plus qu’entre cognitivisme et structuralisme. Quant au premier, je dirais d’abord qu’il convient de soigneusement distinguer le cognitivisme et ce que nous appelons les neurosciences, lesquelles prolongent et poursuivent le projet on ne peut plus « galiléen » auquel on associe souvent — non sans raison — le nom de Helmoltz. Il n’y a pas grand-chose à ajouter de côté-là (du point de vue qui nous retient aujourd’hui, il va sans dire !), sinon que prendre par exemple le cerveau comme objet d’étude est naturellement en soi parfaitement légitime. L’idéologie, si j’ose ce mot, se situe ailleurs. Quant au « cognitivisme » on peut d’ores et déjà affirmer qu’il a échoué en un sens, ou plutôt qu’il n’a même jamais décollé, pas plus que tous les projets d’explications globales du monde qui fleurissaient dans les années soixante, avec une « théorie générale des systèmes » (qui n’a jamais existé) ou des comptes rendus peu informés de la « cybernétique » (qui s’est très vite tarie), voire même de la « théorie de l’information », laquelle n’a guère dépassé les interrogations — tentantes assurément — à propos de possibles — et fécondes ? — analogies avec la physique statistique boltzmanienne. Mais par ailleurs le structuralisme s’est construit ou donné, en particulier sous l’impulsion de Claude Lévi-Strauss (qui fut un grand esprit par ailleurs, ce n’est pas notre propos) un corpus scientifique proprement fantasmatique dans lequel la « lettre » fut véritablement érigée en icône, en particulier depuis la découverte, qui recouvre en vérité une histoire très longue et complexe, de l’ADN et sa double hélice (1953). J’ajouterai que 1953 c’est aussi l’année de la mort de Staline et qu’en fait de l’autre côté de ce qui, en 1961, s’est matérialisé comme le « rideau de fer », se développaient toutes sortes de spéculations, paradoxalement moins « idélogiques » et peut-être plus « scientifiques », ou tout simplement plus intéressantes, qu’en occident. Je songe ici entre autres à un géant des mathématiques et bien au-delà, A.N. Kolmogorov. Et le cognitivisme dans tout cela, en tant qu’une énième proposition de compréhension du monde ? Disons qu’il est mort si ce n’est mort-né, et que sans doute il est apparu à son heure, tout au moins le mot, comme une tentative assez désespérée de sauver le soldat « structuralisme » alors déjà en perdition, plutôt que comme son héritier.
Nous évoquions plus haut les liens entre l’institution de la science moderne et un horizon symbolique et théologique marqué par la recherche de médiations entre Dieu et le monde. Nous évoquions aussi en filigrane les liens de la crise du mot science et de la dissolution des médiations. Ceux-ci ne sont-ils pas flagrants dans la disparition progressive de la théorie, dans la façon dont l’activité dite scientifique se noie dans la modélisation et la statistique ? Tu parles à ce sujet d’un nouveau brouillage du partage de la quantité et de la qualité. Mais il s’agit aussi, dis-tu, d’une sorte de retour à une situation (semblable à celle qui a prévalu de l’Antiquité à la révolution galiléenne) dans laquelle la technologie outrepasse la science, dans laquelle il est possible de faire des choses, de calculer des choses, sans disposer de base conceptuelle organisant cette activité et lui garantissant un référent, un engagement ontologique. Les « big data » ou le « deep learning » n’utilisent en gros, conceptuellement, qu’une petite partie des mathématiques du dix-neuvième siècle, mais ils ont une très grande capacité opératoire, de modélisation, alors que la théorie scientifique, de son côté, mobilise des outils très sophistiqués, mais se retrouve plutôt à l’arrêt (on y reviendra).
P.L. : Absolument. Je ne me renierai pas sur ces points ! Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, répète-t-on depuis Rabelais ou presque. Mais qu’est-ce qu’une science sans concept ? Et peut-on à bon droit réactiver la dialectique hégelienne la mieux popularisée par le marxisme, jadis la plus chère à des partis communistes autrement puissants qu’aujourd’hui, celle du passage de la quantité à la qualité ? Je n’en dirai pas davantage ici, renvoyant à une première ébauche d’un livre, que l’on trouvera au bas de ma page personnelle (La science dans la confusion des temps).
IV. LA PHYSIQUE
Peut-être pourrions nous nous arrêter sur ce blocage de la physique théorique, que nous venons d’évoquer. La physique théorique est un champ que tu connais bien. Tu la connais à la fois activement puisque tu as travaillé entre autres sur des questions liées à la mécanique quantique et aux équations aux dérivées partielles, et par ton histoire familiale, ton père, Georges Lochak, ayant été si je ne me trompe le plus proche collaborateur de Louis de Broglie et, par là, tu as été aux premières loges des controverses autour de la mécanique quantique, en particulier du débat qui a opposé d’une part Einstein, de Broglie et Schrödinger, d’autre part ce qu’on a appelé l’ « école de Copenhague » dont en premier lieu Heisenberg et Bohr. Peux-tu d’abord dire quelques mots sur les difficultés actuelles de la physique théorique ?
P.L. : Il est vrai que j’ai tendance à constater une certaine stagnation, ou un blocage, voire en un sens une régression, dans les domaines de la « microphysique » et de la physique des hautes énergies. Cependant je dois commencer par ce que les anglo-saxons appellent un « disclaimer ». Tout d’abord et pour des raisons chronologiques évidentes ni moi, ni même mon père, n’avons assisté aux discussions qui ont commencé dans les années trente entre les physiciens que tu mentionnes. J’ai connu enfant un certain nombre d’acteurs des années soixante et soixante-dix (J.Bell, B.d’Espagnat, D.Bohm, J.-M. Lévy-Leblond, A.Aspect, J.-P. Vigier, A.Shimony, V.Rapisarda… et quelques autres). Ensuite, je ne me considère pas comme « physicien » à proprement parler (sommes-nous d’ailleurs quoi que ce soit « à proprement parler » ? Je ne le crois pas, en ce qui me concerne du moins). D’autre part, étant donné les découvertes extraordinaires qui ont eu lieu en physique entre — grosso modo — 1900 et 1970, il est très naturel que cette science marque le pas ou se heurte à des difficultés qui paraissent pratiquement insurmontables à l’heure actuelle. Ce fut par exemple le cas après les non moins extraordinaires progrès liés à la physique newtonienne, qu’il a fallu des dizaines d’années sinon un bon siècle pour « digérer ». C’est d’ailleurs là l’origine lointaine de la citation de Lord Rayleigh qui à la fin du dix-neuvième siècle ne voyait plus que deux petits nuages noirs dans le ciel tout bleu de la physique, deux petits nuages qui allaient éclater pour donner respectivement la relativité et les quanta. Notre époque déteste le « progrès », et pourtant elle n’admet pas qu’une science, la physique en l’occurrence, stagne tout simplement, ce qui est pourtant en un sens dans l’ordre des choses.
Peux-tu préciser ?
P.L. : Le fait est que j’ai du mal à voir des avancées vraiment conceptuelles et conséquentes depuis au moins un demi-siècle. Rappelons-nous que c’est par exemple dans les années trente, à propos de l’isospin, que Heisenberg introduit l’idée des groupes de jauges non abéliens, qui ont d’ailleurs énormément frappé quelqu’un comme Gilles Châtelet, des décennies plus tard. L’équation la plus achevée de la mécanique quantique reste sans doute l’équation de Dirac, écrite en 1928, il y a près d’un siècle, et seulement cinq ans après que la thèse de de Broglie avait introduit le dualisme onde-particule, au fond toujours aussi mystérieux. Il semble justifié d’avancer que depuis bien des années, les prix Nobel de physique dite théorique récompensent en réalité la réalisation d’expériences dont le principe était connu depuis longtemps, les résultats attendus, mais qu’il fallait réaliser ou que parfois nul n’avais songé à regarder autrement que des expériences de pensée. En somme le prix Nobel de physique est depuis longtemps devenu un prix de technologie, ce qui d’ailleurs n’aurait pas nécessairement déplu à Albert Nobel, pourvu que cette technologie soit ensuite mise au service du « bien de l’humanité ». Mais c’est une autre histoire. Je me souviens que dans les années soixante-dix l’heure était à la mise au point d’une source stable et fiable de photons corrélés, qui représente le pas clef nécessaire à la réalisation effective de la fameuse expérience de pensée d’Einstein Podolsyki & Rosen (EPR, 1935), visant à tester la non localité de la mécanique quantique. La « compétition » entre si l’on veut, la France — ou son midi — représentée par A.Aspect et l’Italie ou mieux la Sicile, illustrée par V.Rapisarda à Catane, fut abruptement conclue par la mort de Vittorio Rapisarda dans un accident de la route, en 1982. On connaît aussi les inégalités de J. Bell et une version un peu différente due à J. Clauser et A. Shimony. V. Rapisarda, J. Clauser et A. Shimony sont décédés, le premier très prématurément et tragiquement ; on sait qu’Alain Aspect et John Clauser ont reçu l’an passé le prix Nobel de physique. Je me garderai d’oublier la figure attachante de John Bell, décédé depuis longtemps, à un âge relativement tendre pour notre époque (soixante-deux ans). Mais au fond, que montrent ces expériences, sur l’existence possible de « variables cachées » ? Et d’abord il faut souligner que tous les concepts en jeu existaient dans les années 30. Ce sont les avancées technologiques qui sont impressionnantes, et non les concepts théoriques, qui auront bientôt un siècle.
Je m’arrête un moment ici encore. Tu veux dire que, contrairement à ce qu’on entend souvent, la discussion sur la non localité n’est pas tranchée expérimentalement.
P.L. : En fait la situation est moins claire, et infiniment moins originale que ce qu’on entend partout ou presque (« le quantique » est à la mode…). En quelques mots très insuffisants, je voudrais d’abord citer Einstein et une femme très remarquable, Grete Hermann qui, dès la fin des années trente, à propos de ce que les physiciens appellent le « théorème de von Neumann » (mais que les mathématiciens ne baptiseraient sans doute pas « théorème ») avaient introduit les remarques simples qui reviendront plus tard dans la décennie, puis dans les années soixante, et à nouveau aujourd’hui (éternel retour du même, ou quasiment). Dans les années soixante la discussion rebondit du fait de l’apparition des « inégalités de Bell », au demeurant tout à fait élémentaires mathématiquement. Pour ma part j’ai toujours entendu dire que si les expériences EPR étaient un jour réalisées (et elles l’ont été par Aspect dans les années 80), les inégalités de Bell seraient évidemment « violées » — ce fut le cas et ce ne fut absolument pas une surprise. Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’il ne peut pas exister de variables cachées en un sens très fort, autrement dit qu’il n’existe pas de monde complètement déterministe pour ainsi dire sous-jacent au monde quantique que nous connaissons, ou si l’on veut « caché » en dessous. (Je renvoie à l’excellent article Wikipedia consacré à John Bell pour un résumé de cet apparemment inépuisable débat, toujours vivace aujourd’hui, quoique avec très peu sinon aucun progrès réel.) Mais cela, personne ou presque n’en doutait ! Surtout pas Bell, qui n’attachait pas à ses inégalités la signification cruciale qu’à tort on leur confère. Celles-ci n’interdisent pas en effet l’existence de variables cachées en un sens plus faible, que je ne détaille pas ici, et c’est ce dont Bell lui-même avait bien conscience, s’étant d’ailleurs un jour quelque peu excusé de n’avoir cité ni Einstein ni Grete Hermann dont il avait retrouvé certaines remarques sans en avoir eu connaissance. En somme, il y a là un exploit technologique, vieux déjà de quatre décennies, à savoir la mise au point d’une source de photons corrélés, très stable et à très basse énergie, mais pas vraiment d’avancée conceptuelle depuis ce qui se disait il y a plus de cinquante ans, sinon quatre-vingt ou davantage.
Si l’on se place d’un point de vue purement mathématique, les mystères premiers de la mécanique quantique sont assez simplement formalisables. Ce qui est rarement admis aujourd’hui c’est que ce sont effectivement des mystères qui tiennent au rapport à la physique proprement dite. Prenons l’exemple de la non localité. On peut écrire l’équation de Schrödinger pour un système de particules, mettons simplement deux particules. Tout tient au fait que l’équation peut s’écrire dans l’espace des configurations de ces deux particules (un espace à 2×3 = 6 dimensions) ou dans leur espace des phases (2×6 = 12 dimensions) ; la différence n’est pas cruciale. Ce qui importe c’est bien que l’on passe dans l’espace « mathématique » qui décrit le système des deux particules. Mathématiquement, d’un point de vue moderne, on n’a pas fait grand-chose. Expérimentalement, la nature confirme que c’est raisonnable. Eh bien, ça y est, on a déjà abouti à une théorie qui n’est pas locale dans notre espace (à 3 dimensions). Et bien entendu on n’a rien expliqué, physiquement parlant. Par contre on ne peut pas écrire d’équation de Dirac pour un système de particules, ne serait-ce que parce que la notion de centre de masse n’existe pas en relativité. Et donc, tout à coup, la relativité, qui était pourtant, il faut s’en souvenir, à la base de la découverte de la « mécanique ondulatoire » (de Broglie, 1923), la relativité (plus le spin) refuse de « coopérer ». Et on préfère la laisser alors de côté. Prenons encore l’exemple des relations d’incertitude, écrites en 1927 par le jeune Heisenberg et qui ont fait couler énormément d’encre. Mathématiquement parlant, c’est une inégalité sur la transformation de Fourier qui aurait pu être écrite un siècle plus tôt et l’a peut-être été. Ces relations disent en gros que pour qu’une fonction dans l’espace ordinaire soit très « piquée », très localisée, il faut superposer beaucoup d’harmoniques (ou d’ondes planes, pour parler le langage de la physique). La caricature, c’est la distribution de Dirac, dont la transformée de Fourier superpose des ondes qui ont toutes même intensité. Ce qui compte à nouveau, c’est que le mystère tient à la physique. Que signifie vraiment la dualité onde-particule ? Einstein disait sur ses vieux jours qu’après cinquante années de réflexion sur le pourquoi de la quantification des interactions de la matières et du rayonnement (i.e. l’idée initiale de Planck, en 1900, à la base de la quantification et donc de la mécanique du même nom), il n’était toujours pas vraiment plus avancé. Je dirais que nous ne le sommes pas sérieusement davantage. Les relations d’incertitude y renvoient et dès les années trente, les discussions sur ce thème étaient probablement plus riches physiquement qu’elles ne le sont aujourd’hui. Prenons enfin l’équation de Dirac. Elle est écrite par Dirac six ou sept ans après que de Broglie a introduit la « dualité onde-particules » à partir de considérations éminemment relativistes. On a d’abord écrit l’équation non relativiste (Schrödinger), puis on ajoute le spin sans la relativité (Pauli), puis la relativité sans le spin (Klein-Gordon), puis enfin le spin et la relativité (Dirac), tout cela en quelques années à peine (six exactement !), après quoi le positron (l’antiparticule de l’électron) apparaît … miraculeusement et mystérieusement. Da capo historico-mathématique : Hamilton invente les quaternions, au milieu du dix-neuvième siècle, et y attache d’ailleurs une importance peut-être exagérée. En 1869 Maxwell songe à prendre la racine carrée du Laplacien et écrit, dans une note à la Royal Society, l’équation de Dirac libre, quarante ans avant Dirac, dix ans avant l’idée de quantification de Planck, plus de trente ans avant la découverte du dualisme onde-particule par de Broglie. Hamilton était irlandais, Maxwell écossais, Dirac anglais (en partie d’origine française). Dirac connaissait-il les travaux de Hamilton (plus précisément les quaternions) et la note de Maxwell ? Peut-être. Toujours est-il que le mystère de l’équation de Dirac, à nouveau, est d’abord et avant tout de l’ordre de la physique. Pour résumer, mathématiquement, on comprend à peu près (et en fait on comprenait souvent bien avant), par contre physiquement tout cela reste très obscur, aujourd’hui comme il y a trente, cinquante ou même quatre-vingt ans. Et les discussions d’aujourd’hui sont très souvent moins intéressantes et moins nourries qu’il y a des décennies.
Moins intéressantes…. En quoi ?
P.L. : Sociologiquement, l’interprétation de Copenhague a « gagné », elle est devenue « orthodoxe », et la mécanique quantique a une extraordinaire efficacité prédictive. Ce qui est remarquable dans les expériences, depuis une bonne trentaine d’années ou plus, c’est qu’on a transformé des Gedankenexperimenten, des « expériences de pensée », en véritables expériences. On sait faire ou « cuisiner » des atomes froids, des photons lents, des condensats de Bose-Einstein, des expériences EPR, tout cela qui a été conceptualisé, réfléchi, calculé, pensé, il y a très longtemps, mais que seule la technologie moderne permet de réaliser. Et ce qui est aussi extraordinaire, c’est qu’à chaque fois on trouve en fait ce qui était attendu, parfois depuis près d’un siècle. La mécanique quantique fonctionne, elle résiste, elle n’a jamais été prise en défaut. Pourquoi ? That is the question.
Pour résumer, l’efficacité prédictive de la mécanique quantique a conduit à négliger la réflexion sur les problèmes physiques qu’elle véhicule, à l’élaborer comme une véritable théorie physique ?
P.L. : Au fond, de Broglie, Schrödinger, Einstein et quelques autres avançaient des assertions et des questions très simples. Exemple : l’onde de de Broglie existe puisqu’elle se diffracte et qu’on construit par exemple des microscopes électroniques (Davisson et Germer ont reçu pour cela le prix Nobel en 1927). Ce ne peut donc être « seulement » une onde de probabilité.
Autre interrogation évidente : Comment la microphysique pourrait-elle être entièrement linéaire de bout en bout, comme l’est la mécanique quantique ? Question non seulement raisonnable mais quasiment évidente en ce qu’elle vient immédiatement à l’esprit. Ergo, comment croire que la mécanique quantique est une théorie « complète », i.e. décrit « complètement » un certain pan de nature, quand au surplus aucune théorie physique n’a jamais été complète ni ne s’est jamais prétendue telle ? Etc. Or si la théorie est physiquement incomplète, il n’est guère raisonnable de bâtir dessus des monceaux de philosophie ou de « métaphysique » quelle qu’elle soit. Il y a tout simplement des manques, des morceaux que nous ne comprenons pas physiquement. Je m’arrêterais ici, mais il est clair que nous pourrions continuer — très longtemps !
Comment, précisément, la mécanique quantique a-t-elle « tenu » ? Ou plus exactement, comment les théories qui voulaient la remplacer ou l’englober ont-elles « échoué » ?
P.L. : On s’est objectivement heurté à un mur dans le domaine de la physique des hautes énergies. Vers 1964-65, on a commencer à élaborer le modèle de la théorie des cordes, avec l’idée qu’une particule n’est peut-être pas ponctuelle, qu’elle pourrait être un noeud ou une corde, en somme de dimension 1 et non 0, pour parler le langage des mathématiciens. Là encore, ce n’était pas même nouveau. Un siècle plus tôt Maxwell et Lord Rayleigh, deux très grands physiciens, avaient avancé que peut-être les noeuds de l’éther permettraient de classifier les atomes. Et puis comme on sait Mendeleev est arrivé et a montré que les noeuds n’avaient rien à voir avec la structure des atomes, et surtout pas ceux de l’éther.
La théorie des cordes a longtemps eu le vent en poupe, elle a connu beaucoup de raffinements. Edward Witten est loin d’être naïf ou dénué de sens physique mais ce n’est pas par hasard s’il a obtenu la médaille fields plutôt que le Prix Nobel de physique. Il l’a dit lui-même : j’aurais bien aimé que ça « marche ». La théorie est formellement très belle, mais physiquement, en disant par exemple que le monde est constitué de 11 dimensions dont 7 compactifiées, on ne prévoit rien. Aujourd’hui la gravité quantique à boucles prend en quelque sorte le relais, mais avec les mêmes incertitudes. On a attribué un prix Nobel de physique à Penrose, mais comme le dit Carlo Rovelli, un jour sur deux il se lève en se disant que « ça ne marche pas ». Il y a un risque certain que le prix de Penrose finisse comme le prix Nobel de la paix d’Obama pour son discours du Caire. Rovelli a d’ailleurs lui aussi, indubitablement, un grand sens de la physique.
Il n’est pas caricatural de dire qu’il y a peu de problèmes en physiques mais qu’ils sont énormes. Les physiciens ne passent pas leur temps à faire des découvertes. Les idées en physique, c’est très rare ! C’est même là ce qu’Einstein avait répondu à Valéry : des idées, on en a une, au mieux deux dans sa vie. Mais quelles idées ! C’est ainsi qu’en recevant la thèse de de Broglie, Einstein avait dit : « Il a soulevé un coin du grand voile ». Lui-même se créditait de deux idées, et pas une de plus : la relativité et le photon. C’est un peu dur, l’article sur le mouvement browien par exemple est extraordinaire, mais enfin c’est Einstein qui le dit de lui-même.
Entre parenthèses, tout cela n’a clairement rien à voir avec le modèle actuel de la recherche universitaire, le système des publications, des peer reviews, des évaluations en tous genres et j’en passe. Bref, la physique s’est heurtée à des problèmes qu’elle ne sait pas résoudre. D’ordinaire, quand on se heurte à un problème en physique, quand la nature ne répond plus, on s’arrête, on attend, on réfléchit. Or, si je puis le dire ainsi, le hic c’est que depuis plus de cinquante ans, on refuse d’attendre, on essaie de continuer à avancer, on essaie d’délaborer de nouvelles théories, mathématiques d’abord plutôt que vraiment physiques. Il y a de nombreuses de raisons à cela. Des raisons historiques, sociologiques, économiques, démographiques, etc. Et puis en un sens il y a l’hybris. Pourquoi ? Parce que si Dieu est mort tout est permis. Qu’est-ce que ça veut dire en physique ? Je dirais que la traduction, c’est qu’il n’y a plus de raison de se soumettre aux arrêts de la « nature », la phusis. On assiste alors à la création d’une physique détachée de la nature, de l’expérience. Deux possibilités : ou bien l’expérience est impossible et on développe une physique des horizons, pour ainsi dire, une physique qui serait en principe valable à des moments inatteignables (Big Bang), à des distances inatteignables (astrophysique), à des énergies inatteignables (énergie de Planck), etc. Ou bien on décide qu’au fond si le Créateur, qui n’existe pas, n’y a pas pensé, c’est son problème. Si la nature ne comprend que 4 pauvres dimensions, ce n’est pas une raison pour que je ne décide pas qu’il y en a plutôt 11 dont 7 sont compactifiées, ou bien que l’univers bifurque chaque fois que je constate le résultat d’une expérience (N.B. Everett a proposé sa théorie (!) des multivers en … 1956), ou bien que le monde est construit en dernière analyse à partir d’un corps non archimédien, ou bien ceci ou bien cela. En fait il n’y a plus vraiment de limite, et la « physique » finit par rejoindre la « fantasy », sans d’ailleurs toujours voir que cela requiert en fait assez peu d’imagination.
Une autre erreur ou tout du moins une autre facilité, si j’ai bien compris, est d’évoquer la théorie physique, comme s’il s’agissait de quelque chose d’unifié — ou tout du moins comme si l’unification était très proche, alors que nous en sommes en réalité très loin… La fragmentation ne concerne pas seulement des grands domaines comme la mécanique quantique et la relativité générale, ou encore les quatre forces, mais tous les champs de la physique.
P.L. : Notre connaissance de la nature est en effet très parcellaire et les parcelles ne s’ajointent que très grossièrement. Bien sûr la théorie newtonienne est une limite (quand la vitesse de la lumière tend vers l’infini par exemple) de la théorie relativiste. Mais en fait il y a quantité de phénomènes qui sont totalement indescriptibles par la relativité. Les deux théories ne se touchent que selon un très étroit « interface » et pour le reste… pour le reste on fait comme on peut ! Parfois on oublie Newton, le plus souvent on oublie Einstein — et « on se débrouille » ! La dynamique classique ou hamiltonienne comme on dit (le même Hamilton que ci-dessus) est même en un sens plus riche que la relativité et surtout que la mécanique quantique. Bien sûr il y a aussi une limite entre le quantique et le classique (quand la constante de Planck ou la longueur d’onde de de Broglie tend vers zéro), mais en général, là aussi on oublie Planck (et de Broglie, et les autres) et… on reste dans l’univers classique. Les lois de la physique, même si en général elles ne se contredisent pas, même si elles se raccordent à certains endroits, laissent des trous béants, que l’on bouche ou bien comme on peut, ou bien en détournant le regard, en les négligeant, jusqu’à ce que, parfois… C’est aussi le cas en hydrodynamique avec ce qu’on appelle parfois le programme de Hilbert, sur lequel beaucoup de gens ont travaillé (dont Cédric Villani est sans doute, médiatiquement, le plus connu), et qui cherche à relier, dans un certain domaine, le microscopique et le macroscopique, avec de nombreuses étapes intermédiaires et des difficultés, cette fois mathématiques également, considérables.
Les grands succès de la physique du début du XXe siècle, dis-tu, proviennent pour une grande part, de la recherche de linéarisation, alors on a poursuivi cette recherche, mais sans plus trouver de « répondant » dans le réel.
P.L. : Tout d’abord il serait très exagéré d’attribuer les extraordinaires découvertes de la physique au début du XXe siècle à la linéarité (plutôt que linéarisation). L’idée de Planck, lancée véritablement à l’aube du siècle, en 1900, de quantifier les interactions matière-rayonnement s’est révélée absolument extraordinaire. Il s’agissait, Planck en était bien conscient, d’un pari, motivé en grande partie par ce qui était alors la grande question de la physique, prenant la forme de ce que l’on appelait la « catastrophe ultraviolette », autrement dit le fait que la physique classique prédisait que l’énergie contenue dans un « corps noir », un four, celui-là même qui se trouve dans nos cuisines, était… infinie. Encore une fois, Planck avait tout à fait conscience de ce que le pari pouvait échouer. Cette idée de quantification aurait aussi bien pu se révéler expérimentalement fausse ou illusoire, comme l’idée des cordes, et il aurait alors fallu l’abandonner. C’était d’ailleurs le temp où l’expérience, la nature telle que construite si l’on veut par et pour la physique moderne, faisait encore figure de juge suprême. Une théorie physique qui serait allée contre elle ou qui simplement n’aurait pas eu de sérieuses vertus prédictives était purement et simplement abandonnée, comme par exemple la théorie des nœuds victorienne. De ce point de vue la situation a un peu ou beaucoup changé. Ainsi la théorie des cordes a-t-elle survécu ou plutôt très bien vécu pendant un bon demi-siècle, en remettant toujours aux lendemains qui chantent ce que Husserl aurait appelé une Lieferung. Nous disons plutôt en anglais delivery. Toujours est-il que le caractère expérimentalement prédictif de la théorie des cordes est toujours resté quasiment nul, jusqu’à finalement provoquer … un peu d’impatience.
Mais revenons à la linéarité. C’est effectivement, du point de vue des outils mathématiques de la physique, l’une ou peut-être la grande marque de fabrique du vingtième siècle, au-delà même d’ailleurs de la physique, puisque c’est vrai également de l’intérieur des mathématiques, jusques et y compris cette ébauche de théorie des « motifs » que nous a léguée Alexandre Grothendieck, dont on peut bien dire qu’il s’agit d’un immense programme de linéarisation de la géométrie. Après quoi bien des choses se sont produites, dont le tournant homotopique plutôt que (co)homologique. C’est une autre histoire. En physique, il a surtout été question d’espaces (vectoriels, donc linéaires) de Hilbert, d’opérateurs (linéaires) sur ceux-ci et de représentations non moins linéaires de groupes de Lie. Autant dire, et cela a été noté plus haut, que la mécanique quantique est de part en part linéaire, ainsi que, très largement, la physique des particules, qui tend à identifier celles-ci avec des représentations linéaires de certains groupes, à commencer par celui de Lorentz. Les succès du paradigme linéaire sont immenses et en un sens inattendus en ce que la nature a très longtemps répondu positivement, parfois à des questions posées de manière très curieuse. Ainsi les articles (du début des années soixante !) qui en principe « prédisent » l’existence du boson de Higgs (mais pas sa masse) paraissent assez … bizarres, et pour le dire simplement pas toujours très … sérieux, aux yeux d’un mathématicien. Il y est question de bifurcations de valeurs propres d’une façon tout à fait élémentaire et en principe guère à la hauteur de la question.
On a beaucoup de mal à croire que la nature réponde positivement à ce genre de proposition. Or c’est en principe ce qu’elle a fait un demi-siècle plus tard, encore qu’il est possible de s’interroger. Quelqu’un raconte une histoire un peu abraccadabrante dans laquelle il est question d’un mystérieux objet dont on ne sait pas où il a été perdu ni comment. Des dizaines d’années plus tard, après avoir passé la région au peigne fin, au prix de petites et grandes fortunes, quelqu’un d’autre rapporte un objet tout aussi mystérieux, trouvé dans un champ. On identifie immédiatement les deux objets, avec tout de même quelques très bonnes raisons. Mais il faut avouer, sans que j’entende le mettre en doute, qu’il n’est pas évident que l’on justifie ainsi l’histoire originelle.
La linéarité et ses conséquences constitue à coup sûr une grande idée, ou plutôt, en physique, un outil puisssant et précieux. Cependant, après un siècle et plus, les plus grandes idées courent toujours le risque de sombrer dans l’idéologie. Et en un sens c’est bien ce qui est arrivé. Ainsi le réflexe du physicien théoricien contemporain confronté à des objets presque quelconques est-il d’inventer un groupe, s’appuyant d’ailleurs au passage, serait-ce implicitement, sur le théorème d’Emmy Noether qui lie les « forces d’interaction » et les « symétries ». Certains exemples sont devenus assez caricaturaux. Considérons ainsi deux sortes de neutrinos, e et mu. Dans beaucoup de circonstances on observe un mélange des deux, dans certaines proportions, on ne sait pas trop bien pourquoi. Eh bien, le réflexe consiste à linéariser la situation, imaginer si je puis dire un plan, un groupe de rotation puis un angle (dit en l’occurrence de Weinberg) pour décrire cette situation. C’est là une description plutôt qu’une prédiction. Simplement, une certaine proportion mesurée devient fonction d’un « angle » et on parlera alors d’ « oscillation ». Ou encore, comme on sait, on distingue trois quarks, dont l’un beaucoup plus lourd que les deux autres. Il n’empêche que l’on introduit un groupe de symétrie entre les trois, quitte à décider ensuite que cette symétrie est brisée, puisque les trois quarks ne se ressemblent pas tant que ça. À la limite, si l’on se donne trois objets ou animaux quelconque, disons, pour faire plaisir à Nietzsche, un lion un chameau et un serpent, on introduira un groupe de symétrie SU(3) pour décrire leurs symétries, leurs ressemblances, quitte à parler ensuite de rupture ou brisure de symétrie, pour entériner le fait qu’après tout ces animaux sont très différents…
Mais si on procède comme ça, c’est que ça marche.
P.L. : Disons que, longtemps, ça a étonnamment marché, et que clairement il y a quelque chose de « vrai » dans tout ça. Mais tout aussi clairement la nature a a fini par se lasser et ça ne marche plus si bien. Parfois ça ne marche plus du tout, pas mieux que les kholkozes disons. Et alors il faut avouer que c’est l’idéologie — et le capitalisme, et le goût du pouvoir et le choc des ego — qui prend le relai. On continue, pour toutes sortes de raisons, dont le fait important et bien connu que les gens en place préfèrent… y rester. Et puis on ne sait pas trop comment faire autrement ! Il n’est pas là-dedans question d’imagination, en fait tout au contraire. Certes elle manque cruellement, ou disons que nous sommes simplement bloqués, ce qui arrive. On peut d’ailleurs toujours parler d’un nécessaire changement de paradigme, de ce que le nôtre s’est usé, etc. mais ce ne sont pas ces relatives banalités qui nous sortirons d’affaire !
Pourquoi a-t-on poursuivi, si comme tu le laisses entendre « ça ne marche plus » ?
P.L. : Il y a beaucoup de facteurs, ceux qui relèvent de l’économie, de la démographie universitaire, du goût du pouvoir, etc. et d’autres plus philosophiques et plus profonds. Je mettrai sans doute en exergue le manque d’humilité des physiciens théoriciens devant la nature, sous la forme de l’expérience au sens le plus classique (ou si l’on préfère « moderne ») du mot. C’est d’ailleurs ce qui, au CERN en particulier, a conduit tout simplement à une scission nette entre « expérimentateurs » et « théoriciens », ces derniers ayant tendance à ne plus proposer des expériences effectivement réalisables. On trouve d’ailleurs aussi une véritable armée de gens qui effectuent des calculs basés sur des théories apparues il y a plus d’un demi-siècle (et comme de juste fondamentalement linéaires) auprès desquelles les épicycles ptolémaïques sont à la fois beaucoup plus simples et beaucoup plus précis dans leurs conclusions.
Les physiciens ont-ils majoritairement (excuse le caractère caricatural de la question) perdu le sens physique ?
P.L. : Il existe toujours (heureusement !) des physiciens amoureux de la physique et pourvus d’un sens physique étonnant. Seulement pour l’heure, ils n’ont pas été en mesure de débloquer la situation. Les physiciens célèbres du passé ont assurément fait preuve d’un sens physique étonnant, génial même, et gardaient le souci d’une interprétation vraiment physique des situations. Ils ont peut-être eu aussi la chance de tomber dans leur époque. C’est l’éternelle question : que ferait Mozart ou Titien aujourd’hui ?
Par exemple l’article d’Einstein, en 1905, sur le mouvement brownien, est impressionnant et, de l’autre côté, Heisenberg aussi avait un sens physique extraordinaire. Dans le livre sur Opération Epsilon (les Farmhall Transcripts), on raconte comment Heisenberg regarde le film sur Hiroshima, tourné par l’armée américaine, quelques heures seulement après le largage de la bombe. Il comprend immédiatement comment tout cela fonctionne, en plus du tragique de la situation. Au point d’en faire un système de défense d’ailleurs : il prétendra plus tard qu’il a intentionnellement privilégié la voie de l’eau lourde afin d’égarer l’Uranprojekt qu’il dirigeait, alors qu’il aurait su faire la bombe s’il l’avait vraiment voulu. On peut en douter — beaucoup ! — mais le fait est qu’il avait un sens physique extraordinaire et qu’il en a fait preuve en maintes circonstances. Feynmann lui aussi était un authentique physicien, pourvu lui aussi d’un sens physique hors du commun. Quand on lui a demandé de pointer celui de ses résultats qui l’avait le plus frappé, presque ému, il n’a pas du tout parlé de ses fameux diagrammes. En effet, les diagrammes de Feynmann, ce n’est pas vraiment de la physique, plutôt une manière d’agencer intelligemment un calcul, une théorie des perturbations, et de l’interpréter de manière par ailleurs contestable. Lui a préféré évoquer un obscur résultat sur les muons qu’il avait obtenu et que personne ou presque ne connaît, parce que c’était un vrai résultat physique, parce que la nature lui avait alors répondu pour ainsi dire personnellement. C’est ce sens, ce souci de ce que pourrait être une réponse de la nature, qui a été un peu perdu. Comme le disait déjà Dirac, la première quantification est un mystère, la seconde est un foncteur. Même chose pour les relations de Heisenberg. Les trois premières sont mystérieuses ; on en ajoute une quatrième, entre la phase et le nombre de particules, mais il faut avouer que celle-là ressemble plutôt à un objet mathématique formel relativement élémentaire qu’à un « mystère » de la physique.
Si tu devais résumer l’aporie actuelle de la physique théorique ?
P.L. : La première génération de la nouvelle physique était fascinée par des succès qu’ils ne pouvaient comprendre ni expliquer et que nous ne comprenons pas beaucoup mieux ; ensuite, les soucis se sont déportés vers les modèles mathématiques. ll y a là un problème d’imagination ou d’hybris, d’idéologie aussi. Il y avait une certaine humilité de la physique devant la nature. Planck s’est montré a priori très modeste à propos de son hypothèse des quanta, que l’expérience aurait très bien pu contredire. De Broglie rappelait sans cesse qu’il y a sûrement quelque chose « par derrière ». En fait c’est un peu ça. Tous ces grands physiciens ne pouvaient s’empêcher de croire que la nature (ce qui n’est pas la même chose que le « réel ») était voilée, et que, comme avait dit Einstein à propos de de Broglie et du dualisme onde-particule, il était question de « soulever un coin du grand voile ». J’ajoute qu’Einstein n’était pas stupide et ne pensait pas que le grand voile recouvrait un monde purement déterministe, causal, « classique » si l’on veut, comme de bonnes âmes l’en accusent un peu vite. Aujourd’hui beaucoup a changé de ce point de vue. D’une part on suppose que la mécanique quantique fournit le dernier mot sur un certain réel (voilé comme il se doit). C’est si l’on veut le ressort de l’interprétation dite de Copenhague, aujourd’hui universellement admise (même par les journalistes, sans toujours le savoir !). Par ailleurs, en physique des hautes énergies et dans ses régions les plus éthérées, la « physique » a fini par se dire que paradoxalement la confrontation avec la nature, par le détour de ce que l’on appelle communément l’« expérience », n’est plus si nécessaire. En somme si le Créateur n’est pas, tout est permis et l’imagination humaine le remplace avantageusement. Il faut dire aussi qu’on fait rarement preuve de beaucoup d’imagination ! Le succès actuel des multivers par exemple, est plus consternant qu’impressionnant. Et puis il y a aussi le fait que l’imagination mathématique et l’imagination physique sont fondamentalement différentes. Einstein était un physicien de génie, Grothendieck un mathématicien de génie. C’est très différent. Cette distinction s’est largement perdue chez les physiciens, la physique se tournant vers les mathématiques pour y puiser des idées sans plus trop demander son avis à la « nature ». Or la réalité, c’est qu’il demeure à l’évidence d’énormes zones d’ombres. Dans la physique, on l’a dit, il y a des petits bouts qui « fonctionnent », avec de très étroites « interfaces » qui tiennent souvent à un calcul assez élémentaire mais parlant, séparées par de larges zones d’ombres. Bref, quelques ilôts éclairés et beaucoup d’obscurité !
Ce qui va nous permettre d’amorcer une transition pour évoquer les mathématiques, dont un des paradoxes, on va y venir, est qu’il faut à la fois souligner leur puissance formelle et leur sophistication technique, et en même temps la faiblesse devant la nature – leur impuissance à porter seules la physique.
P.L. : En l’an 2000, l’un des problèmes Clay consistait à montrer que les équations de Navier Stokes, lesquelles sont déjà un modèle, autrement dit une simplification voire une caricature de la mécanique des fluides, sont globalement bien posées. Disons que si l’on tourne sa cuiller dans le verre à thé (toujours le même geste, depuis Einstein et le mouvement brownien !), ne risque-t-on pas de voir le verre exploser et le thé s’envoler vers la lune ?! Probablement pas mais on ne sait pas le « démontrer », même en ayant très copieusement simplifié la question auparavant pour lui donner un tour mathématique. Pourtant on sait calculer le spectre de l’atome d’hydrogène avec beaucoup de décimales (au moyen de l’équation de Schrödinger) et même on sait introduire, repérer et calculer d’infimes corrections relativistes (grâce à l’équation de Dirac). Si par contre on essaye de calculer le spectre de l’atome de fer, ou même d’hélium…. tout le bel édifice s’écroule ! Sauf que l’imagination scientifique, et en l’occurrence physique, permet parfois de surmonter ces obstacles. Dans ce cas d’espèce, vient Wigner qui exlique que l’on peut faire « comme si » quelque chose était « stochastique » — et on calcule le spectre à d’aide de la théorie des matrices aléatoires, avec une précision étonnantes. Sauf que… les mathématiques deviennent impuissantes à justifier un pas que les physiciens ou physiciens mathématiciens franchissent allègrement. Dans un contexte un peu différent on dirait qu’on fait une hypothèse — aussi fausse que productive ! — de « phase aléatoire ». Etc. Tout l’art consiste dans ces régions à poser aux mathématiques les bonnes questions, celles auxquelles elles ont tout de même une petite chance de pouvoir répondre. Pour prendre l’exemple d’un tout autre domaine, elles ne peuvent pas répondre à grand-chose dans le domaine de l’économie, pour des raisons assez claires mais qu’il serait trop long de détailler ici.
V. LES MATHÉMATIQUES
Les mathématiques sont au centre de ton travail, non seulement parce que tu les pratiques, pas par ce qu’elles nous apprennent de la raison, de la science, de l’inventivité conceptuelle en général. En particulier, notes-tu, la question de la confusion et de la nécessaire distinction de la raison et de la science et en amont d’elle encore, de la lointaine opposition (déjà évoquée) de la tradition « archimédienne » à la tradition aristotélicienne, refait surface dans la confusion contemporain entre « logique » et « mathématiques ».
 P.L. : Les maths ne sont pas la logique mathématique. C’est la première des chaînes à « déconstruire » : logique-et-mathématiques, qui fait référence spécifiquement au Cercle de Vienne et plus largement à la philosophie analytique. Pour reprendre une célèbre Pensée de Pascal à propos de Descartes, on est tenté d’écrire lapidairement de celle-ci : certain et inutile ; pour ne pas dire nuisible car le Cercle de Vienne et le positivisme logique ont inculqué puis renforcé l’idée profondément fausse véhiculée par cette chaîne syntaxique. En fait, dans la pratique de la recherche, les critères logiques des mathématicien(ne)s sont ceux de la logique la plus banale, celle de l’organon d’Aristote diraient les philosophes ; elle tient en gros la même place que l’orthographe dans la littérature. Il est très mauvais — et même irrémédiable — d’y contrevenir, mais elle passe rarement l’emploi de syllogismes très simples, au pire de raisonnements par l’absurde ou par récurrence qui sont intégrés depuis si longtemps dans la boîte à outils des mathématicien(ne)s qu’ils passent pratiquement inaperçus, comme les règles élémentaires d’accord du participe passé.
P.L. : Les maths ne sont pas la logique mathématique. C’est la première des chaînes à « déconstruire » : logique-et-mathématiques, qui fait référence spécifiquement au Cercle de Vienne et plus largement à la philosophie analytique. Pour reprendre une célèbre Pensée de Pascal à propos de Descartes, on est tenté d’écrire lapidairement de celle-ci : certain et inutile ; pour ne pas dire nuisible car le Cercle de Vienne et le positivisme logique ont inculqué puis renforcé l’idée profondément fausse véhiculée par cette chaîne syntaxique. En fait, dans la pratique de la recherche, les critères logiques des mathématicien(ne)s sont ceux de la logique la plus banale, celle de l’organon d’Aristote diraient les philosophes ; elle tient en gros la même place que l’orthographe dans la littérature. Il est très mauvais — et même irrémédiable — d’y contrevenir, mais elle passe rarement l’emploi de syllogismes très simples, au pire de raisonnements par l’absurde ou par récurrence qui sont intégrés depuis si longtemps dans la boîte à outils des mathématicien(ne)s qu’ils passent pratiquement inaperçus, comme les règles élémentaires d’accord du participe passé.
Les mathématiques, dis-tu, sont extrêmement mal connues et comprises, rabattues sur une conception elle-même étroite de la science, du scientisme, et faussement assimilées à la logique, alors que si on les considère dans leur réalité, on y découvre plutôt un puissant antidote au scientisme.
P.L. : Une anecdote à ce sujet : au début des années soixante-dix Grothendieck et ses amis publiaient une revue au titre de Survivre et vivre qui étaient extrêmement antiscientiste. Et cette revue a publié des articles très intéressants sur le mythe du scientisme. Les mathématiques sont essentiellement indemnes du mythe du scientisme.
Les philosophes n’ont en général pas vu non plus la diversité des mathématiques.
P.L. : De fait celles-ci sont non seulement très diverses mais encore elles sont par certains côtés très puissantes, par d’autres au contraire tout à fait impuissantes face à des « objets » relativement simples. Quant au fait que les objets mathématiques « existent », cela ne fait même l’objet d’aucun débat parmi des mathématicien(ne)s, que l’on préfère parler de platonisme naïf ou d’ontologie régionale. Les objets mathématiques sont objets de désir, de plus il résistent à nos enquêtes ; cela suffit amplement pour les mathématicien(ne)s à attester de leur « existence ».
Justement, malgré cette méconnaissance, dis-tu, les mathématiques se trouvent aujourd’hui souvent en position de véritable bouées de sauvetage — les mathématiques ou plutôt les fantasmes qu’elles suscitent
P.L. : De fait, que ce soit du côté des psychanalystes lacaniens comme des sociologues, des philosophes analytiques comme de certains linguistes, certains ectoplasmes censés représenter les « mathématiques » sont de toutes parts mis à profit pour venir en aide à des disciplines en difficulté, pour diverses raisons. Il faut le dire haut et fort : ce ne sont pas ces pseudo mathématiques, qui n’entretiennent aucun rapport sérieux avec les mathématiques des mathématicien(ne)s d’aujourd’hui, hors quelques dénominations censément garantes de sérieux et de « scientificité », qui pourront authentiquement contribuer à sortir d’autres disciplines des ornières dans lesquelles celles-ci se sont enfoncées.
Tu montres aussi qu’il y a là un piège ; les mathématiques sont assez puissantes pour offrir des modèles ou des formalismes à n’importe quel problème, que ce soit en physique ou dans ce qu’on appelle (à tort selon toi) les sciences humaines, sans que cette application soit nécessairement pertinente ou n’apporte quoi que ce soit à l’intelligibilité de la question traitée. Dans les dernières pages de Mathématiques et finitude, tu montres ainsi, à partir de l’analyse du formalisme repris par Badiou dans Logiques des mondes, « à quel point l’idéee d’utiliser les mathématiques en tant que véritable modèle formel pour la philosophie conduit à des absurdités, ou du moins à un fétichisme puéril ».
P.L. : Là encore je ne crois pas devoir me renier. Logique des mondes est un très mauvais livre, je me suis essayé à le montrer, y compris dans un Appendice en principe « technique » au § 7.2 de Mathématiques et finitudes (mais qui l’est beaucoup moins que n’importe quel article de recherche sérieux de mathématiques proprement dites) auquel je renvoie. Plus généralement et plus sérieusement, il est vrai qu’il est toujours possible d’emprunter aux mathématiques, et en général à des parties en fait très élémentaires de celles-ci, comme à une banque à peu près inépuisable, les formalismes propres à illustrer à peu près n’importe quelle réflexion, n’importe quelle interrogation. Ce qui à mon sens ne résout rien, tout au contraire.
Peut-être… que la confusion vient de ce que le philosophe ne cherche pas ce qu’il faut dans les mathématiques. Qu’il cherche toujours le modèle, la rationalité. Et non la création.
P.L. : Tout à fait d’accord. À condition naturellement de préciser, comme je crois nous y reviendrons, toujours insuffisamment, cela va sans dire.
Tout ce que je voudrais dire, et sur quoi il me semble qu’il faut insister, c’est que les mathématiques (les vraies ! les « ersatz » abondant…) résistent violemment à leur retraduction. Elles ne sont pas là pour offrir une sorte de panoplie, une boîte à outils ou des armes à tout faire, ou encore des modèles prêts à l’emploi. C’est exactement ce qui se passe en ce moment dans quantité de disciplines (y compris en physique théorique !) et je crois que c’est catastrophique. D’abord bien évidemment ces pseudo-mathématiques n’en sont pas, à commencer par la linguistique censément mathématique des années soixante, ou encore Lacan, ou Badiou aujourd’hui ; surtout, s’accrocher à elles comme à autant de bouées de sauvetage contribue à la décadence, pour ne pas dire à l’effondrement de disciplines toutes entières. Quant au mot de « scientificité », utilisé sur un mode proprement « magique », il ne va pas nous sortir d’affaire ! Ce qui est décourageant c’est que le nombre de modèles disponibles est immense. N’importe quelle idée philosophique peut s’incarner dans un objet mathématique existant. Il existe un immense marché des « modèles » ; les mathématiques sont beaucoup plus puissantes que ce que croient les philosophes, lesquels en savent très peu là-dessus, y compris ceux qui sont dit « analytiques », voir philosophes des sciences. Et en même temps ces mêmes mathématiques demeurent impuissantes devant des choses très simples. Il faut donner raison à Hamlet. Il y a davantage dans le mouvement d’un brin d’herbe dans la brise que dans toutes les mathématiques du monde. Ce qui n’empêche pas que les mathématiques peuvent vous offrir « sur un plateau » des modèles pour toute idée un peu « abstraite » qui vous passe par la tête. Et les philosophes peuvent être facilement conduits à commettre l’erreur fatale de s’emparer de versions enfantines de ces modèles. Or les mathématiques sont assez puissantes pour écraser toutes ces maladroites tentatives de modélisation ; mais elles sont toutes petites devant la nature, devant le brin d’herbe qui flotte au vent ou la cuiller qui remue l’eau bouillante dans le verre à thé.
Tu soulignes beaucoup la différence des façons de travailler, de faire de la recherche. Que fait un mathématicien quand il travaille ? Qu’est-ce que le travail mathématique ?
P.L. : Cela dépend beaucoup des domaines. Un algébriste va davantage être dans la langue, un topologue dans la vision. Si l’on croyait ce que disent ou écrivent les philosophes analytiques, il n’existerait pas de travail mathématique. Il suffirait de dérouler des formules. Grothendieck l’exprime très bien et il sait de quoi il parle. On part de ce qu’il appelle une « vision ». On part d’une « image ». Le travail, en un sens, le plus haut peut-être, consiste à tâcher de préciser, donner consistance à cette image, d’abord floue, très vague. Je ne sais pas si on peut parler à ce propos d’herméneutique formelle. Je ne crois pas. En fait il ne s’agit pas d’interpréter à proprement parler, et d’ailleurs il n’est pas toujours, pas même souvent, question de texte, de mots en quelque sens que ce soit. Aujourd’hui les ordinateurs interviennent d’ailleurs dans certains domaines, de manière parfois surprenantes, pour suggérer, constater des coïncidences dont on peut penser qu’elles n’en sont pas, etc. Il y a beaucoup de formes possibles de ce qui mérite de s’appeler « travail » en mathématiques, avec cette caractéristique unique, y compris par rapport à la physique, plus encore la biologie ou la chimie, bien évidemment par rapport aux science humaines ou la philosophie ou la littérature ou le reste, qu’il existe toujours une certaine tension. Un seul chaînon vous manque et tout est dépeuplé. J’ai dit que la logique joue à peu près le rôle de l’orthographe. Il faut affiner un peu. C’est vrai, mais toute faute d’orthographe, disons plutôt de logique, en générale tout à fait banale, est brutale, rédhibitoire. Ce n’est d’ailleurs pas perçu comme une « faute », il n’y a pas de faute, plutôt comme un « chaînon manquant », une médiation qui est absente, un lien qui fait défaut. Ici la comparaison avec les itinéraires, les voies, en montagne, tient tout à fait. Une voie ne mène au sommet que si elle ne comporte pas de trou, de solution de continuité, de verrou infranchissable. Et là c’est la même chose et c’est pourquoi le travail mathématique comporte toujours une certaine tension, et même une tension certaine que l’on ne rencontre pas ailleurs dans le domaine intellectuel. Pour le dire bêtement : « ça passe ou ça casse » ; et souvent ça se bloque — pour des années, des dizaines d’années, parfois des siècles. La temporalité globale en mathématiques est aussi très particulière. Lorsque Wiles a démontré le « théorème de Fermat », celui-ci avait été énoncé (pas en tant que ce que nous nommons « conjecture », il est vrai) depuis plus de trois siècles et demi.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On ne fait pas assez souvent, je trouve, la distinction entre l’usage des mathématiques déjà existantes et la recherche mathématique. Or, il me semble que celle-ci est capitale. Du point de vue de l’usage, les mathématiques ont une histoire très conservatrice. Les mathématiques grecques sont encore parfaitement valables, parce qu’elles peuvent servir à résoudre des problèmes concrets, immédiats (profondeur d’un puits, etc). En revanche, du point de vue de la recherche mathématique actuelle, elles sont dépassées, transformées, déformées. Au point qu’on peut se demander si on parle de la même chose, si les mathématiques du mathématicien actif et celles de l’ingénieur, du physicien, du technicien qui en a besoin sont les mêmes.
J’ai l’impression — peut-être fausse — que ce qui manque aux philosophes, plus encore que la connaissance des mathématiques, c’est justement la pratique des mathématiques vivantes, la pratique de la recherche mathématique. Certains philosophes ont une formation mathématique assez poussée — Husserl a été docteur en mathématiques, assistant de Kronecker. Lautmann s’est formé au contact de Herbrand — mais ils héritent en quelque sorte de mathématiques déjà faites. Ils apprennent à comprendre ce qui est déjà sédimenté. Ils en font une lecture rétrospective. Ce qu’ils ne connaissent pas, ou peu — c’est le moment où l’on cherche.
J’ai de par mes études une intuition vague, mais une intuition tout de même, de ce que peut vouloir dire faire des mathématiques. Très vague dans la mesure où il m’arrivait, même après le bac, de parvenir à résoudre des exercices avant qu’on m’explique la solution, souvent, sans parvenir à une démonstration stricte, en sentant ce qui se passait, ou ce qui avait l’air de se passer. À ce niveau encore assez rudimentaire ,je parvenais à me faire des représentations vaguement géométriques, et dynamiques, et parfois à deviner les moments où l’intuition ne collait plus, où le matériau intuitif devenait insaisissable, trompeur, devait être abandonné, parfois pour parvenir à un autre matériau intuitif. De cette expérience d’étudiant j’extrapole quelque peu (sans doute avec beaucoup de naïveté) ce que peut-être celle du chercheur — sans bien savoir comment se lient ce niveau psychologique et le niveau formel et structurel. Mon impression (peut-être absurde, peut-être fausse) est que, contrairement à ce qu’affirment beaucoup de philosophes, la psychologie de la démarche de création mathématique ne doit pas être trop séparée de la réflexion sur les mathématiques elles-mêmes, les structures, les objets.
P.L. : La — triste — vérité, c’est que les mathématiques telles qu’elles se font et même telles qu’elles sont tout simplement, non seulement à l’heure actuelle mais même à leurs époques, n’ont guère de rapport avec l’image que peuvent en donner le Cercle de Vienne ou la phénoménologie. N’oublions pas qu’on demande beaucoup plus à n’importe quel chercheur débutant, voire doctorant ou doctorante, que ce que Husserl et Lautmann, a fortiori Russel et Carnap, ont à offrir. De fait la première condition pour écrire sérieusement sur ces sujets devrait à l’évidence consister dans une accointance minimale avec eux voire, comme tu le soulignes à juste titre, une connaissance active des difficultés que l’on rencontre à tâcher, serait-ce modestement, de les faire progresser. Ce n’est absolument pas le cas, les exceptions se comptant sur les doigts de la main, y compris aujourd’hui. Je laisse à la lectrice ou au lecteur de prolonger éventuellement ces réflexions très insuffisantes par une comparaison avec, par exemple, les instrumentistes, les chefs d’orchestre et les critiques musicaux, sans parler même des compositrices et compositeurs.
Mais alors… Un non mathématicien peut-il acquérir une culture mathématique ? Et si ce n’est pas le cas, comment les mathématiques peuvent-elles exercer leur influence — maintenant que, contrairement à ce qui se passait du temps de Descartes, et même encore, quoiqu’à un moindre niveau, de Kant, une même personne n’est le plus souvent pas à la fois mathématicienne, physicienne et philosophe ?
P.L. : Excellente et difficile question. Tout d’abord je dirais qu’il importe de ne pas écouter les philosophes des sciences ni les épistémologues si on veut l’aborder sérieusement. Tenons-nous en aux praticiens, aux autochtones si l’on préfère. On peut ensuite se tourner vers une analogie qui est, pour toi en particulier, je crois assez parlante : est-il facile de « comprendre », d’appréhender le travail d’un chef d’orchestre ? Pour moi la réponse est clairement : non. J’ai un certain nombre de musicien(ne)s dans ma famille qui me disent toutes et tous que depuis l’orchestre la qualité du chef est très audible, presque évidente. Mais ce n’est pas le cas à écouter naïvement et de l’extérieur. Très peu de gens perçoivent vraiment la qualité d’un chef. Et il est très difficile d’apprécier sérieusement les qualités et les défauts d’une ou un pianiste (professionnel évidemment). Au demeurant les émissions de critique musicale avec écoute anonyme suffiraient à nous en convaincre. Pour les mathématiques, c’est un peu la même chose — en pire. Quasiment tout ce qui se dit dans le domaine public, que ce soit sur les mathématiques ou sur la physique (en particulier quantique, ces dernières années) est simplement absurde, sans aucun rapport avec la réalité de ces disciplines. J’ai pris ci-dessus l’exemple de la musique, mais ceux de la peinture ou de l’écriture ne sont pas très différents, peut-être aussi trompeurs, mais différemment. Il suffit de lire dans les mémoires de Delacroix la manière dont il apprécie un glacis de Rubens pour constater que son œil est complètement différent d’un œil ordinaire, de même que l’écoute de quelqu’un comme Leonard Bernstein n’a rien à voir (!) avec celle d’un auditeur du commun, serait-il « mélomane ». Plus positivement, il est évidemment impossible de compenser les dizaines de milliers d’heures d’exercices qui forment n’importe quel(le) pianiste professionnel(le), remarquable ou pas. C’est un peu la même chose s’agissant des mathématiques. Et pourtant il devrait être possible d’« écouter » celles-ci, d’une façon ou d’une autre. Ce qui manque chez presque tout le monde, c’est la caisse de résonance intérieure. Or je crois qu’il est possible d’en construire une, ou du moins de la « bricoler », à relativement peu de frais. On peut ême dire que je m’y suis essayé, en faisant feu de tout bois. Est-ce que cela mérite l’appellation de « culture mathématique » ? Je dirais qu’en un sens, oui.
J’ai l’impression qu’une des leçons des mathématiques à la philosophie est l’impossibilité de présenter celles-ci à partir de leurs seuls résultats. Alors que la philosophie de son côté ne cesse de chercher à se résumer, à être à elle-même sa préface, tout en en étant parfaitement consciente d’ailleurs. C’est la préface de Hegel à la phénoménologie de l’esprit. C’est toute la question de la traduction, de la réécriture, que repose Derrida. C’est toute la réflexion sur la pensée indissociable de la temporalité, des étapes, accidents, avatars de son déploiement qu’on retrouve encore chez Marc Richir. Il n’y a aucun intérêt à résumer les mathématiques. Il n’y a aucun intérêt non plus à résumer la pensée des mathématiques, ou les pensées autour des mathématiques.
P.L. : Cette idée que le résumé ou la synthèse si je puis dire trop synthétique — et par là même presque forcément « abstraite » — n’ont en gros aucun intérêt lorsqu’il est question de mathématiques, cette idée donc, me semble très juste. D’autant que par exemple la frontière de l’analytique et du synthétique est fondamentalement et sans cesse floue en mathématiques. Mais c’est l’accumulation d’implications et de métaphorisations qui finit par construire un quelque chose qui s’appelle théorie, autrement dit une forme de contemplation réglée. En somme les mathématiques sont un art d’empiler des métaphores durcies au feu. Mais quel feu ? Tout est là en un sens.
Que faut-il mettre en place pour démontrer ce qui semble évident, sachant que les démonstrations des mathématiciens ne rencontrent que très rarement l’approbation des logiciens, sans même parler des débats depuis très longtemps clos dans la « communauté mathématique », entre « formalisme » et « intuitionisme » ? On peut songer par exemple aux débuts de la topologie. Est-il évident qu’une courbe simple continue et fermée, tracée sur le plan, possède partage celui-ci en deux composantes connexes, un intérieur et un extérieur, lequel contient le point à l’infini. Tiens, voilà donc un infini qui pointe son nez, avec disons ce qu’on appelle compactification d’Alexandrov, ici la compactification du plan dans la sphère qu’en l’occurrence tout le monde peut « voir ». Pourquoi énoncer, comment démontrer ce fait tout simple, qui devient le fameux « théorème de Jordan », un résultat pas du tout évident ? Mais alors, de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce qui est de l’ordre de l’« évidence » en topologie, autrement dit — même étymologiquement — ce qui se « voit », qui saute aux yeux ? Ce qui est évident en topologie n’est pas évident de la même manière en algèbre. Ce qui l’est dans l’ordre de la vision ne l’est pas de la même façon dans l’ordre de la langue. Il y a des traductions, de la topologie algébrique, etc. Le concept de « trou » par exemple, n’a rien d’évident. Les pionniers des théories l’homologiques, Betti, Vietoris, de Rham, Poincaré, souvent des montagnards au demeurant, et d’une longévité étonnante, sauf Poincaré bien sûr, s’attachent à « compter des trous », définir des « bords » : ils inventent ainsi homologie et cohomologie. Un demi-siècle plus tard André Weil se demande comment on compte les trous sur un corps fini (un « corps de Galois » comme il les appelle), des trous qui bien sûr n’en sont plus du tout au sens ordinaire du terme. C’est là une interrogation a priori largement métaphorique. Une surface sur un corps fini ça existe et ça a un genre, ça a des trous. Sauf que rien de tout cela ne possède un sens évident. En ce moment même, d’éminents mathématiciens, en particulier Christophe Soulé et Alain Connes, à la suite de quelques uns, dont Jacques Tits, spéculent sur ce que l’on peut faire avec le fameux « corps à 1 élément ». Celui-ci, littéralement, n’existe pas, c’est très facile à montrer, et pourtant on peut « faire comme si », comme si par exemple certaines formules se rapportaient à lui, comme si on pouvait écrire une fonction zêta, etc. Tout cet effort est pour l’instant largement métaphorique, transport vers un pays qui n’existe pas … pas encore en tous cas. Les pionniers d’aujourd’hui creusent comme toujours dans le sable, sans savoir si quelque chose en jaillira — ou rien, ce qui arrive aussi, le plus souvent sans être inscrit dans les annales.
Nous reviendrons un peu plus loin sur cette idée de métaphorisation en mathématiques. Avant cela, j’aimerais évoquer la question de l’intuition, dont les mathématiciens parlent beaucoup, mais en un sens qui ne semble pas être celui des philosophes. En philosophie aussi d’ailleurs, le terme d’intuition désigne des concepts très différents, de Platon à l’intuition sensible kantienne, l’intuition intellectuelle de l’idéalisme allemand, ou même les tentatives de la phénoménologie pour expliciter une intuition de type catégoriale — ou, comme le fait Dominique Pradelle dans ses derniers ouvrages[2], un processus de remplissement catégorial. Beaucoup de philosophes ont tendance à user d’une compréhension de type assez kantien de l’intuition – ils distinguent l’intuition comme composante empirique, contingente de la recherche, et les nécessités des structures. C’est clairement le cas chez Vuillemin par exemple qui présente l’évolution des mathématiques comme une élimination, ou en tout cas une prise de controle et une secondarisation de l’élément pyschologique et contingent de l’invention ou de la découverte.
Cependant, à bien lire les mathématiciens, il n’est pas sure que cette distinction soit si forte. Dans le livre d’entretien Triangles de pensées, avec Alain Connes et Marcel-Paul Schützenberge, André Lichnerowicz distingue le discours de communication et le discours de création des mathématiciens. Le discours de communication, par essence, est formel, et doit être préservé de tout engagement ontologique comme de toute ambiguïté intuitive. Le discours de création, de son côté est prescriptif et d’une certaine façon phénoménologique : il s’agit à travers lui de « saisir » quelque chose. La structure d’une théorie mathématique est inséparable d’une forme de possession intuitive appartenant à ses conditions d’emploi. C’est aussi ce que souligne le collectif Bourbaki[3] « On ne saurait trop insister sur le rôle fondamental que joue dans ses recherches, une intuition particulière (2) qui n’est pas l’intuition sensible vulgaire, mais plutôt une sorte de divination directe (antérieure à tout raisonnement) du comportement normal qu’il semble en droit d’attendre, de la part d’êtres mathématiques qu’une longue fréquentation lui a rendu presque aussi familiers que les êtres du monde réel. Or, chaque structure apporte avec elle son langage propre, tout chargé de résonances intuitives particulières, issues des théories d’où l’a dégagée l’analyse axiomatique que nous avons décrite plus haut ; et pour le chercheur qui brusquement découvre cette structure dans les phénomènes qu’il étudie, c’est comme une modulation subite orientant d’un seul coup dans une direction inattendue le courant intuitif de sa pensée, et éclairant d’un jour nouveau le paysage mathématique où il se meut ». Maladroitement peut-être, je dirais qu’on peut peut-être aussi chercher des traces de l’occasion ou de l’enracinement sensible dans la structure des objets et théories, qu’il y a en elles des transpositions de dynamiques sensibles, corporelles, etc. Jocelyn Benoist développe cette idée concernant la théorie des catégories[4] ; Marc Richir, lui, a développé une conception de l’idéalité de type un peu prototypique, ou quelle que soit sa nature idéale, celle-ci reste indissociable d’une donnée contingente qui l’occasionne.
P.L. : Il va sans dire qu’il nous faudrait du temps pour aborder sérieusement ces questions. Énormément. Des années — c’est bien pour ça que j’organise un séminaire ! Toujours est-il qu’il y a toutes sortes d’intuitions mathématiques. Ramanujan ou Euler, mais aussi Thom ou Thurston, ou Poincaré, ou Gelfand, ou Grothendieck, ou qui sais-je encore ? Pour certains ce sera l’intuition des formules directement ; le monde s’écrit en formules, en des mathèmes énormément plus compliqués et précis que les mathèmes lacaniens, mais des mathèmes tout de même. Avec d’énormes différences que je ne détaille pas ici. Grothendieck avait, lui, son génie particulier. Il percevait directement une structure derrière un objet, qu’il pouvait extrapoler, transporter, autrement dit métaphoriser à sa guise. Mais tout ceci est très, très insuffisant, il va sans dire…
Une des clefs ce me semble de l’approche phénoménologique des mathématiques — et de ses limites — est le concept d’horizon de Husserl, que reprend Desanti et plus récemment donc Dominique Pradelle. Peut-on faire évoluer ce concept de façon à l’arracher à l’intentionnalité perceptive à laquelle il est d’abord lié pour Husserl ? Que peut-on faire de l’horizon ? Nous avions eu cette discussion avec Dominique Pradelle l’an dernier lors de ton séminaire. Pradelle estime le concept d’horizon suffisamment plastique pour rendre compte de pratiques mathématiques réelles et variées. Pour ma part je crois pertinent, sinon de l’abandonner, du moins de ne pas en faire un fil conducteur — d’essayer de transposer ce qu’il recèle dans d’autres concepts, une autre terminologie, par exemple celle du virtuel. En me heurtant d’ailleurs vite à une nouvelle limite, liée cette fois à l’approche phénoménologique elle-même, à la possibilité d’arracher totalement la langue de la phénoménalité au perceptible et au sensible. Mon impression, quoi qu’il en soit, était que le concept d’horizon « colle » avec la façon dont un étudiant étudie les mathématiques, mais moins avec celle du mathématicien au travail. Si j’en crois les textes du collectif dirigé par Nathalie Charraud et Pierre Cartier, Le réel en mathématiques[5], il y a moins d’horizontalité qu’on le pense et plus virtuel, donc, mais aussi peut-être de blocage intuitif, d’impossible, si on accepte comme tu le fais de parler le « lacanien ».
P.L. : Je ne prétends pas être capable de répondre en connaissance de cause (j’ai « séché » beaucoup trop de cours de « philosophie des sciences » !), mais j’avoue que j’en doute — beaucoup. Par exemple le « modèle » que propose Cavaillès, avec du vertical, de l’horizontal, du paradigmatique, etc. tout cela n’est pas exactement faux, mais il faut avouer que c’est très insuffisant. Ne parlons pas de Kuhn. Tout cela ne semble pas vraiment rendre compte de la recherche telle qu’elle se fait, ni des « explosions métaphoriques » auxquelles on assiste parfois. Ce ne sont là guère que des commentaires plus ou moins intéressants, à vrai dire pas très intéressants pour les autochtones, un peu comme quelques cartes postales envoyées par des touristes plus ou moins bien renseignés sur un pays que l’on a par ailleurs longtemps habité. C’est en cela que Grothendieck est intéressant. C’est un exemple extrême et j’ose dire que je me « sers » aussi de lui, sans vergogne, comme « garant ». C’est-à-dire que ce qu’il écrit, étant donné son passé, acquiert naturellement une force et une autorité très grande, que des réflexions analogues, ou peu s’en faut, n’auraient pas sous la plume d’un « quidam ».
J’en arrive à une question plus générale. Celle des transferts, des influences entre mathématiques, philosophie, autres champs de pensée. Jules Vuillemin en fait le fil conducteur de son livre sur la philosophie de l’algèbre[6] — il étudie en miroir les unes des autres les controverses philosophiques et mathématiques : la question de l’analyse et de l’infini entre Descartes et Leibniz, plus tard la recherche de systématicité en philosophie avec la révolution kantienne, les grands systèmes de la philosophie classique allemande et l’évolution des façons de traiter la question de la résolution des polynômes de degré supérieur à trois chez Lagrange, Gauss, Abel, Galois bien sûr, une perspective qu’on peut juger trop systématique, justement, et étroite. On peut aussi poser la question dans un tout autre sens : ne pas chercher des ressemblance, des congruences, mais au contraire s’intéresser à la capacité des mathématiques à libérer la pensée philosophique de ses intuitions, de forcer — au sens ou le symbolique lacanien force à travers l’imaginaire. Pour en venir à ton propre travail, en quel sens Grothendieck peut-il être une occasion pour la philosophie ? Qu’ouvre-t-il, que libère-t-il, que bouscule-t-il pour elle ? Plus généralement, que faire, aujourd’hui, des mathématiques? Comment, pour le dire avec tes mots, « cette lucarne des mathématiques peut-elle nous aider à regarder vers l’avenir ? »
P.L. : Là encore, je suis loin de posséder l’érudition qui serait nécessaire pour te répondre sur bien des points et j’avouerai même que je ne suis guère enclin à tenter de l’acquérir. Que certaines démarches mathématiques puissent inspirer la philosophie sans tomber dans l’écueil toujours très présent et menaçant du « modèle », de la formalisation facile, je n’en doute pas. J’ai été par exemple quant à moi impressionné par certaines — très longues — notes en bas de page de Hegel (et pas seulement celle qui est souvent citée), dans lesquelles il développe une vue des mathématiques, dont techniquement il est clair qu’il ignore à peu près tout, une vue qui rappelle les audaces de Galois, exactement contemporaines et dont Hegel n’a pas eu connaissance.
Je crois que c’est justement à propos de Hegel que J.-Y. Girard écrit que la philosophie demeure pour les mathématiques « une source inégalée de potentialités inventives ».
P.L. : Je préfère, quitte à y revenir plus bas, souligner la place qu’occupe une forme de métaphore ou métaphorisation dans les « découvertes » mathématiques les plus extraordinaires, les plus inattendues, celles qui véritablement « ouvrent des portes ». Je ne sais si la philosophie pourrait s’inspirer de ces audaces, ni comment. Je dirais qu’en ce moment la psychanalyse, en particulier lacanienne, mais paradoxalement peut-être dans sa « guise » tout à fait non mathématique, me semble plus pertinente pour aborder le thème très délicat du rapport entre mathématiques et … reste du monde.
J’en profite, au risque de faire un peu catalogue, pour me référer à une autre approche, celle de Jean-Michel Salanskis, qui parle des mathématiques comme d’une herméneutique formelle. Une herméneutique de quoi ? De certaines idéalités, termes, ouvertures, envois – l’infini le contenu, l’espace. Qu’est-ce que cette herméneutique a de spécifique ? Le fait que le cheminements herméneutique et interprétatif passe par des gestes de preuve et de calcul – et le formel est précisément le lieu du dessaisissement qui est préalable à toute démarche, à toute posture herméneutique. Qu’est-ce que cela t’inspire ?
P.L. : Très franchement ceci me semble beaucoup trop « abstrait » au mauvais sens de ce terme. Non, je ne crois pas que l’expression « herméneutique formelle », qui peut rappeler Cavaillès, apporte beaucoup de lumière sur les mathématiques, et je note que les préoccupation sur l’infini, l’espace et le continu sont à la fois à la base du développement du calcul infinitésimal et des acteurs obligés de la « crise des fondements » au tournant du vingtième siècle. Pour moi il est clair que Husserl en particulier pose toutes les mauvaises questions, ou du moins celle du monde d’hier, d’avant la Grande Guerre.
Lorsqu’il parle d’herméneutique, il s’agit de l’herméneutique d’une idéalité — d’une adresse posée par un terme. Et d’une herméneutique bien particulière, car il n’est pas question de déplier un sens recelé dans le terme, mais d’une démarche qui a sa part d’invention. Le terme questionne : on propose des réponses à cette impulsion questionnante par un chemin formel.
P.L. : Même, en quoi le terme pose-t-il de prime abord question ? En quoi le concept d’espace pose-t-il question ? En quoi celui de continu pose-t-il question ? Les mathématiques ne procèdent justement pas par la réflexion sur le terme, sur le concept. Elles sont fondamentalement distinctes de la philosophie, aristotélicienne ou non. Il est possible que les mots de la physique, eux, posent plus immédiatement question. Ainsi les mots de « masse » ou d’« énergie ». Nul ne sait pourquoi la masse gravifique et la masse inertielle coïncident, ce qui permet de les supprimer des deux côtés de la loi newtonienne de la gravitation universelle. Ou encore, entre Aristote et le dix-neuvième siècle le mot « énergie » est en réserve de la physique et il revient à Einstein de le mettre en rapport avec la masse. Ces mots, celui de masse surtout, renvoient à des réalités immédiates — non médiatisées. Mais on pourrait rester des siècles à réfléchir aux termes de « points » ou d’« espace, » et on l’a fait, sans jamais « inventer » les topologies de Grothendieck. À chaque fois la nouveauté se base sur des motivations intramathématiques très fortes. Tout est terriblement construit.
Mais justement, Salanskis parle bien d’une herméneutique formelle, médiatisée par le formalisme, pas d’une réflexion. Le terme fait question eut égard à certain horizon, et se questionnement s’incarne au sein d’une tradition formelle, se fait en elle. Salanskis donne l’exemple du continu, car les propriétés autour desquelles les mathématiciens ont l’impression de reconnaitre le continu ont une certaine invariance, au point, dit-il, que Desanti pouvait considérer que le système des grandeurs chez Eudoxe est déjà un modèle des réels de Cantor et Dedekind (ce qui n’est certes pas le cas de l’espace dont l’intuition est au contraire radicalement transformée).
P.L. : Ici, comme pratiquement toujours, nous sommes en retard d’un bon siècle et demi. Le continu, das Kontinuum, est typiquement l’objet phare du dix-neuvième siècle, surtout allemand. Ce qui est intéressant, c’est par exemple le lien entre le continu, les séries de Fourier, Cantor et la théorie des ensembles, dont celle des transfinis et bien entendu ce que l’on a appelé l’hypothèse du Continu, qui a véritablement torturé Cantor pendant bien des années. Je suis désolé de l’écrire mais Desanti connaît très peu de mathématiques, ne les a jamais pratiquées activement (comme Russell, Wittgenstein, les membres du Cercle de Vienne à l’exception de Hahn qui ne prend jamais la parole, etc.). Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu’il écrit, on peut évidemment lire et relire le Théétète et le Timée par exemple, encore que pour moi, ce que racontent les vrais hellénistes de Platon est infiniment plus intéressant, mais finalement on n’en tire pas grand-chose, et on ne rend absolument pas justice à ce qui se fait effectivement en mathématique, depuis un demi-siècle en particulier. Quand on « fait » des mathématiques, on déplace, on transporte. C’est pourquoi il est bien préférable de parler de métaphorisation, de métaphore, comme Yuri Manin, qui est par ailleurs un mathématicien important. Cela rend aussi justice à ce qu’il y a de plus proche de la psychanalyse dans l’activité mathématique.
Peux-tu développer un peu cette idée de mathématiques comme métaphores que tu as déjà évoquée tout à l’heure ?
P.L. : J’ai eu la chance de connaître assez bien, sur le tard, Yuri Ivanovitch Manin, un grand mathématicien malheureusement disparu, qui m’avait demandé de postfacer (et de contribuer à la traduction depuis l’anglais et le russe) le recueil de ses articles non techniques, qu’il a intitulé (déjà dans la première édition russe) : Les mathématiques comme métaphore. Ce titre est excellent. Les mathématiques sont bien en un sens faites d’un empilement de métaphores, toute la question étant de savoir pourquoi cet empilement ne s’effondre pas comme un château de cartes. Pour prendre un ou des exemples, je dirai qu’effectivement Alexandre Grothendieck nous a « transportés » ou il a permis de transporter (alias et littéralement, métaphorisé) des mots comme : « espace », « point », « bord » et d’autres. On touche alors à Lacan, au fait que Grothendieck permet à un concept comme celui d’espace de franchir la frontière entre « imaginaire » et « symbolique », après quoi il conviendrait de s’enfoncer beaucoup plus profondément dans quantité de territoires : herméneutique biblique, théorie des tropes, métaphore et métonymie, Jakobson, Ricœur, Lacan, Derrida, etc. Je m’en suis tenu ici à quelques mots forcément aussi insuffisants que trompeurs. Voir ailleurs pour certains développements, toujours insuffisants et peut-être un peu moins trompeurs ; en ce point comme en bien d’autres, quelques dizaines de pages (au moins !) sont à insérer, dont certaines déjà écrites. Toujours est-il, je l’ai déjà dit, que l’on peut au moins préciser un tout petit peu la phrase bien connue de Kant. Ce qui est caché au plus profond de l’âme humaine, c’est peut-être le schématisme, c’est sûrement l’élan métaphorique : « Sa gerbe n’était ni avare ni haineuse… » écrit Hugo à propos de Booz et Lacan aime à le rappeler. Tout le monde comprend. Pourquoi ? La métaphore est une figure « vive » selon le titre de Ricœur.
Mais la métaphore transfère ou transporte bien « quelque chose ». De quoi se tisse-t-elle ? Quel est son matériau, que transporte-t-elle ? Peut-on parler de structure, d’intuition structurelle ?
P.L. : Non. La théorie des catégories a été construite pour transporter des structures et elle le fait ; on fait même « davantage », avec toutes sortes de catégories supérieures, propérades et que sais-je encore. Mais s’il n’était question que de transporter des structures, il n’y aurait pas de véritables « découvertes ». Ce serait épouvantablement ennuyeux. « Sa gerbe n’était point ni avare ni haineuse », a posteriori peut-être, transporte une « structure » que l’on peut même enseigner à une machine (ah, l’IA !), mais Hugo ne fait pas que transporter des structures (!).
Mais une métaphore poétique s’appuie-t-elle sur la langue de la même façon que la métaphore mathématique sur… les mathématiques existantes ?
P.L. : Encore une fois des termes comme « espace », « point » ou « bord » se construisent lentement, se transportent, s’insèrent dans des métaphores. J’ai essayé de le détailler ailleurs. Mais ce n’est pas plus ou moins « compliqué » que lorsque Lacan commente Booz endormi. Ce n’est pas non plus tout à fait homologue. Pourtant le sujet qui produit des mathématiques, lequel n’est pas nécessairement le « sujet de la science » auquel Lacan se réfère, ce sujet me semble plus proche de ce qui soucie la psychanalyse que du Moi de l’idéalisme allemand, représenté d’abord et surtout par Fichte en l’occurrence, tel que le reprend Husserl et la phénoménologie, avec mille variantes qui vont d’ailleurs jusqu’à la rature pour ne pas dire au reniement. Les différences méritent d’être creusées, en connaissance de cause. On ne peut par exemple pas dire que la différence qui sépare une métonymie d’une métaphore est non pertinente en mathématiques, malgré toutes les critiques que Ricœur adresse à Jakobson à propos de la scandaleuse simplification que celui fait subir à la vénérable théorie des tropes. Toujours est-il qu’il me semble même qu’une théorie des tropes est au moins aussi intéressantes, pour saisir ce qu’il en est des opérations qui nous retiennent, que l’application un peu scolaire d’une doctrine des facultés issue de Kant, ou bien, au-delà, de Saint Thomas, Saint Augustin et Aristote.
J’aime beaucoup cette idée de métaphore. J’ai l’impression aussi qu’elle exprime bien mieux et plus justement quelque chose que je cherchais maladroitement à formuler il y a quelques années, dans un article des Annales de phénoménologie il y a quelques années[7], qui avait en arrière-plan une discussion avec Badiou sur la façon dont les philosophes interprètent les mathématiques – j’essayais de m’opposer à leur ontologisation pour insister sur leur pratique, leur aspiration qui ne cesse d’en déplacer et reconfigurer le paysage, sans avoir les outils, les connaissances suffisantes. Décidément, il est difficile pour un simple philosophe de ne pas dire de bêtises sur les mathématiques.
Je termine par une ultime question : peut-il y avoir à ton avis une métaphoricité de ce type en philosophie ? Ou plus largement, et pour revenir à notre discussion précédente, qu’est-ce que la prise de conscience de cette métaphoricité des mathématiques peut apporter à la philosophie ? Je comprends bien que pour toi, ce n’est pas seulement une question de philosophie des mathématiques, ou de philosophie des sciences, mais du fonctionnement de la pensée, de la façon dont la pensée crée et est emportée dans ce qu’elle crée. Ce qui est mystérieux ici, c’est que les mathématiques non seulement résistent, mais s’épanouissent dans cette métaphoricité. Les mathématiques ont une faculté prodigieuse à se transformer, à se complexifier, et à rester riches dans la technicité et la complexité. Les autres disciplines s’assèchent avec un niveau de technicité bien moins important, au point de devenir inintelligibles. Pour le mathématicien et philosophie Joel Merker, la philosophie et la métaphysique sont en quelque sorte à l’origine des mathématiques, mais « Le niveau « conceptuel-métaphysique » de la mathématique est maintenant dépassé à cause de son élémentarité — ce n’est plus que du B.A.-BA, et les mathématiques sont maintenant bien au-delà! Les réponses non effectives et purement métaphysiques aux questions mathématiques techniques ne sont qu’un premier moment initial dans un vaste parcours imprévisible d’explorations toujours riche en surprises. » Evidemment, cela pose la question de ce qu’i reste alors à la philosophie, de la façon dont elle peut encore se faire sans se contenter d’être une simple épistémologie d’après coup.
En philosophie, d’une part il est beaucoup plus difficile d’aller vers la complexité technique ; celle-ci est rarement la voie la plus sûre vers la rigueur, parce qu’on a affaire à du flou, de l’ambigu. Au bout d’un moment, les distinctions ne dessinent plus rien. Par ailleurs, il ne semble pas si évident en philosophie de transformer, de déplacer les problèmes et les intuitions, en tout cas si vite, si fortement que les mathématiques ? On a envie de postuler un fond, je n’ose dire d’invariance, mais d’inertie dans la philosophie. Certes, cette transformation de la problématicité philosophique comme telle a été au coeur de la philosophie transcendantale et de l’idéalisme spéculatif. Elle a été le projet explicite d’un auteur comme Deleuze, qui a cherché non pas seulement à transformer le site et le langage de la philosophie, mais à faire du déplacement et de l’invention sa matière même. La philosophie, dit Deleuze, n’est pas prisonnière des concepts avec lesquels elle joue ordinairement, qu’elle peut en inventer d’autre… De fait, un certain nombre d’auteurs continuent à interroger ce que peut être la création en philosophie – ce en quoi se nourrit la création conceptuelle au sens de Deleuze, ses mécanismes, ce qui la légitime… Ses difficultés aussi. C’est par exemple un des objets de la pensée d’Alexander Schnell, et un des sujets de l’entretiens que j’ai mené avec lui[8]. Or, la discussion ramène sans cesse à cette question : la philosophie peut-elle créer sinon très rarement, par basculement, transformations profondes, epochale, dirait Heidegger ? Et peut-on se passer en philosophie du mouvement plus lent de la traditionnalisation et de l’inscription dans une institution jamais transparente à elle-même – mais qui ne tolère qu’un degré somme toute réduit de mise en vibration ? Peut-on relancer sans cesse une pensée qui ne prend pas ? Je ne suis pas sûr. J’ai l’impression que la philosophie se nourrit aussi et surtout de petits déplacements, nuances intérieures, degrés de liberté, déplacement d’accents. Il y a un travail constant de réinterprétation — parce qu’il y a une opacité fondamentale dans la philosophie, la langue philosophique. Pour moi, la philosophie a à voir avec cette opacité du sens : elle la montre, la rend visible, la met en scène, mais ne peut le faire que par l’accrétion du passé, la répétition des mots, des catégories, des arguments, même pour y mettre un tremblement intérieur. La vitesse des mathématiques, de la pensée mathématique, semble tout autre — ou peut-être l’est-elle devenue.
P.L. : Vaste question, à laquelle je n’oserai sûrement pas répondre par oui ou par non ! Je ne crois pas du tout que nous sommes à l’heure actuelle en situation d’aborder des questions aussi fines et complexes. Mais je n’aimerais pas simplement « botter en touche », et donc je reviens tout de même à cette question, encore une fois très au-delà de celles que les philosophes des sciences patentés abordent vaille que vaille. Je connais malheureusement mal Deleuze, encore que Différence et répétition est sans doute l’un des livres qui m’a le plus impressionné — je ne prétends cependant pas l’avoir « compris ». Peut-être Grothendieck aurait-il dû rencontrer Deleuze plutôt que Lacan, en particulier à propos du calcul infinitésimal. Mais sans doute c’eût été un autre fiasco !
J’en étais moi-même venu à ce mot de métaphore, à propos des mathématiques, bien des années plus tôt (j’en dis un mot dans Mathématiques et finitude), à travers Saussure, Lacan, le débat entre Derrida et Ricœur, etc. Le mot est je crois fondamentalement juste ; ce n’est évidemment qu’un début, mais c’est aller peut-être un pas au-delà du « schématisme » kantien, fameusement enfoui au plus profond de l’âme humaine. D’autant que l’IA nous provoque malgré tout à des explorations plus précises. Pourquoi, en quoi les métaphores mathématiques sont-elles plus « solides » que les autres, celles des poètes ou du langage ordinaire ? Qu’elles le soient me paraît un fait difficilement contournable. La preuve en est, s’il en faut une, qu’il est possible de les entasser, disons de les superposer, sans que l’édifice ne s’écroule. Pourquoi ? Je ne prétends pas connaître la réponse mais les études de cas sont déjà très parlantes. Je crois aussi, je l’avoue, que la psychanalyse est ici d’une aide plus immédiate et féconde que la phénoménologie par exemple. Dit autrement, le sujet de l’analyse, tel que formalisé par Lacan, me semble plus pertinent que le Moi de la phénoménologie, surtout si on le rapporte à celui de l’idéalisme transcendantal et à ses racines dans le romantisme allemand, chez Fichte tout particulièrement. Le sujet lacanien est très parlant (avec ou sans jeu de mots !) et susceptible de nous éclairer je crois sur le « sujet mathématicien », à condition tout de même, cela peut sembler paradoxal j’en conviens, d’oublier tout ce que Lacan a pu énoncer au sujet des mathématiques (ni mathèmes, ni nœuds lacaniens !). J’ai avancé par exemple l’idée que Grothendieck lui-même a fait traverser au mot « espace » la frontière qui sépare l’imaginaire du symbolique, en en faisant un « signifiant », où je me réfère si l’on veut, implicitement ou pas, au « premier » Lacan (avant Encore), qui me retient davantage.
Qu’est-ce ou que serait une authentique créativité « conceptuelle », un adjectif que l’on opposera trop rapidement à « artistique », créativité « conceptuelle » et cependant non « scientifique » ? Très franchement je ne me sens pas capable de réponde à cette question, et donc de porter quelque jugement que ce soit sur la possibilité d’un renouveau authentique en philosophie. Deux remarques cependant : pour que quelque chose se renouvelle, il y faut … du nouveau, donc de l’inattendu, du surprenant, qui par nature et par définition ne peut être attendu, et peut donc difficilement être discuté avant son apparition. Manière un peu plus élégante de dire qu’on ne peut répondre à cette question, pas plus que l’on ne peut guère prouver la possibilité du mouvement, sinon en marchant. Heureusement, s’il a subsisté autrefois deux petits nuages noirs dans le ciel presque uniformément bleu de la physique classique, j’aime à croire qu’il est aujourd’hui possible de repérer quelques taches de bleu dans un ciel beaucoup plus vaste et largement envahi par le gris.
***
[1] Bernard Lahire, Les Structures fondamentales des sociétés humaines, Paris, La Découverte, 2023.
[2] Dominique Pradelle, Intuition et idéalités. Phénoménologie des objets mathématiques, PUF, 2020, Être et genèse des idéalités. Un ciel sans éternité, PUF, 2023.
[3] Bourbaki, « L’architecture des mathématiques », dans F. Le Lyonnais, Les grands courants de la pensée mathématique, p. 42
[4] J. Benoist, « Mettre les structures en mouvement: la phénoménologie et la dynamique de l’intuition conceptuelle. Sur la pertinence phénoménologique de la théorie des catégories. », Kerszberg, Patras, Loi (éds), Rediscovering Phenomenology, Phenomenological Essays on Mathematical Beings, Physical Reality, Perception and Consciousness, New York, Springer, 2007
[5] Paris, Agalma, 2004
[6] Jules Vuillemin, La philosophie de l’algèbre, Paris, PUF, 1962.
[7] F. Forestier, « Intuition et invention mathématique », Annales de phénoménologie n°15/2016.
[8] https://www.actu-philosophia.com/entretien-avec-alexander-schnell-sur-la-philosophie/







