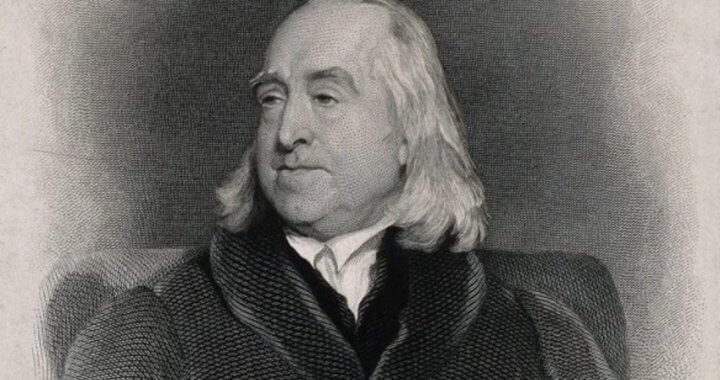« L’homme passe l’homme. »
Blaise Pascal, Pensées[1]
« Je suis animal, et rien de ce qui est animal ne m’est étranger. »
« Au fond, qu’est-ce qui me permet de savoir que la vie de Sami vaut plus que celle de mon chien ? » La question n’avait rien de provocant. Elle me fut posée de manière très sérieuse par un élève de terminale en cours de philosophie. C’était en 2017, peu avant les élections présidentielles. Le Parti Animaliste avait été fondé quelques mois auparavant et faisait campagne pour défendre les droits des animaux. Je ne sais si Sami et son ami s’étaient intéressés à ce programme, mais ils savaient ce qu’était l’antispécisme, et que l’on pouvait mettre en balance la vie de son animal de compagnie avec celle de son camarade de classe.
Cette question méritait une réponse à la hauteur du défi moral à relever : comment savoir, en effet, que telle vie vaut plus que telle autre ? Sous-entendu : qu’est-ce qui me prouve que j’ai raison de respecter davantage un semblable qu’un animal, de le faire passer en premier dans mes choix éthiques ? Sans le savoir, mon élève esquissait « le dilemme du tramway », un classique de la philosophique morale. Cette expérience de pensée, déclinée à l’envi, revient à se demander que faire dans le cas où, en posant un acte qui va sauver un certain nombre de vies, je vais nuire ce faisant à un autre individu. Transposons : s’il me faut trancher entre une portée de chiots et ma grand-mère, qui vais-je épargner ? Qui vais-je sacrifier ? Compliquons l’affaire : entre Médor, mon épagneul bien-aimé, et un groupe de terroristes, qui mérite d’avoir la vie sauve ?
Le trolley problem est le point de départ qu’a choisi Paul Sugy pour passer au crible la pensée antispéciste. Dans son tout premier essai au titre polémique, L’Extinction de l’homme. Le projet fou des antispécistes[2], il confronte entre elles les diverses thèses antispécistes, au risque de mettre en lumière les difficultés qui ne manquent pas de surgir. Celles-ci résistent-elles à l’examen ? Les contradictions pointées trouvent-elles à se résorber ? Faisant la recension de cet ouvrage, le présent article entend donner des pistes de réponse à ces interrogations, sans prétendre pour autant être exhaustif sur un sujet aussi vaste.
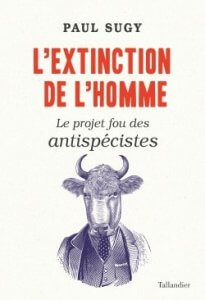
I°) Qu’est-ce que l’antispécisme ?
L’on entend de plus en plus parler du véganisme, « qui exclut, autant que possible en pratique, tout produit d’origine animale (végétalisme) et adopte un mode de vie respectueux des animaux (habillement, cosmétiques, loisirs…)[3]. » Son essor rend compte des préoccupations contemporaines pour la cause animale, lesquelles rejoignent pour une part l’épineuse question écologique sans la recouper entièrement. Souvent embrassé à la suite de campagnes de sensibilisation révélant des scandales de maltraitance animale, le véganisme ne se réclame pas nécessairement de l’antispécisme, même s’il peut y trouver sa justification. En somme, la pratique peut bien se passer de fondements théoriques, alors que l’inverse n’est pas vrai : les théoriciens de l’antispécisme doivent adopter un mode de vie cohérent avec leur manière de penser, sauf à manquer de crédit. Quelles sont donc les origines intellectuelles de l’antispécisme ?
Si les origines du végétarisme remontent à l’Antiquité, l’antispécisme, en revanche, naît plus récemment dans le sillage de l’utilitarisme benthamien. Pour Bentham, le critère fondamental de l’éthique est celui de la sentience, c’est-à-dire de la capacité d’un être à éprouver douleur et plaisir. Ce terme recoupe à la fois la sensibilité et la conscience des affects ressentis. Dans cette optique, est moralement bon ce qui évite la souffrance au plus grand nombre. Il faut ainsi tendre vers la disparition de tout déplaisir, et calculer le meilleur moyen de parvenir à la maximisation du bonheur des membres d’une société. Au sujet des animaux particulièrement, Bentham écrit : « La question n’est pas « peuvent-ils raisonner ? » », ni « « peuvent-ils parler ? », mais « peuvent-ils souffrir ? »[4] »
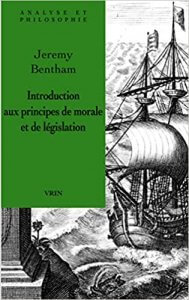
Éviter le malheur de tout être sentient, prendre au sérieux les intérêts de chacun, voilà le point de départ de l’antispécisme qui reprend à son compte l’idéal moral des utilitaristes fondé sur la sensibilité. Or, l’antispéciste part du constat et s’indigne qu’existe « la discrimination d’individus fondée sur le critère de l’espèce », ce qui a pour conséquence que « l’on néglige les intérêts des autres animaux » tandis que « l’on attribue un statut supérieur exceptionnel à l’humain[5]. » Ce « on » coupable est le spéciste, qui discrimine sans raison les « animaux non-humains » au profit des « animaux humains. » Cette nouvelle terminologie est intéressante en ce qu’elle rend compte de l’abolition de toute différence spécifique entre l’homme et l’animal.
« Le spécisme est à l’espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe : la volonté de ne pas prendre en compte (ou de moins prendre en compte) les intérêts de certains au bénéfice d’autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires mais toujours dépourvues de lien logique avec ce qu’elles sont censées justifier.
En pratique, le spécisme est l’idéologie qui justifie et impose l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains de manières qui ne seraient pas acceptées si les victimes étaient humaines[6]. »
Soulignons la reprise analogique du schème marxiste de la lutte des classes, cette fois-ci appliqué à la confrontation homme-animal. Selon les antispécistes, l’être humain serait à l’animal ce que les « capitalistes » ou « bourgeois » capitalistes étaient aux prolétaires : des maîtres exerçant sur eux une tyrannie à renverser. À rebours, « une éthique antispéciste accorde une considération égale aux intérêts de tous les êtres qui éprouvent des sensations, qui sont sensibles à la douleur et au plaisir[7]. » L’antispécisme se déploie donc sur deux versants : pratique comme militantisme, et théorique comme nouvelle idéologie. C’est l’aspect théorique qui retiendra principalement notre attention dans cet article.
II°) Un nouvel humanisme ?
Tel que nous l’avons défini, l’antispécisme semble donc servir une noble cause et ne paraît nullement préjudiciable à l’être humain, puisqu’il peint le tableau d’une humanité enfin réconciliée avec l’ensemble du monde vivant. D’ailleurs, l’on entend parfois qu’il s’agit d’un nouvel humanisme, moins hypocrite parce que plus englobant : plus fraternel parce que moins anthropocentré. Nonobstant cette extension de la « règle d’or » (l’injonction à traiter autrui comme l’on voudrait être traité, qui peut aussi s’exprimer de manière prohibitive : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais point qu’on te fît ») à l’ensemble du monde animal, Paul Sugy voit au contraire dans l’antispécisme une véritable menace anti-humaniste. Cette crainte est-elle fondée ? L’antispécisme, qui se targue d’être « un nouvel humanisme », tient-il vraiment ce qu’il promet ?
Remarquons premièrement que l’humanisme se préoccupe avant tout de l’homme, dont il fait le principe et la fin de sa réflexion. C’est un anthropocentrisme qui implique la reconnaissance de l’homme en tant qu’homme, c’est-à-dire la prise en compte de sa spécificité qui en fait un être absolument irréductible à tout autre. Dès lors, il devient difficile de qualifier l’antispécisme d’« humanisme » alors que ce courant de pensée supprime toute hiérarchie au sein des animaux. Au contraire, dans l’optique antispéciste, l’être humain se voit réduit à son animalité : la pyramide dont l’homme était le sommet le cède à un nivellement où tous les animaux se retrouvent au même niveau.
Par ailleurs, il n’y a d’humanisme à proprement parler que si le discours anthropologique sous-jacent donne à voir l’être humain dans ce qu’il a d’exceptionnel. Car s’il est vrai que l’homme occupe une place à part au sein du vivant, c’est en vertu de facultés qui justifient qu’on lui offre un traitement privilégié. Précisément, aux yeux de l’antispéciste, c’est là que le bât blesse. Pour trois raisons au moins :
- Du point de vue biologique, parce que le réductionnisme animaliste semble corroboré par les nombreuses découvertes de l’éthologie et de la primatologie qui infirment chaque jour davantage l’existence d’un quelconque « propre de l’homme. »
- Du point de vue moral, en raison de la bestialité dont l’homme est capable – bestialité, disons-le sans détour, et tant pis si cela doit écorcher notre orgueil, dont aucun animal ne saura jamais se rendre coupable. À la limite, si l’antispécisme devait reconnaître un « propre » à l’être humain, ce serait sa cruauté. Pour le dire autrement afin de souligner le paradoxe, le signe de l’humanité de l’animal « homme » serait son inhumanité.
- Du point de vue métaphysique enfin, parce que l’ontologie sur laquelle s’appuie l’humanisme traditionnel est infondée. Pire, elle repose sur une ancestrale illusion qu’il est urgent de combattre, car c’est elle qui légitime la domination de l’homme sur le créé.
Le combat de l’antispécisme vise donc explicitement la suprématie autoproclamée de l’être humain, qui « ne relève pas […] d’une loi de la nature mais d’une décision arbitraire[8] » ; à ce compte, il se présente comme un anti-humanisme.
Que répondre à ces trois objections ?
L’impasse du scientisme
Concernant le premier point, notons en premier lieu que si l’homme n’a toujours pas trouvé son « propre », il est bien le seul à le chercher… Ce questionnement inquiet, inassouvissable, archaïque dans la double acception d’originel et de fondateur, ébranle à lui seul la sûreté des raisonnements matérialistes. Que l’homme ne puisse s’empêcher de s’interroger sur ce qu’il est, voilà qui en fait de facto un animal à part : un animal métaphysique. La science peut bien répondre à tous les comment ?, avancer des réponses très sérieuses à la question : « que sommes-nous ? », demeure l’invincible interrogation : « qui sommes-nous ? »
Aussi Paul Sugy met-il en garde contre la tentation du système à laquelle la science, dont se réclament les antispécistes pour étayer leur argumentation, a du mal à résister. Par « tentation systématique », nous qualifions l’ambition de détenir le monopole de la vérité et, conjointement, la prétention à être l’unique explication recevable du réel. Or, Sugy fait remarquer à juste titre qu’on ne voit pas pourquoi l’antispécisme écarterait de son discours sur l’homme d’autres approches que celles de la biologie, surtout si l’homme qu’ausculte le biologiste « n’est pas un homme, mais une abstraction produite par la pensée analytique[9]. » La psychanalyse, la linguistique, la littérature, l’histoire et la philosophie (pour ne citer qu’elles), n’ont-elles pas aussi quelque chose à nous dire sur qui nous sommes ? Pour n’être pas « exactes », toutes ces sciences et disciplines doivent-elles pour autant être frappées de discrédit ?
« L’antispécisme plonge la pensée des hommes dans le néant, puisqu’il affirme que ni nos philosophies, ni nos cultures ne sont suffisamment importantes pour constituer un éventuel « propre de l’homme. » C’est rabaisser la pensée humaine au rang des propriétés accidentelles, et non essentielles, de notre espèce[10]. »
En réalité, à se cantonner rigoureusement aux données de la science, la pensée se met des œillères et s’ampute de la possibilité de mieux comprendre son objet. Allons plus loin et osons affirmer qu’elle se condamne à l’incompréhension de son objet, par étroitesse d’esprit et fermeture au « mystère. » Quoiqu’il n’y fasse pas explicitement référence, Sugy utilise ce terme[11] que l’on trouve sous la plume de Gabriel Marcel lorsqu’il l’oppose au « problème. » Le mystère, écrit ce dernier dans son Journal Métaphysique, « est quelque chose où je me trouve engagé[12] », à la différence du problème qui, ainsi que nous l’apprend l’étymologie grecque, « est quelque chose qu’on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. » En somme, je peux résoudre un problème parce qu’il est par définition objectivable : je peux donc en faire le tour, m’y mesurer, l’absorber. Comment le ferais-je en revanche du mystère qui m’environne et me déborde de toutes parts ? Appréhender l’humanité comme mystère, c’est donc refuser sa biologisation qui finit par la rendre inintelligible.

Reste que cela suppose de s’ouvrir à une forme de transcendance, ce qui peut soulever des difficultés dans la perspective strictement immanentiste qui est celle de l’antispécisme. Comment nier pourtant la transcendance de la conscience, semblant résister aux explications scientifiques ? Pour étayer sa critique du réductionnisme scientiste, Sugy convoque alors Étienne Bimbenet qui, dans son essai magistral Le Complexe des trois singes (2017), récuse l’idée que la science puisse un jour se substituer au « phénomène du vécu. » Sévère à l’encontre de ce qu’il appelle « zoocentrisme », Bimbenet appelle à poser sur l’homme un regard qui ne le dépouille pas de son intériorité ni ne lui ôte l’ensemble dense de significations qui parent sa vie et en font une existence véritable.
L’animalité de l’homme : « une certitude autant qu’un défi[13] »
Quant à l’argument moral, il faut bien comprendre qu’il va de pair avec une forme de misanthropie ou, à tout le moins, de défiance vis-à-vis de notre humaine condition. Car le regard que l’antispéciste pose sur l’être humain n’est pas seulement réducteur (nous ne sommes que des animaux) mais encore peu amène (nous sommes des animaux cruels, voire les pires parmi les prédateurs)[14]. L’engouement pour la cause animale, entre autres origines, s’explique ainsi par le dégoût que l’homme peut ressentir pour sa propre espèce, lui qui si souvent, se montre « un loup » pour son semblable. En somme, nous nous tournerions vers l’animal parce que nous serions las d’être hommes, écœurés et même horrifiés par le pire dont nous nous savons capables. Devant ce constat, deux tentatives d’explication irréconciliables se font face : pour l’antispécisme, l’homme en est arrivé là en raison de son hybris, de sa prétention à se croire supérieur aux autres animaux au point d’asseoir éhontément sur eux son dominium[15]. Pour leurs contradicteurs, l’homme déchoit de sa condition chaque fois qu’il refuse de correspondre à sa nature (le geste par lequel il la nie étant sensiblement identique à celui par lequel il cherche à la transcender). Mais c’est précisément cette vision essentialiste qui se trouve battue en brèche par l’antispécisme.
Or, Paul Sugy parvient à nous faire changer de perspective en soulignant que cette bestialité dont nous pouvons nous rendre coupables révèle en creux l’existence en l’homme d’irréductibles facultés spirituelles. Celles-ci accusent ce qui nous sépare de l’animal plutôt qu’elles ne résorbent l’écart entre lui et nous. Robert Antelme, rescapé des camps de concentration, est cité à l’appui de sa démonstration. On sait que la rhétorique nazie consistait à ravaler les « sous-hommes » au rang d’animal pour justifier leur extermination : selon cette logique, non seulement il n’est pas prohibé d’éliminer des nuisibles, mais c’est là servir l’intérêt général. Or, écrit Antelme dans un article paru en 1945 : « L’homme des camps n’est pas l’abolition de ces différences [entre l’homme et l’animal]. Il est au contraire leur réalisation effective[16]. » Avili, abêti, traité « en bétail d’abattoir[17] », le déporté demeure jusqu’au bout cet être humain que ses bourreaux refusent de considérer en tant que tel. Mais ce refus même atteste l’existence de cette humanité : bafouée, outragée, celle-ci s’avère en même temps imprescriptible et inamissible. Impossible de rejeter ce qui n’existe pas… Ainsi, l’annihilation de tout ce qu’il y a d’humain dans l’homme, l’acharnement haineux à nier ce qui l’exhausse au-delà de la condition animale, révèle paradoxalement l’incommensurable écart qui l’y soustrait. En somme, il suffit qu’on cherche à assimiler l’homme à un animal pour que tout en lui se récrie contre cette réduction. Cette dénégation véhémente n’est pas un déni, mais procède du sursaut de l’esprit qui témoigne de son autonomie à l’égard de la biologie. Alain l’exposait de façon lumineuse en ces termes :
« l’âme, c’est ce qui refuse le corps », précisant aussitôt après que « ces refus sont des faits de l’homme[18] », car seul l’homme est capable de s’arracher à son animalité en posant des actes de volonté libre.
Alors, certes, l’homme peut se comporter pire qu’une bête, mais c’est parce qu’il est plus que ce que sa biologie inscrit en lui. D’ailleurs, c’est le seul animal susceptible de s’indigner ou d’éprouver du ressentiment contre une partie de son espèce qu’il juge indigne de l’homme. Or, si notre inhumanité nous effraie, c’est bien le signe que c’est notre sens moral, et non pas notre cruauté, qui nous définit. Même si l’antispécisme ignore à notre connaissance cette distinction que ne fait pas non plus Paul Sugy, il nous semble important, à ce stade de notre réflexion, de différencier, l’animal, qui jamais ne peut aller à l’encontre de sa nature propre, de la bête comme animal déchu de sa condition. Or, pour déchoir, il faut posséder conscience, liberté et volonté. Seul l’homme le peut donc. Et si, à l’instar de la plupart des antispécistes, l’on refuse une quelconque référence à la « nature », il reste possible de traduire le propos en termes sartriens : l’animal reste au stade de l’en-soi : il est ce qu’il est et ne sera jamais ni plus ni moins que ce qu’il est ; tandis que l’homme, ce pour-soi, expérimente sans cesse l’écart entre un donné et une aspiration, et c’est précisément dans cet écart que s’immisce et se déploie sa liberté. Laquelle est même cet écart, cette visée, cette tension vers autre chose qui manque et n’est pas encore là. La modalité d’être-au-monde propre au pour-soi est donc la non-coïncidence d’avec soi, et c’est pourquoi il lui est toujours possible de se trahir en s’inventant.
L’argument de l’illusion
Enfin, le dernier argument avancé par l’antispécisme pour ruiner l’idée d’une exception humaine est sans doute le plus difficile à réfuter, précisément parce qu’il allègue l’illusion. Or, comment se défendre d’en être victime sans, par là, donner la preuve du contraire ?! Il nous semble donc pour cette raison très important de prendre au sérieux le raisonnement antispéciste quand il oppose à la supériorité de l’être humain celle de son égale dignité avec l’animal. Avant tout, il nous faut définir l’illusion. Appelons illusion une erreur d’interprétation persistante, fruit d’une croyance à laquelle nous tenons bien qu’elle soit fallacieuse, soit parce qu’elle nous est utile, soit parce qu’elle nous est agréable en tant qu’elle flatte l’image que nous nous faisons de nous-mêmes. En l’occurrence ici, l’illusion de notre exception nous magnifierait à l’excès tout en justifiant notre mission de « maîtres et possesseurs de la nature », pour reprendre la célèbre expression de Descartes[19]. Elle nous serait donc aussi bien agréable qu’utile. Le problème de l’illusion est que ni les raisonnements, ni la mise au contact du réel ne parviennent à l’abolir. C’est ce qui explique qu’elle contribue à perpétuer tout système qu’elle fonde et justifie. Dans le cas qui nous occupe, ce système s’appelle le « spécisme » tel que nous l’avons défini au préalable.
La question à laquelle il devient nécessaire de répondre est donc la suivante : qu’est-ce qui nous assure que nous ne sommes pas dans l’illusion quant à notre caractère d’exception ? Refuser d’admettre l’idée d’un continuum biologique de l’animal à l’homme, c’est faire mentir la science et se décrédibiliser d’emblée. Habilement, Paul Sugy ne prétend pas s’aventurer sur ce terrain mais concède volontiers, exemples à l’appui, que les découvertes des scientifiques rendent caduque notre prétention à détenir le monopole du langage, de la capacité à apprendre, à transmettre, à s’organiser en « sociétés » etc. Aussi retourne-t-il la question à ses contradicteurs, tout en la déplaçant sur un autre plan : ce n’est pas de la biologie que l’homme peut attendre la révélation de son identité, car la science ne peut rien dire au sujet de sa finalité. La laisser en décréter par elle-même, en cela réside l’illusion.
Ainsi, par un renversement de perspective, Sugy nous entraîne à penser que s’il est illusoire de s’enorgueillir de « propres » dont nous apprenons qu’ils sont en réalité donnés en partage à d’autres « animaux non-humains », il est tout aussi illusoire d’en conclure que nous pouvons nous contenter du verdict de la science et nous arrêter là.
L’antispéciste lui-même n’en disconvient pas, qui reconnaît à l’homme une responsabilité particulière à l’égard de la cause animale. Or, précisément, on peut appeler « cause » le combat en faveur d’une abolition de la souffrance animale parce que l’être qui s’y voue est un être responsable et, partant, comptable de ses actes. Devoirs de l’homme envers les animaux et imputabilité vont de pair et procèdent d’une même reconnaissance, selon laquelle l’être humain est un animal si peu « comme les autres » qu’à lui seul est dévolue la mission de les préserver tous ! C’est si vrai qu’un des points forts de la démonstration de Sugy est de montrer qu’il est dans l’essence et dans la logique même de l’antispécisme d’être interventionniste au point de provoquer cela même qu’il redoute tant, à savoir le « colonialisme » du monde animal. Le remède serait-il donc pire que le mal ? Ou, pour le dire autrement, si l’homme n’occupe aucune place à part dans la nature, de quel droit s’arroge-t-il donc celui d’en octroyer aux animaux ? N’est-ce pas contradictoire avec la nécessité revendiquée de se retirer du monde animal ?
Nous voici donc face à une double contradiction : d’une part, l’homme ne peut légitimement exercer à l’égard des animaux la mission dont il se sent investie sauf à reconnaître qu’il possède un je-ne-sais-quoi qui l’en rend non seulement capable, mais plus encore qui l’oblige. Réciproquement, à ne pas vouloir se distinguer des autres animaux, l’homme se prive de la possibilité de justifier son action auprès d’eux. D’autre part, l’être humain ne peut pas à la fois renoncer à toute forme d’entrisme au sein du monde animal, et intervenir sans que cela passe pour une forme d’ingérence coupable.
Paul Sugy : L’extinction de l’homme. Le projet fou des antispécistes (partie II)
[1] Blaise Pascal, Pensées, Fragment « Contrariétés » n° 14 / 14, Brunschvicg 434 / Lafuma 131 / Sellier 164.
[2] Paul Sugy, L’Extinction de l’homme. Le projet fou des antispécistes, Paris, Tallandier, 2021.
[3] https://www.vegan-france.fr/blog/definitions-du-veganisme/
[4] Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, 1789, chap. XVII.
[5] https://www.cahiers-antispecistes.org/le-specisme/
[6] https://www.cahiers-antispecistes.org/le-specisme/
[7] https://www.l214.com/antispecisme
[8] Sugy, L’Extinction de l’homme. Le projet fou des antispécistes, Tallandier, 2021, p. 118.
[9] Sugy, op. cit., p. 140.
[10] Ibidem, p. 25.
[11] Ibid. p. 24.
[12] Gabriel Marcel, Être et avoir. Journal métaphysique 1928-1933, Montaigne, 1935, p. 144-146.
[13] Sugy, op. cit., p. 132-133.
[14] Certes, il s’agirait de nuancer le propos en rendant compte des différentes mouvances qui existent au sein même de l’antispécisme. Toutefois, une même visée déconstructionniste irrigue ce courant de pensée qui prend le contre-pied de l’anthropologie classique et « [remet radicalement en cause les] fondements et [l]es acquis de notre civilisation. » (cf. Sugy, op. cit., chap. IV « Le retour du matérialisme », particulièrement les p. 129-130). Nous développons ce point un peu plus loin.
[15] Cf. Gn, 1, 28.
[16] Robert Antelme, in « Vengeance ? », revue Les Vivants, paru en 1945, cité par Paul Sugy, op. cit., p. 102.
[17] Psaume 43, 23.
[18] Alain, Définitions, 1953, « Âme. »
[19] Extrait du Discours de la méthode (1637), VIe partie. Expression stricto sensu : « comme maîtres et possesseurs de la nature. »