Fichte et Schelling : Sur l’essence du savant et la philosophie de la nature (1805-1806) (partie I)
III. Présentation du véritable rapport de la philosophie de la nature à la doctrine fichtéenne améliorée. Écrit pour expliciter la première (1806) par Schelling
Schelling écrit avec ces deux textes assemblés une réponse directe aux allusions du texte de Fichte ; c’est aussi l’occasion pour lui d’exposer les points centraux de son système par contraste, sans pour autant rester relatif au système fichtéen. L’exposé sur le savant n’est qu’un symptôme de ce dernier dont le texte de Schelling va reprendre longuement la mécanique et – il faut bien le dire ici – s’amuser à relever les contradictions et inconséquences. Comme l’indiquent les traducteurs dans leur présentation, si Schelling accepte les premiers principes de Fichte, il s’étonne avec Hegel et Hölderlin de la séparation qu’opère ensuite Fichte dans l’exposition de l’Idée divine, et conclut : « cette séparation en un monde propre à l’effectivité prouve même que dans le monde de la pensée, Dieu n’a pas été posé » (p. 162). Au-delà de ce contexte et de la férocité des expressions, ce texte de Schelling est un abandon clair et définitif de Fichte ; et nous pouvons d’emblée citer un autre texte de 1841, cette fois-ci débarrassé de toute ambiance polémique, mais qui confirme et résume « à froid », plus calmement, le fond des problèmes ici en jeu :
« Avec le moi nous est donné le principe d’un mouvement nécessaire (substantiel), le moi n’est pas un principe immobile, il est un principe qui nécessairement se détermine en avançant – mais c’est là quelque chose que Fichte n’utilise pas. Pour Fichte, ce n’est pas le moi qui se meut à travers tous les degrés du processus nécessaire par lequel il parvient à la conscience de soi et qui passe même à travers la nature, la posant ainsi vraiment pour la première fois dans le moi ; ce n’est pas le moi lui-même qui se meut, mais, selon lui, tout est plutôt rattaché au moi simplement du dehors, par une réflexion subjective, par la réflexion du philosophe, et non acquis par une évolution intérieure du moi, donc par un mouvement de l’objet lui-même ; et cette corrélation subjective au principe a lieu grâce à un raisonnement si arbitraire et si contingent qu’on a du mal, nous l’avons dit, à distinguer le fil qui passe à travers le tout[1] »
Nous tenterons dans la quatrième partie de notre propos d’éclaircir et de « distinguer » ce lien, cette « corrélation » qu’opère Fichte dans son système. Mais pour le moment revenons au texte où Schelling insiste sur cette ex-position du système fichtéen qui, posant le Moi en Non-Moi, ne fait plus de la Nature qu’une limite morte et l’interminable annonce en devoir-être d’un Absolu toujours de plus en plus pris dans une sorte d’avenir sans devenir. Schelling pose alors la question suivante :
« Est-il essentiel ou non à Dieu de s’exposer au-dehors ? Fichte ne s’est pas expliqué clairement à ce sujet ; si l’on en croit une déclaration indirecte, il devrait plutôt choisir la première possibilité. Mais, dans ce cas, Dieu est conditionné dans son exposition, autrement dit dans ce qui lui est essentiel, par les lois immuables d’une exposition extérieure en générale, qui, comme telles, sont indépendantes de lui. » (p. 143 sq).
Autrement dit, le système de Fichte veut une réalisation de l’idée divine sans expliquer pourquoi cet inconditionné se conditionne cependant, donc sans expliquer pourquoi l’Absolu doit nécessairement se perdre par une séparation de lui-même. Alors le système schellingien répond sur ce plan que la vie divine est identique à la nature et se réalise déjà effectivement comme nature. Dans le système de Fichte selon Schelling, ce n’est que la réflexion qui extériorise arbitrairement Dieu et en fait une simple médiation (p. 165) : ce n’est pas la totalité libre qui est connue et sue, mais la limite et la dépendance (p. 178).
Contre cela, Schelling pose les deux problèmes philosophiques que son système prétend résoudre : celui du connaître et de l’être, et l’autre, celui de l’infini et du fini (p. 179). Avant de les utiliser pour examiner la philosophie de Fichte, il enchaîne ainsi pour introduire à sa propre pensée :
« L’idéalisme, s’il considère effectivement la connaissance absolue, à savoir l’affirmation de soi, pénètre sûrement jusqu’à l’indifférence de celle-ci avec l’être, et se résout en son contraire. C’est comme un idéalisme de ce genre que nous avons compris la doctrine de Fichte, car par « moi absolu » nous n’avons jamais entendu que l’affirmation de soi absolue et par suite la forme éternelle dans l’essence éternelle. » (p. 180).

Et de poursuivre ensuite longuement sur l’autre problème pour conclure sur le même mode de l’indifférence :
« Dans cette identité vivante, tu as donc en même temps le conflit, ou la vie, et l’unité, ou l’apaisement de la vie. Le conflit, car l’unité est affirmée dans la multiplicité comme dans une éternelle rébellion contre elle-même ; l’unité, car le tranquille accord avec soi de l’essence perce à travers l’opposition, ou la multiplicité, et par cette seule percée se rend manifeste, en même temps qu’elle rend manifeste l’opposition. L’essence s’enfante dans la forme, et le fruit qu’elle donne dans cette naissance, c’est seulement elle-même, c’est-à-dire l’unité : elle a l’opposition en soi, éternellement et sans origine ; mais, ne révélant dans l’opposition que l’harmonie originaire de son égalité à soi, quand elle en sort, c’est comme tout, comme totalité absolue.(…) La nature elle-même n’est que l’être-là divin dans sa complétude, ou Dieu considéré dans l’effectivité de sa vie et dans son autorévélation. » (p. 184, sq).
C’est fort de ce condensé de son système et de ses optiques aptes à la résolution de ces grands problèmes que Schelling va alors encore revenir à Fichte (p. 189) pour les lui retourner, montrer ici toute sa déception pour la manière fichtéenne « génétique » : le savoir s’identifiant à l’être selon Schelling, il n’est plus nécessaire comme avec Fichte de faire d’abord venir le savoir à l’être (p. 192) ou de distinguer des modes d’apparaître et leurs explications respectives : faire cela, pour Schelling comme pour Hegel, c’est montrer que le système a renoncé devant les limitations à connaître, et n’a donc pas droit de revendiquer l’Absolu qu’il ne fait qu’annoncer interminablement sans le réaliser effectivement. Schelling rappelle à l’appui deux textes de Fichte :
« Quoi qu’il en soit de l’être et de l’être-là, Dieu, entre autres choses, est là : il faut donc bien qu’il existe une connexion entre les deux. D’après les Leçons d’Erlangen (p 332), cette connexion peut être aperçue eu égard au Que, mais pas eu égard au Comment ; la connaissance en est donc factuelle, puisqu’elle ne peut être génétique (il en ressort que toute connaissance doit être ou bien factuelle ou bien génétique et que la connaissance absolue tombe donc exactement entre les deux) … Dans la Vie bienheureuse : « L’être qui n’est jamais devenu, comme on peut seulement le trouver, mais nullement le saisir génétiquement, cet être est aussi, extérieurement » (p. 194)
Selon Schelling, maintenir le transcendantal à la manière de Fichte, c’est falsifier l’Absolu, n’en faire qu’un reflet, un vague écho du point de vue des limitations toutes humaines de la réflexion :
« la vie divine ? A-t-elle peur d’éclater dans sa totalité ? Et comment pose-t-elle ou bien produit-elle la limite ? Ce comment est à coup sûr plus important que le pourquoi que l’on pose d’habitude quand on ne trouve pas de réponse au comment. Il va sans dire qu’une progression continue à l’infini est déjà elle-même la finitude tout entière dans sa figure la plus précaire et que l’explication est parfaitement circulaire. » (p. 197).
Ce reflet tout humain en cercle, n’a d’ailleurs pas logiquement de justification, et ne peut même plus prétendre à l’analogie ou à la projection par induction puisque que le Moi fichtéen n’est, en tant que point de vue tout humain, que la surface de réflexion « naturelle » de la conscience de l’Absolu ; Schelling commente alors cruellement :
« Si l’être qui porte la vie en soi n’est changé en mort que par le regard mort du spectateur mort, le moi absolu est le fondement de toute mort et est mort lui-même ; il est alors le principe mauvais dans l’univers, le dieu de ce monde et non pas le vrai Dieu » (p. 207).
Ce que le texte de Fichte révèle de la Nature, – nature qui n’est que convoquée par l’Absolu, mais non posée, sinon comme simple présupposé de l’extériorisation divine que Fichte avoue d’ailleurs ne pas pouvoir démontrer – n’est donc en définitive, du point de vue de Schelling, qu’une ancienne reprise de la philosophie mécaniste cartésienne, et non pas une nature révélant la dynamique vivante propre à l’Absolu ; et Schelling cite pour finir un extrait qui résonne d’ailleurs étrangement dans le contexte actuel :
« M. Fichte ne manifeste toujours pas une connaissance de la nature plus large que celle que l’on a déjà souvent mentionnée : « qu’aujourd’hui encore plusieurs contrées sont couvertes de marais putrides et de forêts impénétrables, dont l’atmosphère froide et croupissante donne naissance à des insectes venimeux et exhale des effluves générateurs d’épidémie dévastatrices » (Caractère de l’époque actuelle, p. 87) » (p. 219).
IV. Perspectives critiques sur la réflexion chez Fichte et Schelling
Afin d’éviter de se laisser enfermer dans une lecture de Fichte trop unilatérale et dogmatique, attaquée de toutes parts, il semble nécessaire de reprendre l’un des principaux problèmes qui anime son texte : il nous semble nécessaire de l’aborder et de le penser plus exactement sous l’angle de la réflexibilité du savoir qu’incarne le savant. Comme nous l’avons indiqué plus haut, celle-ci a selon Fichte la capacité de se dédoubler, et c’est peut-être cela que Schelling ne met pas suffisamment en perspective dans sa lecture et sa critique de Fichte. Or, l’interprétation fichtéenne du transcendantal consiste très précisément à mettre en évidence cette capacité de la réflexion : elle met alors en évidence dans son dédoublement les conditions de la question même de toutes conditions de possibilités.
Le point de dissension entre Fichte et Schelling porte principalement sur leur conception de la réflexion et de son pouvoir spéculatif systématique : malheureusement dans ce texte, Fichte ne fait souvent que mentionner comme en passant ce concept de réflexion, sans le développer, alors qu’il est au centre de son exposé sur le savant, dans la mesure où ceux-ci « sont dans la pensée divine tels que Dieu réfléchit en partie sa pensée fondamentale du monde ; ils sont des savants en particulier, en tant qu’ils se sont élevés à cette pensée par les moyens de la culture spirituelle la plus élevée existant dans toutes les époques, mais pas sans le concours de la pensée divine » (p. 71). Pourquoi l’Absolu ne se « réfléchit »-il qu’en « partie » ? Fichte n’a peut-être pas mesuré dans son propos le risque qu’il encourait à prendre le problème dans la perspective du savant, lequel rejoue en quelque sorte l’Absolu, mais dans une position qui met en danger le système, car le savant apparaît alors comme un dérivé en dépôt du transcendantal dans son mouvement génétique. Ici, pour prendre la mesure de la difficulté, nous pouvons à nouveau mobiliser le très profond essai d’Alexander Schnell pour caractériser plus précisément ce mouvement de la réflexion :
« Pour Fichte, l’idéalisme schellingien s’arrête toujours au premier niveau réflexif. Schelling n’est pas passé à côté de la réflexion, mais à côté du Grundreflex qui est donc cette réflexion de la réflexion (…) Pour Schelling, Fichte n’arrive pas à sortir du fini pour parvenir à l’infini spéculatif (c’est-à-dire à l’identité absolue du fini et de l’infini) ; pour Fichte, Schelling ne parvient pas à déduire le multiple fini à partir de l’infini (reproche qu’il fait simultanément à Spinoza). (…) L’absolu n’existe pas sous n’importe quelle forme ; ce dont il faut bien plutôt rendre compte c’est de la manière dont l’absolu apparaît sous elle, ainsi que du rapport absolu/forme qui exprime l’extériorisation de l’absolu dans le savoir absolu – (la seule forme d’existence qu’on puisse lui attribuer) – voilà comment on peut résumer le dernier argument fichtéen[2]. »

Et c’est ce mode de l’extériorisation qui intéresse Fichte au fond parce que l’extériorisation dépasse la question du Quoi ? propre à l’être (qui n’est qu’un dépôt), pour poser la question du Comment ? : alors seulement,
« toute connaissance philosophique est, d’après sa nature, non pas factuelle, mais génétique, elle ne saisit pas quelque chose de stable, mais engendre et construit intérieurement cet être depuis la racine de sa vie. Comment est-il devenu savant ? Et – puisque même son être et son être-devenu sont un être vivant ininterrompu et, à chaque moment, un être qui s’engendre lui-même, comment se maintient-il comme savant ? Je réponds : par l’amour pour l’idée, amour qui demeure en lui, qui constitue et absorbe en soi sa personnalité (…) nous disons en nous accommodant de l’apparence, que cet homme aime l’idée et vit en elle, alors que, selon la vérité, c’est l’idée elle-même qui vit et s’aime à sa place et dans sa personne, et que sa personne est uniquement l’apparition sensible de cet être-là de l’idée, laquelle personne n’est là ou ne vit aucunement en et pour soi-même. » (p. 44).
Ce que tente Fichte, c’est toujours de déduire la multiplicité du fini à partir de l’infini, mais ici, le risque est que ce fini est savant, donc transparent à l’infini qu’il exprime lui-même, puisque
« l’homme est lui-même l’exposition de la vie originaire et divine et peut dès lors le voir en général. Que l’homme puisse voir cela signifie que l’exposition peut revenir à son origine, en la reproduisant avec une certitude absolue eu égard au Que ; nullement, toutefois, en la répétant et en l’effectuant encore une fois en fait et en vérité ; l’homme peut voir cela eu égard au Que mais non au Comment : on ne peut concevoir comment ni pourquoi c’est précisément une telle vie temporelle continue et déterminée qui surgit de la vie divine une, que si l’on conçoit toutes les parties de cette vie temporelle en une saisie complète. Cette vie temporelle continue est infinie, la saisie de ses parties ne peut donc jamais être achevée : or, ce qui conçoit est lui-même la vie temporelle et se trouve, en chaque point où l’on veut bien le penser, lui-même enchaîné dans la finitude et les bornes qu’il ne peut jamais abolir totalement sans cesser d’être l’exposition et sans se métamorphoser en l’essence divine elle-même. » (p. 50)
La tension contradictoire du discours fichtéen est évidente si l’on superpose ainsi ces deux textes : d’abord la philosophie génétique pose la question du Comment, puis elle reste face à cette question du mode sans réponse ; mais c’est précisément parce que Fichte ne veut pas déduire du fini l’infini, et c’est pourquoi au début de sa première leçon il insiste sur le fait qu’il faut « présupposer l’essence » du savant (p. 40) afin « d’éventuellement en engendrer la vision » à partir du « fondement supérieur de l’apparition » qui est l’idée divine (p. 41). Or, c’est ce fondement, ce « Grundreflex » qui est précisément la clé de la déduction selon la réflexion de la réflexion, c’est-à-dire que la Nature est effectivement un dépôt, mais un dépôt en tant qu’il est posé par la conscience comme conscience qui se donne à elle-même ses conditions de possibilités, les modes de son apparition. Lorsque le recenseur de Iéna relève et questionne le texte de Fichte ainsi : « comment donc cette nature qui n’a ni être ni être-là peut-elle ainsi disposer quelque chose ? D’où le non-être et la mort tireraient-ils cette puissance ? Il est dit aussi plus loin « que c’est l’idée elle-même qui, par une force propre, se procure en l’homme une vie autonome et personnelle (ce qui veut bien dire individuelle) : si c’est l’idée elle-même qui fait cela, comment la nature le fait-elle alors, elle qui n’est ni n’est là, et doit être toujours davantage supprimée ? » (p. 125), Fichte ne peut que répondre que la nature est ici prise dans un sens différent (note 12, p. 133), et qu’il n’a pas à effectuer la déduction à partir du dépôt de la conscience puisqu’il estime avoir déduit celle-ci à partir du fondement. Le conditionné ne peut déduire l’inconditionné et ne peut, à ce niveau, que rester muet comme la matière en elle-même face à la question du Comment ? Ce n’est pas que « Dieu est conditionné dans son exposition » (p. 144) comme le croit Schelling, mais que Dieu expose toute condition ; et il est vrai, Fichte, parce qu’il présuppose ce fondement de l’apparition, doit en permanence rattraper ce fond ou refluer vers lui à partir de l’apparition en détaillant les modes de l’extériorisation à un niveau non divin.
Fichte conclut pour expliquer la contradiction apparente :
« Le Comment dont il est question ici se réfère uniquement à la détermination matérielle qui restera éternellement incomprise, mais nullement à l’élément formel. En ce qui concerne ce dernier, il est parfaitement démontrable que l’être-là dans son immédiateté ne peut être que conscience… la nature n’étant rien d’autre que le conscient, est médiatisée et posée par la conscience ; mais l’inverse n’est pas vrai. Sans doute, dans la mesure où la nature est pénétrée par ce concept, elle se trouve par-là même transformée en vie ; et cela s’accroît en une progression infinie. » (p 133)
Mais là-dessus, Schelling ne peut que faire remarquer que « l’exposition de la vie divine se trouve elle-même directement affectée par l’ens imaginationis d’un temps infini. » (p. 145) et sur cette vie qui se solutionne dans « l’amour » tout en prétendant atteindre là le sommet de la vraie science, on ne peut évidemment qu’accepter les ironiques remarques de Schelling :
« Comment se fait-il, demande Fichte, que l’être qui n’entre absolument pas de manière pure dans la forme, est cependant connecté à cette dernière ? La forme n’expulse-t-elle pas inexorablement hors de soi et n’installe-t-elle pas un deuxième être, absolument nouveau, alors que cet être nouveau et second est justement tout à fait impossible ? Réponse : pose seulement à la place de tout Comment un simple Que. L’un et l’autre sont simplement connectés (désormais la connexion des deux n’est plus connaissable de manière simplement factuelle, bien qu’elle ne le soit pas non plus de manière génétique) : un tel lien existe parfaitement qui, plus haut que toute réflexion, ne prenant sa source dans aucune réflexion et ne reconnaissant l’autorité d’aucune réflexion, – éclos avec et à côté de la réflexion ». – Ce lien est l’amour ; dans cet amour, Dieu et l’homme ne font qu’un, ils ont complètement fusionné. Cet amour est le point où s’entrecroisent (l’identité absolue, la copule) ce que nous avons appelé plus haut A et B (…) et c’est le même amour qui conduit la réflexion à s’anéantir en Dieu, de même alors que cette réflexion s’anéantissant elle-même et devenue amour divin (devenue ce lien) est le point de vue de la vraie science » (p. 195).
Ainsi, selon Schelling, le système fichtéen a-t-il pour conséquence paradoxale de retomber dans le factuel qu’il condamnait au départ en promettant de faire connaître le mode d’extériorisation, lequel se révèle inconnaissable (voir néo-mystique) dans ce texte : la question du mode d’engendrement est promise, elle oriente même, mais elle finit par se consumer dans l’amour. Schelling résume froidement :
« Fichte a compris la subject-objectivation de l’absolu comme une exposition de soi, en lui ajoutant aussitôt le contresens d’une sortie au dehors. » (p. 151) ;
car ici sa pensée de la réflexion vient prendre en charge certains éléments du Grundreflex de Fichte, mais avec des conséquences très différentes :
« Pour Schelling, le contenu du savoir fait partie intégrante de la saisie de soi du Moi. (…) Dans la première série de réflexions, celle propre à la philosophie de la nature, le Moi produit inconsciemment les moments d’auto-objectivation – qui apparaissent au Moi comme des réalités indépendantes de lui. Tout le processus consiste ici à élever le Moi inconscient au Moi conscient – à « théoriser » la nature, à « subjectiver » l’objet. Dans la seconde série, qui est propre à la philosophie transcendantale, le Moi prend le sens inverse. Ici, il produit les moments dans lesquels il s’auto-objective. Cela implique deux « Moi » : un Moi « naturel » qui opère ces productions, et un Moi « transcendantal » qui comprend ce processus. (…) D’où la méthode spécifique de la philosophie transcendantale : celle-ci procède au niveau de chaque puissance à l’auto-intuition du Moi et consiste ensuite à conduire le Moi (…) d’un niveau à chaque fois supérieur. Le niveau (ou la puissance) ultime est celui (celle) où le Moi sera finalement posé avec toutes les déterminations qui ont donc déjà été contenues dans l’acte libre et conscient de la conscience de soi (acte qui caractérise précisément le point de vue du philosophe). (…) L’ « histoire transcendantale du Moi » correspond ainsi à la traversée des « époques » de l’auto-objectivation du Moi, c’est-à-dire qu’elle retrace le parcours du Moi à travers lequel celui-ci parvient à la connaissance transcendantale grâce à la manière dont, progressivement, il devient son propre objet. (…) Alors que pour Fichte, la réalité est un dépôt de l’activité de réflexion (correspondant, rappelons-le, dans sa compréhension la plus positive à la réflexion de la réflexion), pour Schelling, cette réalité est à chercher dans la conscience, dans les époques constituant l’histoire transcendantale du Moi[3]. »
On peut donc comprendre l’ironie schellingienne à l’endroit de Fichte dans ce texte sur le savant, qui, dans son dédoublement se scinde sans se superposer, et parle deux discours qui se substituent selon des niveaux de question ou de condition sans se signaler ; ainsi, ils ne s’articulent pas et ne constituent rien en terme de savoir dans ce texte de Fichte. Ce qui pose sa possibilité même n’a pas à attendre sa condition pour se poser comme le suggère ici Schelling. On peut donc entendre l’impatience de celui-ci :
« c’est dans cette réflexion sur soi-même inséparable du savoir que le savoir se scinde par lui-même : autrement dit que l’être-là se montre non pas absolument, mais résolument comme tel et tel, que le premier implique le deuxième – quelque chose qui n’a même pas d’être-là!), que lui (le savoir) et, avec le savoir, l’être divin devenu fixe en lui, c’est-à-dire le monde, se décomposent en deux morceaux <en deux quoi?> » (La vie bienheureuse, p. 112sq) (…) vacuité totale avec laquelle ce vain discours s’élève au-dessus de la nature et cherche à saisir l’infinité de ses déterminations et toute sa plénitude en des termes si vagues et nébuleux. (…) Fichte érige en fondement transcendantal universel ce qui pourrait tout au plus être un fondement d’explication psychologique, qui se rattache aux particularités de certaines natures individuelles, dont la sienne, impute au Moi absolu ce qui n’est naturel qu’à une réflexion endurcie et, par une opération très compréhensible, fait apparaître à partir de lui ce monde mort et déformé dont l’image est esquissée dans cette réflexion. » (p. 199 sq)
Conclusion
Selon les traducteurs, Jacobi avait lu de très près ce texte de Schelling, Présentation du rapport de Fichte à la philosophie de la nature pour ensuite l’attaquer, notamment sur l’amour supranaturel absent du système schellingien et donc suspect d’athéisme (p. 33). Il ne savait pas alors qu’il avait eu là un avant-goût de ce que lui réserverait en 1811 le même Schelling, avec l’un des pamphlets philosophiques les plus terribles, sur lequel Heidegger déclare :
« Comment veut-on accuser quelqu’un d’athéisme quand on déclare soi-même qu’il est impossible de rien savoir de Dieu ? Le résultat fut en conséquence : Jacobi devint par la suite – même auprès de ses amis – un homme fini[4]. ».
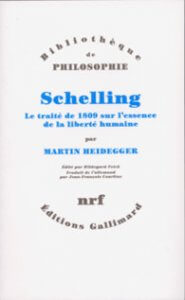
Le ton de la réponse de Schelling à Fichte n’est pas loin de celui employé plus tard contre Jacobi. Et si Fichte tente de prendre une certaine hauteur – qui n’est en somme qu’une pose plus ou moins hautaine -, son silence ne pourra se contenir très longtemps et s’empêcher de faire quelques corrections aux termes de sa propre philosophie, tout en faisant des allusions indirectes à Schelling par la suite, notamment lors du fameux Discours à la nation allemande en 1807 :
« Quiconque installe une nature sans vie à la direction du gouvernement du monde, celui-là, où qu’il soit né et quelle que soit sa langue, n’est pas allemand et est un étranger pour nous, et il faut souhaiter qu’au plus tôt il se sépare de nous totalement » (cité en présentation, p. 32).
Au-delà de cela, cet ouvrage traduit et compile très habilement ces textes, et reconstruit ainsi avec brio un débat que Fichte refuse au départ, auquel il cède pourtant face au recenseur de Iéna, pour enfin laisser se lever Schelling – et l’apercevoir de très loin s’émanciper définitivement de son système. Est-ce que l’essence du savant est ainsi révélée par cet affrontement ? Sans doute, si l’on considère à la lecture de ces textes que la Pensée est d’autant plus riche et exigeante qu’elle engage à un dialogue d’autant plus violent.
[1] Schelling, Philosophie de la Révélation, livre I, leçon III, Paris, PUF, p. 73
[2] Alexander Schnell, Réflexion et spéculation, op. cit., p. 211, sq.
[3] Alexander Schnell, Réflexion et spéculation, op. cit., p. 219, sq
[4] Heidegger, Schelling. Le traité de 1809 sur la liberté humaine, Traduction Jean-François Courtine, Paris, Gallimard, 1993, p. 121.







